+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
LIRE L’INTÉGRALITÉ DU DOSSIER, ICI – CLIQUER
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

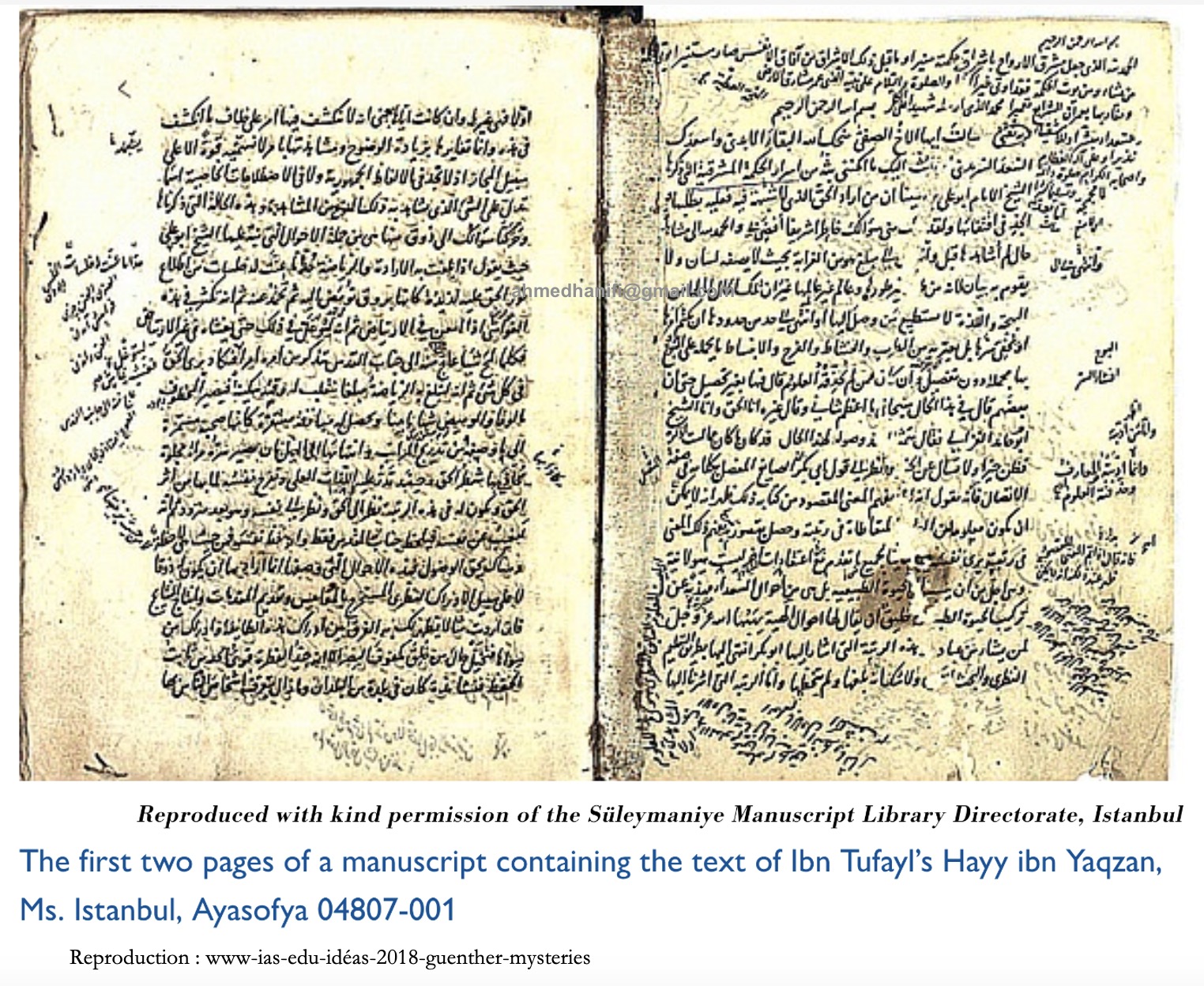





+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
LIRE L’INTÉGRALITÉ DU DOSSIER, ICI – CLIQUER
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

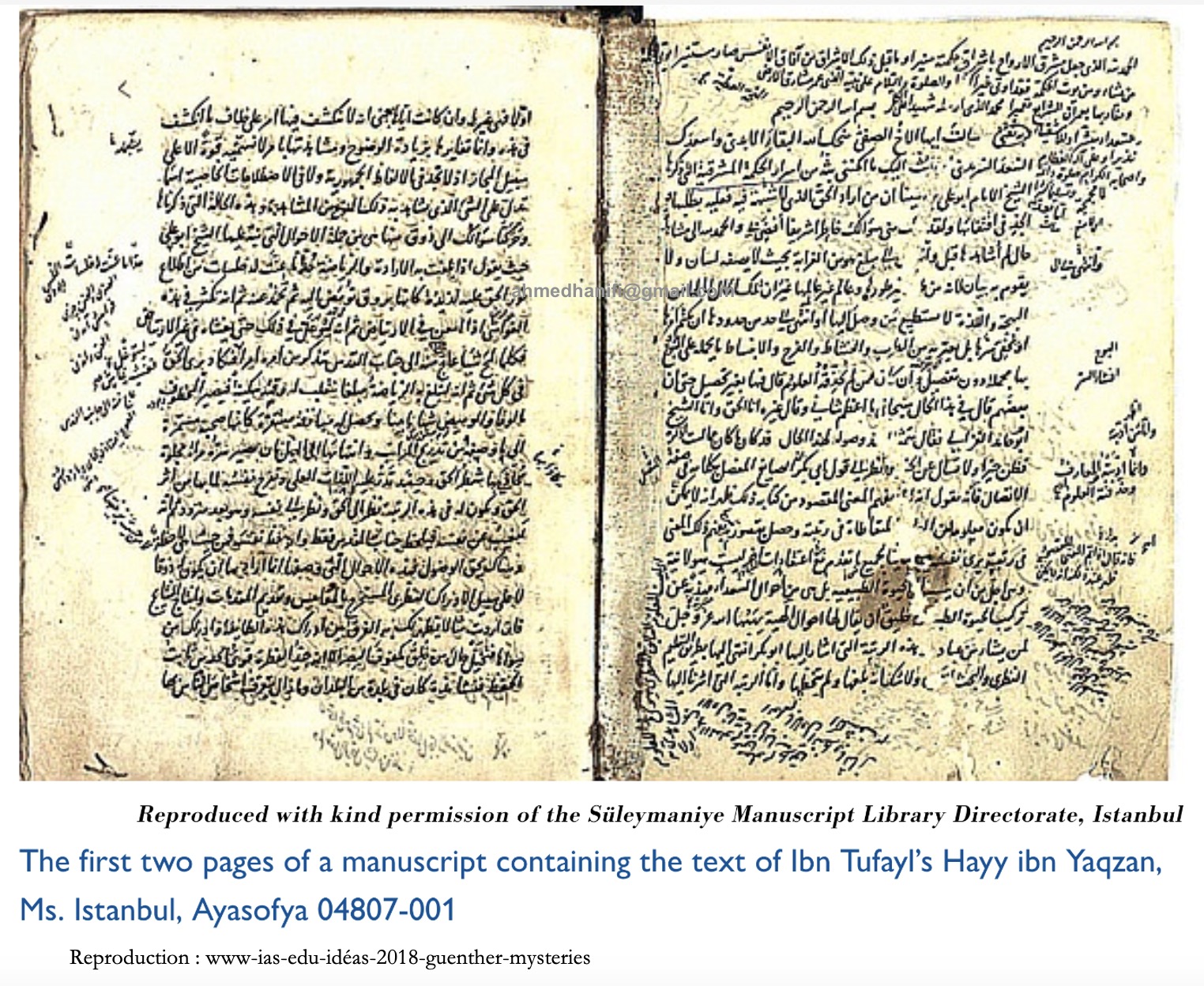






La foire du livre de Francfort s’ouvre aujourd’hui mardi 17 octobre. De nombreux éditeurs la boycottent à cause de l’annulation de la remise du prix LiBeraturpreis 2023 que l’écrivaine palestinienne Adania Shibli devait recevoir ce vendredi 20 pour son livre « Tafsil Thanawi », « Un détail mineur » (ed. Actes Sud), (Eine Nebensache en allemand). La rencontre programmée de l’autrice avec le public de la foire, en présence de Günther Orth son traducteur allemand, a également été annulée. Que raconte Adania Shibli dans son livre ? Un crime commis dans le désert Israélien durant la Naqba en août 1949 par des soldats israéliens sur une jeune bédouine palestinienne qu’ils venaient de kidnapper et violer.
Une pétition signée par 600 écrivains dont trois prix Nobel, Annie Ernaux, le Tanzanien Abdulrazak Gurnay, la Polonaise Olga Tokartczuc a été publiée par Le Monde daté 16 octobre contre ces annulations. Cette tribune est intitulée : « La Foire du livre de Francfort déclare rendre les voix israéliennes “audibles” tandis qu’elle réduit l’espace accordé aux voix palestiniennes ». On interdit maintenant aux Palestiniens de se défendre, de s’exprimer sur la littérature. Ils se doivent même de se taire. Bientôt ne plus respirer. Je ne suis pas abonné au journal Le Monde, je n’ai donc pas accès au texte complet. Si vous l’avez, adressez-le moi. Merci.
_________________________________
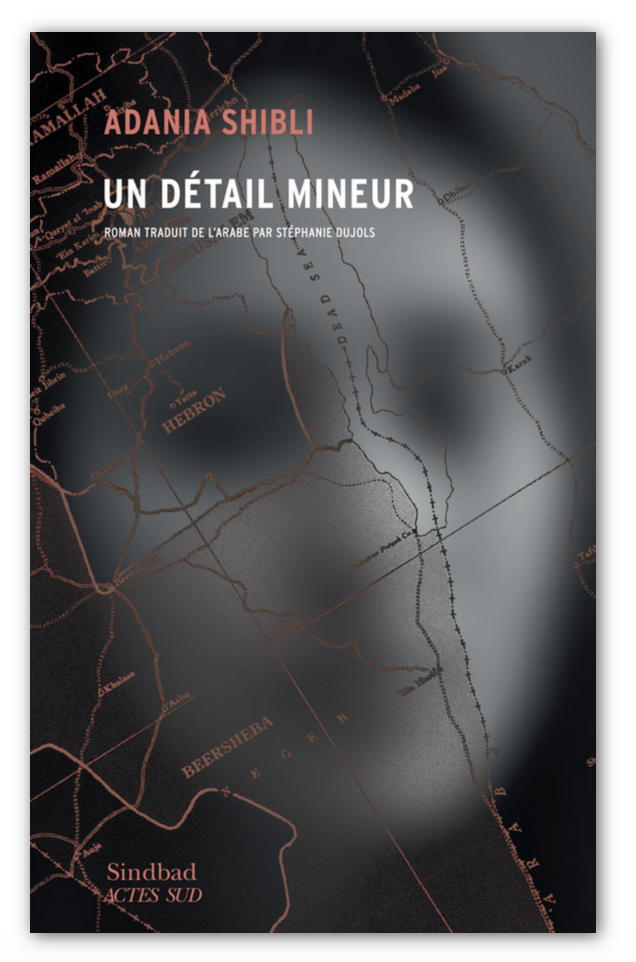
Le texte qui suit se trouve sur « Agence Medias Palestine ».
Qui est Adania Shibli ?
Née en Palestine en 1974, Shibli a vu ses œuvres être publiées partout dans le monde arabe et en Europe depuis la fin des années 1990. Elle a écrit des romans, des pièces, des nouvelles et des essais narratifs, tous sont publiés dans des anthologies, des livres d’art, et des magazines littéraires et culturels, et son œuvre a été traduite en de nombreuses langues, dont l’anglais, le français, l’allemand, l’italien, l’hébreu et le coréen, des langues qu’elle-même connaît.
Elle a remporté à deux reprises le Prix du jeune écrivain de l’année, de la Fondation Abdel Mohsin Qattan : d’abord en 2001 pour son roman Masaas, traduit en anglais par Paula Haydar sous le titre Touch, une nouvelle qui se concentre sur une jeune fille qui est la plus jeune de neuf sœurs dans une famille palestinienne ; et puis en 2003 pour Kulluna Ba’id Bethat al Miqdar aan el-Hub, traduit par Paul Starkey sous le titre We Are All Equally Far from Love (Nous sommes tous également loin de l’amour), sur une adolescente employée dans un bureau de poste, qui fait la découverte d’une mystérieuse série de lettres d’amour.
Si elle a écrit trois romans en arabe, Shibli a également travaillé sur des œuvres non fictionnelles, notamment un livre d’art intitulé Dispositions et une collection d’essais éditée sous le titre A Journey of Ideas Across : In Dialogue with Edward Said (Un voyage d’idées à travers : un dialogue avec Edward Said).
Shibli, qui vit entre Jérusalem et Berlin, est titulaire d’un doctorat de l’Université de Londres-Est et elle a également consacré une grande partie de son temps à la recherche universitaire. Elle a été professeure invitée au Département de philosophie et d’études culturelles à l’Université Birzeit, en Palestine.
De quoi parle Un détail mineur ?
Le dernier roman de Shibli se déroule en deux étapes et tourne autour d’un crime violent commis durant l’été 1949 en Palestine, quand des soldats israéliens exterminent un campement de Bédouins dans le désert du Néguev, dont une adolescente qui est violée, tuée et enterrée dans le sable.
Bien des années plus tard, une autre jeune femme de Ramallah part à la découverte des évènements qui entourent cet acte odieux, qualifié de crime « mineur » à l’heure actuelle, qui a été commis 25 ans jour pour jour avant sa naissance.
« Il en résulte une méditation obsédante sur la guerre, la violence et la mémoire, allant au cœur de l’expérience palestinienne de la dépossession, d’une vie sous occupation, et la difficulté persistante de reconstituer un récit face à un effacement et une déresponsabilisation toujours en cours », peut-on lire dans la description du livre sur le site de l’International Booker Prize.
Depuis sa sortie, le livre a été largement salué par les cercles littéraires du monde entier.
Parmi ses admirateurs, le romancier sud-africain et lauréat du Prix Nobel, JM Coetzee, qui déclare : « Adania Shibli fait un pari en confiant notre accès à l’évènement clé de son roman – le viol et le meurtre d’une jeune Bédouine – à deux narrateurs profondément égocentriques – un psychopathe israélien et un détective amateur palestinien avec un degré élevé d’autisme – mais sa méthode d’indirection se justifie pleinement quand son livre en arrive à sa conclusion décapante».
Dans une critique dans The Guardian, un intervenant écrit : « La terreur que Shibli évoque s’intensifie lentement, ardemment, jusqu’à ce qu’elle reluise sur la page… Le livre est, à chaque étape, dangereusement et terriblement bien écrit ».
« Ma littérature ne parle jamais de la Palestine »
Bien que Shibli maîtrise un certain nombre de langues, elle n’écrit la fiction que dans la langue arabe, « parce que cette langue est une sorcière – une sorcière incroyable, drôle, folle, généreuse, et indulgente » dit-elle dans un entretien avec Bomb Magazine, en 2020.
« Elle m’a tout permis» dit-elle. «C’est l’espace de la liberté la plus intime que j’ai connue dans ma vie ».
Une grande partie de ce qu’elle a écrit se concentre sur la Palestine, même si elle affirme que sa préoccupation pour sa patrie est personnelle, plutôt que littéraire.
« Elle forme ma littérature ; mais ma littérature ne parle jamais de la Palestine», dit-elle dans la publication. «Elle se situe plutôt à l’intérieur et à partir de la Palestine comme une condition de l’injustice ; de la normalisation de la douleur et de la dégradation. Elle révèle les limites de la langue ».
Et elle ajoute : «Ma quête dans le cas de la Palestine n’est pas de m’occuper des opinions et des postures, mais de ceux qui souffrent. Nous n’avons que nous-mêmes dans de tels cas, car les privilégiés ne risqueront jamais leur privilège s’ils peuvent continuer à l’utiliser».
Source : The nationalnews
——————-
Voici ce qu’en dit l’éditeur français (Actes Sud) de « Un détail mineur »
En 2003, un quotidien israélien, Haaretz, révèle qu’en août 1949 des soldats ont kidnappé, violé collectivement, puis tué et enterré une jeune bédouine du Néguev. Un crime qui s’inscrit dans la lignée des massacres commis à cette époque charnière pour terrifier ce qui restait des habitants de cette zone désertique.
Soixante-dix ans plus tard, Adania Shibli s’empare de cet “incident” dans un récit qui s’articule en deux temps nettement marqués. La première moitié relate le déroulement du crime avec une objectivité quasi chirurgicale. Elle met en scène deux personnages principaux : un officier israélien anonyme, maniaque de l’ordre et de l’hygiène, qui envahit les pages de sa présence hypnotique, et sa victime, comme lui jamais nommée. La seconde partie est narrée à la première personne, sur un ton très subjectif et ironique, par une Palestinienne d’aujourd’hui, obsédée par un “détail mineur” de l’incident : le fait qu’il se soit produit vingt-cinq ans jour pour jour avant sa naissance. Bravant les obstacles imposés par l’occupant, elle parvient à se rendre dans le Néguev dans l’espoir d’exhumer le récit occulté de la victime. Mais la détective en herbe ne tardera pas à tourner en rond… Longuement mûri, ce roman décapant dénonce en peu de pages, au-delà du contexte israélo-palestinien, le viol comme banale arme de guerre, et aborde subtilement le jeu de la mémoire et de l’oubli.
_________________________

El Watan, mardi 3 octobre 2023
Rencontre autour de l’œuvre de Mohammed Dib à l’institut français de Constantine : Des contes enchanteurs d’un auteur universel
Par S. Arslan
On ne présente plus Mohamed Dib. On le lit pour apprécier son style inimitable.
Plonger dans ses œuvres, c’est découvrir ou redécouvrir leur portée universelle et humaniste. Grand romancier, il est plus connu par sa célèbre trilogie Algérie (La Grande maison en 1952, L’incendie en 1954 et Le métier à tisser en 1957), merveilleusement adaptée en 1972 à la télévision algérienne par Arezki Berkouk, alias Mustapha Badie, réalisateur du fameux feuilleton El Hariq.
Durant une très longue carrière, s’étalant de 1946 jusqu’à sa mort en 2003, jalonnée d’une œuvre abondante et variée, Dib avait produit des poèmes, des romans, du théâtre, des nouvelles, mais aussi des contes pour enfants. Oui des contes. Une œuvre qui vient d’être revisitée au détour d’une réflexion sérieuse et un débat passionnant entre la fille de Dib, Assia, documentaliste installée à Grenoble, et sa nièce, petite-fille de l’écrivain, Louise, une graphiste et typographe douée, ayant beaucoup roulé sa bosse dans ce domaine grâce à son esprit créatif et foisonnant d’idées.
Le projet inédit, qui a pris cinq ans pour voir le jour, a donné lieu à un coffret de six contes pour enfants écrits par Mohamed Dib à différentes étapes de sa vie.
Un produit édité chez Barzakh et présenté dans l’après-midi du 30 septembre à l’occasion d’une sympathique table ronde animée à l’Institut français de Constantine par Assia et Louise Dib. Une rencontre ayant drainé aussi un public intéressé, qui a eu tout le plaisir de découvrir les talents avérés de deux charmantes dames excellant dans la lecture passionnante et passionnée des contes de Dib, en français par Taos Azzam, coach de théâtre, et en arabe dialectal par Leïla Touchi, comédienne.
Une aventure éditoriale
«Cette première édition algérienne du coffret intitulé Baba Fekrane et autres contes a été une véritable aventure éditoriale, au vu des conditions de sa préparation, sa conception, les aspects techniques qui ont marqué sa préparation. Nous avons réuni six contes écrits par Mohamed Dib sur du beau papier, un projet qui a été réalisé grâce au soutien financier de l’Institut français et l’aide des éditions Barzach qui ont une vieille tradition éditoriale avec l’écrivain. C’est un coffret dont la publication nous tenait vraiment à cœur», a confié Louise.
Ce coffret rappelle les débuts de Mohamed Dib dans l’écriture des contes pour enfants. Il avait publié en 1958 aux éditions La Farandole, son premier album de contes portant le même titre, Baba Fekrane. «Mon père avait un rapport particulier à l’enfance et un attachement au personnage enfantin ; on cite l’exemple d’Omar dans la trilogie ; ça vient du fait qu’il avait été orphelin de père alors qu’il avait à peine 11 ans. Il avait quitté brusquement le monde de l’enfance ; il était l’aîné ; il avait dû prendre la responsabilité de la famille», a expliqué sa fille Assia. Cette dernière rappelle une expression de son père : «L’enfance devient du coup ce paradis perdu.»
Plusieurs personnages de l’enfance sont présents dans certaines œuvres de Dib, à l’exemple d’Omar dans la trilogie, Lily Bell dans L’infante maure, et d’autres dans ses romans nordiques écrits à partir de 1989, et dans son recueil de poèmes L’enfant jazz. Dib s’est beaucoup inspiré dans ses contes des lieux de son enfance qui ne l’ont jamais quitté.
Dans une photo prise de l’écrivain alors qu’il était enfant, on pourrait facilement imaginer le petit Omar dans l’allure de ce garçon qu’était Mohamed Dib. «Mon père avait commencé à écrire des contes pour enfants à l’âge de 35 ans ; il y a une partie de ces contes un peu moins connus ; on connaît les contes apparus en album, mais il y a aussi des contes insérés dans les romans et d’autres publiés dans les revues.
Ses trois premiers contes sont parus dans la revue Horizons en 1958, dont Le petit oiseau qui a trouvé un grain de blé et L’histoire du chat qui boude, alors que son conte Baba Fekrane est paru aux éditions La Farandole», révèle Assia Dib. En fait, Mohamed Dib avait connu deux périodes d’écriture de contes. La première qui s’étale entre 1950 et 1960 a vu la parution de contes inspirés de la tradition orale algérienne. Dans une seconde période, il écrira des contes qu’il a inventés et qui étaient destinés à être insérés dans ses romans à l’exemple de ceux de la phase nordique de ses œuvres.
Baba Fekrane et autres contes
À propos de ces contes, Assia Dib lit des notes de son père. «Je les avais beaucoup travaillés pour atteindre ce côté abouti de la poésie populaire qui rend le texte invisible», écrivait-il. Mais il y a toujours ce côté particulier dans les contes de Mohamed Dib. Il les raconte dans un style inimitable, avec un sentiment de renouvellement. On n’oublie pas de noter que des contes comme Seigneur, Warda marchera-t-elle ?, Barbe de plumes, Salem et le méchant sorcier, Baba Fekrane,
L’histoire du chat qui boude, et L’hippopotame qui se trouvait vilain réunis dans le coffret présenté au public, sont autant de merveilles populaires, qui ont ce côté enchanteur chargé d’humour et qui portent une morale et un aspect éducatif, rappelant cette belle enfance et ces soirées passées à écouter avec attention la grand-mère raconter ces pans du patrimoine qui se perd avec l’avènement de l’internet et des antennes paraboliques.
Mohamed Dib avait bien raison de dire : «Il est une contrée de cette culture qui est particulièrement passionnante pour un écrivain, c’est le conte. La transmission est purement orale. La mémoire du peuple est la bibliothèque nationale de l’Algérie.»
Des paroles si simples, mais qui ont pris des siècles pour être parachevées, comme les perles qui terminent les contes de Mohamed Dib : «Nous sommes allés tout au long de la route et nous avons trouvé un sac de perles, les grosses pour moi et les petites pour toi.»
S. Arslan, El Watan
______________________________________________
°
CLIQUER ICI POUR VOIR ORAN, ÉCOUTER KHALED
°
______________________________________________
Extrait du documentaire TV « L’Algérie vue du ciel », un documentaire franco-algérien réalisé par Yann Arthus-Bertrand et Yazid Tizi, sorti en 16 juin 2015.
J’ai ajouté la chanson magnifique de Ahmed Wahby « Oran » (Wahran) chantée ici par Khaled.









Cela a commencé par la lecture de ce texte outrancière ment violent de Yasmina Khadra qui répond semble-t-il à un autre de Rachid Boudjedra.
Voici le texte de Khadra sur sa page FB, puis repris par « Chroniques algériennes » récemment.
J’ai volontairement ajouté les commentaires de utilisateurs de Facebook.
______________________________________
Dans l’ordre…
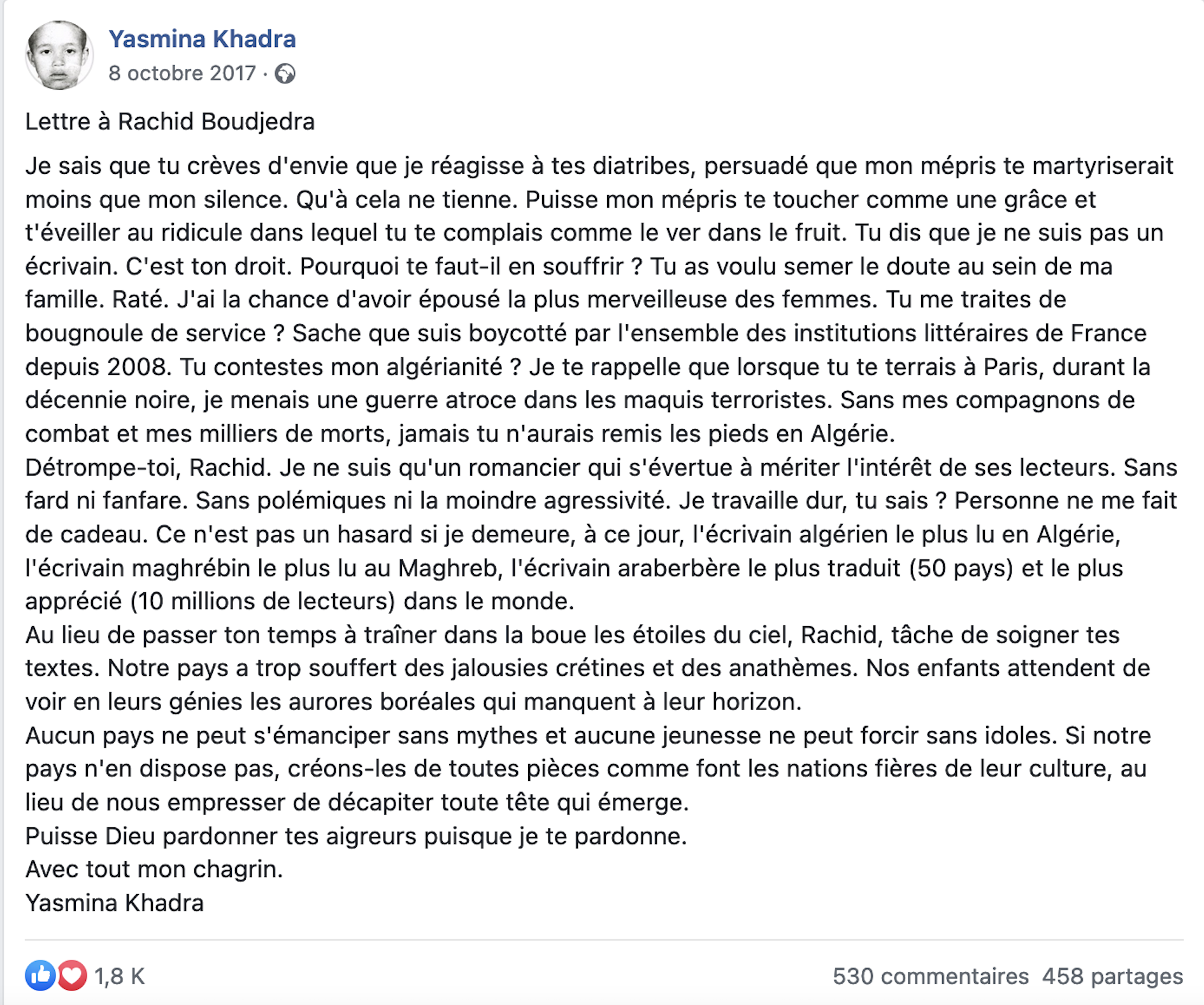
C’est dire l’envergure ! Mais…. je n’ai pas lu le livre à l’origine de tout cela, le livre de Rachid Boudjadra, « Les contrebandiers de l’Histoire » (ed Frantz Fanon, 2017)
Voici mon mot du 20 mars et les commentaires qui ont suivi


Et les commentaires
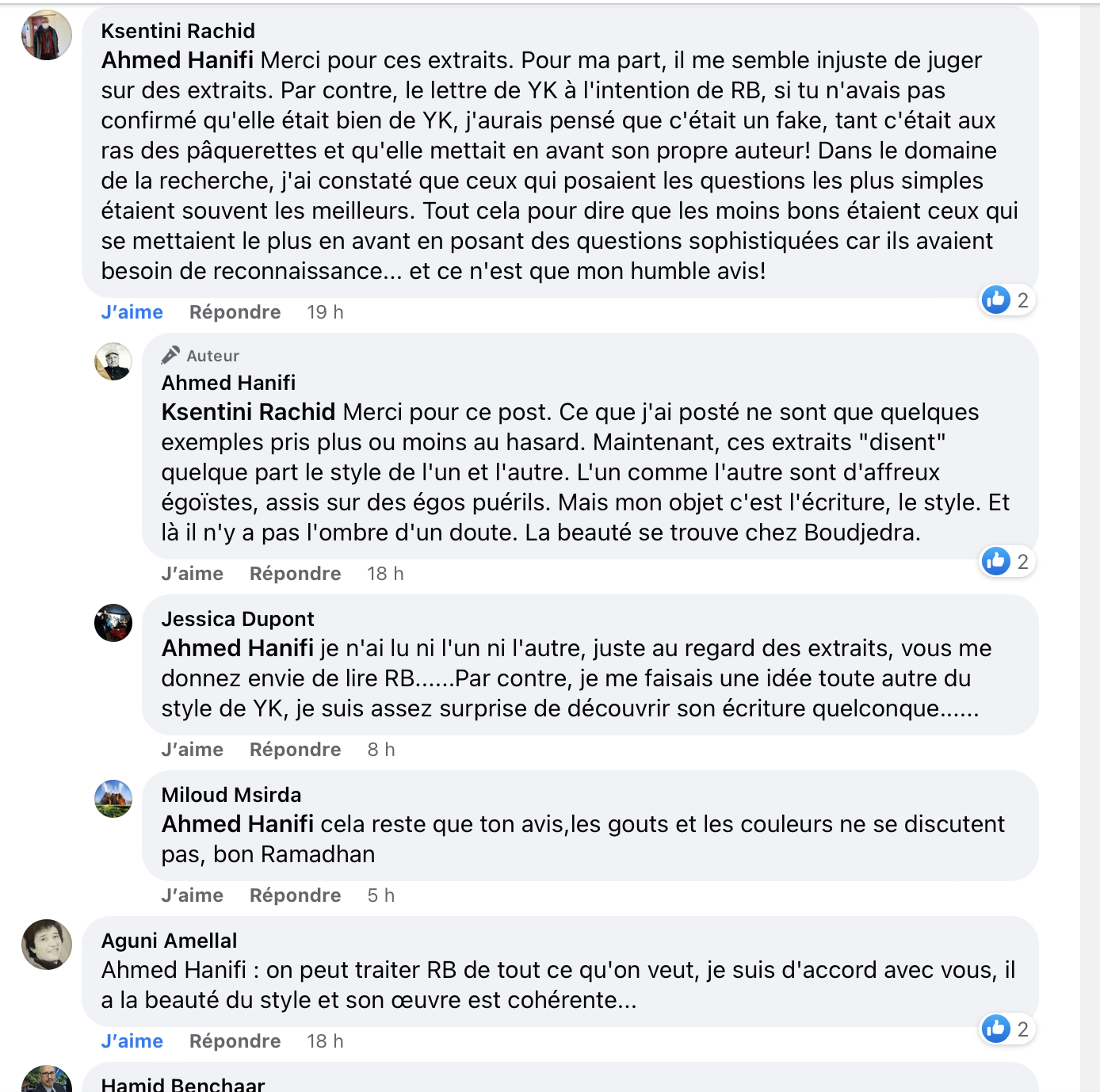

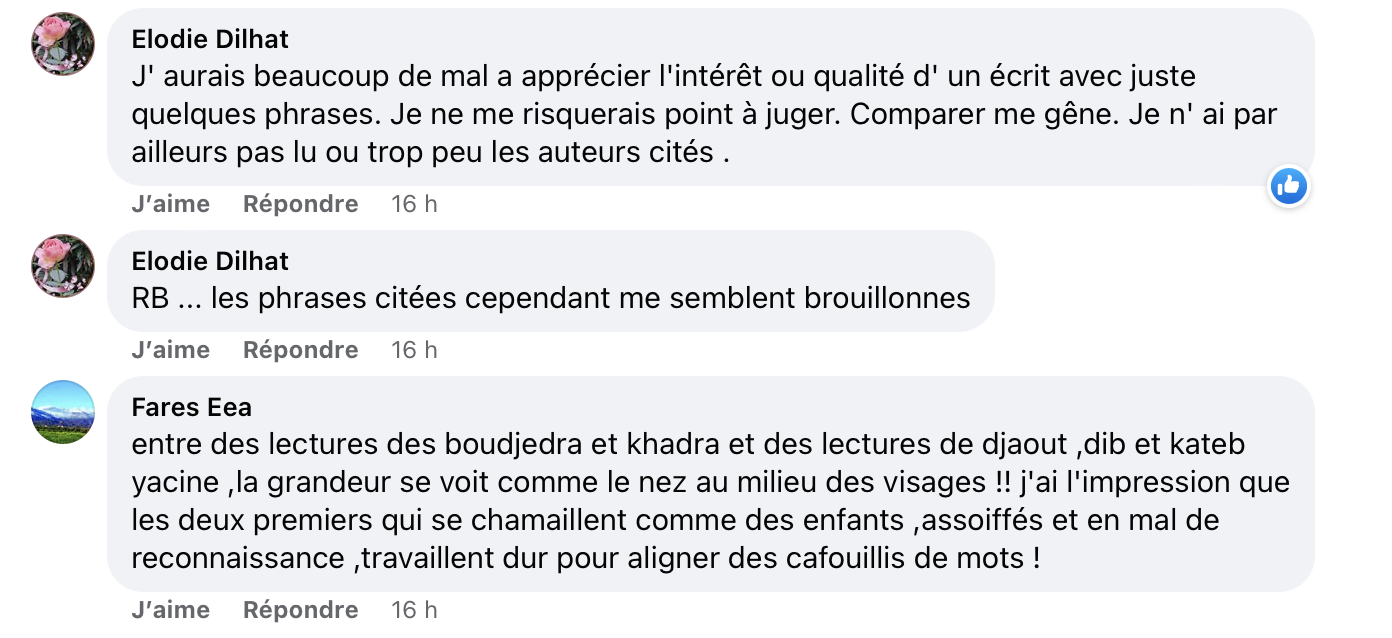
Ce matin, mardi 21 mars, j’ajoute un mot et ces pages des deux romans dont j’ai extrait hier les phrases.
Mon mot:
L’écriture de Rachid Boudjedra (81 ans),« Faulknérienne », une écriture qui se mord la queue (en spirale, circulaire), traverse toute son œuvre. Il use aussi du monologue intérieur, malmène en quelque sorte les schémas classiques d’écriture. Ses textes sont parfois fragmentaires. Il scrute de l’intérieur, les profonds mouvements sociétaux, il dénonce l’ordre sociétal établi, la violence qui traverse la société. Boudjedra use de l’inter et de l’intratextualité. Boudjedra se définit comme un artiste. Elle est loin, très loin de l’écriture de Khadra. Un mot pour dire que depuis quelques décennies, Boudjedra écrit en arabe, puis il adapte (différent de traduire) en français ses propres textes. Est-ce le cas pour tous ses écrits ? à vérifier. Il demeure, dans la durée, l’un des plus importants (sinon le plus important après Kateb Yacine) auteurs algériens. L’écriture mise à part, il est insupportable (trop long à détailler).
Je joins ici (à la suite de ces pages des romans) une vidéo concernant l’autre auteur. Il s’agit d’une émission très célèbre de France Inter (et très ancienne, créée en 1955 !). Écoutez-la. Ces critiques littéraires de l’incontournable « Masque et la plume » sont « sans pitié » comme on dit.(CLIQUER SUR LE LIEN, EN BAS DE CETTE PAGE, EN ROUGE)
Les pages…
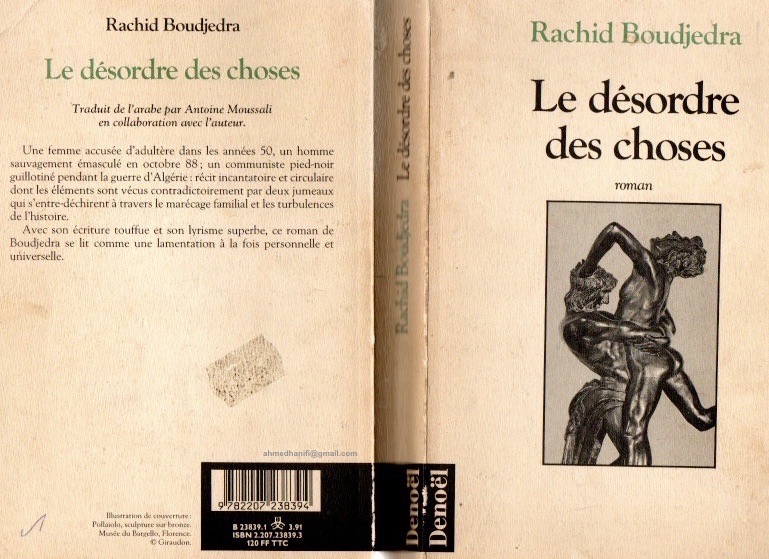
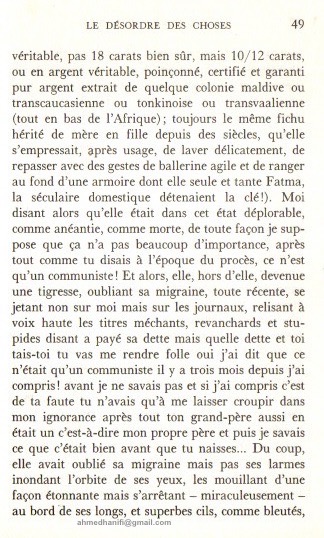
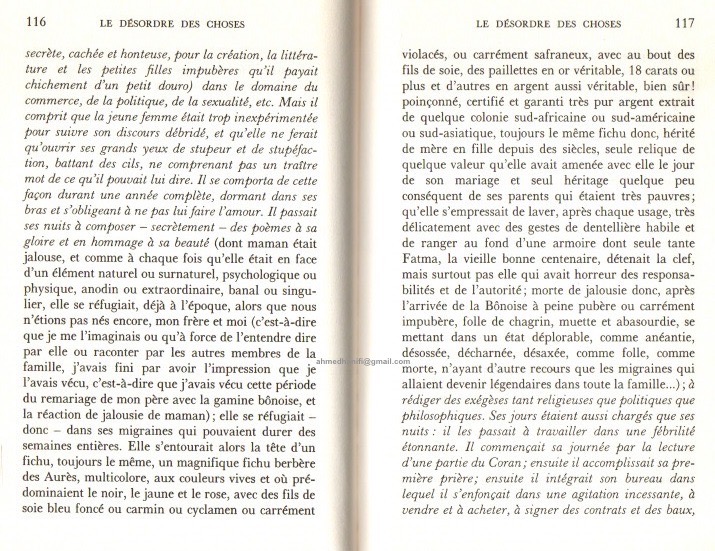
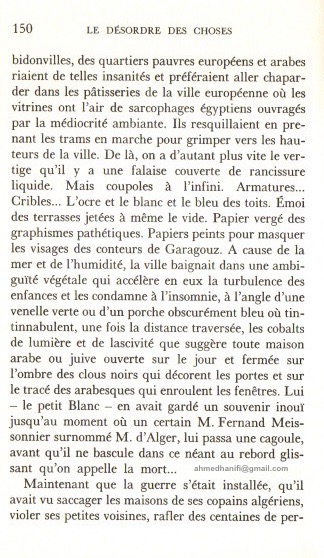
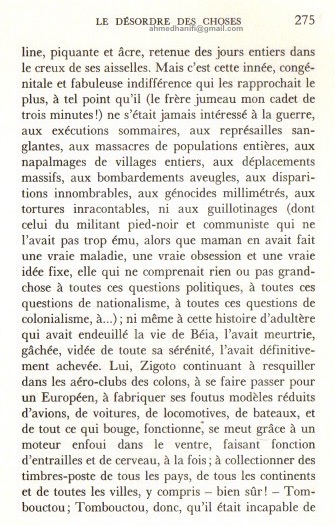
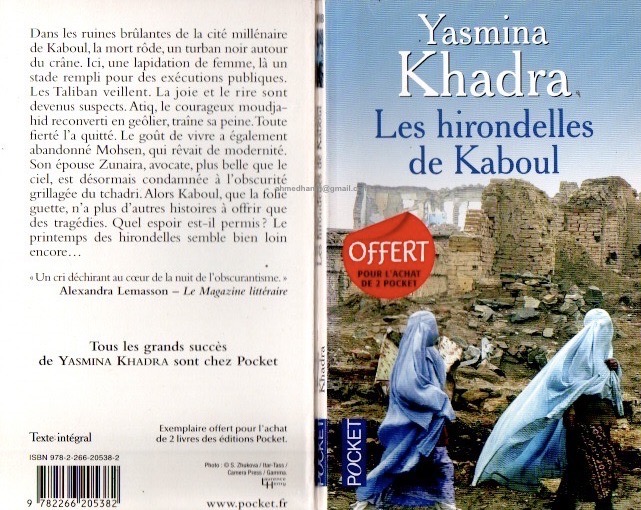
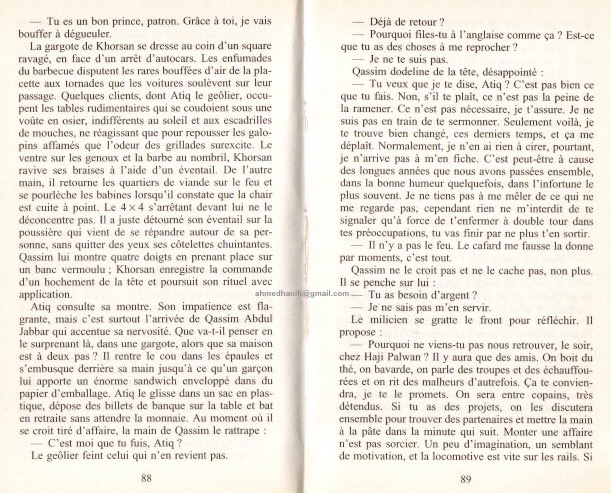
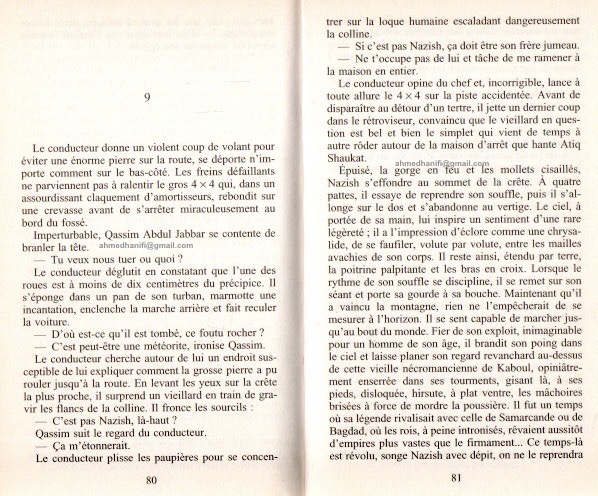
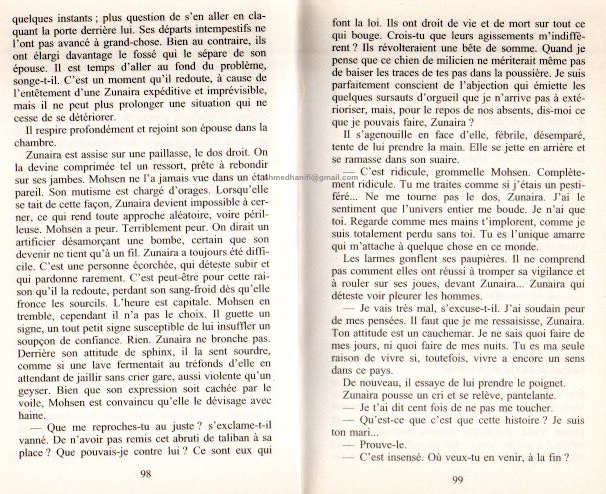
_______________________________________________
//////////////////////////////////////////////////////////////////
CLIQUER ICI POUR ÉCOUTER L’ÉMISSION « LE MASQUE ET LA PLUME » à propos de Yasmina Khadra
//////////////////////////////////////////////////////////////////
VOIR AUSSI:
http://leblogdeahmedhanifi.blogspot.com/2021/02/739-yasmina-khadra-est-un-ecrivain.html
__________________________________
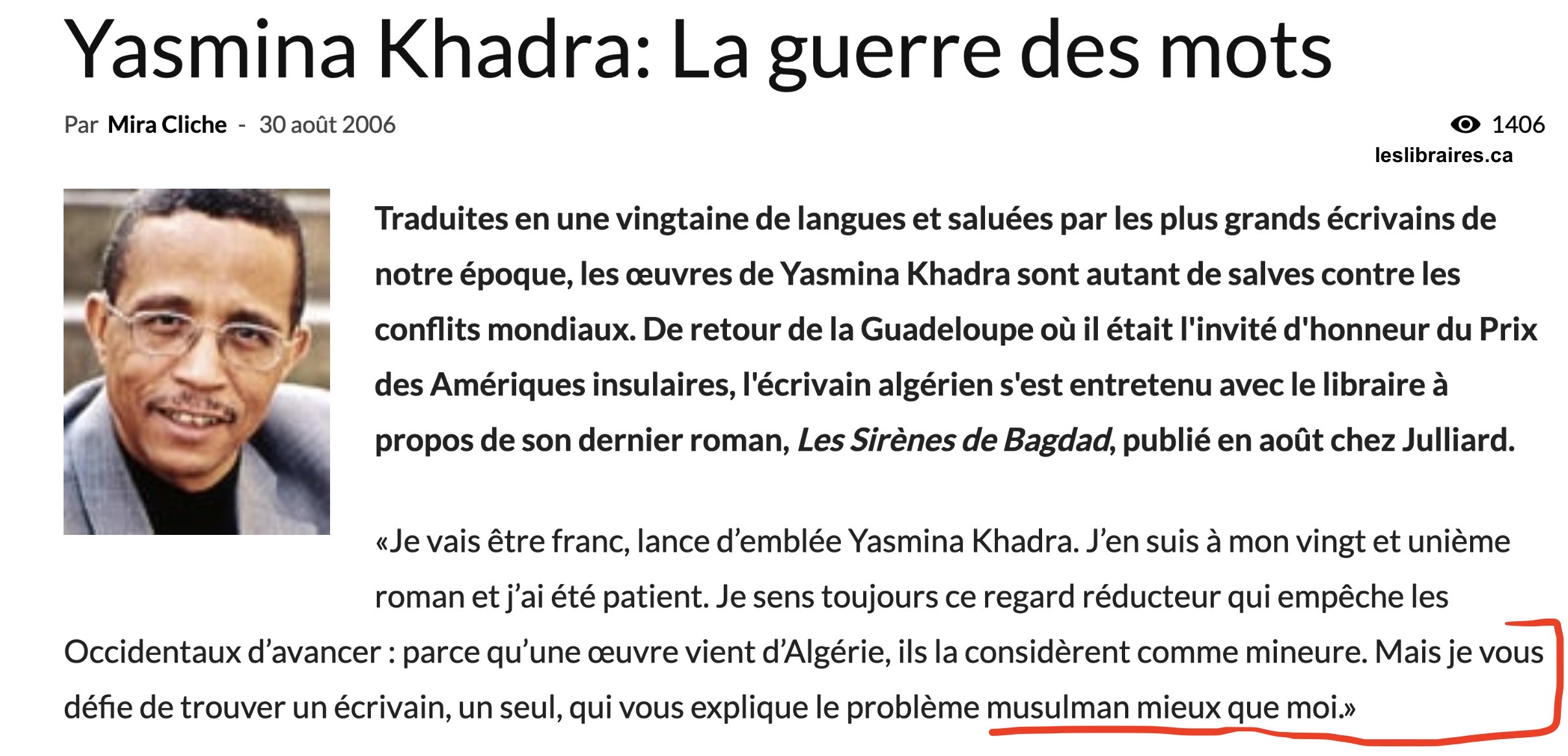

ANNIE ERNAUX recevra officiellement le prix Nobel de littérature à Stockholm, demain samedi 10 décembre 2022. Voici l’intégralité de son discours devant l’Académie suédoise.
« Le prix Nobel de littérature 2022 a été décerné à Annie Ernaux ‘‘pour le courage et l’acuité clinique avec lesquels elle débusque les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle’’. » © Fondation Nobel 2022©
Par Annie Ernaux
(La vidéo suit le texte)
Par où commencer ? Cette question, je me la suis posée des dizaines de fois devant la page blanche. Comme s’il me fallait trouver la phrase, la seule, qui me permettra d’entrer dans l’écriture du livre et lèvera d’un seul coup tous les doutes. Une sorte de clé. Aujourd’hui, pour affronter une situation que, passé la stupeur de l’événement – « est-ce bien à moi que ça arrive ? » –, mon imagination me présente avec un effroi grandissant, c’est la même nécessité qui m’envahit. Trouver la phrase qui me donnera la liberté et la fermeté de parler sans trembler, à cette place où vous m’invitez ce soir.
Cette phrase, je n’ai pas besoin de la chercher loin. Elle surgit. Dans toute sa netteté, sa violence. Lapidaire. Irréfragable. Elle a été écrite il y a soixante ans dans mon journal intime. « J’écrirai pour venger ma race. » Elle faisait écho au cri de Rimbaud : « Je suis de race inférieure de toute éternité. » J’avais 22 ans. J’étais étudiante en lettres dans une faculté de province, parmi des filles et des garçons pour beaucoup issus de la bourgeoisie locale. Je pensais orgueilleusement et naïvement qu’écrire des livres, devenir écrivain, au bout d’une lignée de paysans sans terre, d’ouvriers et de petits commerçants, de gens méprisés pour leurs manières, leur accent, leur inculture, suffirait à réparer l’injustice sociale de la naissance. Qu’une victoire individuelle effaçait des siècles de domination et de pauvreté, dans une illusion que l’École avait déjà entretenue en moi avec ma réussite scolaire. En quoi ma réalisation personnelle aurait-elle pu racheter quoi que ce soit des humiliations et des offenses subies ? Je ne me posais pas la question. J’avais quelques excuses.
Depuis que je savais lire, les livres étaient mes compagnons, la lecture mon occupation naturelle en dehors de l’école. Ce goût était entretenu par une mère, elle-même grande lectrice de romans entre deux clients de sa boutique, qui me préférait lisant plutôt que cousant et tricotant. La cherté des livres, la suspicion dont ils faisaient l’objet dans mon école religieuse me les rendaient encore plus désirables. Don Quichotte, Voyages de Gulliver, Jane Eyre, contes de Grimm et d’Andersen, David Copperfield, Autant en emporte le vent, plus tard Les Misérables, Les Raisins de la colère, La Nausée, L’Étranger : c’est le hasard, plus que des prescriptions venues de l’École, qui déterminait mes lectures.
Je m’éloignais de plus en plus chaque jour de l’écriture
Le choix de faire des études de lettres avait été celui de rester dans la littérature, devenue la valeur supérieure à toutes les autres, un mode de vie même qui me faisait me projeter dans un roman de Flaubert ou de Virginia Woolf et de les vivre littéralement. Une sorte de continent que j’opposais inconsciemment à mon milieu social. Et je ne concevais l’écriture que comme la possibilité de transfigurer le réel.
Ce n’est pas le refus d’un premier roman par deux ou trois éditeurs – roman dont le seul mérite était la recherche d’une forme nouvelle – qui a rabattu mon désir et mon orgueil. Ce sont des situations de la vie où être une femme pesait de tout son poids de différence avec être un homme dans une société où les rôles étaient définis selon les sexes, la contraception interdite et l’interruption de grossesse un crime. En couple avec deux enfants, un métier d’enseignante, et la charge de l’intendance familiale, je m’éloignais de plus en plus chaque jour de l’écriture et de ma promesse de venger ma race. Je ne pouvais lire « la parabole de la loi » dans Le Procès, de Kafka, sans y voir la figuration de mon destin : mourir sans avoir franchi la porte qui n’était faite que pour moi, le livre que seule je pourrais écrire.
Mais c’était sans compter sur le hasard privé et historique. La mort d’un père qui décède trois jours après mon arrivée chez lui en vacances, un poste de professeur dans des classes dont les élèves sont issus de milieux populaires semblables au mien, des mouvements mondiaux de contestation : autant d’éléments qui me ramenaient par des voies imprévues et sensibles au monde de mes origines, à ma « race », et qui donnaient à mon désir d’écrire un caractère d’urgence secrète et absolue. Il ne s’agissait pas, cette fois, de me livrer à cet illusoire « écrire sur rien » de mes 20 ans, mais de plonger dans l’indicible d’une mémoire refoulée et de mettre au jour la façon d’exister des miens. Écrire afin de comprendre les raisons en moi et hors de moi qui m’avaient éloignée de mes origines.
Il me fallait rompre avec le « bien-écrire »
Aucun choix d’écriture ne va de soi. Mais ceux qui, immigrés, ne parlent plus la langue de leurs parents, et ceux qui, transfuges de classe sociale, n’ont plus tout à fait la même, se pensent et s’expriment avec d’autres mots, tous sont mis devant des obstacles supplémentaires. Un dilemme. Ils ressentent, en effet, la difficulté, voire l’impossibilité d’écrire dans la langue acquise, dominante, qu’ils ont appris à maîtriser et qu’ils admirent dans ses œuvres littéraires, tout ce qui a trait à leur monde d’origine, ce monde premier fait de sensations, de mots qui disent la vie quotidienne, le travail, la place occupée dans la société. Il y a d’un côté la langue dans laquelle ils ont appris à nommer les choses, avec sa brutalité, avec ses silences, celui, par exemple, du face-à-face entre une mère et un fils, dans le très beau texte d’Albert Camus Entre oui et non. De l’autre, les modèles des œuvres admirées, intériorisées, celles qui ont ouvert l’univers premier et auxquelles ils se sentent redevables de leur élévation, qu’ils considèrent même souvent comme leur vraie patrie. Dans la mienne figuraient Flaubert, Proust, Virginia Woolf : au moment de reprendre l’écriture, ils ne m’étaient d’aucun secours. Il me fallait rompre avec le « bien-écrire », la belle phrase, celle-là même que j’enseignais à mes élèves, pour extirper, exhiber et comprendre la déchirure qui me traversait. Spontanément, c’est le fracas d’une langue charriant colère et dérision, voire grossièreté, qui m’est venu, une langue de l’excès, insurgée, souvent utilisée par les humiliés et les offensés, comme la seule façon de répondre à la mémoire des mépris, de la honte et de la honte de la honte.
Très vite aussi, il m’a paru évident – au point de ne pouvoir envisager d’autre point de départ – d’ancrer le récit de ma déchirure sociale dans la situation qui avait été la mienne lorsque j’étais étudiante, celle, révoltante, à laquelle l’État français condamnait toujours les femmes, le recours à l’avortement clandestin entre les mains d’une faiseuse d’anges. Et je voulais décrire tout ce qui est arrivé à mon corps de fille, la découverte du plaisir, les règles. Ainsi, dans ce premier livre, publié en 1974, sans que j’en sois alors consciente, se trouvait définie l’aire dans laquelle je placerais mon travail d’écriture, une aire à la fois sociale et féministe. Venger ma race et venger mon sexe ne feraient qu’un désormais.
Comment ne pas s’interroger sur la vie sans le faire aussi sur l’écriture ? Sans se demander si celle-ci conforte ou dérange les représentations admises, intériorisées sur les êtres et les choses ? Est-ce que l’écriture insurgée, par sa violence et sa dérision, ne reflétait pas une attitude de dominée ? Quand le lecteur était un privilégié culturel, il conservait la même position de surplomb et de condescendance par rapport au personnage du livre que dans la vie réelle. C’est donc, à l’origine, pour déjouer ce regard qui, porté sur mon père dont je voulais raconter la vie, aurait été insoutenable et, je le sentais, une trahison, que j’ai adopté, à partir de mon quatrième livre, une écriture neutre, objective, « plate » en ce sens qu’elle ne comportait ni métaphores ni signes d’émotion. La violence n’était plus exhibée, elle venait des faits eux-mêmes et non de l’écriture. Trouver les mots qui contiennent à la fois la réalité et la sensation procurée par la réalité allait devenir, jusqu’à aujourd’hui, mon souci constant en écrivant, quel que soit l’objet.
Le désir de me servir du « je »
Continuer à dire « je » m’était nécessaire. La première personne – celle par laquelle, dans la plupart des langues, nous existons, dès que nous savons parler, jusqu’à la mort – est souvent considérée, dans son usage littéraire, comme narcissique dès lors qu’elle réfère à l’auteur, qu’il ne s’agit pas d’un « je » présenté comme fictif. Il est bon de rappeler que le « je », jusque-là privilège des nobles racontant des hauts faits d’armes dans des Mémoires, est en France une conquête démocratique du XVIIIe siècle, l’affirmation de l’égalité des individus et du droit à être sujet de leur histoire, ainsi que le revendique Jean-Jacques Rousseau dans ce premier préambule des Confessions : « Et qu’on n’objecte pas que n’étant qu’un homme du peuple je n’ai rien à dire qui mérite l’attention des lecteurs. (…) Dans quelque obscurité que j’aie pu vivre, si j’ai pensé plus et mieux que les rois, l’histoire de mon âme est plus intéressante que celle des leurs. »
Ce n’est pas cet orgueil plébéien qui me motivait (encore que…), mais le désir de me servir du « je » – forme à la fois masculine et féminine – comme un outil exploratoire qui capte les sensations, celles que la mémoire a enfouies, celles que le monde autour ne cesse de nous donner, partout et tout le temps. Ce préalable de la sensation est devenu pour moi à la fois le guide et la garantie de l’authenticité de ma recherche. Mais à quelles fins ? Il ne s’agit pas pour moi de raconter l’histoire de ma vie ni de me délivrer de ses secrets, mais de déchiffrer une situation vécue, un événement, une relation amoureuse, et dévoiler ainsi quelque chose que seule l’écriture peut faire exister et passer, peut-être, dans d’autres consciences, d’autres mémoires. Qui pourrait dire que l’amour, la douleur et le deuil, la honte ne sont pas universels ? Victor Hugo a écrit : « Nul de nous n’a l’honneur d’avoir une vie qui soit à lui. » Mais toutes choses étant vécues inexorablement sur le mode individuel – « c’est à moi que ça arrive » –, elles ne peuvent être lues de la même façon que si le « je » du livre devient, d’une certaine façon, transparent et que celui du lecteur ou de la lectrice vienne l’occuper. Que ce « je » soit, en somme, transpersonnel, que le singulier atteigne l’universel.
C’est ainsi que j’ai conçu mon engagement dans l’écriture, lequel ne consiste pas à écrire « pour » une catégorie de lecteurs, mais « depuis » mon expérience de femme et d’immigrée de l’intérieur, depuis ma mémoire désormais de plus en plus longue des années traversées, depuis le présent, sans cesse pourvoyeur d’images et de paroles des autres. Cet engagement comme mise en gage de moi-même dans l’écriture est soutenu par la croyance, devenue certitude, qu’un livre peut contribuer à changer la vie personnelle, à briser la solitude des choses subies et enfouies, à se penser différemment. Quand l’indicible vient au jour, c’est politique.
Forme la plus violente et la plus archaïque
On le voit aujourd’hui avec la révolte de ces femmes qui ont trouvé les mots pour bouleverser le pouvoir masculin et se sont élevées, comme en Iran, contre sa forme la plus violente et la plus archaïque. Écrivant dans un pays démocratique, je continue de m’interroger, cependant, sur la place occupée par les femmes, y compris dans le champ littéraire. Leur légitimité à produire des œuvres n’est pas encore acquise. Il y a en France et partout dans le monde des intellectuels masculins, pour qui les livres écrits par les femmes n’existent tout simplement pas, ils ne les citent jamais. La reconnaissance de mon travail par l’Académie suédoise constitue un signal de justice et d’espérance pour toutes les écrivaines.
Dans la mise au jour de l’indicible social, cette intériorisation des rapports de domination de classe et/ou de race, de sexe également, qui est ressentie seulement par ceux qui en sont l’objet, il y a la possibilité d’une émancipation individuelle mais également collective. Déchiffrer le monde réel en le dépouillant des visions et des valeurs dont la langue, toute langue, est porteuse, c’est en déranger l’ordre institué, en bouleverser les hiérarchies.
Mais je ne confonds pas cette action politique de l’écriture littéraire, soumise à sa réception par le lecteur ou la lectrice avec les prises de position que je me sens tenue de prendre par rapport aux événements, aux conflits et aux idées. J’ai grandi dans la génération de l’après-guerre mondiale, où il allait de soi que des écrivains et des intellectuels se positionnent par rapport à la politique de la France et s’impliquent dans les luttes sociales. Personne ne peut dire aujourd’hui si les choses auraient tourné autrement sans leur parole et leur engagement. Dans le monde actuel, où la multiplicité des sources d’information, la rapidité du remplacement des images par d’autres accoutument à une forme d’indifférence, se concentrer sur son art est une tentation. Mais, dans le même temps, il y a en Europe – masquée encore par la violence d’une guerre impérialiste menée par le dictateur à la tête de la Russie – la montée d’une idéologie de repli et de fermeture, qui se répand et gagne continûment du terrain dans des pays jusqu’ici démocratiques. Fondée sur l’exclusion des étrangers et des immigrés, l’abandon des économiquement faibles, sur la surveillance du corps des femmes, elle m’impose, à moi, comme à tous ceux pour qui la valeur d’un être humain est la même, toujours et partout, un devoir de vigilance. Quant au poids du sauvetage de la planète, détruite en grande partie par l’appétit des puissances économiques, il ne saurait peser, comme il est à craindre, sur ceux qui sont déjà démunis. Le silence, dans certains moments de l’Histoire, n’est pas de mise.
Une victoire collective
En m’accordant la plus haute distinction littéraire qui soit, c’est un travail d’écriture et une recherche personnelle menés dans la solitude et le doute qui se trouvent placés dans une grande lumière. Elle ne m’éblouit pas. Je ne regarde pas l’attribution qui m’a été faite du prix Nobel comme une victoire individuelle. Ce n’est ni orgueil ni modestie de penser qu’elle est, d’une certaine façon, une victoire collective. J’en partage la fierté avec ceux et celles qui, d’une façon ou d’une autre, souhaitent plus de liberté, d’égalité et de dignité pour tous les humains, quels que soient leur sexe et leur genre, leur peau et leur culture. Ceux et celles qui pensent aux générations à venir, à la sauvegarde d’une Terre que l’appétit de profit d’un petit nombre continue de rendre de moins en moins vivable pour l’ensemble des populations.
Si je me retourne sur la promesse faite à 20 ans de venger ma race, je ne saurais dire si je l’ai réalisée. C’est d’elle, de mes ascendants, hommes et femmes durs à des tâches qui les ont fait mourir tôt, que j’ai reçu assez de force et de colère pour avoir le désir et l’ambition de lui faire une place dans la littérature, dans cet ensemble de voix multiples qui, très tôt, m’a accompagnée en me donnant accès à d’autres mondes et d’autres pensées, y compris celle de m’insurger contre elle et de vouloir la modifier. Pour inscrire ma voix de femme et de transfuge social dans ce qui se présente toujours comme un lieu d’émancipation, la littérature.
© Fondation Nobel 2022©
Annie Ernaux
Publié notamment par Le Monde, l’Observateur…datés 7 décembre 2022
____________________ VIDÉO EN PAGE SUIVANTE_______________
______________________________________________
°
CLIQUER ICI POUR VOIR ÉMISSION SUR MARCEL PROUST
°
_________________________________________________

Il y a 100 ans disparaissait un monument de la littérature française, Marcel Proust. Il est l’auteur de la phrase la plus longue de la littérature française. Elle contient 855 mots (et 56 lignes en fichier word). Elle se trouve au début (Partie 1- 1° apparition…page 32+) de Sodome et Gomorrhe.
Respirez !
« Sans honneur que précaire, sans liberté que provisoire, jusqu’à la découverte du crime ; sans situation qu’instable, comme pour le poète la veille fêté dans tous les salons, applaudi dans tous les théâtres de Londres, chassé le lendemain de tous les garnis sans pouvoir trouver un oreiller où reposer sa tête, tournant la meule comme Samson et disant comme lui : “Les deux sexes mourront chacun de son côté” ; exclus même, hors les jours de grande infortune où le plus grand nombre se rallie autour de la victime, comme les juifs autour de Dreyfus, de la sympathie – parfois de la société – de leurs semblables, auxquels ils donnent le dégoût de voir ce qu’ils sont, dépeint dans un miroir, qui ne les flattant plus, accuse toutes les tares qu’ils n’avaient pas voulu remarquer chez eux-mêmes et qui leur fait comprendre que ce qu’ils appelaient leur amour (et à quoi, en jouant sur le mot, ils avaient, par sens social, annexé tout ce que la poésie, la peinture, la musique, la chevalerie, l’ascétisme, ont pu ajouter à l’amour) découle non d’un idéal de beauté qu’ils ont élu, mais d’une maladie inguérissable ; comme les juifs encore (sauf quelques-uns qui ne veulent fréquenter que ceux de leur race, ont toujours à la bouche les mots rituels et les plaisanteries consacrées) se fuyant les uns les autres, recherchant ceux qui leur sont le plus opposés, qui ne veulent pas d’eux, pardonnant leurs rebuffades, s’enivrant de leurs complaisances ; mais aussi rassemblés à leurs pareils par l’ostracisme qui les frappe, l’opprobre où ils sont tombés, ayant fini par prendre, par une persécution semblable à celle d’Israël, les caractères physiques et moraux d’une race, parfois beaux, souvent affreux, trouvant (malgré toutes les moqueries dont celui qui, plus mêlé, mieux assimilé à la race adverse, est relativement, en apparence, le moins inverti, accable celui qui l’est demeuré davantage), une détente dans la fréquentation de leurs semblables, et même un appui dans leur existence, si bien que, tout en niant qu’ils soient une race (dont le nom est la plus grande injure), ceux qui parviennent à cacher qu’ils en sont, ils les démasquent volontiers, moins pour leur nuire, ce qu’ils ne détestent pas, que pour s’excuser, et allant chercher comme un médecin l’appendicite l’inversion jusque dans l’histoire, ayant plaisir à rappeler que Socrate était l’un d’eux, comme les Israélites disent de Jésus, sans songer qu’il n’y avait pas d’anormaux quand l’homosexualité était la norme, pas d’anti-chrétiens avant le Christ, que l’opprobre seul fait le crime, parce qu’il n’a laissé subsister que ceux qui étaient réfractaires à toute prédication, à tout exemple, à tout châtiment, en vertu d’une disposition innée tellement spéciale qu’elle répugne plus aux autres hommes (encore qu’elle puisse s’accompagner de hautes qualités morales) que de certains vices qui y contredisent comme le vol, la cruauté, la mauvaise foi, mieux compris, donc plus excusés du commun des hommes ; formant une franc-maçonnerie bien plus étendue, plus efficace et moins soupçonnée que celle des loges, car elle repose sur une identité de goûts, de besoins, d’habitudes, de dangers, d’apprentissage, de savoir, de trafic, de glossaire, et dans laquelle les membres mêmes, qui souhaitent de ne pas se connaître, aussitôt se reconnaissent à des signes naturels ou de convention, involontaires ou voulus, qui signalent un de ses semblables au mendiant dans le grand seigneur à qui il ferme la portière de sa voiture, au père dans le fiancé de sa fille, à celui qui avait voulu se guérir, se confesser, qui avait à se défendre, dans le médecin, dans le prêtre, dans l’avocat qu’il est allé trouver; tous obligés à protéger leur secret, mais ayant leur part d’un secret des autres que le reste de l’humanité ne soupçonne pas et qui fait qu’à eux les romans d’aventure les plus invraisemblables semblent vrais, car dans cette vie romanesque, anachronique, l’ambassadeur est ami du forçat : le prince, avec une certaine liberté d’allures que donne l’éducation aristocratique et qu’un petit bourgeois tremblant n’aurait pas en sortant de chez la duchesse, s’en va conférer avec l’apache ; partie réprouvée de la collectivité humaine, mais partie importante, soupçonnée là où elle n’est pas, étalée, insolente, impunie là où elle n’est pas devinée; comptant des adhérents partout, dans le peuple, dans l’armée, dans le temple, au bagne, sur le trône; vivant enfin, du moins un grand nombre, dans l’intimité caressante et dangereuse avec les hommes de l’autre race, les provoquant, jouant avec eux à parler de son vice comme s’il n’était pas sien, jeu qui est rendu facile par l’aveuglement ou la fausseté des autres, jeu qui peut se prolonger des années jusqu’au jour du scandale où ces dompteurs sont dévorés ; jusque-là obligés de cacher leur vie, de détourner leurs regards d’où ils voudraient se fixer, de les fixer sur ce dont ils voudraient se détourner, de changer le genre de bien des adjectifs dans leur vocabulaire, contrainte sociale, légère auprès de la contrainte intérieure que leur vice, ou ce qu’on nomme improprement ainsi, leur impose non plus à l’égard des autres mais d’eux-mêmes, et de façon qu’à eux-mêmes il ne leur paraisse pas un vice. »
ANNIE ERNAUX PARLE DE SON ECRITURE _ 1984, « APOSTROPHES »
_________________________
Annie Ernaux « La Place » ⎜ Archive INA – Bernard Pivot, Apostrophe – 6 avril 1984 Annie ERNAUX présente son livre « la Place » – Avec les interventions de Georges Emmanuel CLANCIER et d’Alain BOSQUET- Archive INA Institut National de l’Audiovisuel. AH 20221011
————————–
Par Johanna Pernot
Annie Ernaux est une écrivain contemporaine, connue pour ses écrits autobiographiques.
Née en 1940 en Seine-Maritime, à Lillebonne, elle passe son enfance et sa jeunesse à Yvetot, dans un milieu modeste. Dès avant sa naissance, ses parents se sont affranchis de leur condition d’ouvrier en achetant un café-épicerie à Lillebonne. Ils rêvent d’ascension sociale, pour eux et leur fille. Alors que celle-ci a cinq ans, ils acquièrent un café-alimentation à Yvetot. Annie, qui grandit dans ce café, au milieu de la clientèle, obtient de bons résultats à l’école. Après des études universitaires à Rouen, elle devient institutrice puis professeur certifiée en 1967. Elle est reçue à l’agrégation de lettres modernes en 1971. Au début des années 1970, elle enseigne dans un collège d’Annecy, puis à Pontoise, avant d’intégrer le CNDP. En 1974, son premier roman autobiographique, Les Armoires vides, signe son entrée en littérature. En 1983, elle rencontre le succès avec La Place. De nombreux récits autobiographiques vont suivre, dont Passion simple, en 1991, qui relate une liaison à l’âge adulte ou La Honte en 1997, davantage centré sur le couple parental et la quête d’un traumatisme originel, social et sexuel. Dans Les Années qu’elle publie en 2008, l’auteur commente des photographies d’elle-même qu’elle intercale, dans son récit à la troisième personne, avec des souvenirs choisis pour leur portée historique ou sociologique. « Les images réelles ou imaginaires » construisent une vaste fresque qui court de l’après-guerre à nos jours. Dans L’Autre fille, Annie Ernaux adresse en 2011 une lettre à sa sœur qu’elle n’a pas connue, morte de la diphtérie à l’âge de six ans. La même année paraît son anthologie, Ecrire la vie, qui réunit la plupart de ses écrits autobiographiques, précédés de cent pages de photos et d’extraits de son journal intime et inédit.
L’autobiographie au sens strict, telle que la définit Philippe Lejeune, est un « récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa personnalité. » Elle requiert une homonymie explicite entre auteur, narrateur et personnage. En scellant un « pacte autobiographique », l’autobiographe s’engage à être sincère sur son identité, et le lecteur à le croire. L’autobiographie passe par des étapes-clés, comme le portrait physique, social et moral de la personne, le récit des origines et de l’enfance, les épreuves affrontées… Les Confessions de Rousseau, qu’on considère comme le modèle fondateur du genre, pose déjà un des problèmes de l’autobiographie : celui de la véracité et de la bonne foi de l’auteur. Deux cents ans plus tard, Sartre, avec Les Mots et le recours à l’intertextualité et la parodie, mine définitivement les principes du récit autobiographique. À la définition de Philippe Lejeune, on pourrait donc préférer une notion plus large, qui inclurait l’autofiction, mais aussi les correspondances et les interviews, les albums de photos… À partir des années 60, le récit autobiographique se diversifie et se généralise dans les bibliographies des écrivains. Il prend plus récemment une nouvelle orientation : pour se dire, l’auteur se décentre. Le récit autobiographique initie alors un va-et-vient entre soi et autrui, identité et altérité, comme en atteste La Place d’Annie Ernaux.
Cette autobiographie de cent pages, rédigée entre novembre 1982 et juin 1983, relate l’ascension sociale des parents d’Annie, leurs conditions de travail et leurs espoirs. L’écrivain rend hommage à son père. Il décède deux mois après qu’elle-même a « trahi » son milieu d’origine en devenant professeur de lettres. Le récit, fait de paragraphes qui s’interrompent brutalement, rend compte de la difficulté de dire. Sa sécheresse révèle la douleur latente et la difficulté de parler, entre membres d’une même famille.
Par Johanna Pernot
Créée par Bernard Pivot en 1975, Apostrophes s’impose rapidement comme l’émission littéraire de référence à la télévision. Ce salon littéraire moderne remplit parfaitement sa fonction de démocratisation culturelle. Diffusée tous les vendredi soirs pendant quinze ans, l’émission accueille en direct plusieurs invités venus débattre autour d’ouvrages dont Pivot lit de nombreux extraits. Instigatrice de certains succès, révélatrice de phénomènes littéraires, mais aussi lieu d’affrontement des idéologies, Apostrophes connaît une forte audience (plus de 2 millions de téléspectateurs). De l’ivresse scandaleuse d’un Bukowski à l’interview exclusive d’un Soljenitsyne en passant par les entretiens à domicile de Yourcenar ou Duras, l’émission a fortement marqué la mémoire télévisuelle (voir Florilèges de l’émission Apostrophes). Pour les professionnels de l’édition, le passage par Apostrophes est devenu crucial en vertu de sa capacité à lancer le succès d’un livre – à l’instar de La Place, prix Renaudot 1984.
La lecture initiale de Bernard Pivot oriente la discussion sur le style d’Annie Ernaux et son refus du roman. Les plans rapprochés révèlent le visage à peine fardé de l’auteur, qui, l’attitude humble, le regard un peu fuyant, résume la vie très modeste de son père et sa « toute petite ascension sociale », de paysan à petit commerçant.
En refusant délibérément la fiction mensongère du roman, Annie Ernaux respecte l’ambition originelle de toute autobiographie : dire la vérité, sur soi et son entourage. La création d’un personnage aurait nécessairement embelli son père. Au contraire, le choix d’une « écriture plate », sans commentaire, lui permet de raconter objectivement l’histoire paternelle. Le style dépouillé se veut à l’image d’une vie marquée par la nécessité.
Les écrivains et critiques Alain Bosquet et Georges-Emmanuel Clancier soulignent l’un après l’autre le paradoxe de cette écriture : la pudeur, la simplicité des phrases laissent affleurer les émotions. L’ascétisme du style rend le récit d’autant plus touchant.
Le débat s’achève sur l’articulation tragique entre parole et écriture. « On ne parlait plus le même langage » déclare Annie Ernaux. C’est parce que le père ne maîtrise pas « le beau langage » de la culture dominante, et que la communication devient impossible, que la fille se tourne vers l’écriture et consomme la rupture avec son milieu d’origine.
www.enseignants-lumni-fr
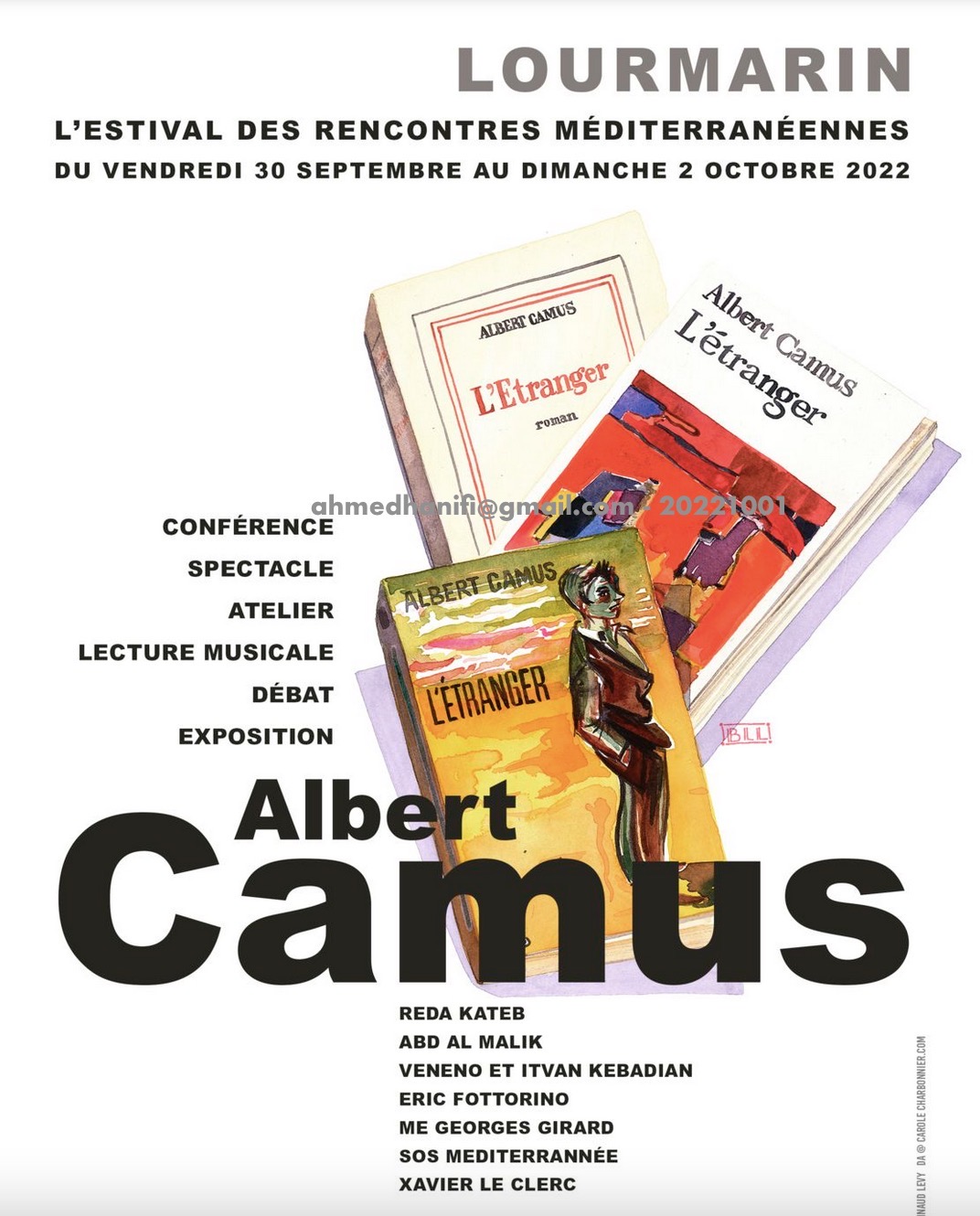
Les Rencontres de cette année ont commencé ce vendredi 30 septembre avec un atelier à destination d’élèves du primaire, animé par Brigitte Lannaud Levy, « autour de la réalisation d’un portrait d’Albert Camus », puis avec une exposition photo de Carole Charbonnier « à partir du travail réalisé au sein de la maison d’arrêt de Paris La Santé, en partie autour de l’Étranger » et en soirée avec une « lecture musicale de l’Étranger par Réda Kateb accompagné du pianiste Didier Davidas ».
Le samedi matin nous avons eu droit à trois belles interventions de Paris Lounis « une critique de la lecture qu’Edward Saïd a faite de l’Étranger », d’Alexis Lager et de Maître Georges Girard « sur le thème du procès de Meursault dans l’Étranger en perspective avec l’actualité. »
(CF VIDÉO ICI EN BAS DE PAGE)
D’autres animations sont prévus les samedi après midi et soirée ainsi que le lendemain dimanche avec diffusion entre autre d’un film de Joel Calmette « Camus avec nous » en présence du réalisateur.
J’ai assisté aux interventions de ce samedi matin. La première notamment avec le remarquable travail de Faris Lounis (voir vidéo ici en bas de page).
Sur le plan anecdotique j’ai noté cette clarification à propos de « Meursault, contre-enquête » de Kamel Daoud.
___________________
_ Catherine Camus confirme ce que j’écrivais dans un article que j’ai fait publier par Le Quotidien d’Oran le 30 mai 2017, (voir le lien en bas de page). J’y rapportais avec Kaoutar Harchi que je cite que Kamel Daoud avait dû modifier des passages de « Meursault, contre-enquête » pour que son roman soit accepté par les lecteurs français, mais prioritairement par les éditeurs, par ce « système éditorial qui a le monopole de légitimer ou déligitimer un texte », et par les ayant-droit.
Voici un extrait : « On s’aperçoit alors que le produit célébré en France n’est pas celui édité en Algérie, ‘‘c’est le projet dépolitisé par le franchissement littéraire’’ où Albert Camus est célébré, mais où la ‘‘petite voix »’’ de Kamel Daoud a été étouffé. L’accueil réservé à Kamel Daoud, cette reconnaissance littéraire a pour effet d’infléchir le discours de l’auteur qui se trouve obligé de l’adapter ‘‘à l’horizon d’attente des consacrants et plus largement du lectorat français’’ constate Katouar Harchi »… K. Daoud bascule d’un « acte littéraire engagé » (dans la version algérienne de Meursault, contre-enquête) écrit la sociologue à un « hommage appuyé à Camus » (dans la française).
Kamel Daoud avait alors réfuté le contenu de notre article et plus encore le pavé de Kaoutar Harchi. Cinq années ont passé depuis. Il ne s’agit pas de « quelques phrases » mais « beaucoup ».
Ce samedi matin, 1° octobre 2022, avait lieu la deuxième journée (sur trois) des « Rencontres méditerranéennes de Lourmarin » avec de très intéressantes interventions dont celle de Faris Lounis très appréciée, « une critique de la lecture qu’Edward Saïd a faite de l’Étranger ».
Lorsque la parole fut donnée au public, madame Catherine Camus est intervenue (par moment, je ne saisissais pas trop bien ce qu’elle disait, notamment parce qu’ inaudible, mais pas que…) Voici ce que j’ai bien entendu : « En ce qui concerne Kamel Daoud (dont le livre « Meursault, contre-enquête » a été évoqué), on doit beaucoup de choses à Alexandre ( probablement son collaborateur Alajbegovic ) dans ce livre parce que quand on l’a reçu, ça commençait par : ‘‘l’assassin habitait au 93 rue de Lyon’’ (Alger), donc c’était nommément Meursault, Camus, je ne sais pas… et Alexandre me dit ‘‘mais on ne peut pas laisser ça comme ça, quand même !’’ Je dis ‘‘ Oui, mais attention, parce que, attention, si je dis quelque chose ‘‘Le Monde’’ (certainement le quotidien parisien) va me tomber sur le paletot en me disant que j’ai attaqué un Arabe (madame Camus dit « Arabe » en appuyant sur les syllabes. Donc j’ai téléphoné directement à Kamel Daoud, poursuit-elle, qui a été très sympa et qui me dit « Oh ben si… » (elle mêle les mots de KD aux siens) « vous pouvez pas commencer comme ça, c’est pas possible. Vous associez papa à l’Arabe, à … (inaudible). Il m’a dit « Oh ben s’il s’agit de changer deux ou trois occurrences c’est pas un problème ». Donc on en a changé BEAUCOUP (C.C appuie sur le mot). Entre ce qui est sorti en Algérie et ce qui est sorti en France, il y a de grosses différences »…
Oui, de grosses différences. Ni Kaoutar Harchi, ni moi-même n’avons repris « des thèses diffamatoires » comme KD me l’a écrit.
Lire ici l’article en question (cliquer)
ou ici LE QUOTIIDIEN D’ORAN (30.05.2017)







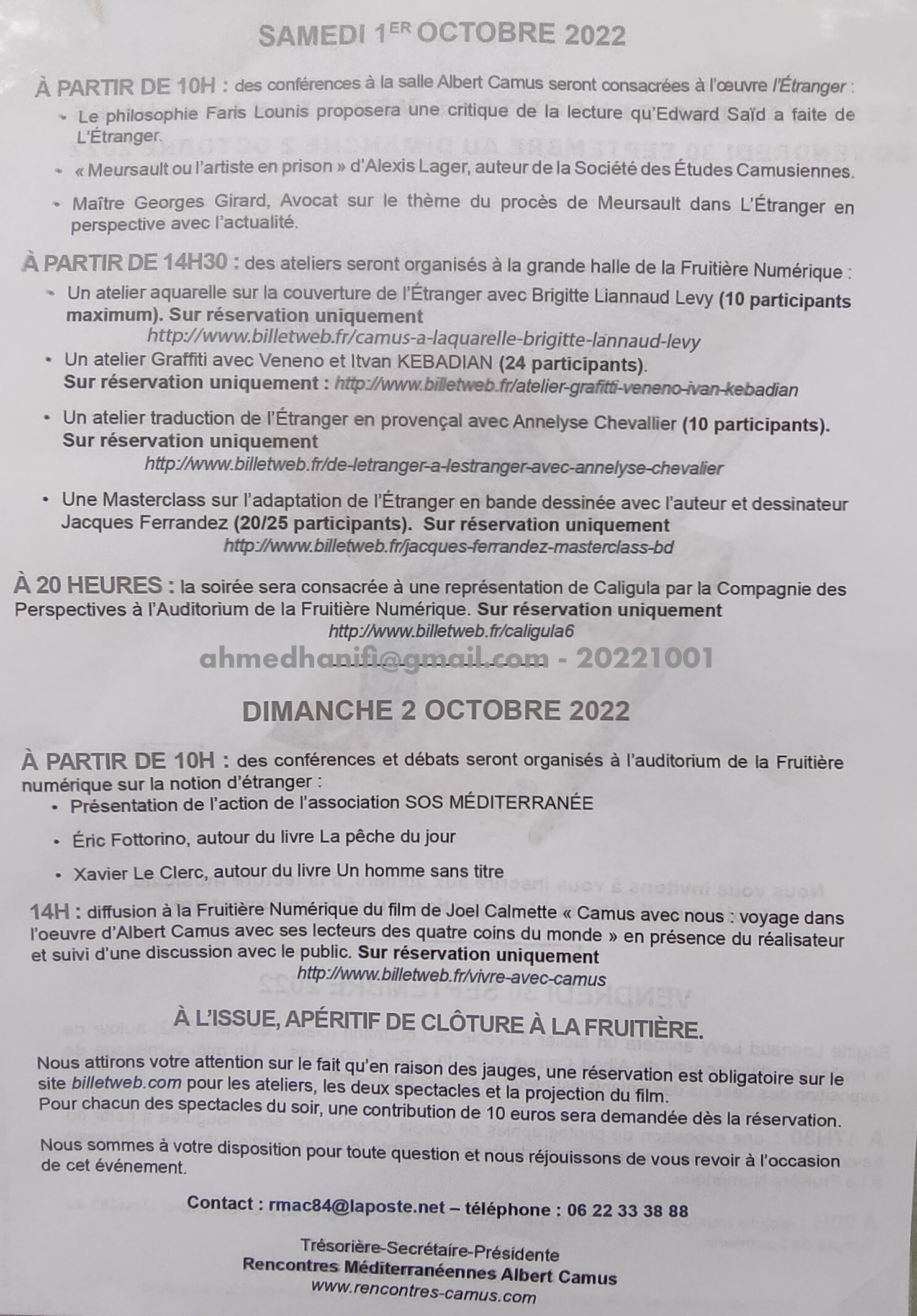









______________________________________________
CLIQUER ICI POUR VOIR EXTRAITS VIDEOS DES RENCONTRES DU SAMEDI MATIN
_______________________________________________
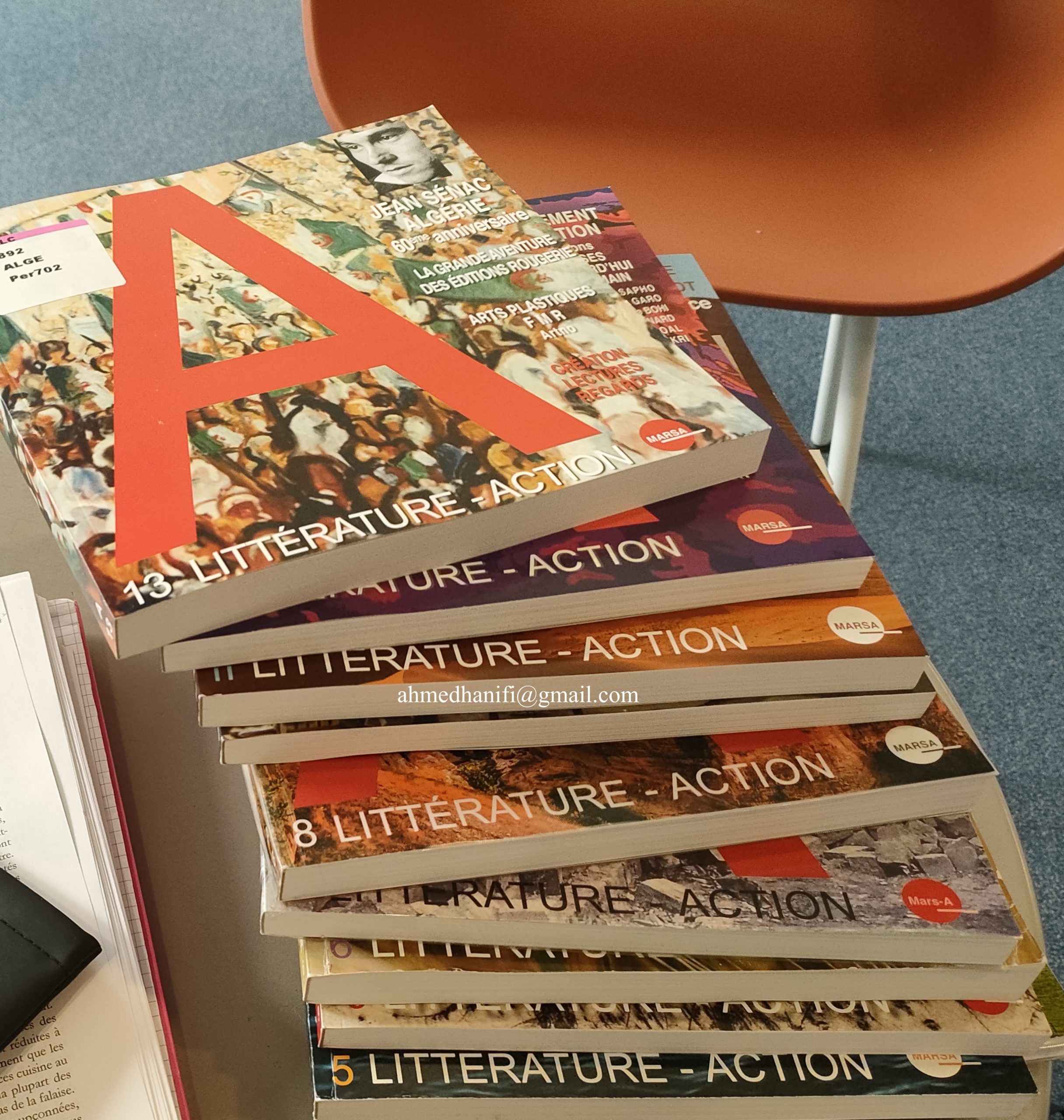
Je suis descendu à Marseille vendredi 10 pour assister à une soirée NUPÈS en vue des élections législatives. Comme il m’arrive souvent lorsque je descends à Marseille, j’ai été pris ce vendredi par une irrésistible envie, celle de faire un tour à l’Alcazar, LA grande bibliothèque, au deuxième étage, « Littérature », en attendant la soirée NUPÈS.
___________
Je suis donc dans l’Alcazar, je m’installe avec « L’anomalie » de Hervé Le Tellier entre les mains. À mes côtés, le roucoulement continu de deux tourtereaux, probablement étudiants, me dérange. Je change de place et m’installe sur un siège devant une petite table ronde, seul près d’un espace silencieux. Je continue ma lecture de L’Anomalie, mais lorsque je lève les yeux, sur ma droite, en direction des rayons, une affiche attire mon attention, une feuille rose 21X27, sur laquelle il est écrit en caractères majuscules : « Espace magazines et littératures à emprunter ou à feuilleter sur place. » Juste en dessous, il y a plusieurs casiers remplis de revues sur le fronton desquels il est écrit : « NRF » pour le premier casier, « L’indice dei libri (italien) » pour le deuxième, « Nuit Blanche (revue québécoise) » et « A-Littérature-Action » sur d’autres. Immédiatement ce dernier titre me renvoie à une revue que j’avais beaucoup appréciée en son temps « Algérie Littérature/Action » dont le directeur de publication était Aïssa Khelladi et la responsable de la rédaction Marie Virolle. Une revue éditée en France par Marsa Éditions.

Je range Le Tellier dans mon sac-à-dos (j’ai toujours un sac à dos, je peux y fourrer tout et n’importe quoi) et retourne à l’espace « Magazines et littératures ». Il y a en tout et pour tout dix numéros de cette revue (du N° 4, janvier- avril 2019 au N° 13 janvier-avril 2022). Les trois premiers numéros soit ont été empruntés, soit n’ont jamais figuré dans les rayons de l’Alcazar.
Ce qui frappe en premier c’est d’abord le format. Il était plutôt classique, 15 cm X 21, passant à un format carré de 20,50 X 20,50, puis ce qui attire l’attention également c’est l’évacuation d’un des responsables initiaux de la revue. Peut-être a-t-il de lui-même refusé cette nouvelle aventure ? Exit donc de la nouvelle revue Aïssa Khelladi qui a complètement disparu des médias depuis le retrait et la disparition de l’ancien président algérien dont il avait écrit un panégyrique « Bouteflika, un homme et… ses rivaux » (Ed Marsa/Alger, 2004). Un livre débordant de haine, notamment à l’encontre de Hocine Aït-Ahmed. Je demeure convaincu qu’il s’agissait là d’un brûlot, un libelle de « commande ». J’appréciais les écrits de Aïssa Khelladi (ou d’Amine Touati), mais là je suis tombé de haut et à la renverse (je savais qu’il avait été officier des Services, un frère parmi les frères, mais je ne pensais pas qu’il avait encore un fil à la patte. Aussitôt après la lecture du brûlot j’ai adressé un courrier de désabonnement à la revue « A.L/A » dont j’appréciais beaucoup les contenus et le travail des collaborateurs. Je me dois d’ajouter que Marsa a été la première maison d’édition à me publier avec « Le temps d’un aller simple » (en 2001 en France et l’année suivante en Algérie). Je ne pouvais pas continuer après ce que j’avais lu dans le livre de Khelladi. J’avais écrit une lettre (cf photo) très sévère. Je la récrirais identiquement aujourd’hui. Mais il me faut être clair, le talent d’écrivain, certain, de Khelladi, n’a rien à voir ici.
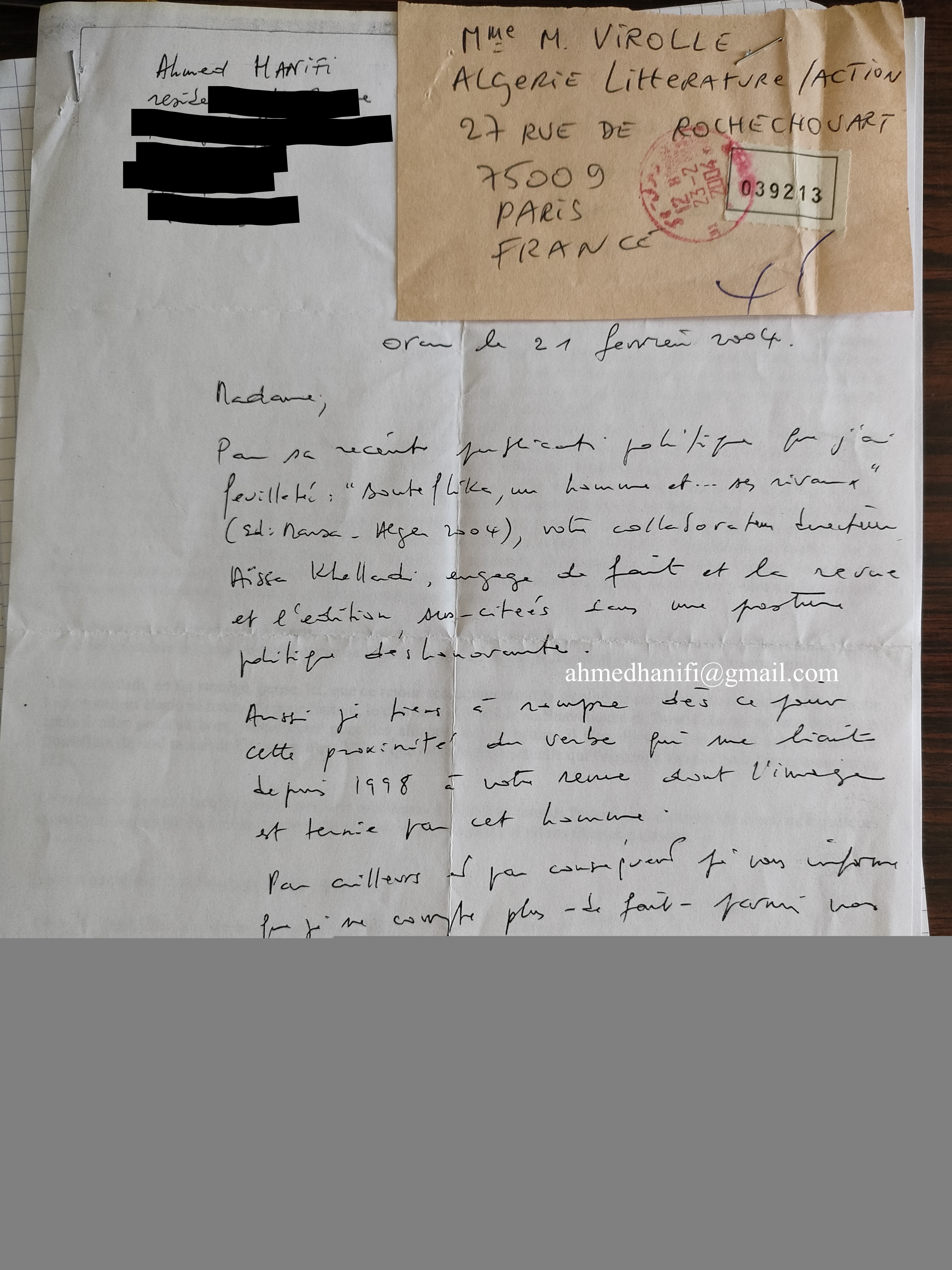
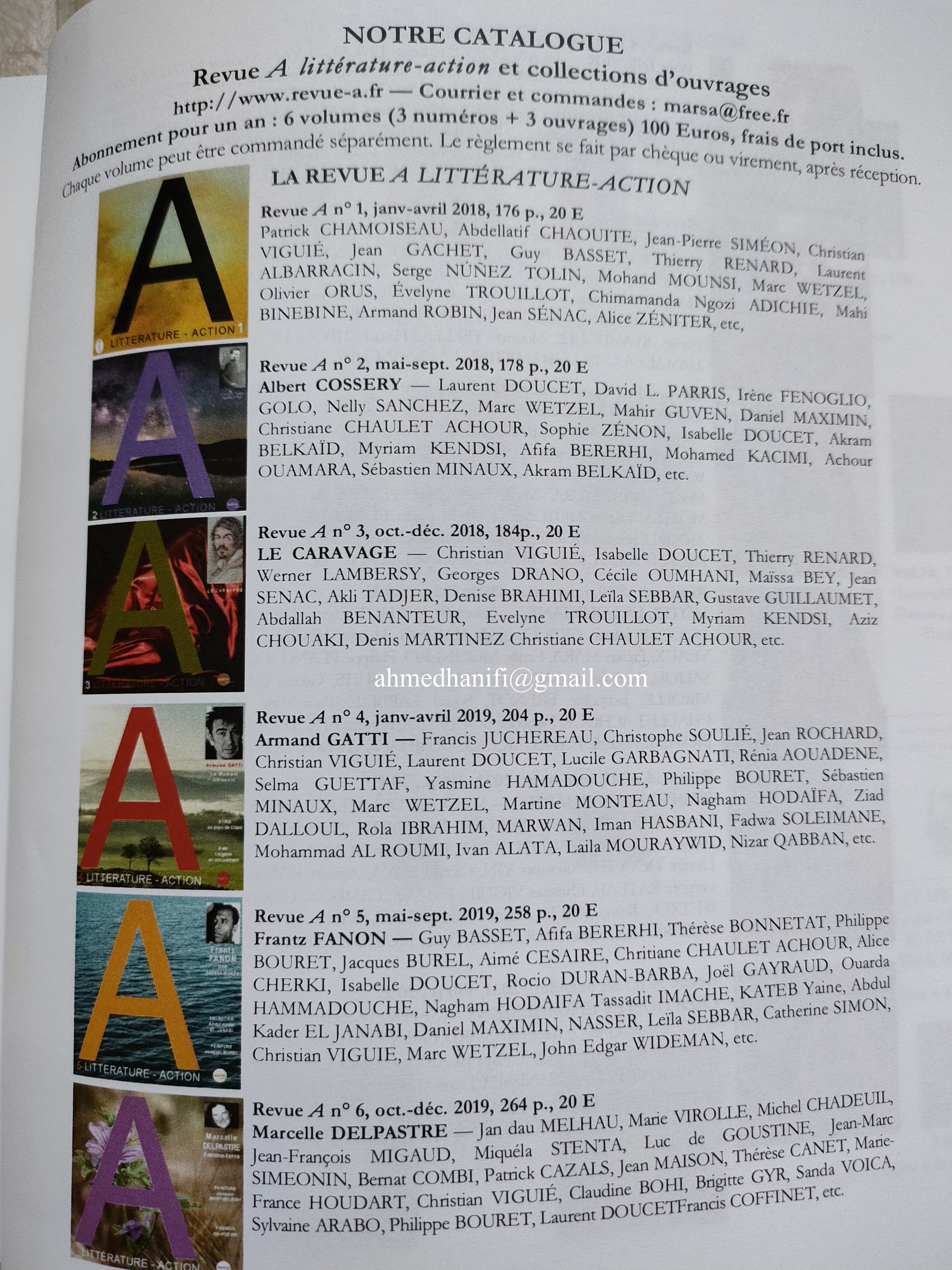
Je reviens à mon mouton pour dire que je suis très content de ce « retour ». Ce type de revue fait cruellement défaut en Algérie (même si, a priori, elle ne traite pas exclusivement de l’Algérie), et puis, c’est une revue française, pas algérienne. Je suis surpris qu’on ne trouve nulle trace de « A littérature-action » dans la presse algérienne qui bizounourse (du verbe bizounourser) en rond. Toujours les mêmes encore et encore. À moins que je sois un mauvais lecteur de cette presse. C’est vrai aussi, mais si tel aurait été le cas je pense qu’on en aurait eu vent via Facebook non ? Là encore je n’ai peut-être pas les « bons amis » qu’il faut ? Je commence à tourner moi-même en rond. Je me reprends et continue sur « A ».
La direction de cette nouvelle revue « A littérature-action » « Appelons-la ‘‘A’’ », est assurée par Marie Virolle et Laurent Doucet (« poète et professeur de lettres, d’histoire et de géographie dans un lycée professionnel de la banlieue de Limoges »). La revue est éditée par « Mars-A Publications Animations » (Marsa était le nom de l’ancienne revue). Le A « Algérie » de la précédente revue s’est transformé en « A comme le A de Ailleurs, le A de Autre, A des continents, des rives et des dérives, Afrique, Asie, Amérique… » Mais pas Algérie ? il y a là quelque malentendu ou méprise (ou impasse).
Si Algérie Littérature/Action était bimestrielle, la revue « A » est plutôt irrégulière. Elle couvre tantôt une période de trois mois (N° 9 et 12), tantôt quatre (N° 4, 5, 6, 8, 11, 13) ou même cinq (N°10). « ‘‘A’’ s’inscrit dans la continuité de l’action de ‘‘Marsa Éditions’’ et reprend à son actif le bilan de vingt années de publications et d’animations de cette structure » est-il précisé sur son site Internet ( https://revue-a.fr). Si tracasseries il y eut, elles sont d’ordre administratif (tout refaire : Urssaf, impôts, Afnil, Bnf…) et ce n’est pas rien !
J’ai emprunté les quatre derniers numéros, à savoir 10 à 13 couvrant la période de janvier 2021 à avril 2022. Ce sont ces quatre numéros que je vais exposer, détailler.
Des trente-quatre anciens collaborateurs et parrains (plusieurs y figuraient alors que décédés) de la revue Algérie Littérature /Action, seuls deux poursuivent l’aventure avec « A » la nouvelle revue : Denise Brahimi et Christiane Chaulet-Achour plus Marie Virolle (sans cette dernière la revue disparaîtrait sur le champ ou illico). Si le nombre total des collaborateurs (ne pas confondre avec contributeurs ou coordinateurs) indiqués sur le site Internet est de quarante-neuf noms, celui mentionné sur la revue papier diffère selon le numéro. Ils sont 23 collaborateurs aux numéros 10 et 11, 18 au 12 (dont une modification de nom) et 19 pour le dernier. Sept personnes sont en charge de la Rédaction de l’actuelle revue (dont Marie Virolle et Christiane Chaulet-Achour). La direction est assurée par Marie Virolle et Laurent Doucet. La revue « A » est domiciliée en France et publiée « avec le concours du CNL et de l’ANCT (CNL et FAS pour la revue disparue).
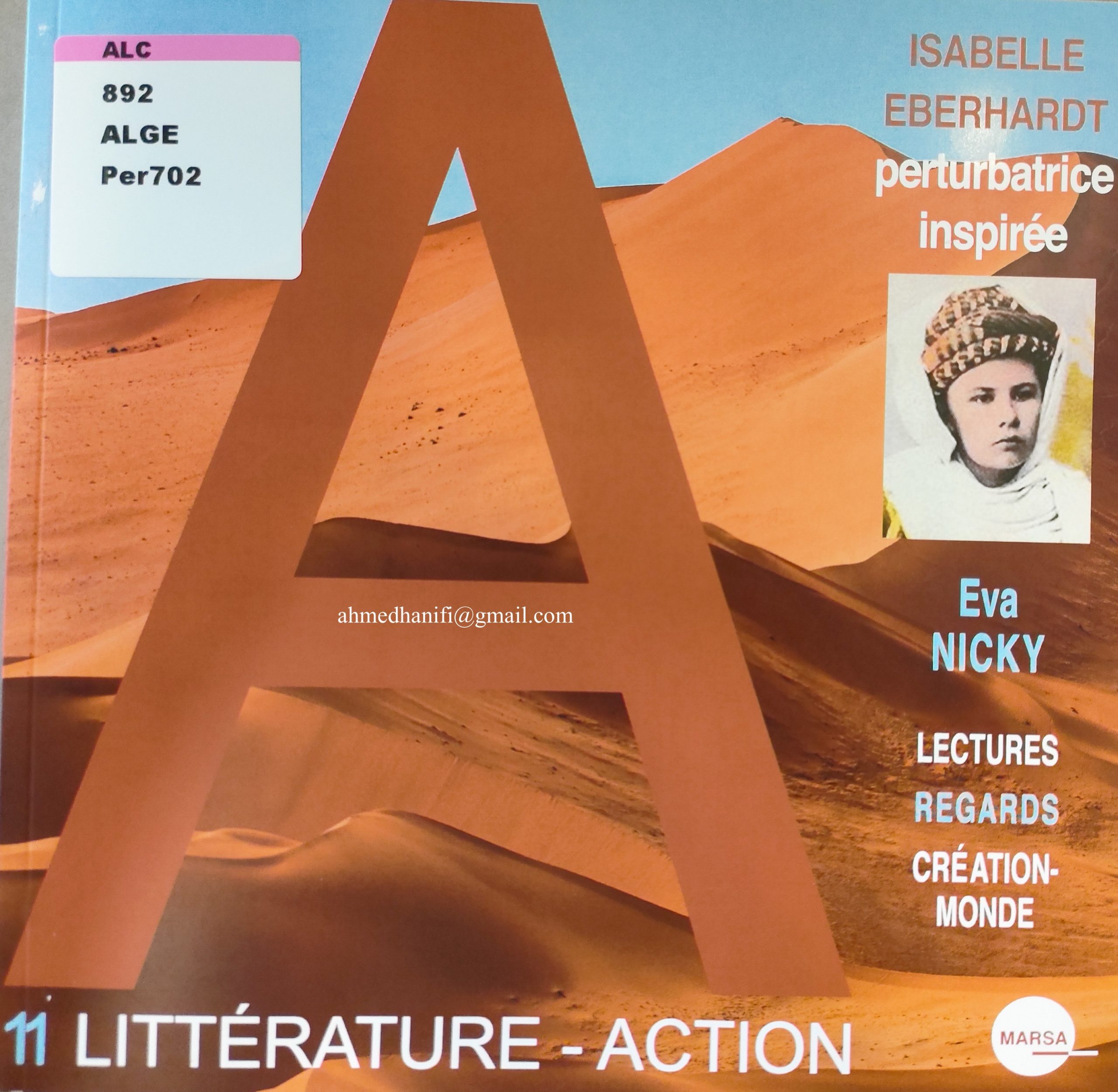
La lettre A occupe systématiquement une importante partie de la Une de la revue (voir photos). Quant au contenu de « A », les unes des numéros 4 au 13 mentionnent, dans l’ordre, jusqu’à la plus récente : Armand Gatti, Frantz Fanon, Marcelle Delpastre, Peter Diener, Kateb Yacine, échanges avec le Japon, Hôtel La Louisiane, Isabelle Eberhardt, Engagement et création, Jean Sénac. Il y a quatre grandes rubriques (elles n’apparaissent pas toutes systématiquement). Prenons-les dans l’ordre des numéros, du 10 au 13 :
1- En Une (82 pages au numéro 10, 73 pour le n° 11, 44 p pour le n° 12, et 120 pour le 13)
2- Études, lectures, regards (22 pages, 48, 50, 115)
3-Création-monde (89 pages, 60, 48, 28)
4- Arts plastiques (néant pour le n°10, 26 pages, 34 pages, et néant)
De quoi de qui traitent-elles ces rubriques ? Je les propose (très grossièrement) dans l’ordre de parution.
1- Rubrique « En Une »
N° 10 de la revue : 82 pages sont consacrées à l’hôtel littéraire La Louisiane (60 rue de Seine à Paris) où ont été accueillis de nombreux écrivains, artistes dont Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Boris Vian, Oscar Peterson, Gene Vincent, Étienne Daho… magnifiques textes accompagnés de photos, dessins… la rubrique est scindée en deux : a- Gens de La Louisiane, b- Femmes de La Louisiane.
N° 11 : Isabelle Eberhardt (Mahmoud Saadi), un dossier de 73 pages coordonné par Marie Odile Delacour (notre MOD de Libé d’antan, pas Libération non, Libé des belles années) et Jean-René Huleu (même parcours !) Je me demande si ce n’est pas elle qui a mis (la première) en lumière notre Alla du Foundou de Bechar. MOD et Huleu sont des spécialistes de la belle « perturbatrice ». On trouve parmi les contributeurs ces mêmes auteurs ainsi que… Leïla Sebbar, Christiane Chaulet Achour, Karima Berger (bonjour !), Patti Smith (une de ses chansons) : « … il me faut un radeau/ pour m’emporter sur/ la rivière jaune/ un harem de cloches à pierres/ carillonnant Isabelle/ la ballade d’une fille/ violon ivre/ qui s’est noyée dans le désert… »
N°12 : Sa « Une » porte sur des questions-réponses, précisément « 10 questions ; 10 réponses pour aujourd’hui et pour demain », sur 44 pages. J’ai trouvé certaines des questions (pardonnez-moi) un peu naïves, plutôt lisses que rugueuses. Sont conviés à y répondre onze (pourquoi pas 10 ?) artistes, philosophes, une cantatrice, des auteurs… dont Sapho, Boualem Sansal, Cécile Oumhani, Sophie Bessis… Les questions : Quels sont les événements qui vous ont le plus marqué…, quel est le plus grand enjeu actuel, quels sont les plus grands dangers pour les sociétés humaines, le mot ‘‘engagement’’ a-t-il un sens, l’art et le politique peuvent-ils encore transformer le monde ? etc.
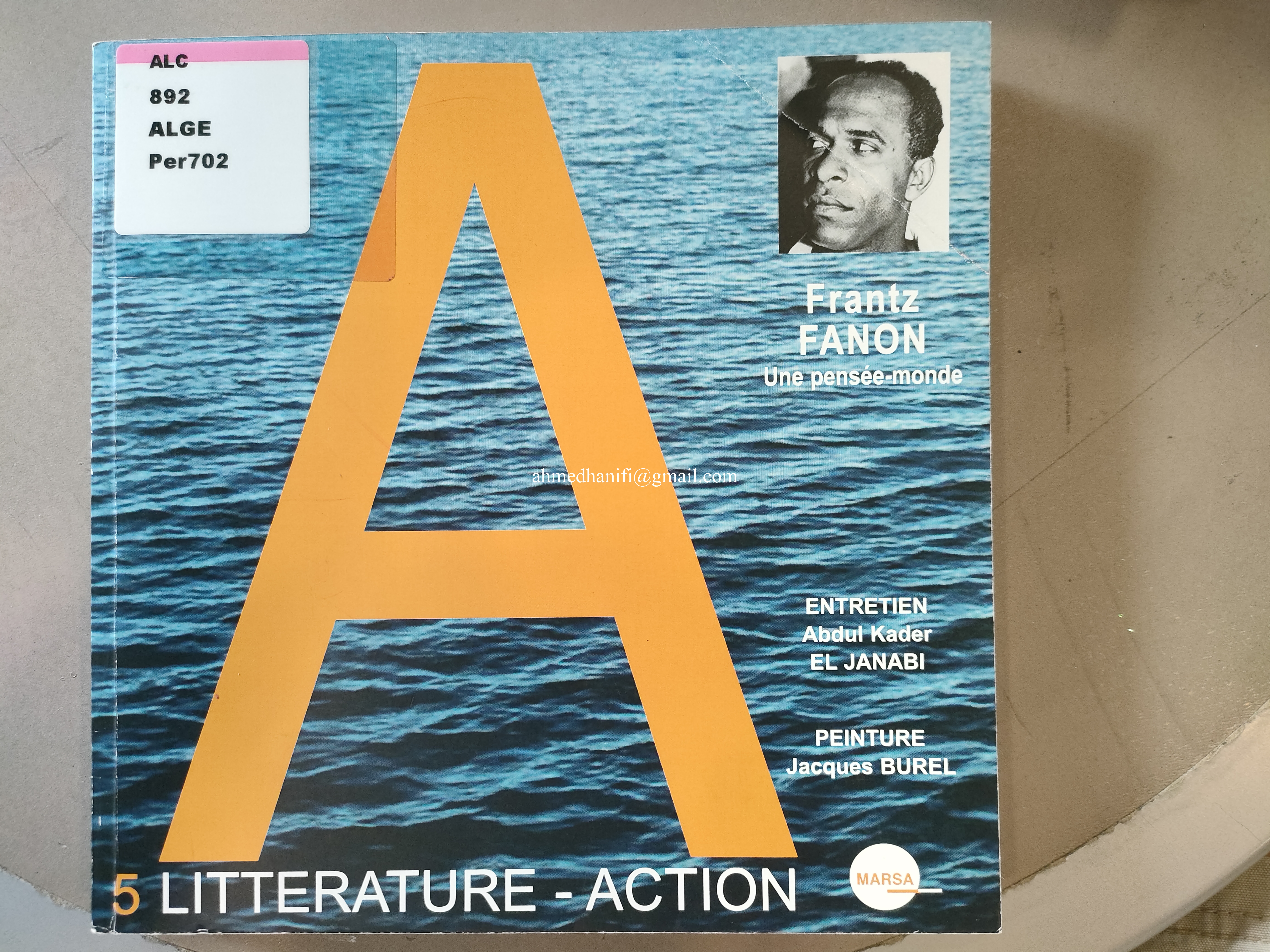
N° 13 : Sur les pas de Jean Sénac. Un dossier de 120 pages avec des contributions de feu Hamid Nacer-Khodja, de Marie Virolle, Jean Bénisti ainsi que des textes de Jean Sénac. Il est question bien sûr des portraits de Denis Martinez, de son Talisman dédié à Sénac… Il est important de noter que l’ancienne revue Algérie Littérature-Action a produit un numéro (410 pages, publié au 1° trimestre 1999) entièrement dédié à Jean Sénac, « un volume réalisé sous la direction de Jacques Miel et de Jean de Maisonseul ».
2- Rubrique « Études, lectures, regards »
(je commence à fatiguer)
N° 10 de la revue : critiques de textes (François Augiéras, poésie de Lahiri, ) commémoration (La Commune de Paris), dialogue autour d’un auteur, notes de lectures (Idir Tas, Pierrette Epsztein)
N°11 : lecture de « 2 siècles de solidarités en Limousin », le verlan dans la BD, hommage à Bruno Krebs, un beau texte de Kamal Guerroua sur « l’exil linguistique » ou les écrivains algériens « placés par l’Histoire en position de rupture avec leurs racines », des fiches de lectures (Un Afghan à Paris, Une embuscade dans les Aurès…)
N°12 : Un entretien avec Catherine Simon (« Un baiser sans moustache » notamment) par Kinda F.Z. Benyahia (auteur d’une thèse sur « poétique du roman policier, cas de trois autrices… », une note de lecture de « Le doigt » de Dalie Farah (par Denise Brahimi), d’autres notes par Françoise Bezombes… Mais aussi un texte de Christiane Chaulet Achour sur l’intertextualité en prenant pour exemple deux romans, celui de Mohamed Mbougar Sarr « La plus secrète mémoire des hommes » et celui de Yambo Youologuem « Le devoir de violence ». La recension (c’en est pas à proprement parlé d’une recension) commence ainsi : « Il y a souvent une certaine perplexité quand la critique journalistique en France s’entend pour encenser dans un concert de louanges un roman d’un auteur francophone. Pourquoi, alors que tant d’autres publient en même temps et qu’on les ignore ?… » L’interrogation de Christiane Ch.A. me fait sourire. Car on peut la compléter en la transposant à l’environnement algérien. « Pourquoi ‘‘les critiques’’ de la presse algérienne (par flegme ou dépourvus d’instruments ?) tournent-ils en rond ? Pourquoi 40, voire 50 ans plus tard ils en sont encore à encenser plus que tous les autres, des écrivains qui n’en ont pas besoin, des hommes comme K. Yacine, M. Haddad, R. Boudjedra (qui ne produit plus), Mimouni, Jean Sénac… matin et soir (j’exagère à peine), alors qu’il y a des talents à la pelle (jeunes) à peine trentenaires (ou quadra) formidables ! (il suffit de tendre l’oreille et d’ouvrir l’œil, notamment lors du SILA). La réponse (indirecte) a été donné mille fois par Bourdieu. Et c’est dommage (dommage que Bourdieu ait mille fois raison).
N°13 : 115 pages sont dédiées à cette rubrique (y compris les Arts plastiques) dans ce numéro. On y trouve pêle-mêle Nawal El Saadawi, Assia Djebar, Al Hallaj, Leïla Sebbar et un long entretien avec Abdellatif Chaouite (par Bruno Guichard)
Deux autres rubriques, Création-monde et Arts plastiques complètent la revue, ainsi que des critiques de films, documentaires… (Je suis fatigué). Je m’arrête là car l’heure tourne. La combinaison fatigue et temps agissent comme un boa constricteur.
Je reprendrai et retravaillerai entièrement cet article lorsque j’aurai lu l’ensemble des 13 (ou plus) numéros de la revue et si le courage m’accompagne. Je souhaite à « A » bonne route (elle a quand-même quatre ans ! – elle est née en 2018 alors même que j’étais sur le point me concernant, de mettre un terme à ma maison d’édition « Incipit en W » hélas.)
Allez, il me faut quitter la bibliothèque et filer droit à la soirée NUPÈS.
Quant à l’ « A », je m’y abonnerai pour sûr, promis, juré, craché, croix de bois, croix de fer, si j’mens…


__________________________
°
°
CLIQUER ICI POUR VOIR LA COMPILATION DE « JERUSALEMA »
°
°
__________________________
« Jerusalema ikhaya lami/ Ngilondoloze/ Uhambe nami/ Zungangishiyi lana… »
(c’est juste une prière… Protège-moi, ne me laisse pas ici, marche avec moi…)
Un phénomène mondial. « Jerusalema » est une chanson de Kgaogelo Moagi, plus connu sous le nom de Master KG (musicien et producteur de disques Afrique du Sud) – « En octobre 2019, Master KG sort de son album Jerusalema, ainsi qu’un titre éponyme au nom de l’opus, soit Jerusalema. Il met en vedette la chanteuse Nomcebo Zikode sur cette chanson groovy. (Wikipedia)
_________________________
Jerusalema ikhaya lami
Jerusalem est ma maison
Ngilondoloze
Protège-moi
Uhambe nami
marche avec moi
Zungangishiyi lana
Ne me laisse pas ici
Jerusalema ikhaya lami
Jerusalem est ma maison
Ngilondoloze
Protège-moi
Uhambe nami
Marche avec moi
Zungangishiyi lana
Ne me laisse pas ici
Ndawo yami ayikho lana
je n’ai pas ma place ici
Mbuso wami awukho lana
Mon royaume n’est pas ici
Ngilondoloze
Protège-moi
Uhambe nami
marche avec moi
Zungangishiyi lana
ne me laisse pas ici
Ndawo yami ayikho lana
je n’ai pas ma place ici
Mbuso wami awukho lana
Mon royaume n’est pas ici
Ngilondoloze
Protège-moi
Uhambe nami
Marche avec moi
Ngilondoloze (x3)
Protège-moi (x3)
Zungangishiyi lana
Ne me laisse pas ici
Ngilondoloze (x3)
Protège-moi (x3)
Zungangishiyi lana
ne me laisse pas ici
Ndawo yami ayikho lana
je n’ai pas ma place ici
Mbuso wami awukho lana
Mon royaume n’est pas ici
Ngilondoloze
Protège-moi
Uhambe nami
Marche avec moi
Ngilondoloze (x3)
Protège-moi (x3)
Zungangishiyi lana
Ne me laisse pas ici
Ngilondoloze (x3)
Protège-moi (x3)
Zungangishiyi lana
Ne me laisse pas ici
www.lacoccinelle.net/



Je me suis rendu hier lundi, tôt le matin, au « Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée » de Marseille ou MUCEM. Il faisait bon, peut-être un peu frais encore à cette-là, 10 heures, heure de l’ouverture. Par cette exposition, qui a été inaugurée le 5 avril dernier et qui se tient jusqu’au 22 août, on entend « remettre en lumière la figure d’Abd el-Kader dans toute sa richesse et son importance historique et intellectuelle » (web du Mucem).



C’est lui-même, l’Émir Abdelkader, qui m’accueille à l’entrée du musée, avec sa djellaba blanche. Il porte dans sa main gauche un grand chapelet. Je le salut, son regard est serein, sa posture est quand-même un peu figée. Ce retour en France et toute cette lumière portées sur lui, le perturbent peut-être un peu. Je me dirige à la billetterie « c’est pour l’ L’exposition sur l’Émir Abd el-Kader » (11€, au 2° étage).





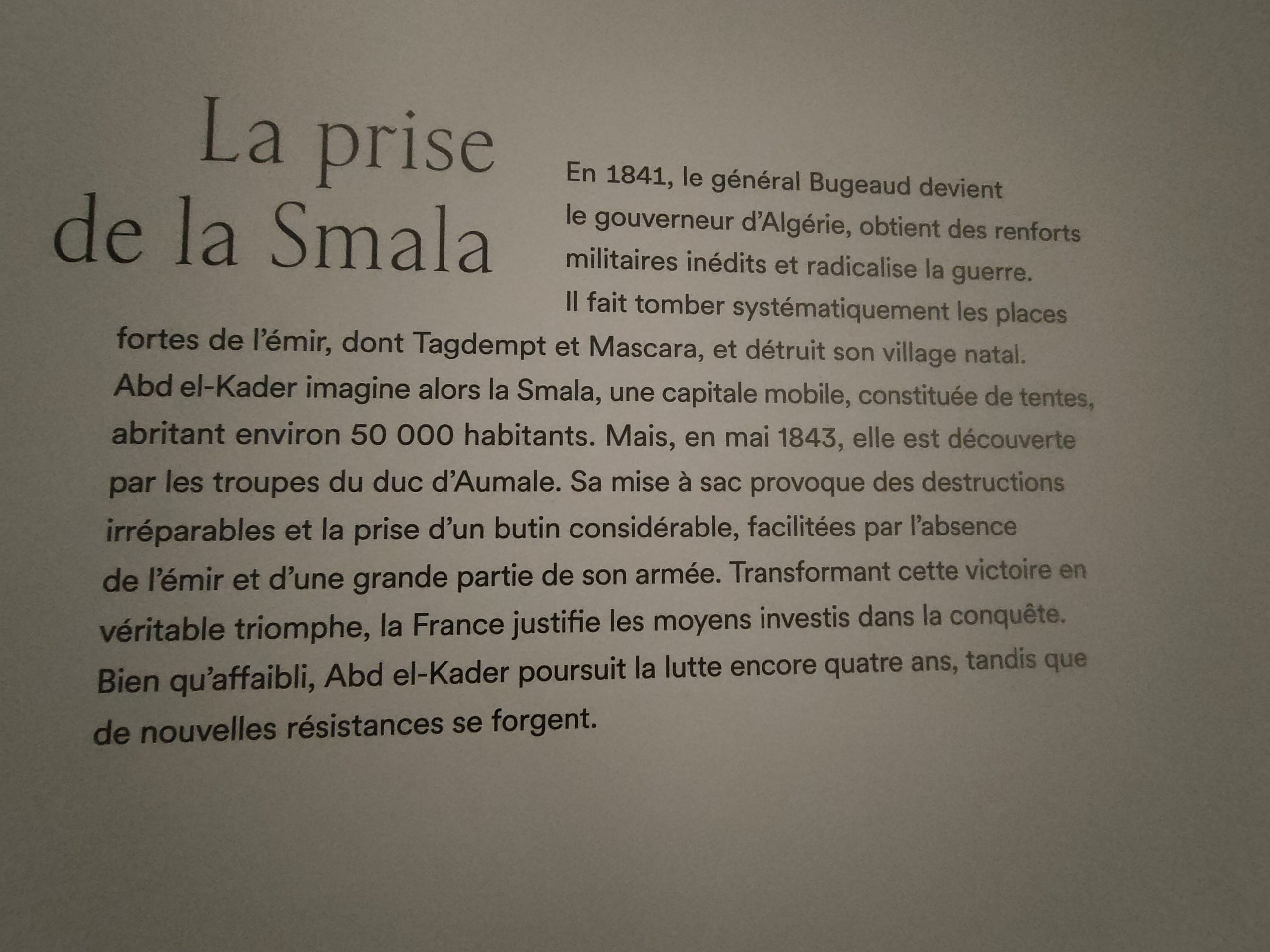
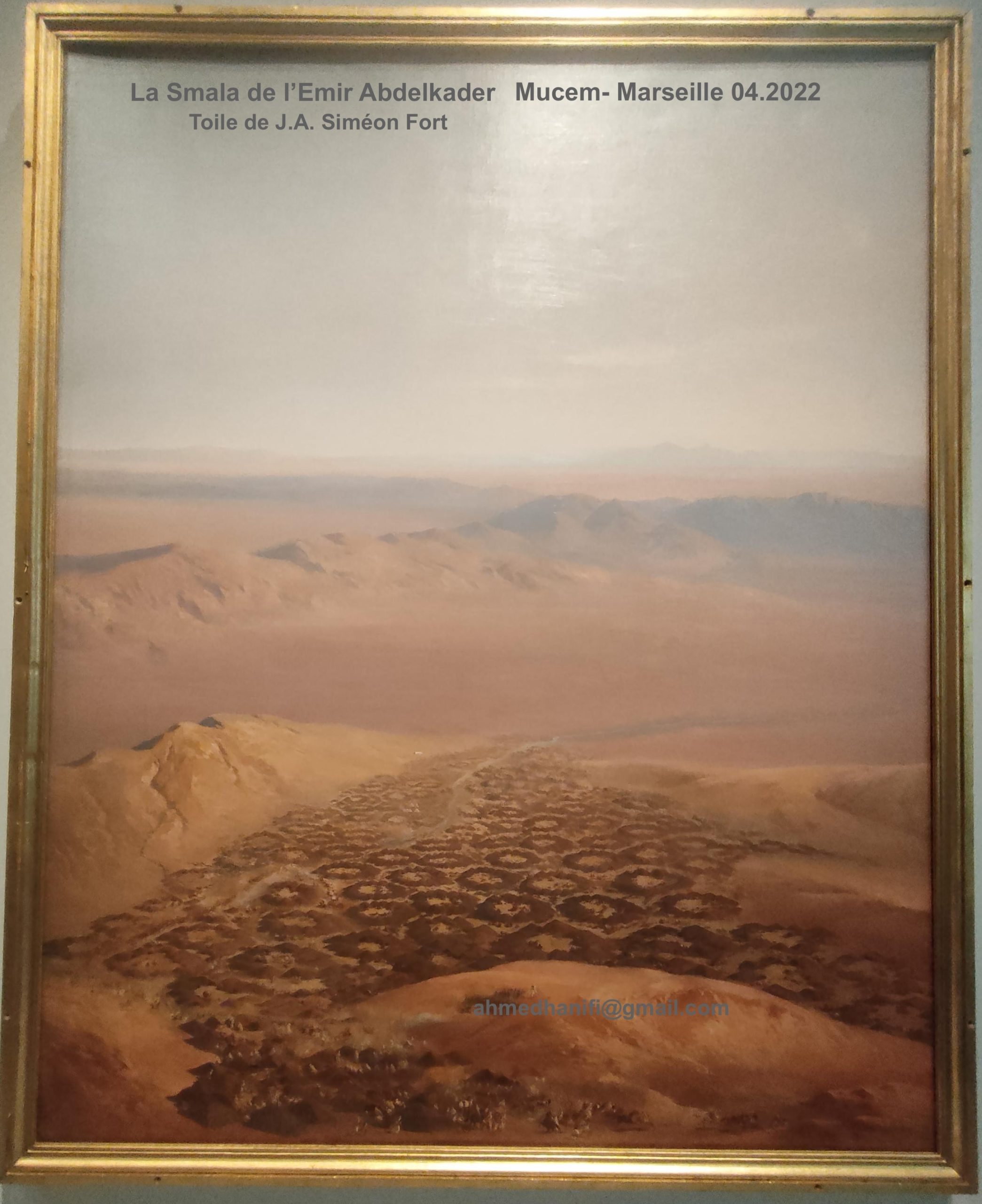

Dès l’entrée, la première salle (il y en a plusieurs) je suis emporté. On est mis en situation. La campagne d’Égypte et la défaite française face aux Anglais. En Méditerranée, Napoléon 1° observe la côte algérienne grâce à son espion, le capitaine Boutin, en 1808, l’année de naissance à El Guettana (Mascara) de Abdel-Kader ben Mohi Eddine qui sera (ainsi est-il présenté sur la page du Mucem : « Émir de la résistance, saint combattant, fondateur de l’État algérien, précurseur de la codification du droit humanitaire moderne, guerrier, homme d’État, apôtre… » En 1832, à 22 ans, il succède à son père dans la résistance à l’armée coloniale. J’admire le beau sabre qu’il a porté pour défendre les siens et la selle d’apparat. Et ses chéchias dans un style qui n’a plus cours aujourd’hui en Algérie. La sacoche de selle, ‘‘dejbida’’, est magnifique, « brodée de fleurs et d’arabesques sur son rabat extérieur ». L’Émir cherche des appuis internationaux, comme par ce courrier de 1840 adressé au consul des États-Unis. Les chapelets et le Coran ne le quittent pas. Dans la salle suivante un grand tableau montre la Smalah (zmala) de l’Émir : mille à deux mille tentes organisées en cercles d’une quinzaine de tente chacun (des zmala) avec les familles, les guerriers.

La défaite devant l’occupant oblige Abdelkader au retrait. Ce qu’il fait en se rendant au Maroc qui lui offre son aide. Le sultan est lui aussi défait lors de la bataille d’Isly (1844). Les luttes de l’Émir se poursuivent autrement. En 1847, l’Émir se rend contre la promesse que les autorités françaises le laisser se rendre en Orient arabe.
D’autres résistants à l’invasion françaises se mobilisent à l’instar de Cherif Boubaghla (ses restes furent rapatriés de France en juillet 2020) et Fatma N’Soumer tous deux en Kabylie. N’Soumer sera capturée. Elle mourra en prison six années plus tard, en 1863. L’Émir sera d’abord emprisonné dans le château d’Amboise durant cinq années. Il y écrit beaucoup. Des courriers à des hommes politiques, mais aussi de la poésie.
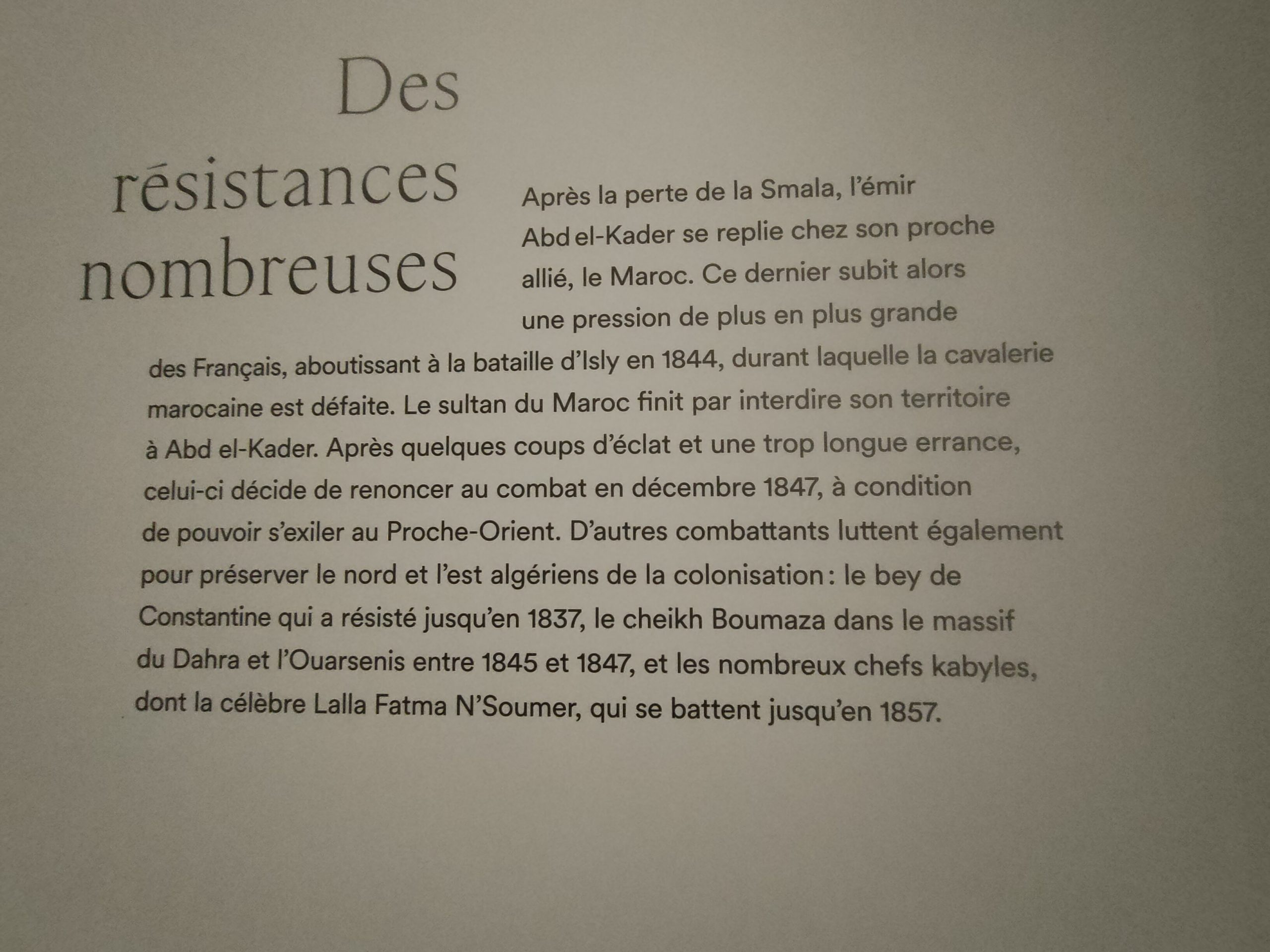


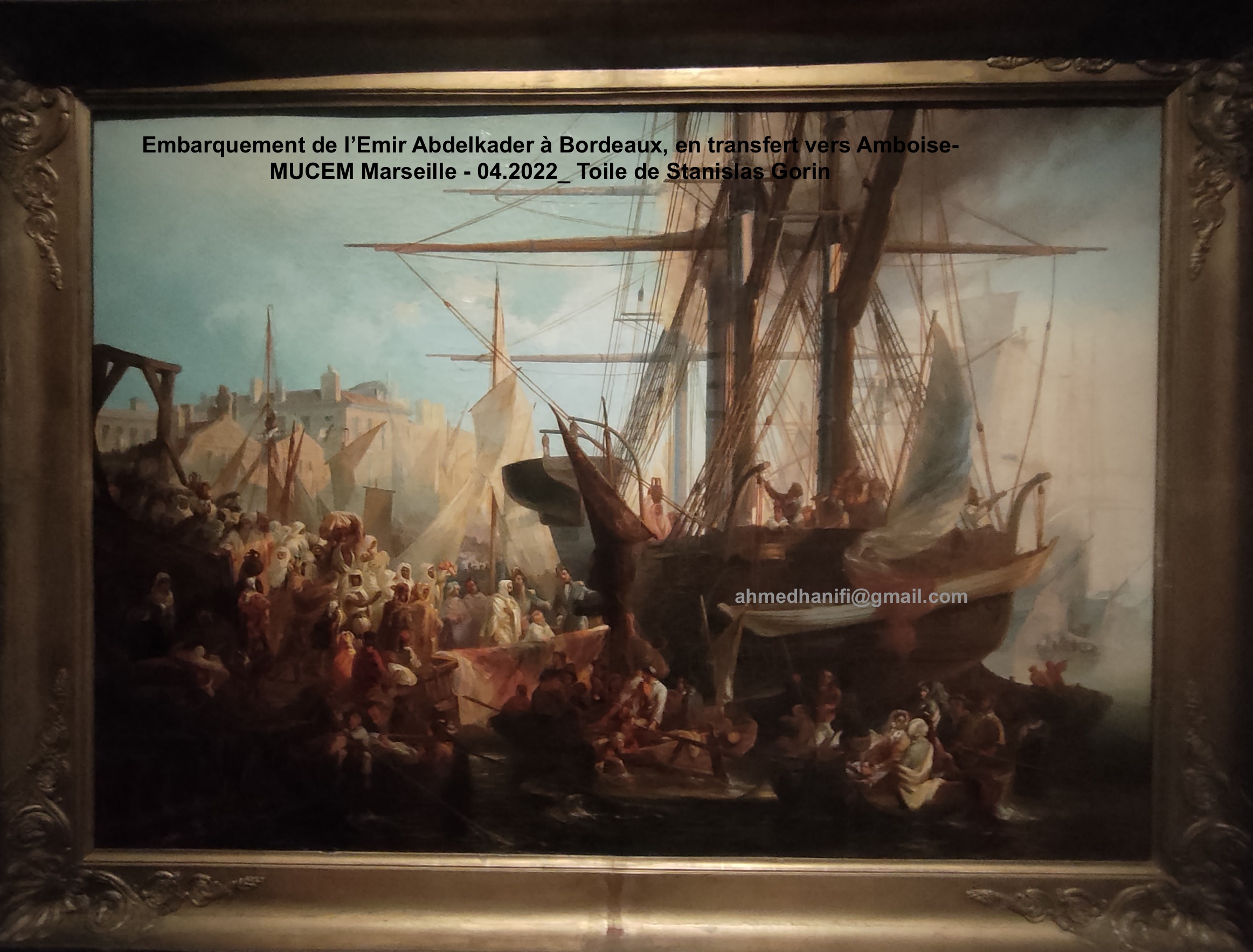
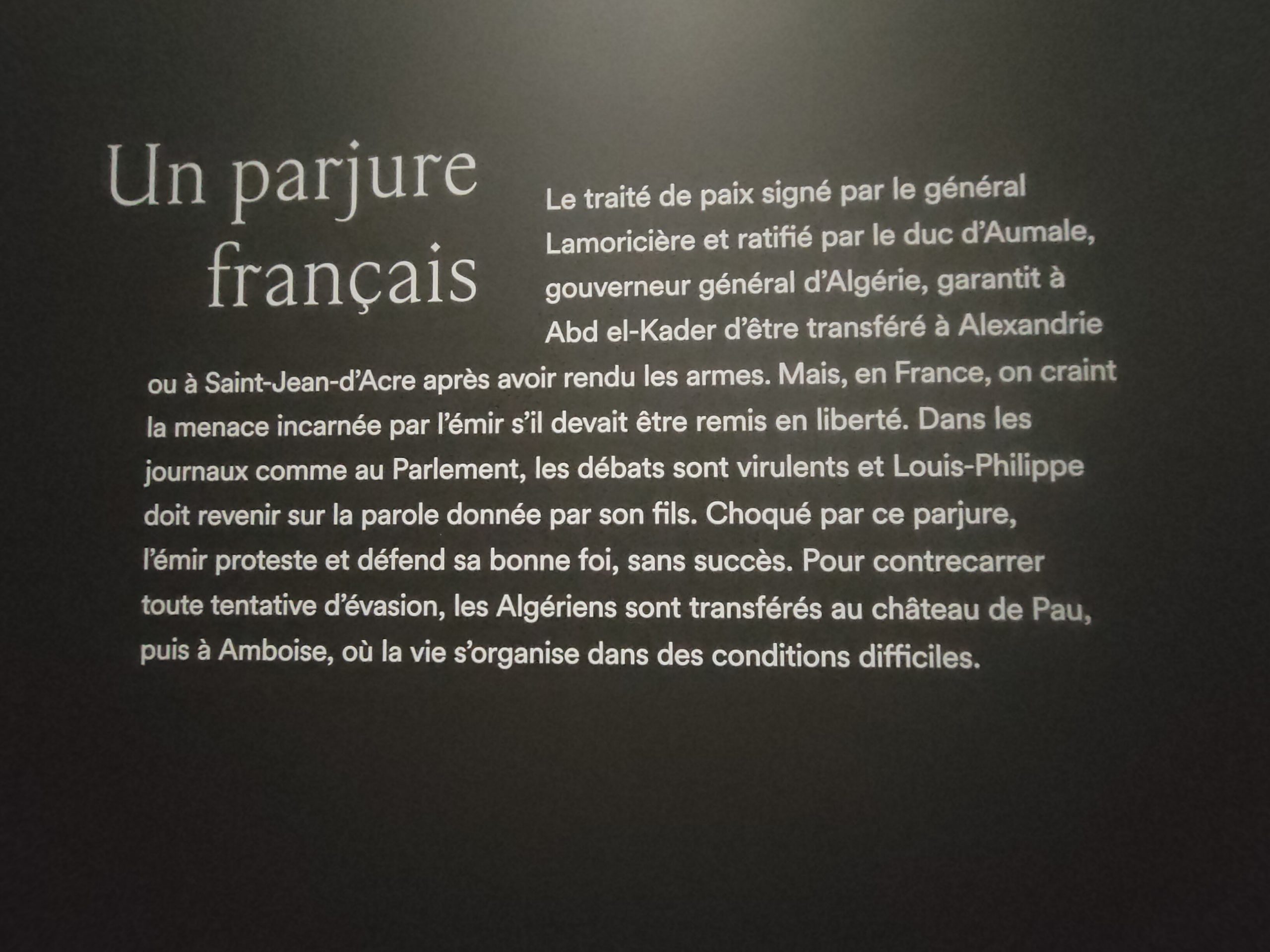
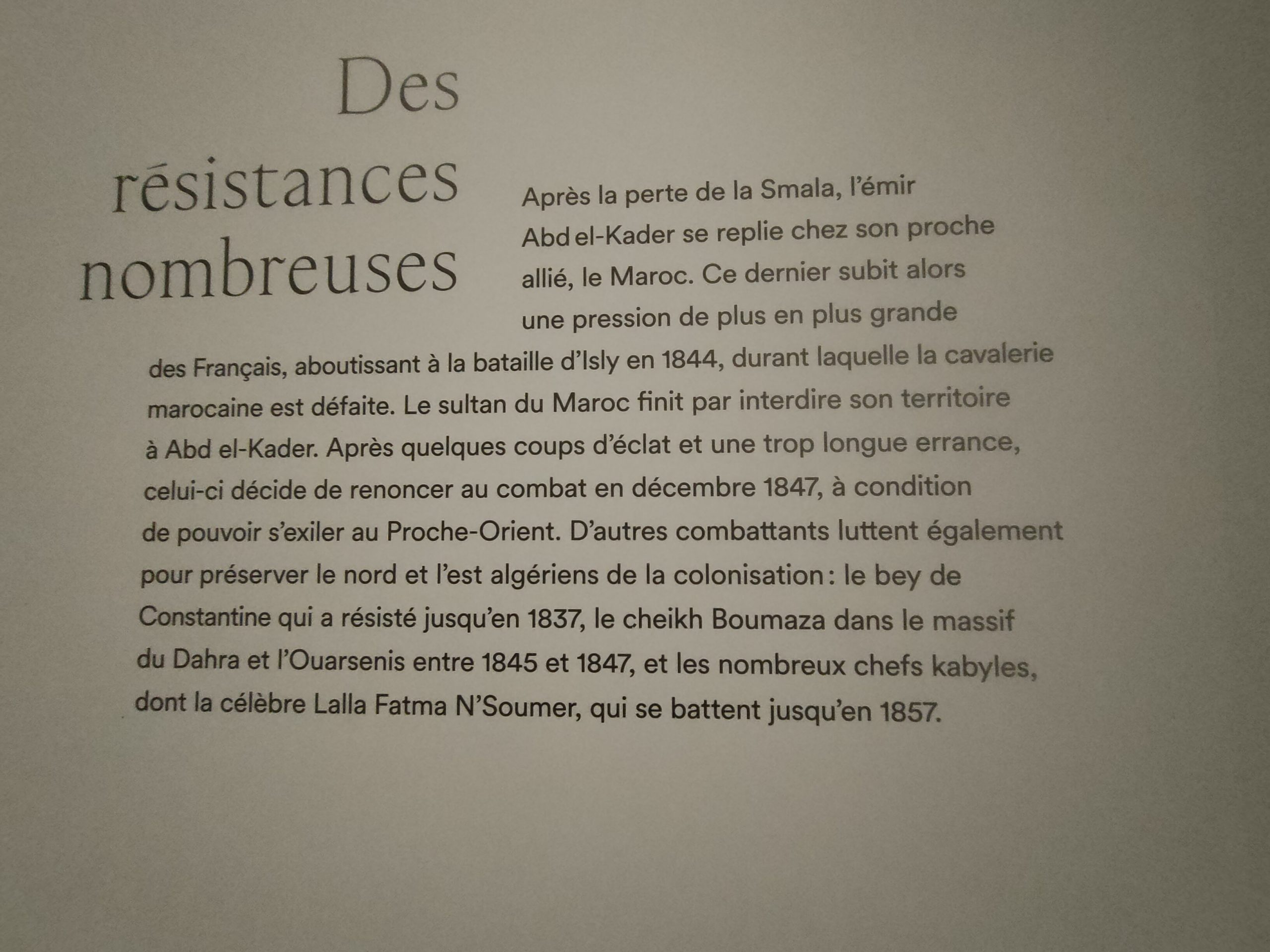

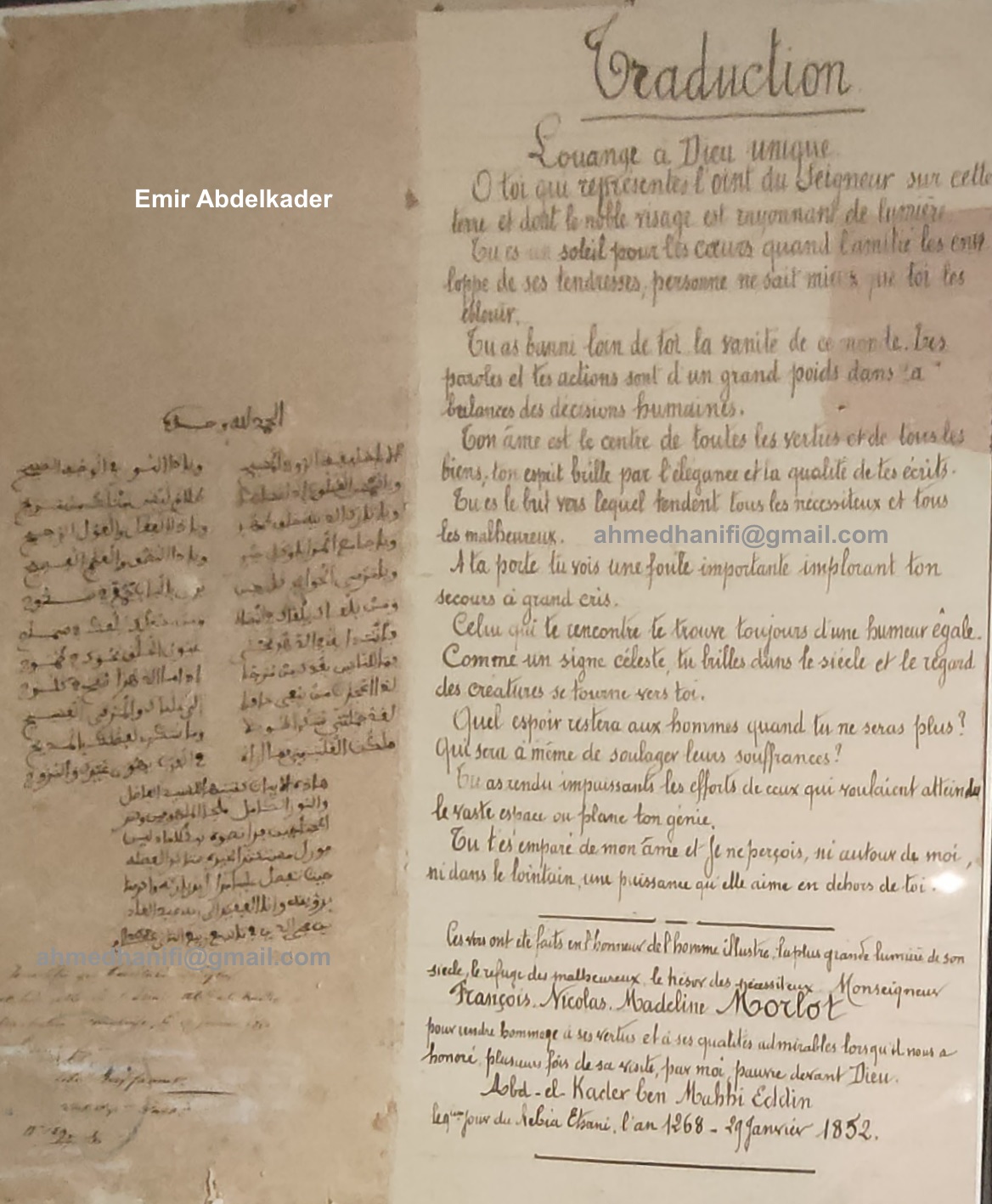



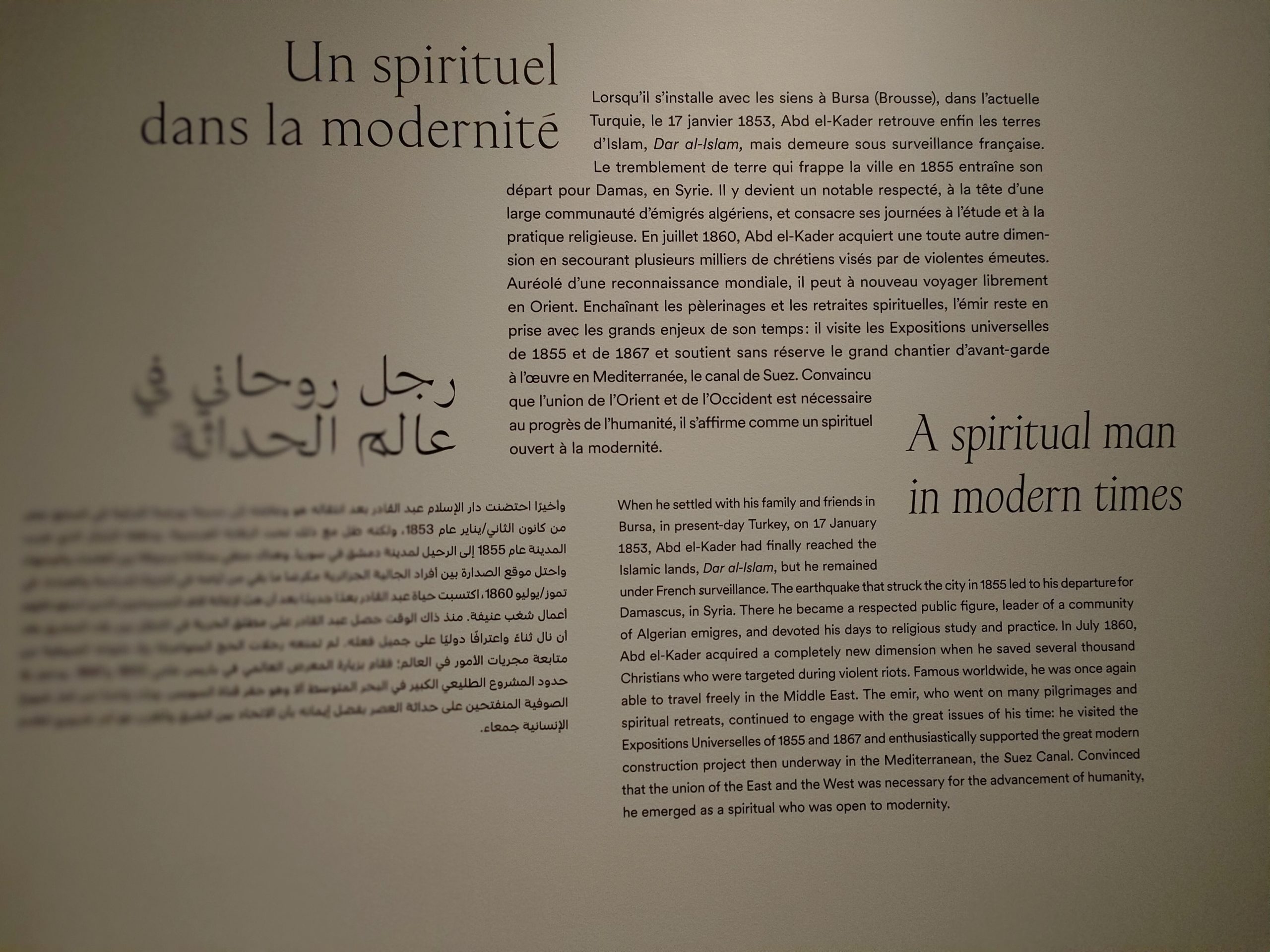

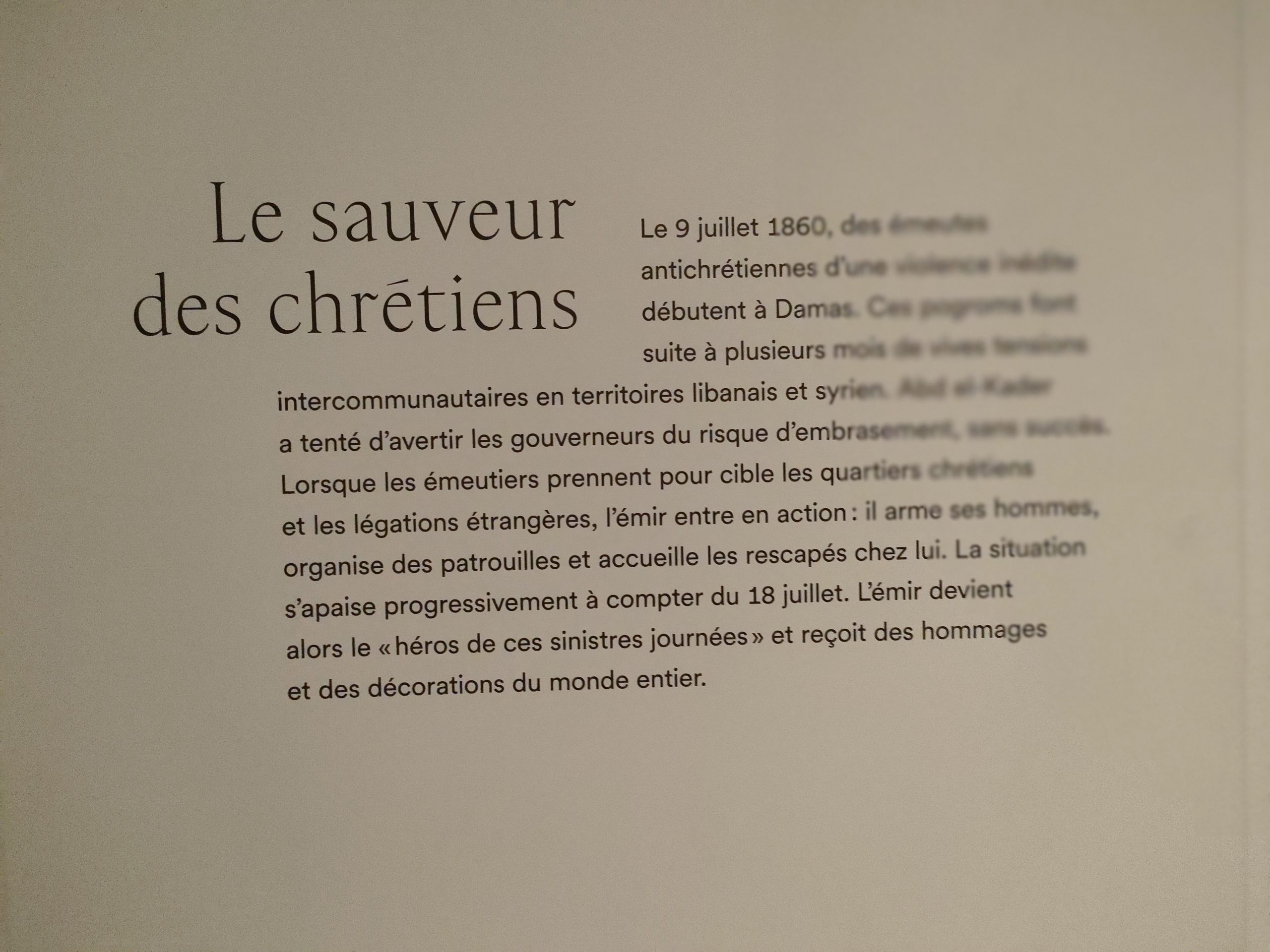




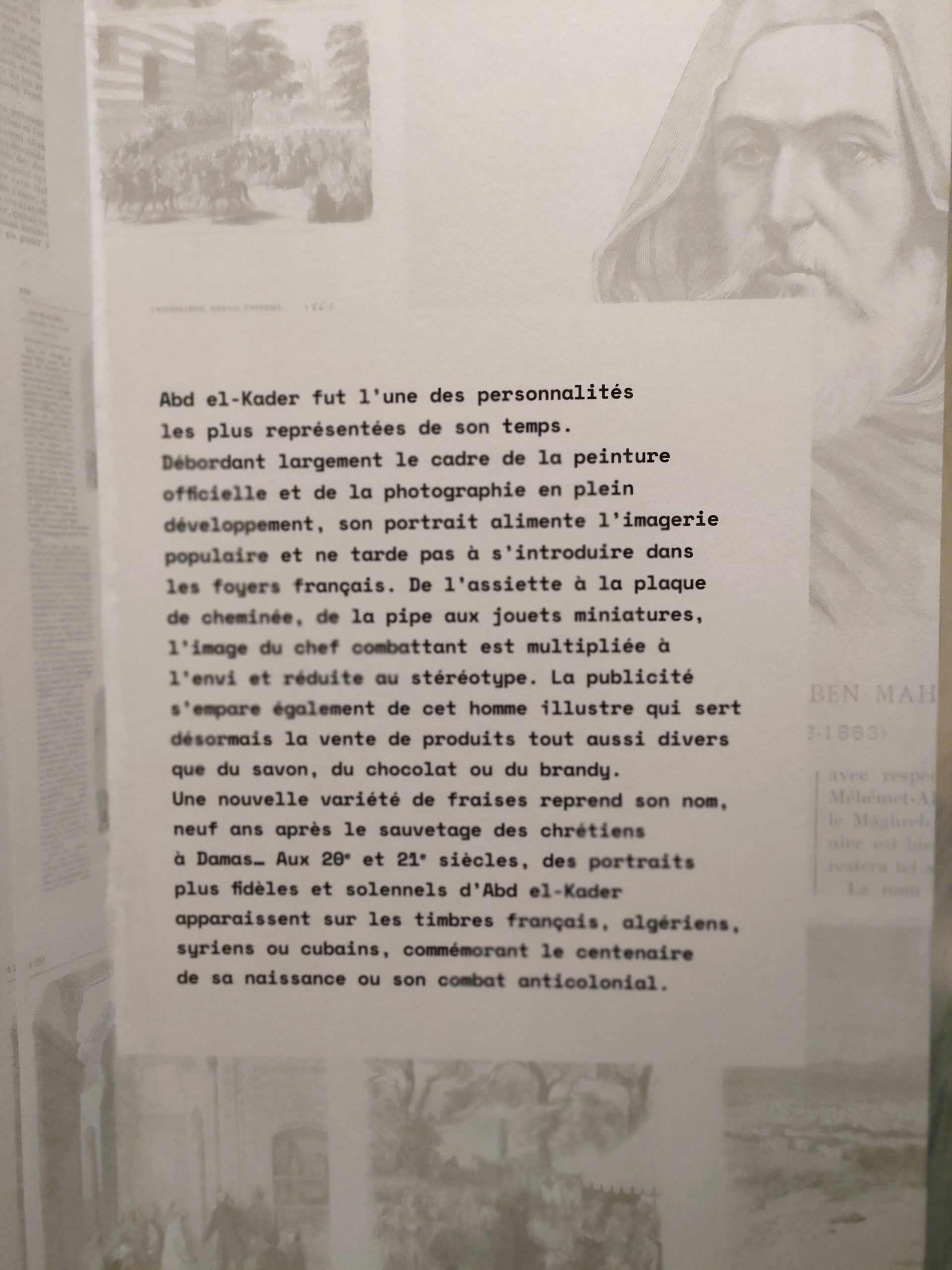
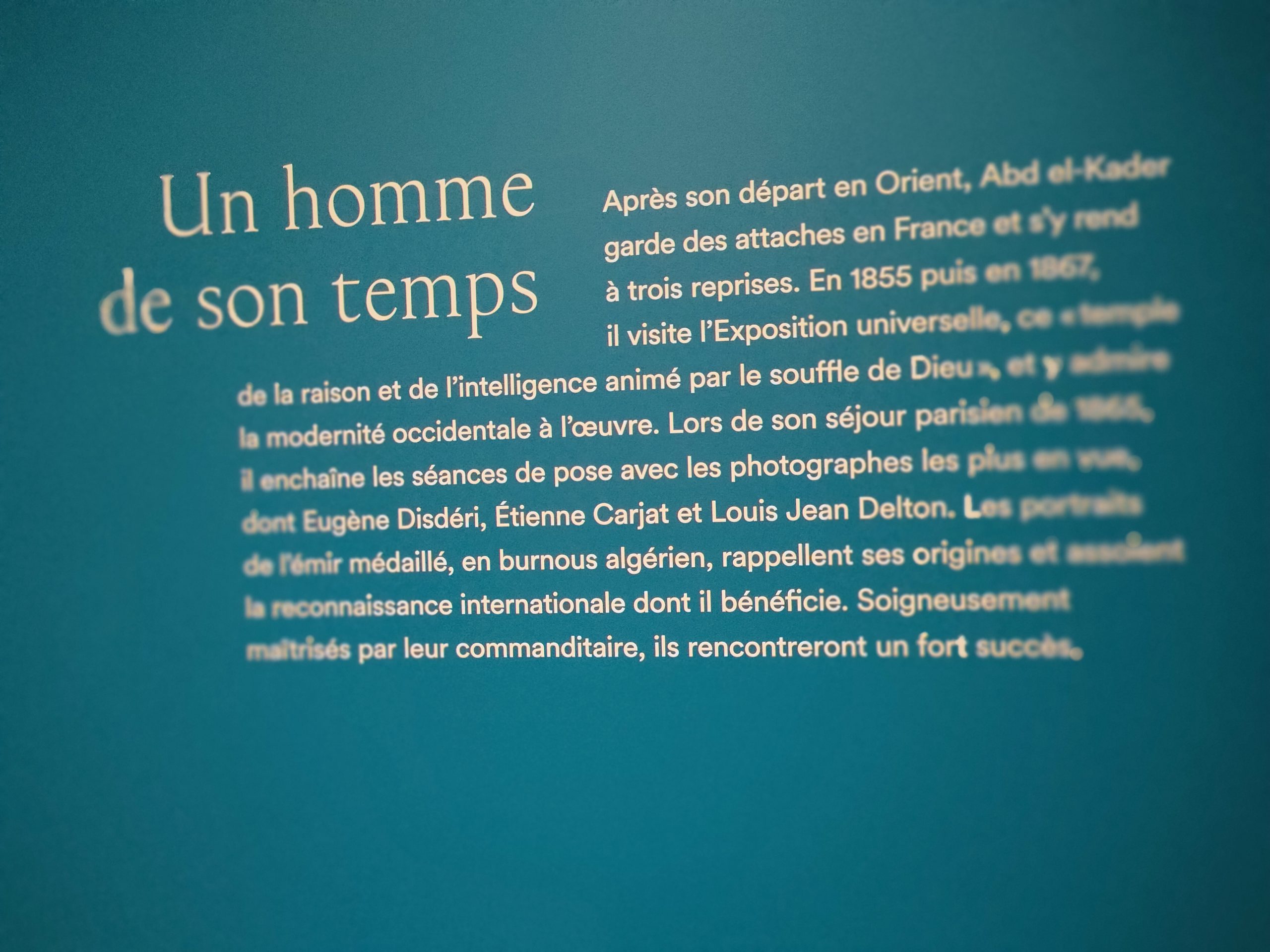
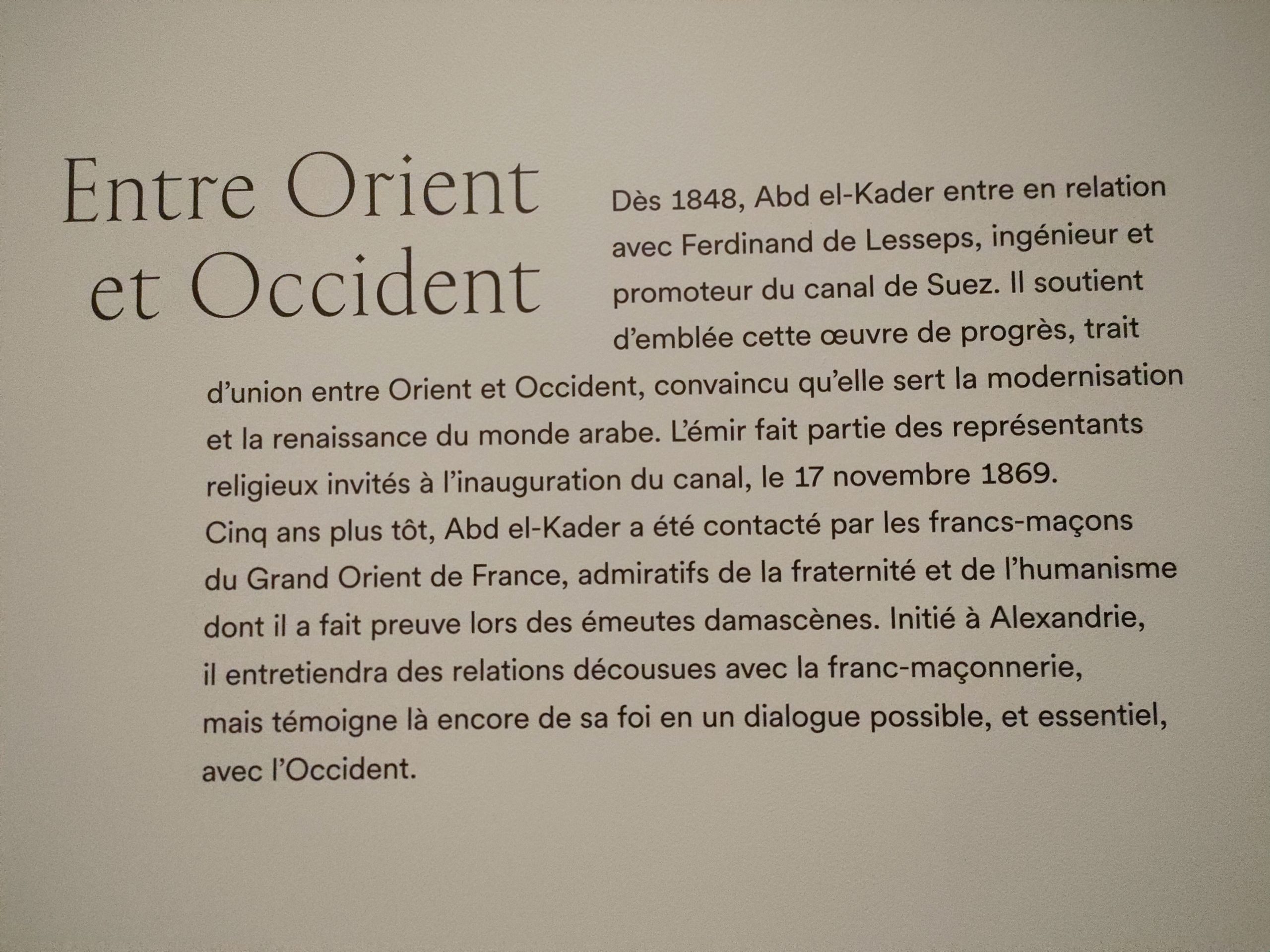

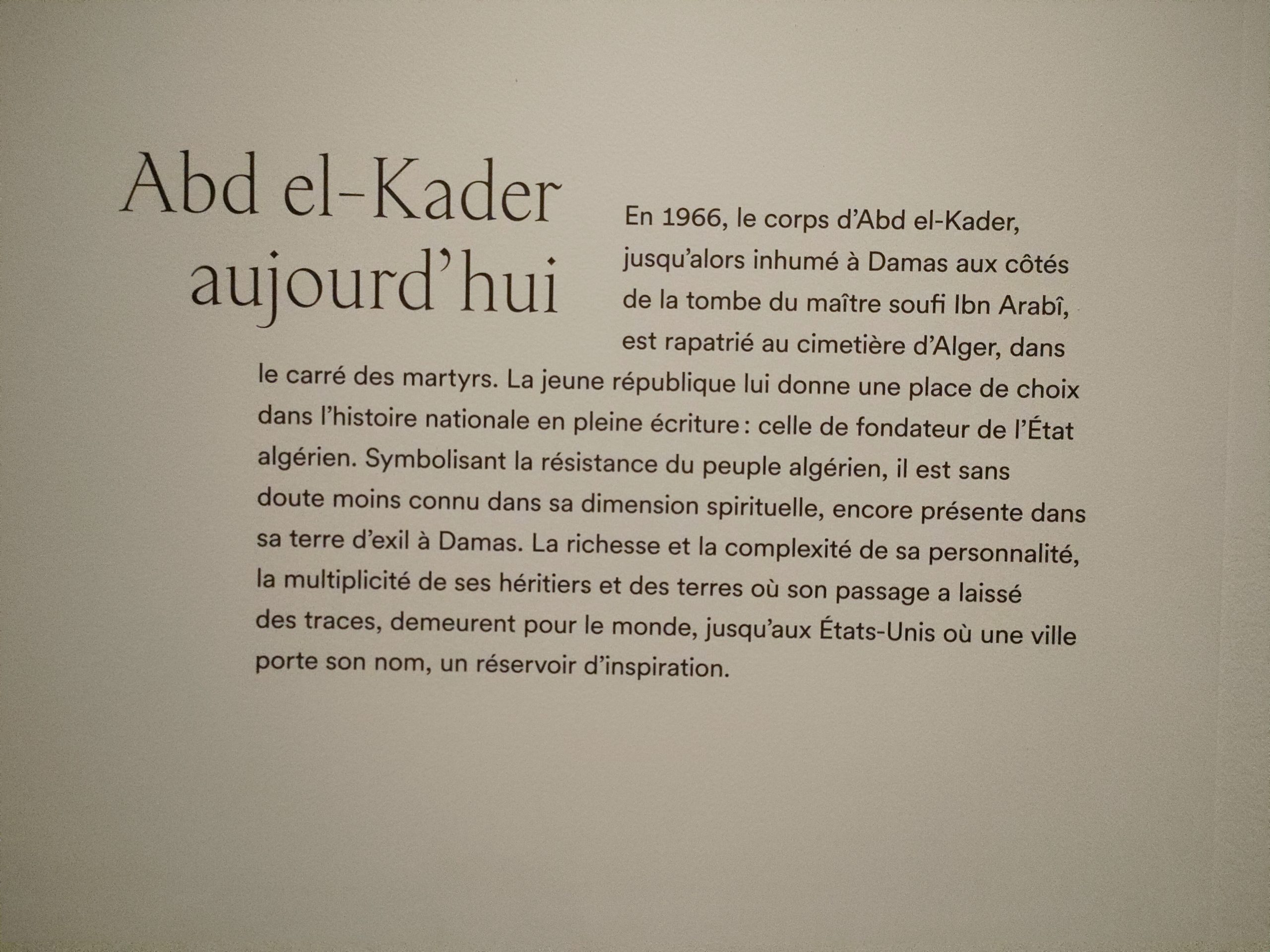
Pour sa propre image, « pour sa gloire » Napoléon III fera de l’Émir un grand ami de la France, alors que l’Émir ne pense qu’à une seule chose, quitter la France. Il s’installe en Turquie, dans la ville de Borsa « Bourse, la ville sainte » qu’il quitte l’année du terrible tremblement de terre en 1855 pour s’installer à Damas, « sur les traces d’Ibn Arabi ». L’Émir Abdelkader meurt en 1883 à Damas où il sera inhumé. Le 6 juillet 1966 ses cendres sont rapatriées en Algérie, au cimetière des Martyrs.


Je n’ai pas vu passer les deux heures dans cette exposition. La 24° journée de ramadan glissa entre mes pensées et mon corps, mais on peut passer quatre heures dans l’exposition, à l’aise, tant il y a à voir, à lire, à apprécier. J’aurais souhaité mille expositions comme celle-ci sur 1001 sujets…. En Algérie même. Ah oui, mais y a le foot l’arrogance et le j’m’en-foutisme, c’est vrai. Hélas.
À Marseille, le 26 avril 2022
+++++++++++++++++++++++
CLIQUER ICI POUR LIRE LA CONFÉRENCE DE KATEB YACINE (il a 17 ans) SUR L’ÉMIR ABDELKADER
+++++++++++++++++++++++
mais aussi : https://www.youtube.com/watch?v=lwQhFyQk0lk
__________________________________

_____________________________________
°°°
CLIQUER ICI POUR VOIR/ENTENDRE VIDÉO FRANCE INTER
°°°
____________________________________
 9
9


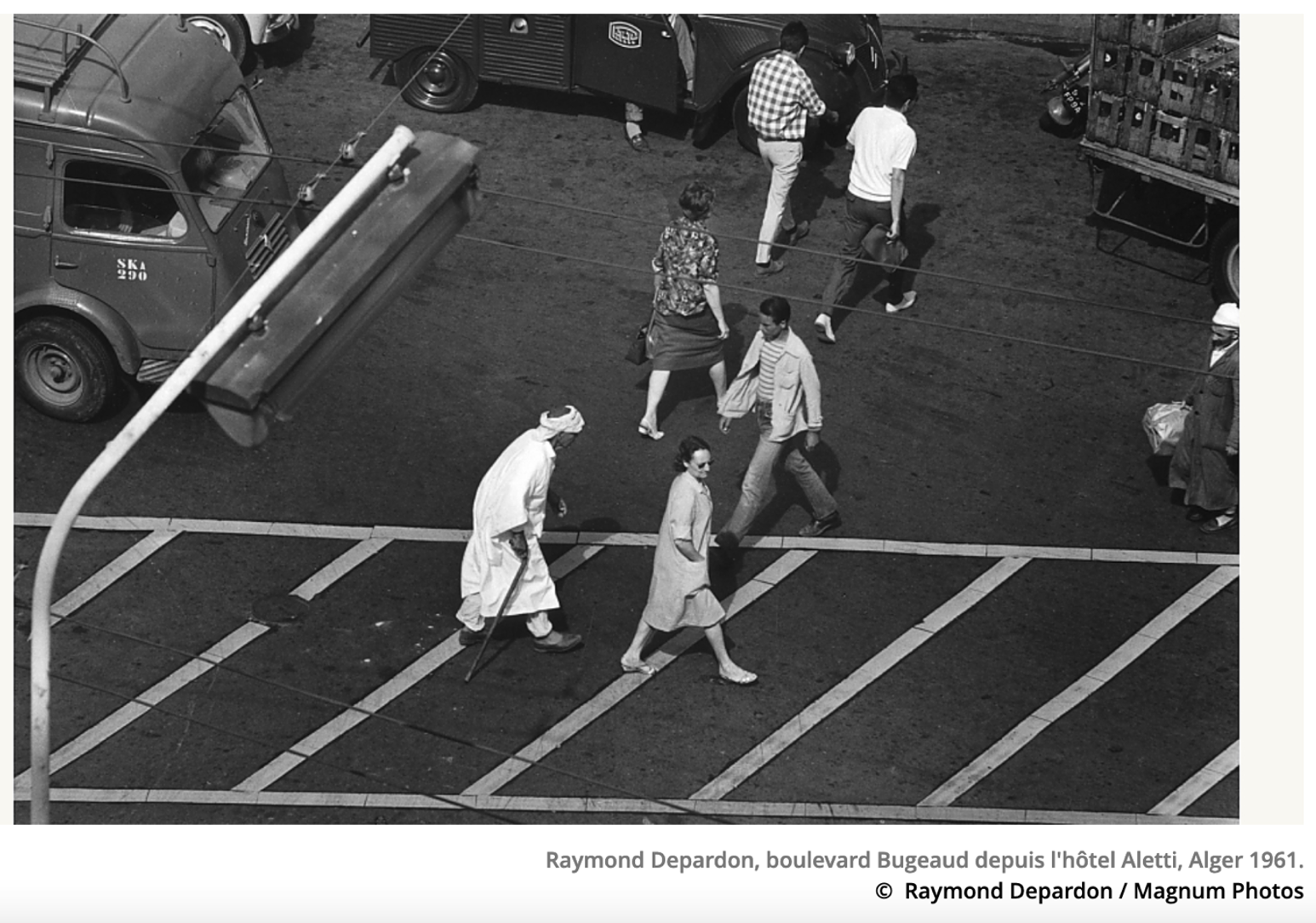
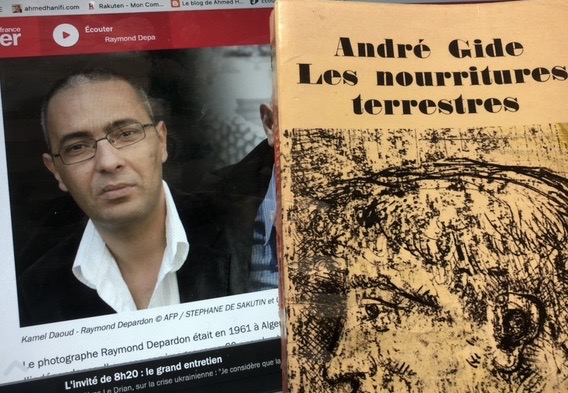


C’est si rare !
___________________________________
par Tiphaine Samoyault
2 février 2022
Il y a plusieurs façons de penser l’émancipation littéraire. Elle peut être un arrachement au contexte et aux normes qui régissent à la fois la langue et un champ, qui prend alors le nom de l’avant-garde ou de l’autonomie. Mais l’émancipation peut être aussi plus radicale, en faisant exploser en même temps le concept d’autonomie par la mise en œuvre d’une lutte qui entraîne avec elle l’idée de littérature et tout le dispositif institutionnel qui la protège.
En devenant mondial, Ulysse s’est arraché à son ancrage national, mais aussi à sa position excentrée. En revanche, en créant autour de lui une nouvelle socialité, il a profondément transformé l’idée d’autorité littéraire.
Je propose de penser que l’œuvre de Joyce renverse par sa langue et sa politique l’idée même d’absolu littéraire alors même qu’en France elle a été placée sous la bannière de ce combat. Si, en situation postcoloniale, Joyce émancipe la langue et la nation, en France il affranchit du message. Pour Tel Quel, qui a le plus contribué à cet éclat français de l’écrivain, un roman de Joyce ne « dit » rien, il s’écrit. Même chose pour Robbe-Grillet. La récente publication de la correspondance croisée du groupe a permis de voir que c’est la lecture d’Ulysse qui conduit Alain Robbe-Grillet à vouloir écrire (il le dit clairement et en détail dans une lettre à Claude Ollier). Dans un entretien radiophonique avec Alain Veinstein en 1988, Claude Simon confie : « j’ai appris à lire dans Joyce et dans Faulkner ». Ce que l’on reconnaît alors à Joyce, c’est que l’équivocité du langage est première, et peu importe si, pour se faire entendre, il faut tendre vers une certaine univocité, que reconnaissent celles et ceux qui, finalement, s’attachent aux personnages.

Sylvia Beach et James Joyce à la librairie Shakespeare & Company au moment de la sortie d’ « Ulysse » (1922) © Courtesy of Princeton University Library
Pourtant, dans une tout autre lecture, l’œuvre de Joyce permet aussi de penser l’autonomie de certaines littératures dominées en offrant une œuvre en perpétuel mouvement, infixable et donc appropriable par tous. Ce livre démystifie, au moins autant qu’il en représente l’idéal, les valeurs de la littérature (les idées de style, d’œuvre achevée, d’original…). Ainsi, il peut instaurer un événement qui a des répercussions infinies et qui, à tout le moins, définit une idée de la littérature qui nous importe aujourd’hui, même si on ne peut pas dire qu’elle prévale tout à fait, et qui renoue avec des formes prémodernes de conceptions du littéraire.
Cet événement, c’est celui de l’œuvre collective ou de ce qu’on peut appeler le collectivisme littéraire. Le texte – je parle essentiellement d’Ulysse mais c’est peut-être plus vrai encore de Finnegans Wake – induit l’action et la participation de plusieurs instances : les lecteurs bien sûr, mais aussi les éditeurs, les traducteurs, les autres écrivains, les institutions, sont invités à participer à la genèse interminable de l’œuvre, à son work in progress.
Cela commence du vivant de Joyce, dès la première publication d’Ulysses, en anglais, à Paris. Cette publication d’un texte hors de son lieu, hors de sa langue, si elle n’est pas un cas unique, a déjà plusieurs conséquences. D’abord, le mouvement de sa traduction commence en même temps que sa publication. Ensuite, il doit être conduit dans les pays anglophones par de nombreux intermédiaires. Enfin, sa rapide interdiction dans les pays de langue anglaise (Grande-Bretagne, États-Unis) oblige à des opérations de diffusion clandestine dans lesquelles de nombreux écrivains sont impliqués jusqu’à la levée de la censure aux États-Unis en 1934 et en Grande-Bretagne en 1936. Il faudrait faire le recensement d’une scène topique, que l’on trouve dans de nombreux récits modernistes américains, de ces jeunes gens rapportant Ulysses dans une valise à double fond. De Henry Roth, qui dans À la merci d’un courant violent(traduit de l’anglais (États-Unis) par Michel Lederer, L’Olivier, 1994) décrit en détail la façon dont il trafique soigneusement sa valise et la sueur dont il se couvre au moment du passage de la douane, à Anthony Burgess, qui dans Little Wilson and Big God (1986), affirme qu’un de ses professeurs l’avait rapporté, caché en morceaux sous ses vêtements, de l’Allemagne pourtant déjà nazie.
La publication partielle aux États-Unis, dans la Little Review, des débuts de la rédaction du roman, avait entraîné un procès pour indécence en 1919, en pleine écriture du roman, puis une interdiction pure et simple, rendant aléatoire une quelconque publication. Cette absence de perspectives d’édition a sans doute eu pour Joyce un effet libérateur qui l’a conduit à radicaliser son projet esthétique, ce qu’ont montré les spécialistes. Tous ces obstacles ont été des aiguillons plutôt que des empêchements. Cela met en évidence une première interaction, au moment même de la genèse de l’œuvre, entre la réception et la production, « à travers un jeu complexe d’anticipations et de faits accomplis, de transgressions et de soumissions », comme l’expliquait Daniel Ferrer en 2001.
Cette censure spectaculaire a entraîné toute une socialité autour du livre qui implique en particulier des femmes courageuses, les éditrices (Margaret Anderson and Jane Heap, rédactrice de la Little Review, Sylvia Beach qui publie le livre en France), des postiers (qui saisissent les numéros de la Little Review après sa première condamnation), des juges, des éditorialistes qui défendent malgré tout le livre ou qui contribuent à le dénoncer de façon virulente alors même qu’il est interdit, les douaniers qui saisissent cinq cents exemplaires de la première publication du livre à Folkestone en 1922 et qui le brûlent immédiatement, les éditeurs qui cherchent à lever la censure sur le livre (aux États-Unis, Random House, en 1932, avec le procès « United States of America vs. One Book Entitled Ulysses by James Joyce »). La puissance de transformation du texte est d’ailleurs soulignée à ce propos : « Avoir été interdit a joué un rôle important dans le caractère transformateur du roman de Joyce. Ulysse n’a pas seulement changé le cours de la littérature du siècle qui a suivi, mais la définition de la littérature aux yeux de la loi [1]. » En particulier, la définition que l’on donne de l’obscène ou du pornographique qui n’en sont plus aux yeux de la loi lorsque les scènes ne sont pas intentionnellement « aphrodisiaques ».
James Joyce (vers 1920) © D.R.
On voit ici comment un vide (l’absence du livre) appelle un plein, cette socialité nombreuse qui se forme autour d’un livre qui, dans ce cas, produit le phénomène suivant qu’Ulysse est probablement le livre non lu le plus connu à travers le monde. Je veux dire que la proportion de gens qui le connaissent sans l’avoir lu du tout est plus importante que pour les autres classiques mondiaux.
Cette socialité nombreuse qui collectivise l’œuvre, on la retrouve aujourd’hui dans les fameux Bloomsday. Je dis « les » car le 16 juin n’est pas célébré seulement à Dublin, mais à Philadelphie, Melbourne, Montréal, New York et dans bien d’autres endroits du monde pour des événements plus restreints ou plus ciblés. Sur le site touristique « ireland.com », on avance même de façon décomplexée l’argument de la non-lecture : « Même si vous n’avez jamais feuilleté le roman emblématique de James Joyce, Ulysse, vous pouvez toujours profiter du Bloomsday. » Est-ce de la littérature « hors du livre », comme on l’appelle aujourd’hui ? On peut en douter, mais c’est en tout cas une formidable extension du domaine d’action d’un livre qui est, me semble-t-il, une des formes de sa collectivisation, et qui touche l’idée même de littérature.
Philippe Forest en est bien conscient, lui qui rejette entièrement l’idée qu’Ulysse serait un livre illisible et en fait au contraire un livre qui parle à la fois de la vie de celui qui l’écrit et de celui qui le lit, selon le programme donné par le roman lui-même, dans l’épisode « Charybde et Scylla » : « Nous marchions à travers nous-mêmes, rencontrant des valeurs, des spectres, des géants, des vieillards, des jeunes gens, des épouses, des veuves, et de vilains beaux-frères. Mais toujours nous rencontrant nous-mêmes. » Dans Beaucoup de jours, publié pour la première fois aux éditions Cécile Defaut en 2011 et réédité par Gallimard à l’occasion de ce centenaire, Philippe Forest avance au fil des différents chapitres d’Ulysse, les expliquant, les commentant, mais surtout les croisant à la première personne avec ses propres livres, sa propre vie. Il offre ainsi un double guide, à Ulysse et à son œuvre, à la fois lumineux et émouvant, où le voyage d’un seul jour se double de celui de beaucoup de jours. En attendant Nadeau reviendra sur cet ouvrage à l’occasion d’un prochain article sur son dernier roman, Pi Ying Xi. Théâtre d’ombres.
Le numéro de la revue Europe « Joyce/Ulysse/1922 » est passionnant. Outre un entretien avec Philippe Forest qui complète la préface inédite donnée par celui-ci à Beaucoup de jours, il contient une remarquable chronologie d’Ulysse, proposée par Mathieu Jung, coordinateur de l’ensemble du numéro. Dédié à la mémoire de Jacques Aubert, maître d’œuvre de l’édition de Joyce dans la Pléiade et de la traduction de 2004, il contient des textes inédits en français de Mario Praz, d’Evgueni Zamiatine, de Serguei Eisenstein et de Giorgio Manganelli, ainsi que des études éclairantes et subtiles, en particulier de Valérie Bénéjam sur la relation de Joyce à l’antisémitisme, de Pierre Vinclair sur « Les bœufs du soleil » ou encore de Danielle Constantin sur l’imaginaire joycien de Jack Kerouac. Au centre du numéro, deux textes sont consacrés aux enfants de Leopold et Molly Bloom, Rudy (mort à 11 jours) et Milly, et ils résonnent avec les multiples effets générationnels que répercute un centenaire.
in: www.en-attendant-nadeau.fr/2022/02/02/
____________________
°
Poursuivre lecture à propos de JOYCE. Cliquer sur ce lien
°
____________________
°
Autres infos sur JOYCE… Cliquer ici
°
__________________
Voilà une langue, la langue française, qui revendique ses nombreux emprunts aux autres langues et notamment à la langue arabe, avec fierté. Ces emprunts l’enrichissent, la dynamisent. Voilà aussi pourquoi j’aime cette langue qui se revendique de toutes les langues. « Les mots voyagent et réinventent la langue, la vie ».Que deviendrait la langue française si on chassait tous ces immigrés ? tous ces mots immigrés ? Elle s’assècherait, se viderait, mourrait…
FRANCE5 _ LA GRANDE LIBRAIRIE_ 26 janvier 2022, avec Érik Orsenna, Bernard Cerquiglin, Aurore Vincenti et Tonino Benacquista
_______________________________________
°
CLIQUER ICI POUR VOIR LA VIDÉO
°
_______________________________________
Je joins à cet article sur F5, la réaction outrée de Salah Guemriche, postée sur son mur Facebook ce 01 février 2022
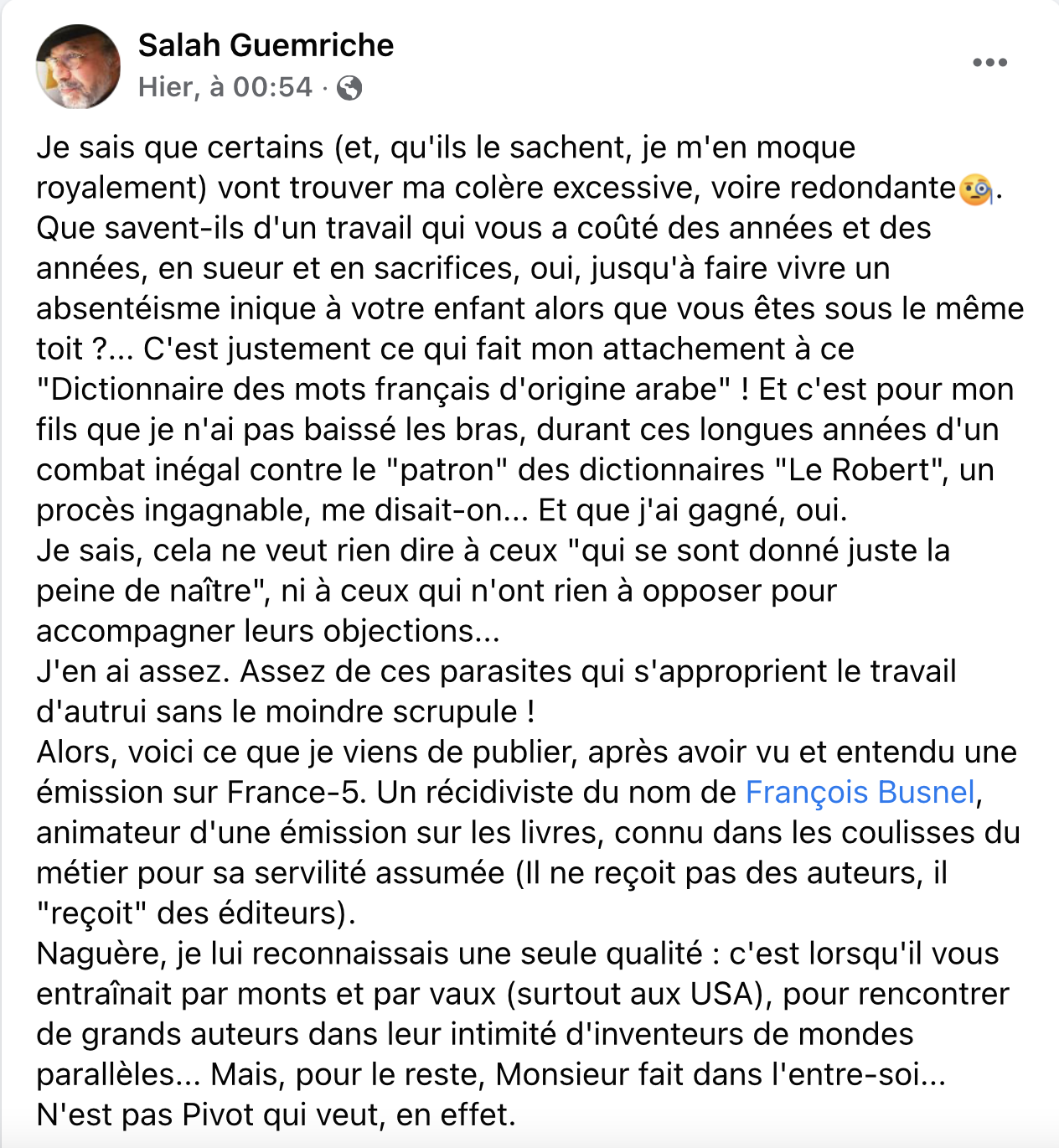
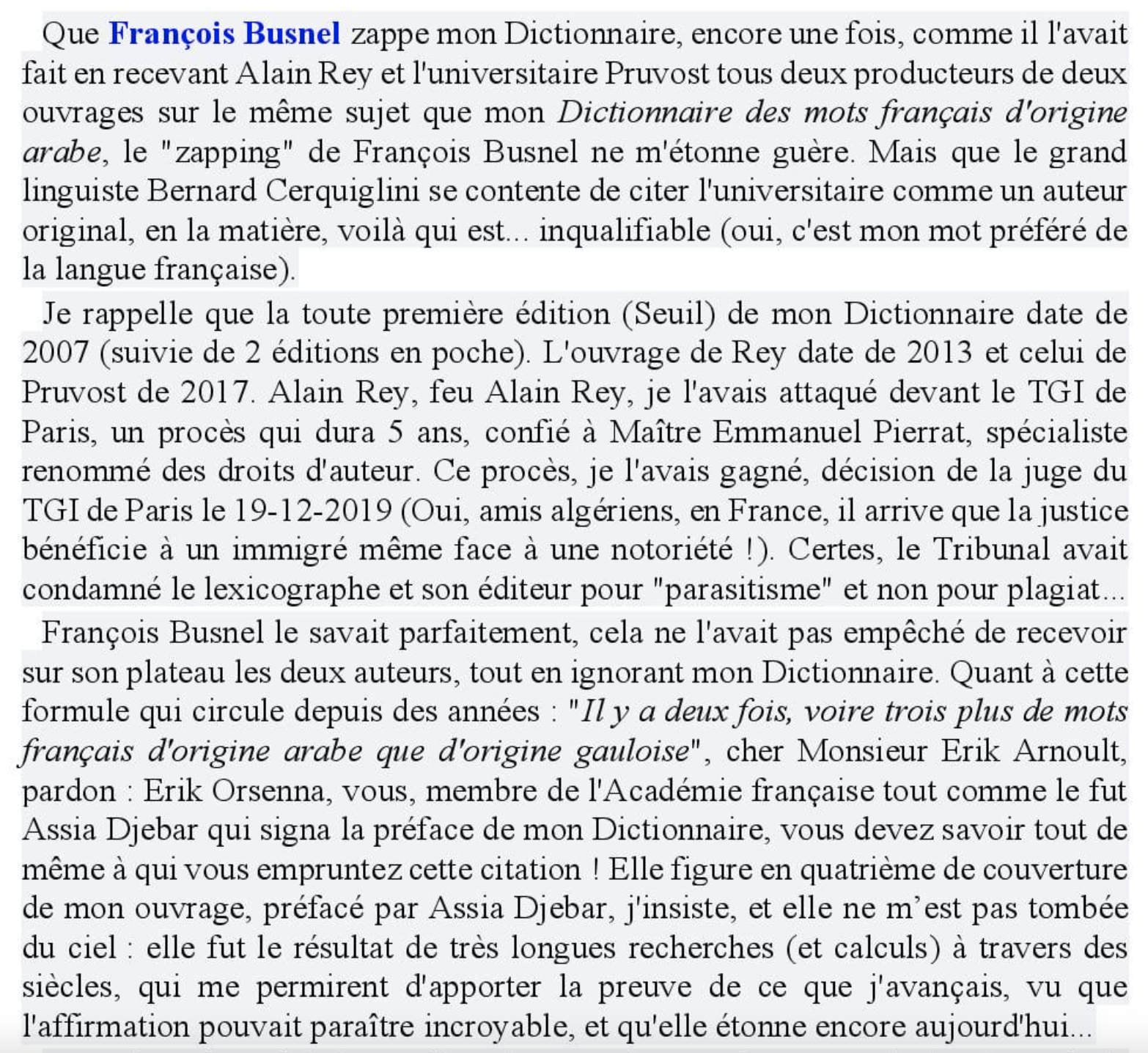
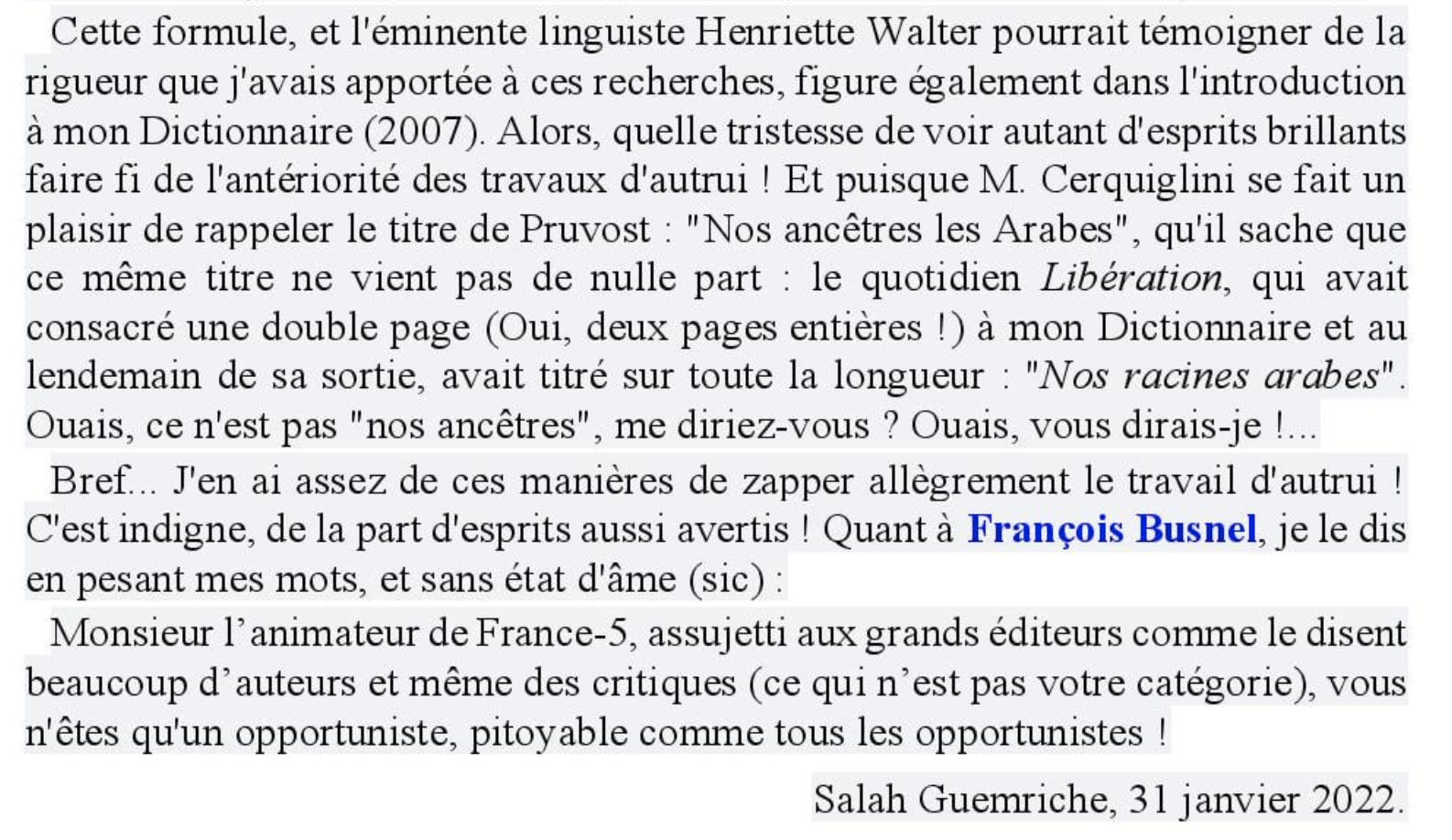
___________________________________
CLIQUER ICI POUR ECOUTER LA VIDEO
______________________________________
Dubaï, Dubaï, Dubaï…
Un article de RFI:
Une chanson israélienne enflamme les réseaux sociaux dans le monde arabe
Publié le 20.01.2022
Texte par : Sami Boikhelifa
Une chanson intitulée « Dubaï, Dubaï », diffusée à la télévision israélienne, a dépassé les frontières de l’État hébreu pour enflammer les réseaux sociaux du monde arabe. Elle a été interprétée par une comédienne israélienne, très engagée aux côtés des Palestiniens. Noam Shuster Eliassi adore faire le buzz. Elle est connue notamment pour avoir demandé en mariage, en 2019, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salman.
De notre correspondant à Jérusalem,
C’est un titre satirique dans lequel Noam Shuster Eliassi critique la normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis. Sur scène, l’artiste israélienne aux multiples talents – comédienne, chanteuse – fait mine d’adresser un message de paix. Le ton est faussement innocent ; le verbe est acerbe.
« Si seulement tous les Arabes étaient comme ceux de Dubaï. […] Riches à millions, ils ont oublié la cause palestinienne et un peuple qui a souffert de la Nakba, dit la chanson. Ils ont oublié que nous imposions un blocus à Gaza. Tout ça pour normaliser leurs relations avec Israël. »
« En Israël, on a choisi d’être gentils avec les Arabes du Golfe »
La chanson est interprétée en arabe avec un peu d’hébreu. Noam Shuster Eliassi parle un excellent arabe. Elle se décrit comme Juive mizrahi, autrement dit Juive orientale. Elle met d’ailleurs en avant ses racines juives iraniennes et défend les Palestiniens : « En Israël, on a choisi d’être gentils avec les Arabes du Golfe, qui sont pourtant à 4 000 kilomètres d’ici. On a choisi de tisser des liens économiques avec eux. Mais en parallèle, nous préférons ignorer la question palestinienne. Et chaque Juif de gauche qui souhaite parler d’égalité, de la fin de l’occupation, est taxé de Juif qui a la haine de soi et qui est anti-israélien. C’est complètement faux. Donc, avoir réussi à faire la lumière sur tous ces sujets à travers un simple sketch, c’est un rêve qui se réalise. »
Sur les réseaux sociaux du monde arabe, beaucoup saluent cette prouesse artistique. « Le sarcasme, une arme redoutable », ont écrit certains internautes opposés à la normalisation des relations entre Israël et les Émirats arabes unis. Noam Shuster Eliassi avoue être ravie d’apprendre que même des Émiriens partagent son point de vue. « J’ai beaucoup d’amis à Dubaï, à Abu Dhabi et dans le Golfe, qui m’ont dit que ma vidéo avait été largement partagée sur WhatsApp, confie-t-elle. Je pense qu’on ne devrait pas sous-estimer la jeunesse dans les pays du Golfe. Moi, je suis une voix critique en Israël, et dans le Golfe aussi il y en a. Peut-être qu’ils n’ont pas le loisir de s’exprimer librement en public. Mais dans la sphère privée, ils peuvent être très critiques. »
De nombreux détracteurs
Toutefois, cette chanson n’a pas fait l’unanimité. Comme souvent sur internet, elle a déclenché une vague de haine et un torrent d’insultes. Certains l’ont prise au premier degré et n’ont pas compris le message de cette artiste israélienne. Ils ont cru qu’elle se moquait de la souffrance des Palestiniens.
Noam Shuster Eliassi dit comprendre leur point de vue : « Je sais que dans le monde arabe, certains peuvent être très sceptiques. Ils se disent : comment une Juive peut s’exprimer de cette manière ? Peut-être que tout cela est orchestré, peut-être que tu es un agent du Mossad ? Et donc, je leur dis : je suis contente d’incarner la différence. Je suis contente d’être une Juive qui parle arabe et qui ne met pas ses compétences au service de l’armée israélienne. Mais qui s’en sert plutôt pour être créative et montrer qu’une alternative est possible ici, dans la région ».
Par Sami Boukhelifa
https://www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20220120
ah. 22 01 2022
____________
______________________________________________________
CLIQUER SUR CE LIEN POUR LIRE LE ROMAN « La plus secrète… » en PDF
______________________________________________________
Ce qui suit est un entretien que Mohammed Mbougar Sarr a accordé à Jeune Afrique
_______________
JEUNE AFRIQUE
CULTURE
30 décembre 2021
Par Clarisse Juompan-Yakam
Mohamed Mbougar Sarr : « La colonisation est une épine plantée dans la chair de l’ancien colonisé »
Sénégal, relations Afrique-France, homosexualité, et surtout littérature… Le Prix Goncourt 2021 a tenu Jeune Afrique en haleine avec une verve réjouissante.
Plus d’une cinquantaine d’interviews avec des médias internationaux tels la Deutsche Welle, le Financial Times ou encore le Guardian ; entre 2500 et 3000 exemplaires de son livre événement dédicacés dans une vingtaine de librairies à travers la France… Mohamed Mbougar Sarr tient ses comptes depuis le 3 novembre, jour de son couronnement par l’Académie Goncourt pour La Plus secrète mémoire des hommes, une enquête étourdissante entre le Sénégal, la France et l’Argentine, sur les traces d’un écrivain disparu des radars, qui questionne le pouvoir de la littérature et le face-à-face entre l’Afrique et l’Occident.
Considéré malgré lui comme un sacré phénomène, l’enfant de Diourbel a pourtant encore de la ressource : mots soupesés – et pas un seul de travers –, propos structuré, il nous tient en haleine durant deux bonnes heures, délivrant son discours sans flottement, avec une douceur et une autorité intimidante. Comme lors de ce savoureux échange de plus d’une heure sur le rôle de la littérature en politique avec christiane Taubira, ex-ministre française de la Justice, argument contre argument, citation contre citation. Un régal.
Fêlures et angoisse
Jeune homme bien dans son époque, mais profondément habité par la littérature, ce fils de médecin a déjà commencé, par petites touches, à constituer « une œuvre honnête », celle, dit-il, dont il n’aura pas à avoir honte. Remarqué dès 2014 après la publication de sa première nouvelle, La Cale, pour laquelle il reçoit le prix Stéphane-Hessel de la jeune écriture francophone, il est révélé en 2015 par Terre ceinte, son premier roman, qui lui vaut le prix Ahmadou-Kourouma puis le Grand Prix du roman métis.
Pourtant, Mohamed Mbougar Sarr confesse quelques fêlures, ainsi que son angoisse, obsessionnelle, de ne pouvoir un jour exprimer ce qu’il veut, de céder à la médiocrité ou de se prendre pour ce qu’il n’est pas. Et ce qu’il n’est pas, Mohamed Mbougar Sarr entend aussi le dire sur le continent, où il envisage d’effectuer une tournée. Une façon de se connecter à sa poésie pour être au plus près de l’esprit humain.
Jeune Afrique : Des polémiques sont apparues après votre couronnement par l’Académie Goncourt. Par exemple, l’un de vos textes, publié en 2013 – vous aviez 23 ans – et décrivant une foule sénégalaise se rendant à un concert de Youssou N’Dour, a été dénoncé comme étant raciste.
Mohamed Mbougar Sarr : J’étais en effet très jeune, mais ce n’est pas une excuse. Je savais déjà ce que j’écrivais. Exhumer de vieux écrits pour confondre leurs auteurs est un procédé classique. Je réalise que la moindre visibilité vous soumet au regard inquisiteur des autres : on fouille dans votre passé à la recherche d’une sorte de vertu ou de pureté absolue. C’est vain. Le texte en question est un exercice de satire et d’autodérision. Je m’inclus dans ceux que je moque. Je suis allé à ce concert que je raille. Lire ce texte au premier degré, c’est manquer son humour et sa distance ironique. Mais je comprends que la négrophobie qui, historiquement, passait aussi par le recours aux stéréotypes, à la caricature et à la satire, a tellement fait souffrir les Noirs que, aujourd’hui encore, diriger une satire – fusse-t-elle littéraire – contre eux est toujours mal perçu. Davantage encore quand l’auteur de la satire est lui-même un Noir. C’était un texte peut-être maladroit, mais, en tant qu’écrivain, je refuse de me cantonner à certains thèmes et genres littéraires parce que je serais noir.
JE DÉFENDS L’IDÉE D’UNE LITTÉRATURE OUVERTE, OÙ TOUS LES IMAGINAIRES TROUVENT LEUR PLACE
Justement, on vous reproche d’écrire pour les Blancs…
Je ne suis pas toujours certain de comprendre ce procès, qui relève plus de l’idéologie et de l’identité que du poétique et du littéraire. J’y sens presque, parfois, un fond de mépris pour les Africains, qu’on peut finir par infantiliser à force de vouloir les particulariser, comme s’ils n’étaient pas en mesure d’être de vrais lecteurs. Que signifierait écrire pour les Africains ? Écrire sur des thèmes africains (à supposer qu’on sache ce que seraient ces thèmes) ? Écrire dans des langues africaines (étant entendu qu’il ne suffirait pas d’écrire dans ces langues pour être lu des Africains) ? Je défends l’idée d’une littérature ouverte, où tous les imaginaires trouvent leur place. Je suis africain, sénégalais, sérère. Mon imaginaire l’est tout autant et, qu’on le veuille ou non, cela ressurgit dans mes textes.
Votre roman De purs hommes, qui traite de l’homosexualité et de l’homophobie au Sénégal, a reçu de l’association Verte Fontaine et des éditions du Frigo, le « Prix du Roman gay », ce qui vous a valu les foudres de certains sur les réseaux sociaux et sur le continent, où ces sujets dérangent. C’est un cadeau empoisonné ?
Je trouve étrange qu’il arrive maintenant, pour un roman paru il y a trois ans. J’ai été surpris mais cela m’a aussi fait sourire: le prix Goncourt produit de pareils effets : beaucoup en veulent un morceau.
Vous ne le reniez pas ?
Au fond, ce prix m’indiffère, mais je me serais bien passé de la polémique qu’il a générée, qui me prête des intentions invraisemblables et m’éloigne de la littérature. [Il a été accusé d’être sous l’influence des lobbys LGBTQIA+, ndlr]. Désormais, quelle que soit la position que j’adopte, elle pourrait m’être reprochée par quelques-uns. C’est la rançon de la surexposition médiatique. Je dois accepter de vivre avec, c’est-à-dire, ne pas répondre à toutes les polémiques, refuser de comparaître devant tous les tribunaux institués pour clarifier des positions. Mon tribunal, c’est ma conscience. Mes juges, ce sont mes livres. Je voudrais demeurer un écrivain, quelqu’un assume ces moments de tensions créés par le langage littéraire, lequel est subtil, ambigu, fait de malentendus. Cette ambiguïté, dérangeante pour certains, moi m’intéresse.
Avez-vous été blessé par ces attaques ?
Certaines, violentes, étaient dirigées contre ma famille. Elles me touchent, mais ne m’ébranlent pas. J’essaie de comprendre les logiques profondes de ces réactions, mêmes les plus abjectes d’entre elles. Écrire, c’est prendre le risque d’être jugé et incompris. Je ne suis pas le premier écrivain dans cette situation. Je ne serai pas le dernier. Je remercie en tout cas toutes les personnes qui ont défendu la liberté de créer et de s’emparer de tous les sujets dans une perspective romanesque. Il ne s’agissait pas seulement d’un lynchage : il y a aussi eu débat, et il dépassait ma personne pour toucher à des principes.
N’y-a-t-il pas un décalage entre la réalité et les tabous que sont pour la société sénégalaise la sexualité, l’homosexualité, l’avortement ?
Comme la plupart des sociétés africaines, la société sénégalaise a été brutalement projetée dans la mondialisation. Les grandes questions sociétales se posent désormais à elle dans des termes qui lui sont étrangers. Par exemple, lors de la parution de De purs hommes, certains m’ont soutenu que « l’homosexualité [venait] de l’extérieur. » Or les études scientifiques prouvent qu’elle a toujours été présente sur le continent. Mais comment étaient-elles présentes ? Sous quel mode ? Là est la question. En réalité, les sociétés africaines ont toujours su intégrer toutes les minorités. Elles ont toujours eu des structures et stratagèmes d’intelligence sociale, que les colonisations ont précisément détruites. Aujourd’hui, parce qu’il y a ce contact avec l’extérieur, européen ou arabo-musulman, l’homosexualité devient paradoxalement un tabou, là où, à une époque, elle était digérée par un génie social, culturel et traditionnel africain. Aujourd’hui, suivant des logiques occidentales, et de façon brutale, on soulève la question de sa dépénalisation. Cela provoque des crispations au sein des populations, persuadées qu’on veut leur imposer un modèle de société. On en arrive ainsi à des violences homophobes.
N’est-ce pas assez hypocrite ?
Les choses se savent, se vivent, mais ne doivent surtout ni se dire ni s’écrire. C’est la définition la plus exacte de l’hypocrisie : savoir et ne pas vouloir se l’entendre dire.
Dans La plus secrète mémoire des hommes, vous racontez l’histoire d’un écrivain qui se lance à la poursuite d’un auteur disparu, dont l’unique roman a marqué l’histoire de la littérature africaine et française. Qu’est-ce que ce récit dit de la relation entre l’Afrique et la France ?
Il rappelle un mouvement de civilisation et un moment historique, où le racisme était présent partout, y compris dans la littérature. Racisme et préjugés pesaient alors beaucoup dans l’accueil réservé aux auteurs africains en France. Et Paris seule décidait de la valeur de ces écrivains, les encensant parfois avant de précipiter leur chute. Au-delà de l’histoire de cet écrivain fantôme, je tente de disséquer cette relation complexe entre deux espaces. Le premier, qui a été – s’est crû ou se croit encore – central, s’est arrogé le droit de dominer et coloniser l’autre. Fort de sa position, l’un dénie parfois à l’autre le droit de s’exprimer sur leurs relations, sur lui-même et sur l’ancien colonisateur. J’essaie de montrer comment la colonisation a pu, à travers un personnage d’écrivain, être un espace de domination, d’ambiguïté et d’exclusion, mais aussi d’amour et de relations puissantes. Le récit interroge non seulement les structures de l’échange littéraire africain, mais aussi le face-à-face entre l’Afrique et l’Europe, qui seraient vouées à se regarder en chiens de faïence.
Les deux parties semblent désormais d’accord sur un point : il faut en finir avec ce face-à-face.
Comme je le dis dans le livre, la colonisation est une épine plantée dans la chair du colonisé, et toute la question est de savoir comment continuer à vivre avec cette épine sans plus être obnubilé par elle et en lui ôtant le privilège de nous faire souffrir et d’emprisonner notre mental. Beaucoup s’imaginent qu’il n’y a qu’une seule manière de le faire.
Et quelle serait-elle ?
La rupture, définitive, radicale. Ceux qui la prônent voudraient cesser toute relation avec la France, ce qui est inenvisageable pour la simple raison que le monde est interconnecté. De plus, l’histoire tragique que l’Afrique entretient avec le continent européen a aussi fait naître des histoires individuelles et familiales entre ces deux espaces. Rompre avec l’Europe voudrait alors dire introduire des cassures, des désordres dans les trajectoires des familles, qui sont d’ici et de là-bas. Quelle relation aurait-on alors avec la diaspora ? Il ne faut pas voir les choses de manière abstraite et idéologique. Lutter contre l’impérialisme et le néocolonialisme est une cause noble a priori. Reste à gérer les complexités historiques de la mise en œuvre de ce combat. Il faut aussi admettre qu’il existe d’autres voies, plus apaisées, qui tentent, en établissant le dialogue, de poser des questions qui sont tout aussi radicales dans la mesure où elles touchent au fond des choses. Et ça passe aussi par un déplacement géographique. Tournons-nous, par exemple, davantage vers le continent sud-américain. Identifions ce que nous pourrions avoir d’intéressant à construire ensemble, afin de sortir de la relation exclusive avec l’Europe, qui devient toxique.
LE PANAFRICANISME EST UNE BELLE UTOPIE DIFFICILE À METTRE EN ŒUVRE
Le panafricanisme peut-il être l’une de ces voies ? A-t-il encore un sens ?
Je crois en l’idée. Elle me séduit dans ses expressions individuelles et locales, mais son échec, à l’échelle des grands ensembles, est patent. Même les grandes organisations continentales ne travaillent pas à le faire vivre, et donc échouent à se faire entendre sur des sujets essentiels comme la présence des armées étrangères en Afrique ou le franc CFA. Ces sujets sont portés par des activistes, parfois par des intellectuels, jamais par de grandes institutions politiques. Ce caractère inaudible me conforte dans l’idée que le panafricanisme est une belle utopie difficile à mettre en œuvre. La seule difficulté à voyager librement à l’intérieur même du continent africain pousse au désenchantement.
Beaucoup veulent pourtant que la relation Afrique-Europe évolue.
Tout le monde le veut. Mais il suffit de proposer des solutions pour assister à une levée de boucliers. Dire qu’on veut améliorer les rapports, c’est aussi accepter de prendre en compte l’autre protagoniste. Or c’est cette prise en compte de l’autre qui est vilipendée. Mais il faut se dire qu’on ne change pas une relation seul.
Cet autre, c’est la France. Emmanuel Macron fait-il vraiment ce qu’il faut pour réparer la relation Afrique-France ?
Oui et non. Il fait ce qu’il peut et ce qu’il doit. Son désir, sincère, de faire évoluer la relation n’entre pas en contradiction avec sa volonté, tout aussi sincère, de préserver les intérêts français sur le continent. Il a bien conscience que la relation de jeunes Africains à l’Hexagone change. Et, sans doute parce qu’il appartient à une génération différente de celle de ses prédécesseurs, Emmanuel Macron tente de leur apporter des réponses ou des garanties. Cela ne prend pas toujours les formes les plus pertinentes et ne réussit pas toujours non plus, mais il essaie. Il a multiplié les gestes bien plus qu’aucun autre président français ne l’avait fait avant lui, mais il peut et doit aller plus loin.
La restitution des objets d’art spoliés fait partie de ces gestes censés contribuer à réparer la relation. À ce jour, seuls 28 ont été rendus, sur plus de 90 000 officiellement répertoriés. On est loin du compte.
Ce chiffre peut sembler dérisoire, mais le processus est enclenché. Je préfère retenir les scènes, touchantes, de l’accueil au Bénin des pièces de retour au bercail. Ça continuera. À condition que les États africains n’arrêtent pas de les réclamer. Côté français, il serait souhaitable qu’une loi-cadre voit rapidement le jour.
D’un point de vue philosophique, en quoi est-ce si important que ces objets soient restitués ?
Posez la question aux peuples qui se sont sentis dépossédés de ces figures-là – je dis bien figures. Parler d’objets, comme le dit si bien Felwine Sarr, est une manière anthropologiquement coloniale de nommer des statues. Or, dans nombre de nos cultures, ce sont des sujets vivants ou dépositaires de vies, des ancêtres qu’on voudrait voir revenir. Évidemment, cette dimension spirituelle ou philosophique ne vient pas immédiatement à l’esprit quand on évoque le développement du continent ou la résolution de ses problèmes sociaux les plus élémentaires. Ce n’est pas nier ces autres urgences que de s’en préoccuper.
LA COLÈRE DES JEUNES AFRICAINS N’EST PAS UNIQUEMENT DIRIGÉE CONTRE LA FRANCE, MAIS CONTRE L’IMPÉRIALISME SOUS TOUTES SES FORMES, QUI LES PRIVE DE TOUT HORIZON
Pourquoi le sentiment anti-français semble plus qu’exacerbé en dépit de ces gestes ?
Je ne crois pas en un sentiment antifrançais spécifique. C’est une colère générale, plus diffuse, née de frustrations diverses et d’un désespoir profond, qui englobe la suspicion et la méfiance envers les élites politiques françaises. Il ne serait pas juste de l’en isoler. Il anime surtout les Africains les plus jeunes. Leur colère n’est pas uniquement dirigée contre la France, mais contre l’impérialisme sous toutes ses formes, qui les prive de tout horizon. Une part de ce mécontentement est d’ailleurs orientée contre les élites africaines elles-mêmes, qu’ils tiennent aussi pour responsables de leur désespérance, et va de pair avec le sentiment que le France soutient et parfois légitime les gouvernements qui les oppriment. S’il est souhaitable de discuter sans complaisance avec la France, nous devons aussi prendre nos responsabilités en exprimant clairement nos aspirations politiques et en interpellant nos propres gouvernements. Par exemple, sur le tripatouillage des Constitutions, qui ne relève pas directement du fait colonial…
Quel regard portez-vous sur l’état de la démocratie en Afrique ?
En Afrique de l’Ouest, la région que je connais le mieux, j’ai toujours l’impression qu’on est dans « un régime démocratique de basse intensité », comme dit très justement mon ami Elgas, c’est-à-dire une démocratie de pure forme, où les instruments permettant de la mettre en œuvre concrètement n’existent pas. Nos structures sont là, elles sont anciennes, elles se reproduisent. Il suffit qu’une élection se passe à peu près sans encombre dans un pays pour qu’on salue sa vitalité démocratique et que ses dirigeants s’en vantent alors même que leurs populations ne l’expérimentent pas au quotidien, dans des attitudes citoyennes, dans des débats d’idées, dans l’existence de contre-pouvoir, dans la liberté de la presse. C’est absurde et humiliant.
Le Sénégal ferait partie de ces démocraties au rabais ?
Parce que ses structures de base étaient solides, il a été pendant longtemps été perçu comme un modèle de démocratie. Je m’inquiète de plus en plus des relations entre les différents pouvoirs, entre l’exécutif et le judiciaire, notamment – même si je ne peux nier que la liberté de la presse est une réalité. Les dix dernières années ont vu l’apparition de mouvements citoyens jeunes, forts – critiquables peut-être pour leur absence de projet clair -, qui se sont installés parce que les institutions avaient failli.
J’ESPÈRE FORTEMENT QUE MACKY SALL NE SE REPRÉSENTERA PAS. IL AURAIT AINSI LES COUDÉES FRANCHES POUR MENER À TERME SES DIFFÉRENTS PROJETS POUR LE SÉNÉGAL
Ces mouvements qui sont apparus dans plusieurs pays pourraient donc constituer l’autre terme d’une alternative ?
Je n’aime pas ce terme. Il impose l’idée d’un homme providentiel, prêt à sauver le monde. Finissons-en avec la mythologie du salut. Mais, oui, ces mouvements fournissent des exemples de ce que pourrait être un régime démocratique plus direct. Il faudrait interroger davantage la place du parlementarisme dans nos sociétés. Nos assemblées nationales ont-elles encore du sens ? Je n’en suis pas sûr. Il faudrait réfléchir à des modes de gouvernement ou de distribution des pouvoirs qui engageraient davantage les citoyens et les éduqueraient ainsi à une vie démocratique pleine et entière, vécue sur le plan individuel – ce qui suppose de savoir ce que vivre en citoyen démocrate signifie exactement. Il faudrait partir de la base et ne plus s’enfermer dans des armatures dites démocratiques.
La démocratie implique-t-elle forcément la limitation du nombre de mandats ?
Ce n’est pas le seul critère, mais il est fondamental. J’accorderais bien un satisfecit au Ghana, qui a réglé la question du renouvellement de la classe politique et des mandats à vie, ce qui permet au pays de se consacrer à des sujets essentiels comme la santé, l’éducation, le développement. En Afrique francophone, nous perdons un temps fou parce que nos Constitutions sont fragiles, manipulables avec une facilité désarmante et accablante.
Le président Macky Sall devrait donc s’abstenir de se représenter ?
J’espère fortement qu’il ne se représentera pas. Il aurait ainsi les coudées franches pour mener à terme ses différents projets pour le Sénégal. Pour en avoir discuté avec lui lors de son passage à Paris, je sais qu’il en a un certain nombre. Il lui serait tellement plus simple de s’en occuper s’il était libéré de l’équation du troisième mandat. L’exemple du président Abdoulaye Wade devrait suffire à l’en dissuader. En mars 2021, le président a eu un aperçu de ce dont la jeunesse révoltée est capable, même si cette colère-là n’était pas motivée par son éventuel troisième mandat. La population jeune est si désespérée qu’aller mourir dans la rue lors de manifestations lui semble d’une grande banalité.
Qu’est-ce que le retour des coups d’État au Mali, en Guinée et, dans une certaine mesure, au Tchad inspire au militaire que vous avez failli être ?
Cela m’effraie. Légitimer un coup d’État, c’est oublier la menace d’illégitimité qui pèsera ensuite sur le pouvoir ainsi arraché et qui, tôt ou tard, aura raison de lui. Et, tôt au tard aussi, consacrera une instabilité institutionnelle et militaire. Faire un coup d’État, aussi justifiable soit-il, c’est ouvrir la porte à d’autres coups de force. Que les populations descendent dans la rue pour protester et prendre leur destin en main est appréciable. Mais quand l’armée s’en mêle, c’est toujours inquiétant. Plus encore dans un pays comme le Mali, en proie à la menace terroriste.
Au Sahel, malgré la présence des troupes françaises, on échoue à éradiquer le terrorisme. Pourquoi est-ce si compliqué de venir à bout des insurrections jihadistes ?
C’est un phénomène difficile à circonscrire, à expliquer et à combattre. Les défaillances militaires à elles seules ne peuvent expliquer l’échec de la lutte contre le jihadisme dans cette zone immense, où les frontières compliquent les contrôles et où les modèles de jihadisme diffèrent suivant les pays. Tant qu’il n’y aura pas de réflexion politique élémentaire impliquant que chaque pays africain se sente solidaire du pays menacé, tant qu’on laisse aux autres le soin de s’en occuper, la lutte sera inefficace. Les crises multiples et incessantes du Sahel prouvent que, malgré le G5, il y a un déficit de coopération entre les États. Il faut des actions politiques, militaires et sociales transnationales. Ces crises révèlent aussi la faiblesse de nos armées, lesquelles parviennent pourtant à renverser des chefs d’État.
LES ATTENTATS TERRORISTES RELÈVENT TOUJOURS D’UNE VISION STRATÉGIQUE CLAIRE, AVEC UN PROJET D’OPPOSITION, DE CONQUÊTE ET DE RENVERSEMENT CIVILISATIONNEL
Les insurrections jihadistes posent aussi la question de l’islam politique. Les attentats contre la France étaient-ils un acte de rejet du mode de vie occidental, une riposte aux frappes françaises contre l’État islamique, relèvent-ils d’une pensée stratégique articulée ou d’un simple acte de barbarie ?
Je le dis depuis mon premier roman, Terre Ceinte. Les attentats relèvent toujours d’une vision stratégique claire, avec un projet d’opposition, de conquête et de renversement civilisationnel. C’est aussi cela qui nourrit et fait la force de tous ces mouvements jihadistes autour de l’État islamique. Réduire ces attentats à des représailles, c’est ignorer toute l’idéologie qui se construit depuis de très longues années. Une telle idéologie ne peut se fonder sur la simple idée de représailles. Certes la haine de l’Occident existe et entre dans l’idéologie mais elle ne constitue pas la seule motivation ou le seul principe. Il y a une pensée, structurée, qui peut être de la barbarie. Ça pose des questions philosophiques sur ce que seraient la barbarie, la civilisation ou l’humanité. Reste que les jihadistes sont des êtres humains qui réfléchissent, qui veulent davantage de pouvoir et qui veulent dominer, au même titre que la civilisation occidentale a dominé pendant de longs siècles toute la planète. C’est leur projet et il passe par cet affrontement-là.
Dans Terre Ceinte, il est question de colonisation et de la Shoah. Quel lien établissez-vous entre les deux ? Était-il important de les évoquer dans le même ouvrage sachant que certains n’hésitent pas à se livrer à des batailles mémorielles ?
Il est indécent de parler de concurrence mémorielle. Hiérarchiser les souffrances, les évaluer suivant des critères oiseux, comme la durée, le nombre de morts ou l’exceptionnalité historique, c’est tomber dans le piège de la concurrence des mémoires qui fait perdre de vue le caractère spécifique – le moment historique particulier où ça s’est produit – de toutes ces tragédies, ainsi que les souffrances des individus, qui se valent les unes les autres, dans ces grandes catastrophes humaines. Ces horreurs, qui font honte à toute l’humanité, ne doivent plus arriver et leur mémoire doit être entretenue à cet effet. Il faut donc situer les responsabilités et raconter l’histoire le plus lucidement possible. Chercher à savoir comment cela s’est produit, pourquoi, que faire pour que cela ne se produise plus. De mon point de vue, ce sont ces regards historiques qu’il faut poser tant sur l’esclavage que sur la Shoah et la colonisation.
Vous écrivez en français. La question de la langue peut, elle aussi, se révéler très politique. À votre avis, la francophonie ne consacre-t-elle pas le rapport de domination politique.
La francophonie, c’est d’abord la conscience d’une langue en partage. Disant cela, j’évacue le piège qu’installe le rapport entre centre – la France – et périphérie – les autres pays membres. Personnellement, je ne subis pas ce rapport de domination. Mais, s’il existe, il faut s’en défaire. Le centre de la francophonie de doit pas être en France car le français appartient à plusieurs millions d’autres locuteurs, sans que ceux dont ce n’est pas la langue maternelle soient assujettis aux autres. Je n’ai pas le complexe du français ou devant le Français.
À QUOI SERT UN ESPACE [FRANCOPHONE] S’IL EST IMPOSSIBLE D’Y CIRCULER, Y COMPRIS ENTRE PAYS AFRICAINS ?
Faites-vous allusion à la francophonie culturelle et linguistique?
Il y a une francophonie plus politique et plus institutionnelle qui a du mal à peser. Récemment encore, lors des discussions dans le cadre du comité Mbembe, chargé de réfléchir à la refondation de la relation Afrique-France, la question d’un visa francophone pour faciliter la mobilité s’est encore posée. À quoi sert un espace s’il est impossible d’y circuler, y compris entre pays africains ?
Vous avez déclaré que votre prix est un signal fort adressé à la francophonie.
Il dépasse à la fois ma personne et le livre lui-même. Je ne peux ignorer le symbole qu’il représente. Il doit pouvoir dire à tous les écrivains subsahariens (mais aussi d’ailleurs) d’expression française : « Cette langue est aussi la vôtre, vous pouvez l’utiliser pour écrire des œuvres qui seront saluées. » Mais ça ne doit pas rester un signal exceptionnel. Il ne faudra pas attendre un siècle de plus pour couronner un autre Subsaharien.
Votre roman place en arrière-plan l’écrivain malien Yambo Ouologuem, prix Renaudot 1968 tombé en disgrâce sous des soupçons de plagiat. Avez-vous l’impression de l’avoir réhabilité ?
Je m’inscris dans une grande tradition de personnes qui, en Occident comme sur le continent, ne l’ont jamais abandonné, n’ont jamais voulu l’oublier et qui lui ont consacré au fil des décennies des hommages sous des formes diverses. C’est le cas de l’universitaire Jean-Pierre Orban, qui a ainsi réédité, en 2015, Les Mille et une bibles du sexe. J’ai écrit sur Ouologuem, à ma manière, pour lui payer ma dette, parce qu’il m’a aidé à devenir l’écrivain que je suis. La lecture du Devoir de violence, en particulier, m’a structuré. Si La Plus Secrète Mémoire des hommes peut permettre de relire ses livres sans préjugés, je peux assumer cette forme de réhabilitation-là.
Mais l’avez-vous innocenté ? Selon vous, les auteurs empruntent les uns aux autres, et toute l’histoire de la littérature est celle d’un grand plagiat.
On n’innocente pas un innocent. Il l’était. Parce qu’il concevait la littérature comme un grand espace de jeu à l’intérieur duquel la référence, l’intertextualité et l’hommage occupent une grande place. On n’a pas voulu voir cette inventivité-là, celle des vrais écrivains qui s’autorisent tout dans cet espace réservé. Je reviens sur sa vie pour représenter au monde cet écrivain qui aurait pu construire une œuvre magnifique mais qu’on a perdu parce qu’on lui a dénié le droit d’être singulier. On le lui a dénié parce qu’il s’appelait Ouologuem, c’était à la fin des années 1960, il était jeune, il affichait une insolence qui agaçait autant l’intelligentsia africaine que l’élite culturelle française. On ne lui a pas reconnu le droit de ne pas se plier aux injonctions que les deux bords semblaient lui adresser.
Quels sont les autres auteurs africains qui vous séduisent ?
Ils sont nombreux. Malick Fall, auteur très tôt disparu de La Plaie – récemment réédité par Jimsaan. Il présente quelques similitudes avec Le Devoir de violence. Parus la même année, en 1968, ils sont les œuvres quasi uniques de deux auteurs majeurs, auxquels j’ajouterais Ahmadou Kourouma, auteur de Les Soleils des indépendances. J’apprécie Valentin-Yves Mudimbe, pour ses romans, et, bien sûr, Ken Bugul, qui m’a inspiré le personnage de Siga D dans La Plus Secrète Mémoire des hommes. Boubacar Boris Diop et moi ne partageons pas les mêmes positions idéologiques, mais il reste important pour moi sur le plan de la fiction romanesque. Je suis très proche de Sami Tchak avec qui j’entretiens des relations presque filiales mais aussi très amicales, et dont le roman Hermina a été une source d’inspiration directe. Nous discutons beaucoup de nos goûts littéraires, de ce que nous essayons de faire, de notre travail, des sujets concernant le continent africain, aussi. Je lis de plus en plus Leonora Miano, que je trouve très stimulante, même si je ne partage pas toujours ses idées. Chacune de ses prises de position sur un sujet vous invite toujours à clarifier la vôtre. La liste des écrivains africains que j’admire serait longue. Je vous enverrai un jour, promis, ma bibliothèque idéale africaine, qui inclurait les anglophones et les écrivains du Maghreb.
Et Mongo Beti ?
J’ignore s’il aurait aimé mon roman. Mais il est important pour moi. Il assumait le fait d’être une conscience. Il ne reniait ni ses engagements ni ses prises de position, au prix parfois d’une certaine méchanceté à l’égard de ses confrères. Ses railleries à l’encontre de Camara Laye et Ahmadou Kourouma étaient injustifiées : drôles et féroces, mais un peu faciles.
L’ENGAGEMENT EST TOUJOURS LA RENCONTRE D’UN TEMPÉRAMENT D’AUTEUR ET D’UNE SENSIBILITÉ DE LECTEUR. JAMAIS ABSOLU, IL EST TOUJOURS RELATIF, FRAGMENTAIRE
Et hors du continent, il y a poète, romancier et nouvelliste chilien Roberto Bolano, à qui vous devez le titre de votre roman ?
Oui, il a changé radicalement ma conception de l’écriture en me faisant prendre un tournant décisif, jusqu’à la rédaction de La Plus Secrète Mémoire des hommes. Cela pourrait conforter ceux qui m’accusent d’avoir des « références de Blancs ». C’est ignorer que Sony Labou Tansi s’est inspiré de Gabriel García Márquez, lequel s’est lui-même inspiré des traditions africaines transbordées à Cuba ou à Haïti. Et il existe un « Bolano africain », qui parle du continent comme nul autre. Il situe plusieurs de ses actions dans l’Afrique des années 1980 – 1990, notamment dans Les Détectives sauvages. Son propos sur l’atmosphère d’instabilité politique au Liberia, tout en poésie et sans vision coloniale exotisante, est particulièrement juste, alors qu’il n’y a jamais été. C’est cela la littérature : un voyage, une ouverture, un continent à part qui englobe tous les autres.
Un écrivain doit-il forcément être engagé ?
Oui, au moins dans et pour l’écriture. L’engagement le plus significatif est existentiel. Les grands livres contiennent toujours l’âme et l’esprit de leurs auteurs, qui s’y projettent. Pour ce qui est de l’engagement politique, il ne lui suffit pas à un auteur de le clamer ou de le vouloir pour que son œuvre le révèle. L’engagement est toujours la rencontre d’un tempérament d’auteur et d’une sensibilité de lecteur. Jamais absolu, il est toujours relatif, fragmentaire.
Et quels intellectuels africains admirez-vous ?
Felwine Sarr, pour ses multiples travaux, Achille Mbembe pour l’importance de son œuvre, Fabien Eboussi Boulaga, Cheik Anta Diop, Léopold Sédar Senghor, Sophie Bessis… Au-delà des clivages qu’il peut y avoir entre eux, je les estime. Ma considération n’implique pas une adhésion à leurs idéologiques, mais à l’intérêt que leur pensée ou leur œuvre occupent dans l’histoire des idées. Je peux admirer Souleymane Bachir Diagne aussi bien que Boubacar Boris Diop.
Vous abordez une multitude de thèmes touchant à la littérature. L’édition française en prend pour son grade car vous épinglez les écrivains qui écrivent avec trois mots, la critique pour laquelle tout se vaut, les éditeurs qui fabriquent des produits marketés…
Je force le trait pour attirer l’attention sur l’absence de réelle foi dans la littérature, sur le fait que l’exigence est considérée comme contreproductive car peu commerciale, sur la standardisation et l’uniformisation des œuvres dans le seul but de vendre. C’est une conception éloignée de ce que devrait tenter de faire la littérature : un lieu de connaissances, d’élucidation du monde et de soi, de questionnements toujours plus profonds et plus philosophiques. La littérature doit renoncer uniquement aux clichés – c’est-à-dire à tout ce qui est déjà installé dans une langue donnée – pour tenter de trouver, sous cette langue usuelle et ordinaire, une autre langue, poétique, qui nous interroge mieux, questionne tous les phénomènes du monde en les soumettant à une lumière exigeante. La grande littérature tend vers cette exigence poétique.
L’année 2021 est une année de grande moisson littéraire pour les écrivains africains. Cela préfigure peut-être un âge d’or ?
Il y a toujours eu d’immenses écrivains sur le continent. Peut-être les institutions littéraires se rendent-elles compte que leurs palmarès présentent quelques anomalies et cherchent à découvrir et à mettre en avant cette littérature. Ce n’est pas simplement pour obéir au politiquement correct. Tous les livres primés sont indéniablement de belles œuvres. On arrive peut-être à une époque où, massivement, les œuvres sont reconnues sans que cela ressemble de façon trop évidente à des calculs équilibristes visant à contenter tout le monde. Ces récompenses s’inscrivent dans un moment qui me semble être celui de l’effort fait sur le continent pour la promotion de la littérature. Et ça passe notamment par la création de maisons d’édition qui tentent de se structurer par la création de prix littéraires. Comme le prix Ivoire, qui s’installe dans le paysage. En somme, l’institution littéraire africaine, bien qu’encore balbutiante, fait un mouvement qui, par un jeu de domino, finit aussi par se répercuter dans les grandes institutions internationales. Il faut souhaiter que ça se poursuive.
Comment avez-vous reçu la petite phrase du président de l’Académie Goncourt, Didier Decoin, soulignant les « tournures africaines » de certaines de vos phrases ?
C’était sans doute une petite maladresse, mais sans malice. Didier Decoin a aussitôt ramené le livre vers la littérature et l’a bellement défendu comme œuvre littéraire. Mais au-delà de ce petit épisode, plus généralement, je constate qu’il y a parfois une sorte de malaise à parler en Occident des œuvres d’Africains. L’imaginaire colonial pèse encore sur le langage de l’évaluation, de la description, du jugement de leurs créations.
En 2000, Robert Sabatier, alors membre du jury Goncourt, avait déclaré que le prix n’avait pas été attribué à Ahmadou Kourouma du fait de « ses manières trop africaines ».
Oui, il subsiste parfois dans l’inconscient un arrière-fond douteux. On a des mots qui ne veulent rien dire, ou qui disent tout. Et affirmer que Kourouma a été privé de Goncourt pour cela est profondément scandaleux. En vingt ans, les choses ont évolué. De tels propos ne peuvent plus être tenus aujourd’hui.
L’UNIVERSITÉ FRANÇAISE EST RESTÉE BLOQUÉE SUR QUELQUES NOMS DE LA LITTÉRATURE AFRICAINE ET SUR LES ANNÉES 1970, 1980 ET, PEUT-ÊTRE, 1990
Ces malentendus tiennent peut-être aussi au peu de place que les universités françaises accordent à l’enseignement de la littérature africaine ?
Elles accusent un grand retard dans ce domaine. L’université française est restée bloquée sur quelques noms et sur les années 1970, 1980 et, peut-être, 1990. Elle ignore assez nettement les auteurs contemporains. Si certains font l’objet de thèses individuelles, leurs œuvres ne sont quasiment pas enseignées, ce qui contribue à alimenter encore un peu plus les préjugés dont elles sont victimes.
Et comment accéder à la postérité dans ces conditions ?
C’est une question difficile sous tous les cieux. Tous les écrivains se la posent, sans doute avec angoisse, parce qu’ils ne sont pas assurés de survivre, finalement. Chez les écrivains africains, la préoccupation est double car se pose aussi la question de leur survie dans leur pays d’origine. Ils demeurent dans la mémoire comme des figures importantes. Pour autant, sont-ils lus, sont-ils encore vivants à travers leurs œuvres, celles-ci sont-elles réactualisées ? Appréhende-t-on toute la complexité de leur pensée si les mêmes analyses, les mêmes interprétations et les mêmes cours sont délivrés au fil des décennies ? Pas si sûr.
LA MUSIQUE D’OMAR PENE, C’EST LE RIRE DE DÉMOCRITE ET LES PLEURS D’HÉRACLITE. J’AI TOUJOURS L’IMPRESSION, EN L’ÉCOUTANT, QU’IL SAIT EXACTEMENT CE QUE JE RESSENS
La musique du Sénégalais Omar Pene a accompagné l’écriture de votre dernier roman. Il y a chez lui quelque chose de profondément mélancolique. Qu’est-ce que ça dit de vous ?
Même lorsqu’elle est rythmée, gaie, sa musique conserve un fond de mélancolie. Ce n’est pas tout à fait de la tristesse, ni de la noirceur, mais elle nous touche et nous rappelle que notre rapport au monde est toujours structuré par l’intuition d’un manque, une promesse qui nous attend, une chose vers laquelle nous nous dirigeons et que nous n’attendons pas toujours. Sa musique exprime cet état d’attente, de désir, d’impuissance. Elle rend triste et joyeux à la fois. Ce sont les deux faces de la mélancolie déjà bien représentée par les tableaux métaphoriques de Démocrite (le rire) et d’Héraclite (pleurs). La musique d’Omar Pene, c’est le rire de Démocrite et les pleurs d’Héraclite. J’ai toujours l’impression, en l’écoutant, qu’il sait exactement ce que je ressens et qu’il l’exprime très simplement.
Ce prix change-t-il votre vie ?
Certainement. Ça change le regard des gens sur moi. Mais pas mon rapport à la littérature et à l’écriture. J’essaierai de suivre les principes que je me suis fixés et la complexité que je tente d’introduire dans chacun que mes livres. Je suis un écrivain et j’entends bien le rester.
——–
La bibliothèque de l’Alcazar à Marseille a accueilli ce samedi 11 décembre à 17h-20h, la romancière et scénariste Faïza GUÈNE pour parler de son roman « La discrétion » (Plon, 08.2020). Elle a répondu aux question de Soraya Guendouz (qui est chargée de mission et organisatrice au centre de ressources Approches Cultures & Territoires (ACT). Durant la soirée, des extraits du roman de Faïza Guène ont été lus par Nora Maknouche (qui est éditrice chez Cris écrits et présidente de la librairie associative Transit). Il y eut ensuite les questions du public (une centaine de personnes).
______________________________________________________________________
°°
CLIQUER ICI VOIR LA VIDÉO « Faïza Guène à l’Alcazar de Marseille »
°°
_______________________________________________________________________
À PROPOS DE SON ROMAN:
La Discrétion, le dernier roman de Faïza Guène
Faïza Guène, La Discrétion (Plon, août 2020)
C’est plus un compte rendu (long) de lecture qu’une académique recension du livre de Faïza Guène, La Discrétion (Plon, août 2020) que je vous propose ci-après.
Voici un livre qui, quelque part, me réconcilie avec moi-même, avec mon passé, mon présent, ici en France. J’ai trouvé un certain réconfort à la lecture de ce roman qui dépeint « une famille française » et algérienne et musulmane, pleine d’une histoire chargée, de noms, de culture, de présent dont le pays, la France, n’a d’autre choix – si elle veut sérieusement incarner comme elle le proclame sur tous les frontons l’égalité, la fraternité – que de reconnaître, de revendiquer même, de prendre cette famille (et toutes les autres familles maghrébines) comme elle est, avec ses complexités. De lui attribuer les mêmes droits et d’attendre d’elle de se plier aux mêmes devoirs que tous les autres citoyens, ni plus, ni moins. Le pays doit s’abstenir de vouloir continuer d’« effacer » une part de ces hommes et femmes qui participent à sa construction, de leur soustraire une part de leur être profond. Si la France a procédé ainsi avec les anciens qui se sont éreintés dans les chantiers dans la discrétion, dans le silence, dans l’effacement, elle devra, pour son propre devenir national, écouter les enfants de ces êtres oubliés et plus encore leurs petits-enfants qui donnent de la voix sans complexe aucun pour un égal traitement républicain. Avec raison.
Le roman de Faïza Guène, La Discrétion, est léger et agréable, se lit d’une traite.
La Discrétion est le sixième roman de Faïza Guène. Le premier, Kiffe kiffe demain, est publié en 2004 chez Hachette. Elle a 19 ans. Il aura un grand succès et sera traduit dans plus d’une vingtaine de langues. Deux ans plus tard, elle publie Du rêve pour les oufs (Hachette, 2006), puis Les Gens du Balto (Hachette, 2008), Un homme, ça ne pleure pas (Fayard, 2014), Millénium Blues (Fayard, 2018). La page Faïza Guène de Wikipedia fourmille d’informations et sur l’autrice et sur ses écrits et films, car elle est également scénariste.
Comment se présente le roman ?
La Discrétion est composé de 35 parties que j’ai numérotées (c’est pratique). Il comporte 253 pages. Ce sont de courts chapitres allant de deux à seize pages. Vingt chapitres sont constitués de moins de six pages. Les chapitres 1 et 26 sont ceux qui comportent le plus de pages : 15 chacun.
Au cœur de l’ouvrage, en page 137, entre le 17° et 18° chapitre, Faïza Guène cite Frantz Fanon. « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » (Les Damnés de la terre).
Elle dédie le roman « à ma mère et à toutes nos mères ». En fin d’ouvrage elle renouvelle sa reconnaissance et en ajoute d’autres « À la mémoire de mon père, mort de discrétion… À ma mère, à son cœur qui déborde, à tous les héritiers d’une histoire en fragments, à Djamila Bouhired, à ma fille, à l’unique que j’aime et qui m’a portée… »
La page 9 porte en exergue une citation de James Baldwin extraite de son essai La prochaine fois, le feu. »
Chaque chapitre porte un titre. Et chaque titre porte le nom d’un lieu, du pays (France, Algérie ou Maroc) et l’année du déroulement des faits. Plus le numéro du département lorsqu’il s’agit du territoire français. Un seul titre porte les numéros de départements non français, il s’agit de « Wilaya d’Oran (31), d’Aïn Témouchent (46) et de Tlemcen (13)… »
Quelles sont les communes dont il est question dans les titres (et dans le livre évidemment) ? :
Pour le Maroc : Ahfir.
Pour l’Algérie : douar Atochène, village d’Arbouze, commune d’Aïn Kihal, villes d’Oran, Témouchent, Tlemcen.
Pour la France : Aubervilliers, Bobigny, Les Lilas, Pillac et Paris (plusieurs arrondissements).
23 des 35 titres de chapitres comprennent des noms de villes françaises : Aubervilliers fait l’objet de onze titres, Paris, de huit… Neuf titres comportent les noms de villes algériennes, et trois, marocaines (Ahfir).
Quinze titres portent en sus une précision, ainsi :
« Marché du boulevard de Oujda, (Ahfir, chapitre 8),
« les vacances » (Wilaya d’Oran (31)…, chap. 26),
« Brasserie Le coq français » (Les Lilas, chap. 7),
« Mairie » (Bobigny, chap. 28)
« Chemin des vignes (Bobigny, chap. 15),
« Les jardins familiaux », (Aubervilliers, chap. 21)
« Rue du Moutier », (Aubervilliers, chap. 24)
« Bar Joséphine » (Paris 6°, chap. 29)
« Renault Talisman » (Paris 6°, chap. 3)
« Cabinet de madame Aït Ahmad » (Paris 11°, chap. 31)
« Service stomatologie et chirurgie maxillo-faciale » (Paris 13°, chap. 30)
« Lav-Story » (Paris 18°, chap. 13)
« Impasse saint François » (Paris 18°, chap. 5 et 33)
« Maxi Toys » (Paris 19°, chap. 25)
Le roman déroule une histoire qui s’étend de l’année 1949 à 2020
Les années suivantes ne sont évoquées que par un seul titre : 1949 (chap. 2), 1954 (chap. 4),
1956 (chap. 6), 1959 (chap. 8), 1962 (chap. 10), 1963 (chap. 12), 1964 (chap. 14), 1967 (chap. 16), 1978 (chap. 18), 1990-2000 (chap. 26).
L’année 2018 est évoquée dans trois titres : chap. 1, 3 et 5.
L’année 2019, dans les dix chapitres impairs de 7 à 25
Enfin, l’année 2020 est traitée dans les titres 27 à 33 et le dernier, 35.
Comment sont ventilées les années par chapitre. Les chapitres ne comportent pas de numéro. Je leur en ai attribué un pour la facilité de l’analyse.
Le 1° chapitre s’ouvre sur l’année 2018
Le 2° chapitre renvoie à l’année 1949 (année de naissance de Yamina). Avec le 3° chapitre on revient à 2018. Le 4° se déroule en 1956. Le 5° de nouveau traite de 2018.
Les chapitres impairs suivants : du 7° au 25° se passent en 2019. Chacun d’eux est suivi d’un chapitre pair pour évoquer les années 1959 à 1981 (2019-1959-2019-1962-2019-1963 etc.)
Le chapitre 26 évoque les années 1990-2000.
Les chapitres 27 à 33 se situent en 2020. Le chapitre 34 en 2012 et le dernier, le 35°, en 2020 à Pillac. (C’est la première fois que la famille prend de vraies vacances. « Ils sont émus de se dire qu’ils font partie de l’histoire de France »)
J’ai développé l’analyse ci-dessous en respectant l’étendue temporelle allant de 1949 à 2020.
La quatrième de couverture fait bien de se concentrer sur Yamina, la mère, car elle est au cœur de la famille Taleb et du livre. Tout ou presque se fait, se pense, se positionne à partir d’elle. Yamina, dans l’Algérie en guerre « À peine adolescente, elle a brandi le drapeau de la liberté… » et aujourd’hui en France « Quarante ans plus tard, à Aubervilliers, elle vit dans la discrétion. N’est-ce pas une façon de résister ? »
La question de la liberté, de la dignité, de la résistance face au mépris, à la condescendance, traverse tout le roman. Les enfants de Yamina et de Brahim Taleb sont d’ici, de France aussi, maintenant plus qu’hier. Ils portent en eux une histoire de plusieurs générations, leur histoire, qu’ils revendiquent la tête haute, hic et nunc.
Maintenant que l’architecture du roman est posée, j’en viens au contenu.
Ce compte rendu-rendu je le réalise à partir d’une lecture du roman respectueuse de la ligne du temps (de 1949 à 2020), et non tel qu’il se présente à la lecture au premier abord avec ses chapitres qui vont et viennent d’une année vers une autre, du passé au présent avec plusieurs retours vers telle ou telle autre année du passée pour revenir une nouvelle fois vers 2020.
Le point de départ. Dans une maison en argile, le « tlakht », l’atmosphère est fébrile. Nous sommes en Algérie en 1949 dans le douar d’Atochène. Province de Msirda Fouaga. L’autrice suggère que la guerre a déjà commencé, ce qui n’est pas le cas. « Le soldat est à son 19° mois de mobilisation… » il bouscule une jeune femme enceinte et fait tomber son balluchon… mais elle ne montre pas qu’elle a peur. La peur elle la garde pour elle. « Rahma accouche dans une grande douleur, sa souffrance est telle qu’elle se confond avec la mort ». Le nourrisson s’appelle Yamina.
Quelques années ont passé. À cette époque, en 1954, il était imprudent de dormir dans la cour en été, car « les soldats français pouvaient faire irruption à tout moment ». La précision est inutile, car s’il y a soldats, ils ne peuvent qu’être français. Et puis nous sommes en été et Faïza Guène anticipe la guerre qui ne commencera réellement que l’année suivante, bien après l’automne dans un certain nombre de régions, certainement pas dans une mechta isolée et « sans intérêt » pour les colons et l’État français.
La guerre est déclarée depuis deux ans. La famille fuit le douar à l’aube « sous le regard embrumé de jeddi Ahmed, le grand-père, pour se réfugier au Maroc, à Ahfir, accueillis par la grand-mère de Yamina. Son père est au front. C’est un résistant. Deux des frères de Yamina, sans autre précision, sont nés en exil. Des inconnues passaient voir les réfugiés algériens au Maroc et donnaient des instructions « ne parlez pas de vos maris, de vos frères ».
Yamina a grandi. C’est maintenant une petite fille de dix ans. Des femmes portent d’immenses plateaux de pain à faire cuire. Des enfants cirent des chaussures d’adultes ou mendient. Une fillette, à peine plus âgée que Yamina, mendie. « Personne ne s’arrête pour lui donner une pièce ou un bout de pain. » Yamina a mal à une dent « qui lui donne le vertige ». L’arracheur de dents pratique une médecine ancestrale. Il lui arrache la dent avec « une petite pince de forgeron en métal, non stérilisée. C’est pire que dans le pire des cauchemars. » Pendant 14 ans, jusqu’en 1973, « elle souffrira d’abcès et de migraines, régulièrement. »
Sept ans de guerre ont passé. La famille de Yamina se trouve toujours à Ahfir chez la grand-mère. C’est l’indépendance de l’Algérie. Yamina, 13 ans, « portait une tenue aux couleurs du pays : jupette verte, chemise blanche et cravate rouge. » Yamina n’en avait jamais voulu à sa mère, Rahma, « plutôt froide, voire inaccessible et verrouillée. Yamina avait bien compris que manifester ses sentiments n’était pas une évidence. » Les sentiments demandent de l’espace pour s’exprimer, mais « le problème c’est qu’avec la guerre et la misère, c’est que la guerre et la misère prennent toute la place. » Faïza Guène exprime formidablement bien cette pudeur qui plombe de très nombreux (la majorité ?) Maghrébins. Yamina, tout comme sa mère, se retenait naturellement de déborder. Les émotions restaient coincées à l’intérieur de leur corps. « Le corps ne coopère pas toujours avec le cœur, même si le cœur brûle, exulte, le corps doit rester là, figé, inapte. Ils finissent parfois comme deux étrangers qui ne parlent pas la même langue. »
Yamina a été obligée d’arrêter l’école « pour aider ses parents à la ferme » et élever ses nombreux frères et sœurs dont cinq deviendront des professeurs. Elle en est l’aînée. On ne connaît pas le nom de tous les frères et sœurs de Yamina. Leurs parents sont Rahma et Mohamed Madouri qui vivent à Aïn Témouchent. Dans la fratrie il y a Moussa, Norah, Nabil, Djamila « dernier né des enfants ». Cette dernière porte le prénom d’une révolutionnaire. Plus tard (en mars 2015 ?), Yamina emportera avec elle une photo du journal algérien Liberté sur laquelle on pouvait voir la splendide révolutionnaire Djamila Bouhired, à l’occasion d’une visite officielle en Égypte » en juillet 1962.
La famille est retournée dans le village ancestral d’Arbouze, à Msirda Fouaga. Le figuier de Yamina est mort. Elle se lamente à son pied. La pauvreté est un lot quotidien « Yamina et ses frères ont été longtemps sous-alimentés. » Après l’indépendance, le père est sans emploi et « les gens de la campagne ont tout perdu. » Le père « traîne dans les cafés. » La guerre a volé sa gentillesse et sa sérénité ». Il est devenu violent « et Yamina déteste la violence… Sa mère culpabilise sa fille – « c’est ta faute, tu ne sais pas parler, tu n’es bonne à rien » – qui n’a pu acheter à crédit. « L’épicier refuse de faire crédit, car l’ardoise est trop chargée ». L’année suivante, le choléra a touché plusieurs familles du village. Yamina s’en remet à peine. L’autrice écrit « quelques semaines plus tôt », mais sans préciser la date de référence.
Yamina fuit la tatoueuse du village, « elle n’accepte pas ce tatouage (sur le front), elle refuse d’être marquée à vie ». Faïza Guène fait un hasardeux parallèle entre le front et le front. Elle écrit que le front de Yamina est « son front de libération personnel. Elle le gardera libre jusqu’à la tombe. »
« Une dizaine de familles vivent dans la vieille ferme d’Aïn Kihal », près de Aïn Témouchent. Yamina a 18 ans, « elle a un regard de miel. Elle est belle mais elle ne le sait pas, il n’y a pas de miroir. » Mohamed Madouri, le père de Yamina « a été choisi par ses collègues agriculteurs pour les représenter au Syndicat régional des agriculteurs. C’est un analphabète, mais un orateur doué. » Le travail est dur, « de l’aube à la dernière prière du soir. » Yamina passe une partie de ses journées à coudre. « Elle confectionne des jupons et des robes pour les femmes », mais également et surtout elle « s’occupe de nourrir les animaux, faire le ménage, préparer ses jeunes frères et sœurs pour l’école. » Chaque matin, le vieux voisin, Tayeb, transporte les enfants sur son tracteur jusqu’à l’école, à 5 km.
Le chapitre suivant est long de 22 lignes. Nous sommes en 1978, année de la mort du dictateur Boumediene. Yamina vivait encore en Algérie, « elle eut la sensation que l’Algérie perdait son père. » J’aurais tendance à penser qu’il était plutôt détesté dans cette région frontalière de l’ouest, nonobstant sa politique implacable. Le dictateur était de l’Est et le coup d’État qu’il a mené l’a été contre un président issu d’un de ces villages frontaliers avec le Maroc. Le « régionalisme » est très profond en Algérie et cela est étonnant d’écrire « pour la famille, Boumediene était un sauveur », mais possible.
Yamina a accepté à contre-cœur d’épouser un émigré de dix ans plus âgé qu’elle. Le mariage avec Brahim a lieu à la mairie de la Daïra de Aïn Kihal. Brahim réside en France où Yamina ne veut pas vivre. Mitterrand préside désormais et depuis peu aux destinées de la France. Yamina était devenue « la vieille fille du coin. » Elle ne s’est pas mariée auparavant car son père avait besoin d’elle, elle dont il disait qu’elle « valait au moins les six garçons. »
En juillet de la même année, on organisa une fête chez le frère aîné de Brahim, au 17° étage d’un immeuble du quartier de Bel-Air, à Oran. Les parents de Yamina viennent de quitter les lieux après la fête. « Sur le boulevard, la mère ne s’est pas retournée, son père a levé la tête vers le balcon. Elle se sent abandonnée. » Elle a envie de retourner chez eux, « de tout annuler ».
Ce n’est pas facile de devenir une femme « c’est brusque, elle n’a pas la marche à suivre. »
Yamina passera ici 4 mois avant de rejoindre Brahim. Ils partirent pour la France en août.
Voilà Yamina en France. « Brahim n’a eu que deux semaines pour trouver (grâce à des amis Kabyles) un logement. Jusque-là il a toujours vécu seul dans des foyers de travailleurs, dans des cafés-hôtels, dans des baraquements, dans des préfabriqués, chez des cousins dans les bidonvilles de Nanterre. » Faïza Guène rappelle le rouge octobre 1961, « Brahim se souvient de celui qui n’est jamais revenu, que la police française avait jeté dans la Seine » et la proposition faite par Giscard d’Estaing aux Algériens pour quitter la France « avec cette aide de 10.000 pauvres et pitoyables francs. Une honte plus qu’une aide. » C’était difficile à Brahim de faire oublier l’exil à son épouse. Elle pleurait tout le temps. Il la trouve « tellement douce et gracieuse »
Nous faisons un saut de plus de dix années. Nous sommes dans « la décennie noire » à la fois dans la région d’Oran, de Aïn Témouchent et de Tlemcen. Yamina et Brahim ont quatre enfants dont rien n’a été dit jusque-là, sinon que Omar est né « à la clinique de La Roseraie à Aubervilliers ». Tous nés dans la décennie 80 : Malika est née en 1980, Hannah en 1985, Imane en 1987 et Omar en 1988. Pour Yamina et Brahim « élever des enfants » c’est « avant toute chose, qu’ils ne manquent de rien » Pour les générations suivantes, celles du « bien-être » comme celles de leurs propres filles et fils c’est s’accroupir et parler avec leurs enfants « d’une voix mielleuse en regardant l’enfant dans les yeux ».
Pour Malika, Hannah, Imène et Omar et leurs parents, les vacances c’était en Algérie, une semaine à Oran chez l’oncle et à la mer. « Une ville magnifique Oran, baignée par une lumière qui n’existe nulle part ailleurs. » Hannah se demandait comment faisaient les Oranais pour deviner qu’elle venait de France, « à croire qu’ils ont un détecteur ‘d’immigrés’ ». Le week end ils se rendaient au village de vacances Les Andalouses, ils écoutaient le raï de Cheb Hasni « pourquoi a-t-il été tué, il ne faisait pas de politique ». Puis ils se rendaient à Aïn Témouchent chez les parents de Yamina. « Omar était chanceux ‘comme un garçon’ » Faïza Guène n’explique pas pourquoi « comme un garçon ? »
« À Oran, alors qu’il a 8 ans, Omar demande à son père ‘papa, pourquoi il y a que des Arabes ici ?’ Poser une telle question à 8 ans, cela paraît difficile à croire. Il n’était peut-être jamais venu en Algérie avant 1996 ? Peut-être également que ses parents et ses sœurs ne lui ont rien dit non plus des habitants de ce pays ? En Algérie, l’espace public est largement occupé par les hommes écrit justement l’autrice. « Les femmes sont obligées de trouver des stratagèmes pour se frayer des passages et, furtivement, passer sans trop déranger. » Les vacances familiales s’achevaient à Msirda Fouaga. De Aïn Témouchent à Msrida ils ont mis « 4 heures à saigner le goudron » alors qu’il y a à peine 135 km. Brahim préfère-t-il les pistes à la route nationale ? Dans la mechta de la tante paternelle Fatima, l’aînée, « il n’y avait ni montre, ni miroir, ni télévision ». Cela est difficilement imaginable alors que nous sommes dans les années 1990-2000. « Les enfants n’avaient d’autres activités que de dormir, marcher, grimper aux arbres, attraper des scarabées, monter à dos d’âne. Ils faisaient leurs besoins, avant le coucher de soleil, derrière les cactus, au milieu des poules, pour éviter d’avoir à faire ça en pleine nuit parce que ça leur foutait la trouille toutes ces histoires de vipères et de chacals. L’ennui c’est que les figues de barbarie à longueur de journée ça donne la diarrhée »
Le chapitre suivant évoque les attentats terroristes qui ont pris la France pour cible durant les années 2012 à 2016, et l’angoisse qui saisit les Maghrébins, plus encore les Algériens à cause du climat nauséeux, voire délétère qui les vise périodiquement, eux plus que toute autre communauté, du fait de la guerre d’indépendance. « Les Taleb se soutiennent le front, les yeux hagards, devant les images terribles et les bandeaux qui défilent sous l’écran ». Un attentat. Effroi d’abord puis l’empathie pour les victimes et leurs familles. Et un vœu : « faites que le terroriste ne soit pas un ‘‘Arabe’’. » Exactement comme en cette quinzaine de fin octobre 2020, à la suite de l’assassinat de Samuel Paty le vendredi 16. Quel Algérien n’a pas, au plus profond de lui, imploré « faites que le terroriste ne soit pas un Algérien. » Lorsque le lendemain j’ai appris que l’assassin de l’enseignant n’était ni Algérien, ni Maghrébin, j’ai respiré profondément, très profondément. Il était néanmoins musulman, et une partie de la société, de la classe politique à l’affût, plus encore des médias, particulièrement des commentateurs et invités de la télévision, exigèrent (exigent toujours) des musulmans de se « désolidariser ». Mais je ne suis plus vraiment dans l’analyse. J’y reviens.
« Les enfants Taleb savent qu’ils seront écartés du deuil national. » Ils sont habitués. Ils sont aussitôt rangés du côté des accusés. « On les somme de descendre dans la rue dans un cortège à part. » De sortir du rang pour se désolidariser des terroristes. » Les Taleb, réunis en famille comme tous les samedis, parlent de la tragédie. Ils se demandent s’il leur faut chanter plus fort la Marseillaise, changer de prénom, ou adhérer à un parti d’extrême droite pour qu’on leur accorde l’autorisation de faire partie de la communauté nationale.
En 2018, Yamina a 69 ans et vit à Aubervilliers. Chaque samedi matin, elle se rend au marché de la ville, « c’est un rituel ». Dans le bus on lui cède la place mais elle refuse car « elle n’aime pas qu’on se dérange pour elle ». Yamina ne se plaint jamais « comme si cette option lui avait été retirée à la naissance ». Lorsque son médecin traitant la tutoie, lorsqu’il lui demande de dégager ses oreilles de son foulard « Allez, madame Yamina, on enlève sa petite burqa pour montrer ses petites oreilles », elle n’y voit aucune condescendance, ou mépris. Elle ne voit pas cette échelle invisible (sic) sur laquelle il se perche chaque fois qu’il s’adresse à elle ». À moins qu’elle ait choisi « de ne pas se laisser abîmer par le mépris ou envahir par le ressentiment », sa façon de résister.
Elle enfouie sa colère, contrairement à sa fille Hannah qui la laisse exploser comme devant la guichetière de la préfecture de Bobigny « qui blesse les gens avec son comportement » sa façon de parler avec eux « très fort en articulant lentement » Malika est divorcée. Les trois autres sœurs et Omar sont célibataires. Les samedis, ils se retrouvent chez leurs parents qui sont heureux de les recevoir pour le rituel couscous.
Omar n’a jamais fait la moindre remarque à ses sœurs qui étaient pour lui comme « trois petites mères ». Il est le chouchou de Yamina, qui peut faire se lever l’une de ses filles pour que lui, le garçon de la famille, s’assoit « ma fille, lève-toi, c’est la place de ton frère »
Les sœurs considèrent que Omar est le préféré de leur mère. « Imène, détachée, lâche en haussant les sourcils « Inch’Allah que j’ai pas d’enfants, si c’est pour faire des différences, c’est pas la peine ! » Lorsque Brahim, le père, rentre des courses et qu’il a oublié les Chocapic, les céréales préférées de Omar, « Yamina le boude ». Suit une liste d’actions de Yamina montrant combien Yamina chouchoute Omar. Pourtant, Si Omar est la fierté de sa maman, Malika est la fierté de la famille, « Elle travaille au service de l’état civil de la mairie de Bobigny. » Elle se fait discrète, « elle ne fait jamais de vague. » Yamina rappelle à tous qu’elle ne fait aucune différence entre ses enfants « qui sont comme les doigts de ma main, je peux pas en couper un. » Mais Imane est persuadée qu’elle est « l’auriculaire de Yamina, ce doigt inutile. » alors elle quitte la pièce peinée.
La famille habite à Aubervilliers, « rue du Moutier », non loin du cirque Zingaro, à quelques kilomètres de Paris et du stade de France.
Yamina se lève à l’aube pour faire sa prière. Une fois, alors qu’elle allait faire ses ablutions, elle s’est rappelée d’un rêve dans lequel elle se voit se rendre à l’école qu’elle trouve fermée. Elle crie « ouvrez-moi, je veux rentrer », mais en vain. Elle est ramenée à la maison par son père « qui fronce les sourcils ». Yamina a dû arrêter l’école pour aider ses parents. Ses enfants à elle ont tous été à l’école. Malika, sa fille aînée, divorcée, intellectualise tout. Elle ajoute toujours « à ce qu’il paraît » lorsqu’elle avance une citation d’un auteur « ce qui affaiblit malheureusement la crédibilité de son propos. »
Les phrases sont en italiques lorsqu’elles reprennent les échanges entre par exemple l’employée de la préfecture et Hannah, mais aussi lorsque l’autrice s’adresse au lecteur « peut-être que ça ne vous frapperait pas immédiatement en la regardant, mais derrière Yamina il y a une histoire comme derrière tout un chacun. » Faïza Guène utilise l’humour, parfois de manière subtile, « Sur les boites de Chocapic, sous la date de péremption, on devrait ajouter l’âge limite pour en manger », parfois de manière incongrue ou trop légère, sans pertinence ainsi ces formules à l’emporte-pièce, ces formules qu’on entend parfois ou d’autres inutiles ainsi « il gare sa voiture toujours au même endroit, sous le lampadaire devant Chez Akfadou, la boucherie halal des Kabyles, juste en face de la rôtissoire à gaz (capacité trente-quatre poulets). »
Yamina a de bonnes relations avec sa voisine, « elle lui tient la porte, lui envoie une assiette de msemen ou de crêpes mille trous », mais elle est gênée quand son chien la renifle. La voisine croit qu’elle en a peur, « Il va pas vous mordre ». Yamina comprend que d’autres gens aiment les chiens « c’est leur façon de vivre ». Pourtant, des chiens elle en a vu dans la mechta de son enfance. Ils étaient libres d’aller et venir dans la ferme. Elle pense que « l’appartement ce n’est pas un destin acceptable pour un chien. » Yamina évite le chien, non parce qu’elle en a peur, mais c’est que pour prier il faut être pur, c’est-à-dire avoir fait ses ablutions. Or, tout contact avec un chien invalide cette pureté et Yamina sera obligée de refaire ses ablutions. C’est donc mieux d’éviter. Elle pourrait expliquer tout cela à sa voisine, mais « quelque chose empêche Yamina d’avoir ce dialogue. Aujourd’hui on ne peut pas dire qui on est. » L’atmosphère a changé depuis les années Zidane et les années 80, la décennie de la Grande marche citoyenne de Marseille à Paris « Pour l’égalité et contre le racisme ». Mais peut-être que Yamina « a tendance à embellir ses souvenirs ». Yamina dit vrai. L’atmosphère s’est alourdie. Elle n’aime pas écouter « les polémistes islamophobes à qui on donne la parole pour beugler leur haine, la bave aux lèvres, ces faces de chien, Woujah el kelb » Les Woujah el kelb comme le Zemmour prolifèrent à la radio, à la télé et même dans les quartiers. Hannah, elle, n’a pas la patience de sa mère. Elle, elle dit à la voisine « tenez votre chien là s’il vous plaît ». Mais lorsque sa mère lui demande d’user de patience « c’est comme ça benti, ma fille, on doit accepter, on est comme leurs invités, on est chez eux » Hannah ne supporte pas. « On n’est pas des invités ! t’as reçu un carton d’invitation toi ? Ça suffit, ça fait 35 ans que j’entends ça ! Nous on est chez nous ! on est nés ici ! » Et gare donc à qui ose lui barrer le chemin. Elle n’a pas froid aux yeux et elle a raison.
La famille possède depuis plus de dix ans un jardin ouvrier près de la nationale, du cirque Zingaro et du cimetière, à deux, trois kilomètres de l’appartement. Il est entouré d’autres jardins et des villes de Drancy, La Courneuve, Pantin et Bobigny. Dans ce jardin ouvrier il y a un figuier qui fait penser à Yamina à celui de son enfance à Msirda et qui a péri. « Désormais, l’arbre de Yamina, sa baraka, n’est plus en Algérie, il est ici, à Aubervilliers, bien enraciné. » La famille a pour voisin un vieil espagnol avec lequel Brahim échange fièrement en portugais, mais Brahim fait erreur.
Lorsqu’elle jardine, Yamina est comme transportée dans son enfance, « elle oublie tout et ne s’arrête que pour prier dans la cabane du jardin… Avant, elle priait même sur l’herbe fraîche, mais aujourd’hui elle ne se sent plus en sécurité. Elle se cache. »
Omar est chauffeur Uber depuis deux ans. Il porte un costume de grande marque en guise de tenue de travail. Sa nuit de travail touche à sa fin, l’aube pointe. Il dépose des clients devant le luxueux hôtel Lutétia. Omar peut se donner les moyens pour prendre un verre dans le bar de l’hôtel, mais « il y a dans sa tête une frontière nébuleuse qui lui raconte qu’il ne peut pas y entrer… Il y a des choses qui ne sont pas faites pour nous » mais pour les dominants « qui font à peine l’effort de nous exclure. Nous le faisons très bien nous-mêmes. » Il prend les derniers clients, deux touristes américaines qu’il dépose sur la place de la Bastille, avant de rentrer se coucher, mais avant « avec un peu de chance, il arrivera à temps pour prier el fajr à la mosquée d’Aulnay-sous-Bois. » Yamina est fière de son fils. Elle trouve qu’il s’en sort mieux que nombre de jeunes comme « ceux qui mendient avec leurs chiens, ceux qui ont fait de la prison ».
Une autre fois, Omar prend une cliente à la gare Montparnasse pour la déposer à Romainville. « Ils ont parlé de tout et ‘d’autre chose’. Il aurait voulu que la course dure jusqu’à l’aube. » Que devient-elle à la fin du roman, cette cliente ? est-ce la meuf qu’évoquera Hannah dans la grande maison de Pillac ?
« Omar pense aux vacances qu’il a passées à Marseille l’année dernière, avec sa serviette de plage FC Barcelone, achetée au bled en 2012, à Tlemcen. » Je n’ai réellement pas saisi le sens, y en a-t-il un, de cette phrase, même si Faïza Guène précise « Il se souvient que le vendeur aussi s’appelait Omar » Très bien, mais quand même « passer ses vacances avec une serviette », quand-même…
La cliente qu’il a prise à la gare Montparnasse s’appelle Nadia. « Ses yeux sont si noirs qu’on distingue à peine le contour de ses pupilles… elle est plutôt bavarde. Omar souhaite la revoir. « Elle lui donne son pseudo Facebook » Omar n’est pas sûr de lui. Il pense qu’elle a accepté par politesse. « Il a des fourmillements dans sa poitrine, chaque fois qu’elle rit. »
Il pense qu’« elle plairait bien à maman ». N’est-ce pas là un cliché du garçon maghrébin accroché aux jupons de sa maman ? Omar est timide, « il peine à trouver sa place dans le monde. C’est un garçon arabe qui ne se conforme pas à ce que le monde attend de lui, c’est-à-dire devenir dominant, brutal, conquérant, viril et, si possible, fourbe, voire dangereux. » À Port Say, il y a quelques années, son cousin lui a appris qu’il fallait draguer les filles mal fagotées » pour avoir plus de chance de conquête. Il a échoué. Suivent trois pages sur la virilité telle que développée dans les westerns américains.
En 2018, Omar « va bientôt passer les 30 piges » indique l’autrice (page 36). Un an plus tard, en 2019, « Omar a 29 piges » (page 159). Petit problème donc. La chambre de Omar ressemble à celle d’un étudiant. Lorsqu’il était en CDD à l’Assurance-Maladie Omar a acheté un très grand téléviseur « qui mange littéralement la pièce » qui supporte aussi d’autres meubles, « une armoire, une table basse, une banquette, un bureau », et surtout une Play-Station 4. Il passe des heures à jouer ce que ne comprend pas son père « Jouer ? à 30 ans ? » Brahim pense que son fils fait partie de cette « génération à l’enfance prolongée et aux responsabilités réduites » « Lui, Brahim, à 16 ans il descendait à la mine, la gueule noire, du côté de Roche-la-Molière et Firminy, dans la Loire ». Yamina ne comprend pas pourquoi son mari « s’entête à endurcir Omar ». Elle s’interroge, « les chauffeurs Uber d’aujourd’hui, comme leur fils, ne sont-ils pas les mineurs d’hier ? » Yamina souhaite que Omar se marie et « qu’il ne suive pas le chemin de ses sœurs demeurées célibataires. L’aînée est divorcée. Omar y songe peut-être.
Tout en nettoyant sa belle voiture de travail à la station de lavage, « Omar pense à inviter Nadia, la cliente qu’il a ramenée de Montparnasse à Romainville. Elle lui a plu. Pour échanger avec elle il a créé un compte Facebook et envoyé quelques messages.
Sa sœur Imane, 31 ans, est la troisième enfant. Elle habite seule dans un studio. Lorsqu’elle a annoncé à ses parents qu’elle projetait d’habiter seule, ils ont eu peur du « qu’en dira-t-on » des gens. Imane fuit le regard de son père qui est déçu par elle. Aucune des filles Taleb n’est mariée. « Malika, l’aînée, avait été mariée quelque temps », aujourd’hui elle est divorcée. Brahim avait dansé au mariage de sa fille (en août 1999, elle avait 18 ans). Mais celui-ci ne tint qu’un temps et comme les parents des mariés se connaissaient bien, le divorce ou « ‘l’arrangement’, s’était déroulé à merveille. » À cette époque, Brahim rodait avec le père Ammouri (mort d’un cancer de la gorge). L’auteure use d’une image qui s’apparenterait à un stéréotype pour décrire l’ami et voisin de Brahim « Avec son long corps de Berbère qui avait des airs de Jacques Brel trempé dans de l’huile d’olive. » Pas vraiment pertinent. « Les aînés de la fratrie, comme Malika, acceptaient les règles désuètes » des parents, car à leurs yeux ils faisaient de leur mieux. Il y a lieu ici de parler plutôt des fratries en général car, s’agissant de la famille Taleb, même Malika, née en 1980, est jeune pour avoir à « accepter » ces règles anciennes. Pourtant « décevoir les parents c’est pire que tout. » Comme on vivait « ici » il fallait bien trouver des règles. « C’est ainsi qu’ils avaient inventé instinctivement des lois hybrides ». Mais les parents, « avaient peur de tout perdre. Ils tenaient à rester qui ils sont. Ils ont refusé d’être effacés »
De nombreux passages, comme en page 60 et 61, sont marqués par une graphie particulière avec des phrases courtes de trois à neuf mots et retour à la ligne.
« Malgré eux, les parents, par les sacrifices énormes qu’ils leur ont consentis, ont fait de leurs enfants des gamins écrasés, accablés et les enfants accablés font comme leurs parents, ils marchent la tête baissée. » Pas toujours, on le constate bien avec Imène et Hannah. Celle-ci a 34 ans et elle se sent épuisée. C’est une adulte indignée. Elle semble regretter « la bonne époque, celle d’avant le 11 septembre 2001, d’avant Charlie. Au moment où les Arabes avaient été à la mode, grâce à Zidane, à Djamel Debbouze et à Rachid Arhab. C’était cool d’être rebeu à cette période ». Mais des malheurs étaient passé par là, et Charlie avait brisé le cœur du coeur de millions de Français musulmans « au nom de la liberté ».
Hannah a rendez-vous avec un homme « pas très beau, il a de l’embonpoint, des poils sur les doigts » et porte « un jean qui épouse ses hanches. Si Hannah remarque les hanches d’un homme, automatiquement il devient une sœur. » Généralement les garçons arabes s’intéressent plus « à la femme blanche, aux cheveux raides. » Hannah méprise les gens qui souffrent de la haine de soi. Elle déteste par-dessus tout, les gens qui se détestent. Une fois elle est tombée amoureuse d’un type, Samy, « qui s’est mis à vouloir la contrôler. Il n’avait pas assez d’amour pour en donner convenablement. Elle l’a quitté à contre-cœur. »
Maintenant Hannah est avec Hakim. Il parle beaucoup et elle, « son esprit s’évade. » Il n’a aucune originalité Hakim. Hannah se lasse des choses, des gens et, dans la vie, s’ennuyer constamment n’est pas de tout repos. » Elle décroche lorsqu’il lui détaille son voyage en Thaïlande « son plus beau voyage qu’il a jamais réalisé ». Hakim voulait pratiquer la boxe thaïe, mais il a été découragé par un ami. « Frère, Wallah, t’as pas la condition physique pour ça. Le prends pas mal mais t’es sacrément dodu, t’as des seins mon frérot. » Ce type d’humour très drôle n’est pas rare dans le roman. Entre massage et boxe thaïe, les vacances à vingt ans en Thaïlande peut être un excellent rite initiatique. Ce pays avait fait de Hakim et de ses semblables, des hommes. Hakim voulait retourner une 4° fois au Salon de massage, mais le même ami avait essayé de l’en empêcher, « Eh Wallah frère c’est chaud. Elle t’a fait une marabouterie asiatique ou quoi ? Fais belek, j’crois qu’tu tombes amoureux frère. »
La petite sœur, Imane, se trouve dans un Lavomatic au nom de « Lav’ Story », tenu par un Chinois qui force les sourcils en permanence. Imane aime le lavomatic « ça lui permet de rêvasser tranquille dans une atmosphère de linge humide ». Puis-je écrire qu’il s’agit là par contre d’un humour, disons bon enfant ? Le nom de la laverie renvoie Imane à un célèbre film américain, un film qu’elle a vu en cassette avec sa grande sœur Malika « une bonne centaine de fois. »
Cette année encore Imane, à Noël, intègrera l’équipe de vente de ‘Maxi Toz’. Le travail la fatigue « elle en a assez de la hiérarchie et de la pression qu’elle lui inflige. » Elle ne peut arrêter, il lui faut payer le loyer de son 20 m2, et il est cher. Ses parents lui feraient un scandale s’ils l’apprenaient « quoi ? 850 € ? ça fait 8 millions et demi » en Algérie, de quoi louer 7 appartements à Aïn Témouchent ! » Et Faïza Guène n’est pas vraiment généreuse ! Aujourd’hui on offrirait le double aux parents, 17 millions de centimes.
L’autrice imagine une suite de propos entre Imane et son père « cette histoire aurait possiblement mal fini. Imane aurait quitté l’appartement en claquant la porte. » Elle serait allée faire un tour « et se serait sentie incomprise dans cette famille « de toute façon y en a que pour les grandes et pour Omar ».
Une fois par semaine, en cette année 2020, Hannah se rend chez une psychologue. « Elle en a honte. Elle fait croire à sa famille qu’elle s’est inscrite à un cours de zumba ». Cela n’a pas été facile car il lui a fallu « déconstruire les fiertés mal placées qu’elle portait en elle, ‘‘je suis algérienne ! je n’ai pas besoin d’aide !’’ » en levant le poing si nécessaire ou en agitant un drapeau algérien. Y a-t-il un seul Algérien qui ne reconnaîtrait pas chez tel ou tel de ses proches ce nif tellement « mal placé ? » et au nationalisme démesuré ? L’esprit de Hannah est taraudé par la question de la LÉGITIMITÉ (en lettres majuscules).
Depuis dix ans, elle est éducatrice spécialisée auprès de jeunes en réinsertion professionnelle. « Elle côtoie les psy dans le cadre de son travail », mais ce n’est pas la même chose. Un jour de septembre elle s’est adressée à une psychologue dans le 11° arrondissement de Paris, madame Aït-Ahmad – le troisième « a » n’est pas un « e », aurais-je commenté. Hannah a honte, mais « elle doit franchir la frontière pour ses enfants à peine en projets, même pas nés, encore flous. Les impacts de la vie sont dans la chair de Hannah. » Si un jour elle a des enfants « elle ne veut pas qu’ils héritent de cette colère qui dévore ses tripes et qu’ils soient fiers de qui ils seront. » Elle leur racontera sa propre histoire, celle de ses parents, celle de Djamila Bouhired, l’Histoire, sans ambages.
Malika se doit en sa qualité d’officier d’état civil d’incarner l’impartialité et la neutralité de l’État. Mais elle peine. Comment rester neutre devant un chibani « qui se noie dans son charabia sans lui tendre une main compatissante. » Ce que ne comprend pas du tout, et ne peut peut-être pas comprendre, l’employée de la préfecture de Bobigny qui s’en était prise à Yamina. Quand Hannah s’adresse au vieux monsieur dans son propre dialecte, ses yeux fatigués s’illuminent. Même sa hiérarchie ne la comprend pas et « lui a remonté les bretelles », ni même sa propre mère qui lui demande de « rester discrète. » Dans les moments d’accalmie, Malika fait des micro-siestes ou surfe sur l’Internet. Elle recherche et trouve le village de « Sidi Ben Adda ex Les trois marabouts », près de Aïn Témouchent où ont vécu ses aïeux. Elle trouve un site qui relate la période coloniale, mais rien des anciens de sa famille « leurs vies se sont discrètement éparpillées dans la poussière ». Ils sont absents du site. Malika n’a reçu qu’une « histoire fragmentée, un puzzle ». Il reste à ses propres enfants d’en assembler les fragments, de le reconstituer.
Omar n’est pas à l’aise. Il sue. Il s’est habillé comme « lors du mariage de son copain »
Il se trouve au bar du Lutétia. En attendant Nadia, la cliente de Romainville il commande un cocktail « alcohol free ». Suit cet échange sensé nous faire rire. Omar se remémore d’une discussion qu’il a eue avec une fille lors d’une fête. « – tu fais quoi dans la vie – je suis Uber – c’est marrant t’as pas une tête à t’appeler Hubert. » Bon.
Nadia arrive, « sa façon de traverser le bar, de slalomer entre les tables… c’est sûr, Omar est amoureux de cette fille. » Elle préfère aller ailleurs, ce bar ne lui plaît pas « on va pas payer 24 balles pour six accras de morue. » Ils se rendent chez un traiteur libanais « beaucoup plus accessible. »
Imane se rend à l’hôpital Salpétrière, « il paraît qu’ils ont de bons stomatos ». À 31 ans, Imane a besoin de sa maman à ses côtés, « c’est une douillette ». Elle a des difficultés à avoir une demi-journée « à croire que sa responsable a un problème personnel avec elle ». « Sa responsable est toujours à la surveiller, à chronométrer ses temps de pause. » Là encore cet humour est un peu lourd. Imane pense que si elle se trouve ici en stomatologie c’est à cause de sa responsable, « elle a une dent contre moi ».
Hannah raconte à la psy ses cauchemars. Tout le texte est en en italiques. Hannah se voit avec ses copines de lycée dans un restaurant chinois. Elles mangent, rigolent… lorsque tout à coup arrivent des cars de CRS. Le patron, Sofiane, est terrorisé. Du dessous de la caisse, « il sort vite une tondeuse, il la branche et se met à tondre sa barbe. » Les CRS, cagoulés, tirent en l’air, mais l’un d’eux, un vieux militaire d’extrême droite, haineux avec un bandeau de pirate sur l’œil, « tire sur les jeunes en riant ». Arrive un autre de ses acolytes, de la même veine, qui écrase la tête de Yamina. Hannah hurle. « Il me tire dessus dans le front. Boum. » C’est ce qu’elle raconte à la psychologue, madame Aït Ahmad. Elle lui raconte d’autres cauchemars, des corps d’Algériens dont celui de son père qui flottent sur la Seine. Hannah ne sait quoi faire de « toutes ces histoires qui la hantent ». La psy trouve les mots qui réconfortent. « C’est normal, cette violence fait partie de votre histoire, et les humiliations vécues avant vous, vous en héritez… mais vous ne pouvez réparer seule, l’offense. » Ces mots lui font du bien car Hannah « a toujours le sentiment de devoir réparer l’offense subie par les parents » qui seront, certainement, « enterrés sans avoir la reconnaissance méritée. » Son père en se rappelant son arrivée en région parisienne en 1961, pensait « à Nasser, celui d’entre eux qui n’est jamais revenu » jeté dans la Seine en octobre 1961. Il a dû raconter ce vécu à Hannah.
Ce père qui offre des fleurs à Yamina chaque année à la Saint- Valentin. De tout temps il « glisse un billet de 20 € dans les pages du Coran de Yamina. Elle a fini par l’aimer, lui et ses manières gauches. » Brahim a arrêté de jouer au tiercé et de fumer, mais il a gardé des petits plaisirs, comme « mettre du parfum, se rendre au café Casanova, écouter Dahmane el Harrachi, regarder des westerns à la télévision. »
Thomas, le petit ami de Imane, sanglote dans cette impasse du 18°. Elle l’avait prévenu qu’il ne fallait pas compter sur elle pour qu’elle s’engage. Imane ne supporte pas de le voir dans cet état. « Elle est au degré zéro de l’empathie… Même si elle déteste leurs pensées archaïques, leur autorité, leurs manières trop viriles, Imane préfère chez les garçons arabes le trop de virilité que le pas assez. » « Thomas était gentil avec Imane, mais malheureusement, l’électrocardiogramme est resté plat. Tout s’est évaporé lorsqu’elle l’a vu se dégonfler et baisser les yeux lorsqu’un mec leur a cherché bagarre dans un bar. Tout à coup il l’a dégoûtée, littéralement. » Thomas gagne bien sa vie, il est propriétaire de son appartement, mais il est trop près de ses sous. « Toujours à tout compter, à mettre sa part, à donner l’appoint, toujours avec ses ‘‘on fait moit’-moit’ »
Imane est indépendante. « Elle soutient la liberté d’expression, mais elle n’est pas Charlie pour autant. Elle est musulmane et féministe. Elle est française et algérienne. Quand la viande n’est pas halal, Imane est végane (c’est-à-dire ne consomme pas de produit d’origine animale. Ne porte pas de laine, de fourrure ou du cuir). En un mot ou en treize, elle vit dans un monde qui n’est pas prêt à accueilli sa complexité. »
Le roman s’achève en Charente, dans une grande maison. C’est la première fois que la famille prend de vraies vacances. Les grands-parents sont morts. Les enfants se sont cotisés pour louer « une maison de 170m2 à Pillac, au nord de Bordeaux, avec piscine, ping-pong et balançoire. » Tout autour, des champs à perte de vue, Yamina ne se lasse pas de les regarder. Hannah apprend involontairement à ses sœurs que Omar « a une meuf ». Peut-être est-ce Nadia, sa cliente de Romainville ? La famille est heureuse, elle profite du lieu, Brahim somnole à l’étage.
« Yamina a six ans, elle rit aux éclats, elle se sent libre ». Malika, Hannah, Imène et Omar sont bouleversés. Ils sont heureux de « découvrir un nouveau visage du pays où ils sont nés, et plus heureux encore de le faire découvrir à leurs parents. » Ils sont émus de se dire qu’ils font partie de l’histoire de France, d’une manière ou d’une autre, ‘‘qu’ils le veuillent ou non’’. »
Voilà une famille qui remplit au quotidien sa mission, sans colère, dans la lignée des anciens et dans un environnement pas toujours bienveillant. Et lorsqu’ils manifesteront, ils ne descendront plus dans la rue « dans un cortège à part » qu’on le veuille ou non.
La Discrétion est un beau roman, malgré quelques imperfections, quelques lourdeurs. Il soulève plutôt avec subtilité nombre de questionnements liés au mal-être, à l’identité, à l’intégration, à l’altérité, au racisme banal, au travers l’évolution d’une famille algéro-française vivant en France. Un roman agréable à lire.
Ahmed Hanifi,
mercredi 27 octobre 2020
lire ici Article et autres informations : https://ahmedhanifi.com/la-discretion-le-dernier-roman-de-faiza-guene/
———————————— CLIQUER ICI ——————————-
http://ahmedhanifi.com/wp-content/uploads/2020/10/Faiza-Guene-La-Grande-librairie-Mer-23-09-2020.mp4
Faïza Guène à La grande librairie, le mercredi 23 septembre 2020
_____________________________________________________
Je vous propose d’écouter « À voix nue » une émission de France Culture. L’invité est Kamel Daoud. Il s’exprime durant cinq épisodes de 30 minutes chacun, diffusés du 29 novembre au 3 décembre. Son discours est franc et intelligent. Il dit les choses, ses convictions, son parti-pris, ses réflexions, ses doutes, comme à son habitude en vous regardant droit dans les yeux. Il faut prendre parfois sur soi et surtout ne pas rejeter ou s’offusquer « bêtement » (pardonnez-moi). Je n’adhère pas à tout ce qu’il dit, non, mais je trouve qu’il fait beaucoup avancer les débat si tant est qu’on lui oppose, lorsqu’on n’est pas d’accord avec lui, non des stigmatisations et autres noms d’oiseaux mais un argumentaire. Il est de mon point de vue primordial que nous arrêtions avec cet esprit et propos constrictifs « plus nationaliste que moi tu meurs » ! Personnellement j’aurais quelques réserves sur certains passages (la presse, l’écriture, le militantisme…) Je regrette qu’il ne rende pas hommage à feu « Moussa » Bennaoum son 1° employeur (lui, K.D., qui était alors un jeune en recherche d’une stabilité, d’un salaire) « Moussa » dont il cite furtivement le nom de son journal.
______________________________________________
CLIQUER ICI POUR VOIR LA VIDÉO DE KAMEL DAOUD
______________________________________________
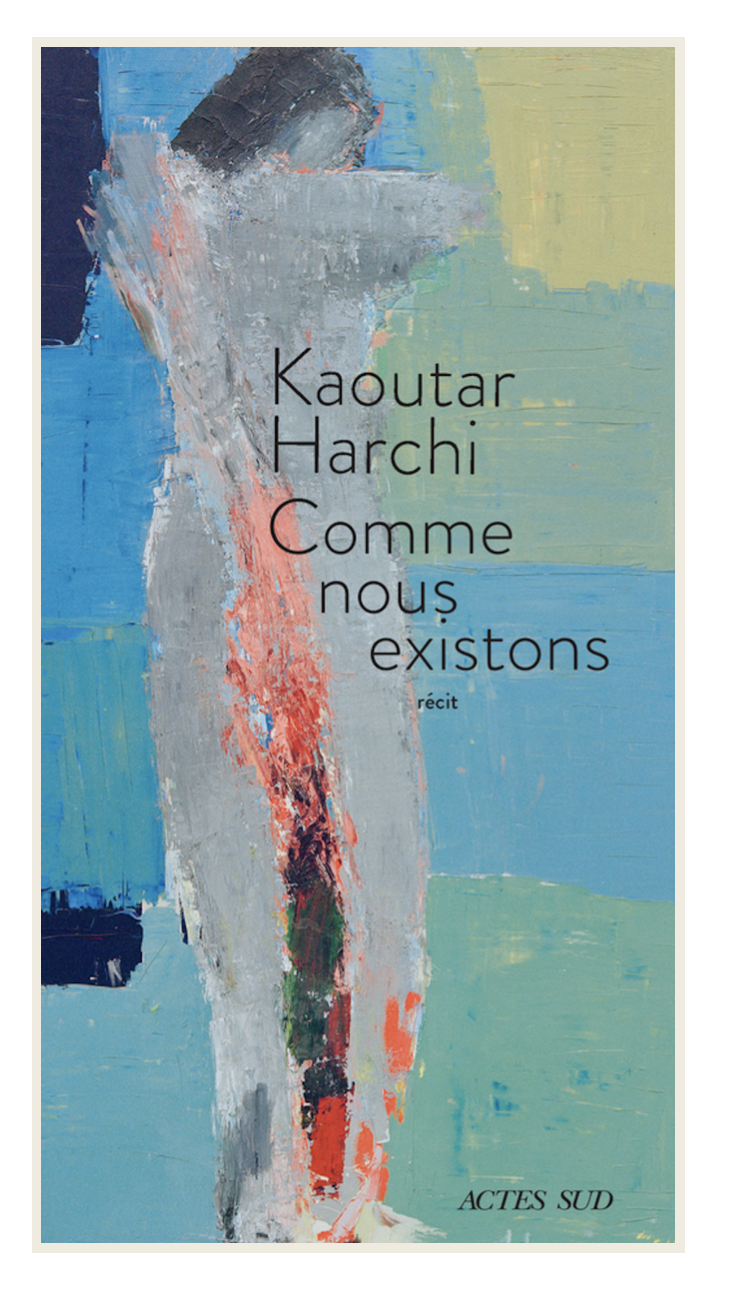

_____________________________________________
LA VIDEO SE TROUVE EN BAS, À LA SUITE DU TEXTE
_____________________________________________
Kaoutar Harchi a présenté hier samedi 27 novembre son dernier ouvrage, « Comme nous existons » (Actes Sud) , une « enquête autobiographique », à la médiathèque Alcazar de Marseille.
Je vous propose ces vidéos et à leurs suite une lecture de quelques extraits de son intervention qui a duré une heure et demie.
La séance s’ouvre sur une question du cheminement entre les différents ouvrages écrits par l’autrice. « La question de la trajectoire est une question complexe. Le point de départ qui est sûrement partagé par de nombreuses personnes, c’est le sentiment de la privation dans les deux sens du terme, être dans un espace domestique, familiale il y avait quelque chose qui paraissait complexe à cet endroit-là… et il y avait aussi la notion du sentiment d’être privé et aspiration à devenir publique au sens d’aspiration à faire des choses qui revêtent un caractère collectif, quelque chose qui relève d’une certaine forme d’utilité ou d’une certaine forme de réponse aux nécessités qui pouvaient être les miennes quand j’avais 17 – 20 ans. Beaucoup de choses se forment à ce moment-là et en tant que jeune fille de l’immigration post-coloniale comme je peux l’expliquer dans ce récit, la question scolaire était une question assez importante, assez centrale et l’écriture a fait naturellement au regard de la place que prennent les écritures scolaires quand on est enfant puis adolescent, la question de l’écriture a pris une place importante mais aussi parce que l’écriture c’est quelque chose d’assez paradoxal au sens où en France c’est très fortement érigé comme une sorte d’art suprême, mais c’est aussi un art plus accessible que peuvent l’être d’autres formes d’expressions artistiques qui exigent des instruments, qui exigent des cours, qui exigent une maîtrise technique.
Donc j’ai été une jeune fille soucieuse de sortir dehors mais aussi inquiète à l’idée d’être confrontée à ce dehors-là que nous connaissons tous et qui est marqué par une sorte de violence qu’elle soit intellectualisée, analysée ou qu’elle soit simplement vécue de manière brutale et immédiate. Je m’interrogeais beaucoup sur ces questions. J’essayais de trouver un sens partageable aux différentes formes de sacrifice qui avaient accompagné la trajectoire et comment elles étaient aussi principalement un sacrifice d’ordre parental. Ces récits ont traversé cette histoire et j’essayais à chaque fois de résoudre quelque chose en me disant qu’après cet ouvrage-là les choses seront plus résolues. Les choses n’étaient pas plus résolues au sortir du livre, mais j’avais peut-être gagné en lucidité en radicalité. »
Sur la question la mise à jour de l’intime, sur les limites, les ressources…
« La question autobiographique m’intéressait depuis un certain temps. J’avais commencé à écrire des récits de fiction. Le roman est un genre dominant. On y entre en tant qu’écrivain convaincu que c’est la forme la plus importante qui soit. À travers cette expérience de l’écriture romanesque qui était une expérience que je définissais avec beaucoup d’assurance comme une écriture émancipatrice, comme une écriture de la progression, comme une écriture de l’ouverture. Progressivement je me suis rendue compte que les choses, matériellement, ne se présentaient pas ainsi et que mon statut d’écrivaine qui était assez légitime à mes propres yeux ne l’était pas forcément aux yeux des personnes qui m’entouraient et des personnes dont le travail était de produire des formes de jugement sur ce type de récits. J’ai donc été confrontée à des formes de situations parfois paradoxales quand en tant qu’écrivaine je cherchais à affirmer une forme de singularité ou une forme de spécificité et que je mobilisais le ‘‘je’’ en disant ‘‘moi je pense, moi j’estime, moi je considère’’… les réponses qui pouvaient m’être faites étaient souvent des réponses qui pouvaient mobiliser non pas ma propre subjectivité mais mobiliser une certaine forme de groupe d’appartenance imaginaire, à ‘‘moi je pense, moi je considère, moi j’estime’’, on pouvait me répondre ‘‘mais vous les musulmans, vous les femmes arabes, vous les habitants des quartiers populaires’’ et j’étais toujours dans une forme de décalage en tout cas dans une forme de désajustement très fort entre le point, la situation qui était la mienne et la difficulté à faire reconnaître l’individualité qui était constitutive de mon travail et cette difficulté à faire reconnaître une individualité elle est absolument centrale dans le cadre des rapports qui régissent les populations minoritaires et les populations majoritaires. Elle est centrale aussi dans les processus de désubjectivation et dans les processus d’identification qui sont souvent des processus d’identification qui réduisent ce que vous êtes à ce que vous semblez être. La question de l’apparence est absolument fondamentale et on peut y entrer par la question du genre, par la question de la classe et bien évidemment par la question de la race. Donc à partir d’une expérience apparemment anodine et apparemment simple, celle d’être une jeune femme dans le champ littéraire français se sont redéployées des problématiques d’ordre général que j’aurais pu expérimenter à partir d’un ensemble infini d’espaces sociaux, mais je les ai expérimentées à partir d’un espace où le symbolique où la catégorie où la valeur où le jugement où la qualification sont absolument fondamentaux, et cela a exacerbé un certain nombre de choses et j’ai toujours été par la suite à la recherche de ce ‘‘je’’ en fait, j’ai toujours été à la recherche de cette forme d’individualité.
Je crois de manière très simple et très élémentaire et avec des formes de sédimentation très profondes dans le temps, le temps de ma vie, mais aussi le temps qui précède ma vie, c’est-à-dire tout ce qui s’est passé avant moi et avant nous tout cela a pris une forme qui ressemblait à quelque chose, a pris une forme qui était celle d’un pouvoir qui s’exerce et d’une résistance qui est appelée à se faire connaître. »
De nombreux thèmes ont été développés, ainsi les ruptures entre les attentes de la société français et le milieu d’origine… la peur à travers les personnages (personnes) du récit… le choix du collège de l’auteur par ses parents… les questions d’actualité, la violence, le précariat, les inégalités, le politique, les formes d’apartheid, les corps en survie…
Je vous laisse apprécier des extraits de vidéos que j’ai prises à cette occasion.
Marseille, 28 novembre 2021
___________________________________
°
CLIQUER ICI POUR VOIR LA VIDÉO
°
___________________________________
_____________________________________
°
CLIQUER ICI POUR ÉCOUTER « SUZANNE »
°
______________________________________
Il y a cinq ans disparaissait LEONARD COHENPour ne pas oublier Léonard et SuzanneC’était en 1973. J’avais l’âge de toutes les folies et même deux ans de plus. Et le diable au corps. Je me trouvais dans un pays lointain, aujourd’hui à deux clics de souris, à deux doigts donc. Mais à l’époque, ce pays qui nous faisait rêver était pour nous le bout du monde. Par ce « nous » j’entends la bande Snouci and C° du quartier Michelet d’Oran – bande à laquelle s’est jointe Suzanne L. fraîche émoulue de La Sorbonne, enseignante à la fac de Lettres d’Oran Sénia. Dès qu’arrivait le vendredi, veille de week-end, nous délaissions la brasserie Le Majestic, notre quartier général, pour aller fureter les quartiers autour de la place des victoires, du marché, de la cinémathèque. Mais LGF, « el-khawa » nous empêchaient de tourner en rond. Treillis verts et triques noires, non merci. Où que nous allions, ils exigeaient de nous qu’on écrase l’Afras ou la Marlboro et qu’on leur montrât le livret de famille, ou de rentrer à la maison. Le temps était venu pour notre groupe, la bande Snouci and C°, d’aller voir ailleurs. Au début des années soixante-dix, notre plus bel ailleurs, à l’unanimité, était la Suède. Chacun a fait comme il a pu pour quitter (déjà !) notre pays d’enfer (le terme est ici très négatif). Il nous fallait bouger.En 1973, je me trouvais donc en Suède et plus exactement à Farsta dans un grand appartement de son centre. Farsta est un joli bourg dans le sud de Stockholm. J’étais à moitié allongé sur un sofa. J’étais plus ou moins allongé avec dans la main une cannette de je ne sais plus trop quoi. Il me reste dans mes souvenirs que le jus était sacrément énergisant. Dans la pile de vinyles j’avais choisi « Suzanne » un morceau très en vogue, « Suzanne takes you down to her place near the river/ You can hear the boats go by/ You can spend the night beside her/ And you know that she’s half crazy… » Dans le spacieux appartement vivait une demi-douzaine de personnes, toutes – je le découvrirais – aussi sympathiques et farfelues que déglinguées. C’était Suzana, une fille que j’avais connue dans une auberge de jeunesse « L’auberge du quai de Jemmapes » à Paris qui m’y avait invité. Nous avions fait le trajet ensemble en stop de la Porte de Clichy jusqu’à la banlieue de Stockholm grâce à un routier sympa de Max Meynier (vous ne connaissez pas Max ? un jour je vous raconterai). Trois jours de route. Ce jour à Farsta était un samedi, je m’en souviens bien, Suzana m’avait proposé d’aller voir ensemble Viskningar och rop de Bergman, à son retour. Elle était partie voir sa mère je ne sais plus où. Les autres co-locataires étaient eux aussi absents. J’étais seul, allongé sur un sofa blanc, une canette à la main, captivé par Suzanne de Cohen. « But that’s why you want to be there/ And she feeds you tea and oranges/ That come all the way from China/ And just when you mean to tell her/ That you have no love to give her » Les Suzanne m’envoutaient. De sa voix profonde Cohen nous embarquait auprès de lui, il nous invitait aux voyages les yeux fermés en toute confiance. J’étais plus ou moins allongé en sirotant mon jus de je ne sais plus quoi, lorsque j’entendis le bruit d’une clé dans la serrure de l’appartement suivi par le grincement de la porte. Le temps de me retourner, un mec était planté là, courbé, un pack de Carlsberg V dans les bras. Il a dit quelques mots en suédois. J’ai compris « vän » (ami). Son allure générale n’inclinait guère à la bienveillance. Manifestement il semblait bien éméché. Et même plus qu’éméché. Je me suis levé comme un soldat prêt à se mettre au garde-à-vous. Que faire d’autre lorsqu’à vingt ans on se trouve dans de tels draps ? « Hi » j’ai dit en tendant la main, peu rassuré. Le gars m’a regardé un moment. N’a pas répondu à la main tendue. Il s’est affalé dans un fauteuil, puis a posé sans délicatesse le pack de bière sur la table basse à côté. « U come here with Suzana, is n’t man ? » Et l’autre là-bas qui sillonnait sur le tourne-disque, se fichant de la situation. Il chantait encore « Then she gets you on her wavelength/ And she lets the river answer/ That you’ve always been her lover ». J’ai dit « Suzana, heu, yes, yes… » Je ne savais quoi dire en fait, car le type ne m’inspirait pas confiance. Le visage déformé il a baragouiné je ne sais quoi d’autre, a porté son bras droit dans la poche arrière de son pantalon pour en extraire un objet noir qu’il a tendu vers moi. « Cohen se fiche de moi » ai-je pensé. Il n’arrêtait pas. « And she shows you where to look/ Among the garbage and the flowers/ There are heroes in the seaweed/ There are children in the morning/ They are leaning out for love/ And they will lean that way forever/ While Suzanne holds the mirror ». Le voyou cracha « This is for you guy ». Le « this » signifiait l’objet qu’il tenait fermement dans la main. Et il disait qu’il me le destinait. Je n’avais pas trop vite saisi. Était-ce une plaisanterie ? Le gars ne souriait pas. Son regard, sa bouche, son visage, exprimaient plutôt de la colère. Je compris au terme d’un moment qui me parut une éternité que décidément non, le malfrat ne rigolait vraiment pas. Mais alors pas du tout. J’ai tenté d’entamer une discussion avec lui. Sur le bout des doigts ou des pieds. Plutôt des pieds. Le type était occupé à dégoupiller une Carlsberg, il cherchait dans sa poche avec sa main libre un instrument pour. L’autre main tenait fermement un révolver. Le moment était propice si je voulais connaître la suite du temps qui passe. En une fraction de seconde, de celles qui nous motorisent, qui nous galvanisent lorsque nous nous trouvons dans d’identiques situations, j’ai réussi à m’extraire de la nasse qu’était devenu l’appartement. J’ai dévalé je ne sais comment les trois étages de l’immeuble, traversé la cour, suis sorti dans l’avenue, ai couru, couru, couru, sans me retourner jusque dans Djurgarden, un grand parc où se promenaient des centaines de personnes au sein desquelles je me suis fondu. « Peut-être pas des centaines » ai-je penssé, mais enfin, ce n’était pas l’heure de ronchonner. Il faisait lourd, il faisait beau, je ne sais plus. Ces petits détails n’ont pas marqué mon esprit. J’entendais au loin Suzanne, « And you want to travel with her/ And you want to travel blind/ And you know that you can trust her/ For she’s touched your perfect body with her mind. » Je ne voulais rien d’autre que « voyager avec elle… voyager les yeux fermés » Je savais que je pouvais lui faire confiance… »Le soir, lorsque la nuit se fut bien installée, Suzana me raconta l’histoire de ce type « il est un peu dérangé, il n’est pas méchant, non, il dit toujours qu’il va tuer quelqu’un. He always says that ! ». C’était en 1973. J’avais l’âge de toutes les folies et même plus.Aujourd’hui, lorsque j’écoute cette chanson, je retrouve mes vingt ans. Finalement le temps, est d’une certaine manière, défait.Leonard Cohen est mort, mais pas Suzanne. Aucune des trois. La suédoise est grand-mère, l’égérie d’Oran a retrouvé Paris et Suzanne l’éternelle est en nous tous. Elles sont toutes plus vivantes que jamais. Je les entends encore, près de cinquante ans plus tard, les cheveux blanchis, me fredonner notre air préféré, « And you want to travel with her/ And you want to travel blind … »
Ahmed Hanifi,Marseille le 6 novembre 2021Ce texte (modifié) a été initialement écrit le 12 novembre 2016
Léonard Cohen est mort le 7 novembre 2016 à Los Angeles à l’âge de 82 ans
_____________________________
Sur Facebook, il y eut des réactions au texte…

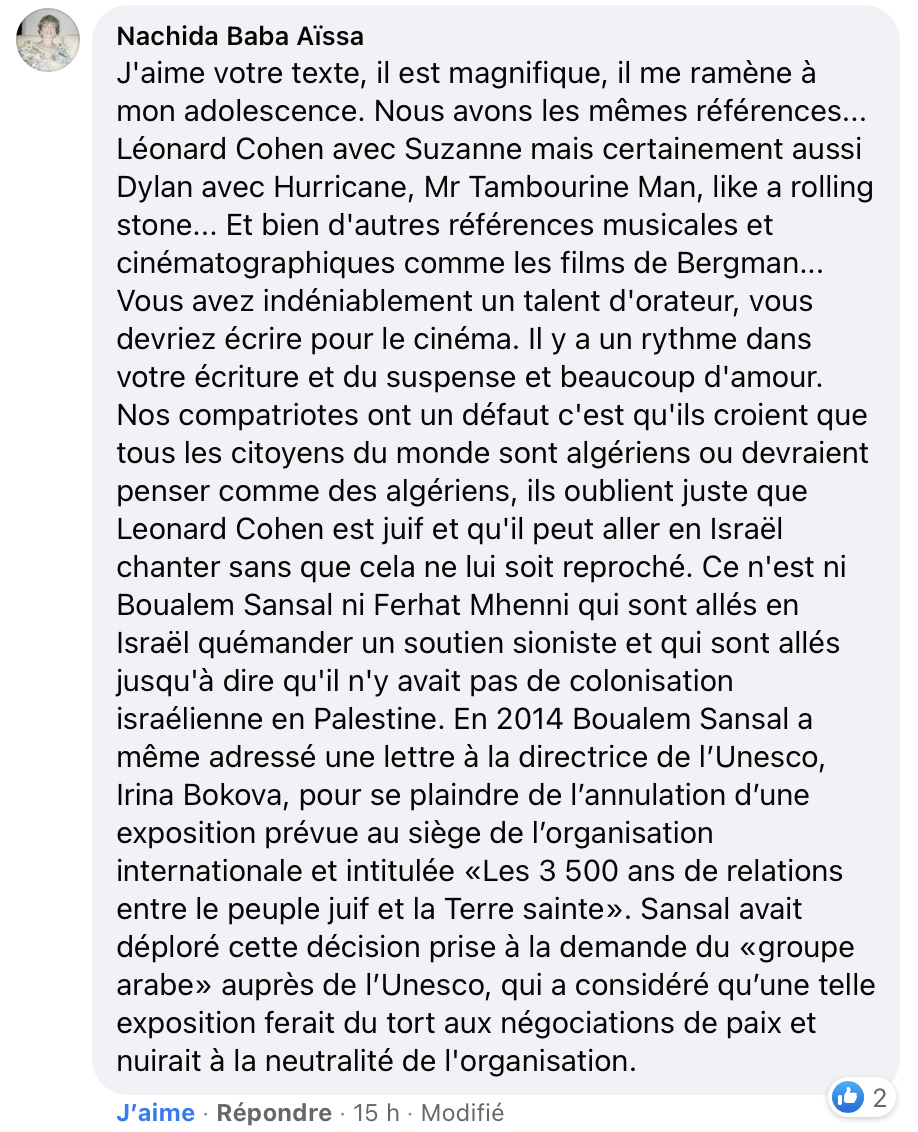




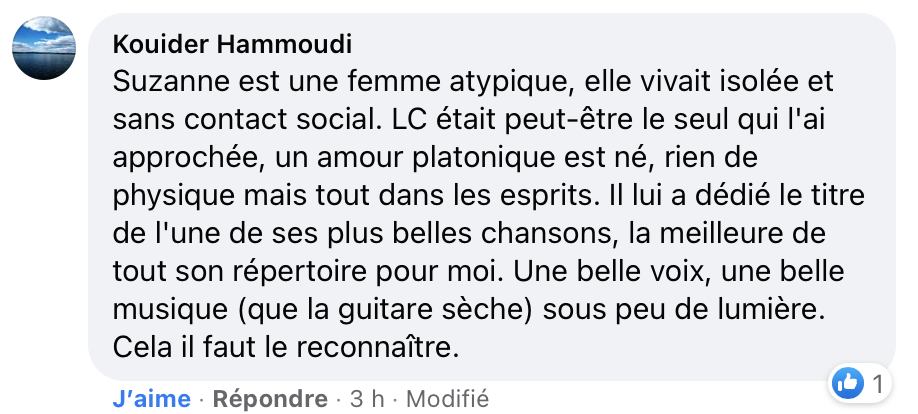
Il y eut des réactions quant à la proximité de Léonard Cohen avec l’état (colonial) d’Israël. Je ne les ai pas reprises ici, car mon propos se veut axé sur la poésie, la chanson, la littérature, le souvenir d’une époque… Nous savons tous les ravages de l’État d’Israël et nous savons que beaucoup de chanteurs, écrivains… sont proches de lui hélas, mille fois.
_____________________________________
Suzanne takes you down to her place near the riverYou can hear the boats go byYou can spend the night beside herAnd you know that she’s half crazyBut that’s why you want to be thereAnd she feeds you tea and orangesThat come all the way from ChinaAnd just when you mean to tell herThat you have no love to give herThen she gets you on her wavelengthAnd she lets the river answerThat you’ve always been her lover Etc.
____________________________________
°
Et sa muse, la connaissez-vous ? Vous ne connaissez pas Suzanne VERDAL ?
°
___________________________________
LES PAROLES
(en français = de Graeme Allright°
Suzanne takes you down to her place near the river
Suzanne t’emmène chez elle près de la rivière
You can hear the boats go by
Tu peux entendre les bateaux voguer(1)
You can spend the night beside her
Tu peux passer la nuit auprès d’elle
And you know that she’s half crazy
Et tu sais qu’elle est à moitié folle
But that’s why you want to be there
Mais c’est pour ça que tu veux rester
And she feeds you tea and oranges
Et elle te nourrit de thé et d’oranges
That come all the way from China
Qui ont fait tout le chemin depuis la Chine
And just when you mean to tell her
Et juste au moment où tu veux lui dire
That you have no love to give her
Que tu n’as aucun amour à lui donner
Then she gets you on her wavelength
Elle t’entraîne dans ses ondes
And she lets the river answer
Et laisse la rivière répondre
That you’ve always been her lover
Que tu es son amant depuis toujours
And you want to travel with her
Et tu veux voyager avec elle
And you want to travel blind
Et tu veux voyager les yeux fermés
And you know that she will trust you
Et tu sais qu’elle aura confiance en toi
For you’ve touched her perfect body with your mind.
Car tu as touché son corps parfait avec ton esprit.
And Jesus was a sailor
Et Jésus était un marin
When he walked upon the water
Quand il marchait sur l’eau
And he spent a long time watching
Et il passa très longtemps à observer
From his lonely wooden tower
Du haut de sa tour solitaire en bois
And when he knew for certain
Et quand il eût la certitude
Only drowning men could see him
Que seuls les hommes sur le point de se noyer pouvaient le voir
He said All men will be sailors then
Il dit tous les hommes seront des marins alors
Until the sea shall free them
Jusqu’au moment où la mer les libérera
But he himself was broken
Mais lui-même fut brisé
Long before the sky would open
Bien avant que le ciel ne s’ouvre
Forsaken, almost human
Abandonné, presque humain
He sank beneath your wisdom like a stone
Il sombra sous ta sagesse comme une pierre
And you want to travel with him
Et tu veux voyager avec lui
And you want to travel blind
Et tu veux voyager les yeux fermés
And you think maybe you’ll trust him
Et tu penses que peut-être tu lui feras confiance
For he’s touched your perfect body with his mind.
Car il a touché ton corps parfait avec son esprit.
Now Suzanne takes your hand
Maintenant Suzanne prend ta main
And she leads you to the river
Et te conduit à la rivière
She is wearing rags and feathers
Elle est vêtue de haillons et de plumes
From Salvation Army counters
Venant des guichets de l’Armée du Salut
And the sun pours down like honey
Et le soleil coule comme du miel
On our lady of the harbour
Sur notre dame du port
And she shows you where to look
Et elle t’indique où regarder
Among the garbage and the flowers
Au milieu des déchets et des fleurs
There are heroes in the seaweed
Il y a des héros dans les algues
There are children in the morning
Il y a des enfants dans le matin
They are leaning out for love
Ils s’inclinent par amour
And they will lean that way forever
Et ils s’inclineront ainsi pour l’éternité
While Suzanne holds the mirror
Pendant que Suzanne tient le miroir
And you want to travel with her
Et tu veux voyager avec elle
And you want to travel blind
Et tu veux voyager les yeux fermés
And you know that you can trust her
Et tu sais que tu peux lui faire confiance
For she’s touched your perfect body with her mind.
Car elle a touché ton corps parfait avec son esprit.
(1) littéralement passer ( mais fallait éviter la répétition de passer )
Merci à : w.lacoccinelle.net
_____________________________
le 13 novembre 2016,
(modifié le 21 juin 2017)
La légende folk Leonard Cohen s’est éteinte jeudi. Cohen devait son tube planétaire à une danseuse hippie de Montréal, Suzanne Verdal, qui l’obséda toute sa vie.
Leonard Cohen est mort jeudi. (Reuters)
A-t-elle écouté son dernier album, You Want It Darker, chant funéraire paru il y a trois semaines? C’est peu probable. Écouter Leonard Cohen lui était devenu insupportable. Pourtant, qui d’autre connaissait mieux la légende folk, le plus sérieux concurrent de Bob Dylan, qui s’est éteint jeudi à l’âge de 82 ans? Justement, Suzanne Verdal le connaissait peut-être un peu trop. Le chanteur lui doit son premier succès et probablement la plus belle histoire d’amour de ce séducteur impénitent. Plutôt que de lui offrir son corps, la femme qui survit aujourd’hui avec ses rêves hippies dans un cabanon au bord du Pacifique, lui a inspiré la chanson qui restera à jamais associée à son œuvre.
L’histoire de Suzanne commence au début des années 1960. Poète et écrivain sans le sou, Leonard Cohen retrouve au Vieux Moulin, un club de jazz de Montréal, son ami, le sculpteur Armand Vaillancourt, dont la complicité avec sa très jeune fiancée sur la piste de danse le fascine. Trois ou quatre ans passent. Son ami a divorcé de sa danseuse. À l’été 1965, Leonard Cohen décide de rendre visite à la belle dans la maison au bord du fleuve Saint-Laurent, où elle élève seule sa fille, Julie.
Dans les rues de Montréal, ils se promènent à l’unisson, allument des bougies à l’église Notre-Dame-de-Bon-Secours. Chez elle, Suzanne lui offre du thé venu de Chine. « Nous n’avons jamais été amants sur un plan physique s’entend, c’était beaucoup plus profond que cela. Vous savez combien Leonard est un homme sexuel! Il est très attirant pour les femmes et je ne voulais pas être une de plus dans la foule », confiera Suzanne Verdal. « C’était un loft à une époque où l’on ne connaissait pas l’existence de ce mot. Elle m’a invité en bas à prendre du thé avec des zestes d’orange dedans. Les bateaux passaient devant les fenêtres et je touchais son corps parfait par l’esprit, faute de pouvoir faire autrement », racontera Leonard Cohen.
La chanson naît d’abord sous forme d’un poème, Suzanne Takes You Down. Quand le chanteur le psalmodie à Judy Collins au téléphone, elle lui demande d’en faire une chanson qu’elle enregistre en premier. Puis Suzanne ouvre en 1967 le premier album de Leonard Cohen, Songs of Leonard Cohen, avec pour autre succès, So Long Marianne, inspirée par Marianne Jensen, encore une ex-épouse d’un de ses amis artistes, avec laquelle Leonard Cohen vivra. Mais les histoires qui se concrétisent n’ont pas le privilège de l’éternité. Leonard Cohen rencontrera une autre Suzanne (Elrod), avec qui il aura deux enfants. La première devient un classique, bientôt repris par les compagnes et muses de Bob Dylan, Joan Baez et Françoise Hardy, mais aussi plus tard par la chanteuse de Abba, Anni-Frid Lyngstad, Graeme Allwright ou Alain Bashung. Leonard Cohen comparera sa Suzanne à un Château Latour de 1982.
À la fin des années 1970, Leonard Cohen se produit à Minneapolis. Suzanne Verdal s’est acheté un billet et vient le voir dans les coulisses à la fin du concert. « Tu m’as offert une belle chanson », la remercie le chanteur, devenu une superstar. Celle qui a voyagé de San Francisco à New York via Paris est retournée vivre à Montréal, où elle élève trois enfants de trois pères différents, toujours seule. Vingt ans après l’été 1965, Leonard Cohen est lui aussi à Montréal, où il reprend ses promenades lorsqu’il aperçoit sur la place Jacques-Cartier un spectacle de rue. Il s’approche, la danseuse le remarque. C’est Suzanne qui se présente à lui en mimant une révérence. Brutalement, il tourne les talons. On ne saura jamais pourquoi et s’il l’a reconnue ou bien ignorée.
En 1999, la danseuse tombe d’une échelle. Dos et poignets brisés. L’ancien rayon de soleil du Vieux Moulin ne peut plus enseigner la danse et sombre dans la dépression. Sa chanson la poursuit jusque dans les restaurants, qu’elle quitte dès qu’elle en entend les premières notes. Sans aucune ressource, elle est sans-abri à Los Angeles, survivant sur un parking de Venice Beach. L’eau toujours devant soi mais sans amour. L’ancienne fille qui faisait tourner la tête à toute la Beat Generation ne se doute pas que son ancien prétendant a déménagé à quelques kilomètres. Il vit dans un monastère bouddhique sous le nom de Jikan.
Ils ne se reverront plus jamais. En 2008, Leonard Cohen reprend la route, ruiné par sa manageuse mais sauvé par Suzanne. La vraie n’écoute plus la chanson, mais a gardé les mêmes « haillons », ce manteau de bohème qu’elle n’a jamais quitté.
Source: JDD papier
www.lejdd.fr

Le prix Goncourt a été décerné ce matin mercredi 3 novembre 2021 à l’écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr, 31 ans, pour son roman « La plus secrète mémoire des hommes » édité chez Philippe Rey. Il est « l’un des meilleurs romans de cette rentrée littéraire » (François Busnel, F5_ 09.09.2021_ LGL.)
« Mohamed Mbougar Sarr signe l’un des meilleurs romans de cette rentrée littéraire. « La plus secrète mémoire des hommes », chez Philippe Rey, est une quête labyrinthique qui dit le pouvoir de la littérature. » (Vidéo La Grande librairie 9.09.2021)
Chez Busnel il évoque
À écouter et à lire Mohamed Mbougar Sarr.
_______________________________
En 2018, Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, découvre à Paris un livre mythique, paru en 1938 : Le labyrinthe de l’inhumain. On a perdu la trace de son auteur, qualifié en son temps de « Rimbaud nègre », depuis le scandale que déclencha la parution de son texte. Diégane s’engage alors, fasciné, sur la piste du mystérieux T.C. Elimane, se confrontant aux grandes tragédies que sont le colonialisme ou la Shoah. Du Sénégal à la France en passant par l’Argentine, quelle vérité l’attend au centre de ce labyrinthe ?
Sans jamais perdre le fil de cette quête qui l’accapare, Diégane, à Paris, fréquente un groupe de jeunes auteurs africains : tous s’observent, discutent, boivent, font beaucoup l’amour, et s’interrogent sur la nécessité de la création à partir de l’exil. Il va surtout s’attacher à deux femmes : la sulfureuse Siga, détentrice de secrets, et la fugace photojournaliste Aïda…
D’une perpétuelle inventivité, La plus secrète mémoire des hommes est un roman étourdissant, dominé par l’exigence du choix entre l’écriture et la vie, ou encore par le désir de dépasser la question du face-à-face entre Afrique et Occident. Il est surtout un chant d’amour à la littérature et à son pouvoir intemporel.
In : www.leslibraires.fr/livre
__________________________________
°
CLIIQUER ICI POUR LIRE LA VIDÉO
°
________________________________
°
CLIQUER ICI POUR LIRE LA 2° VIDEO
(agrandir la vidéo pour lire les commentaires en bas de page)
°
_______________________________

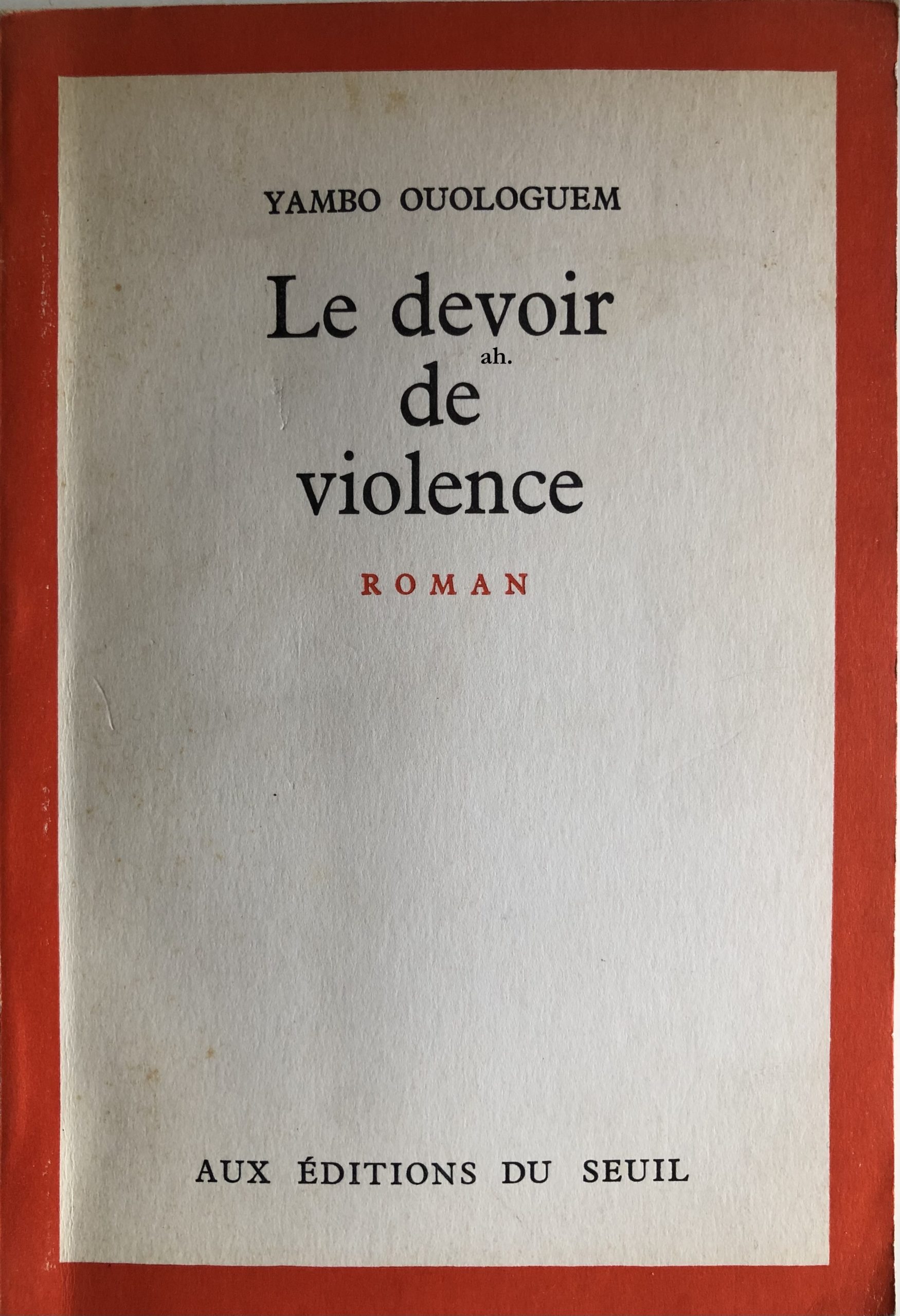
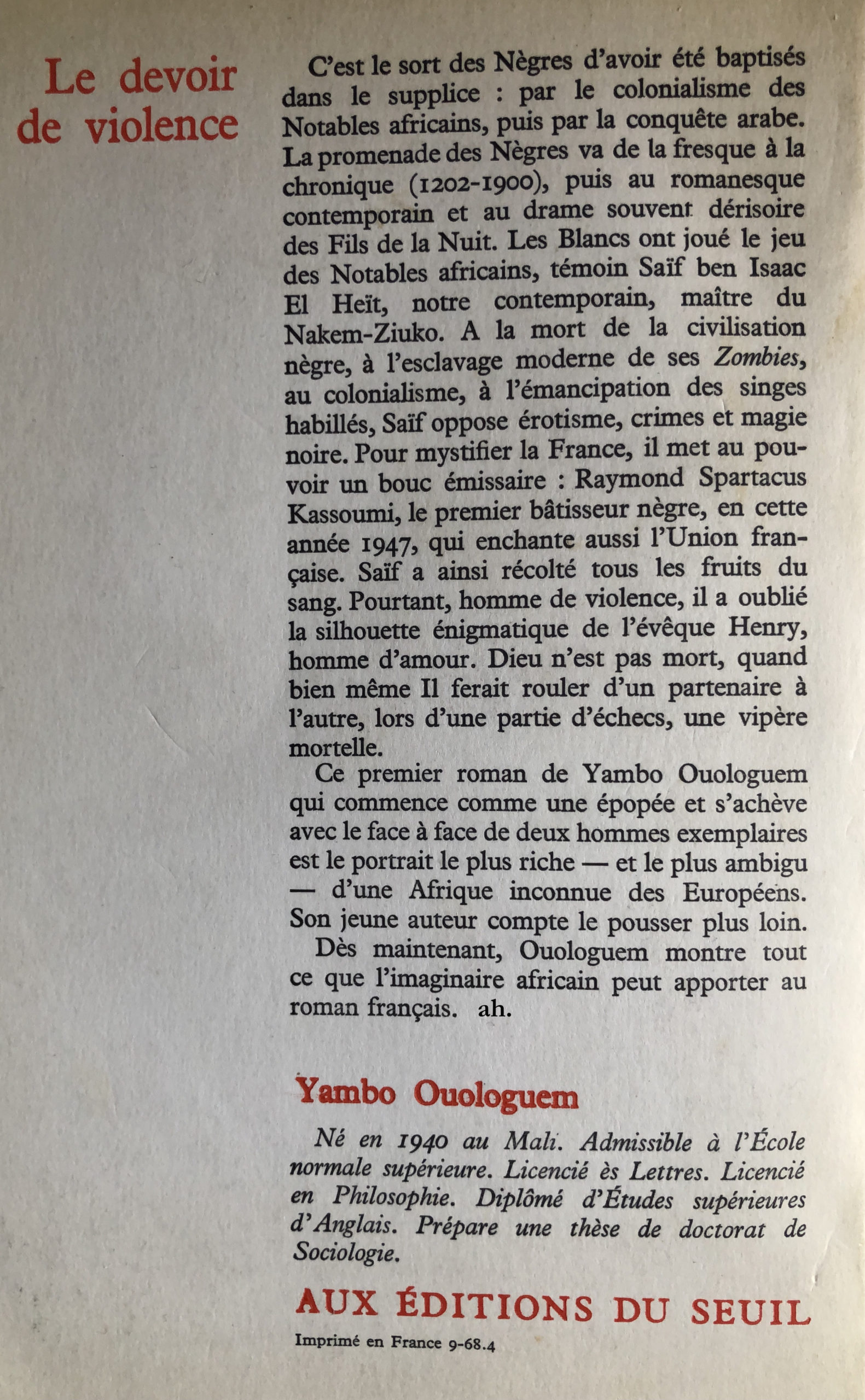
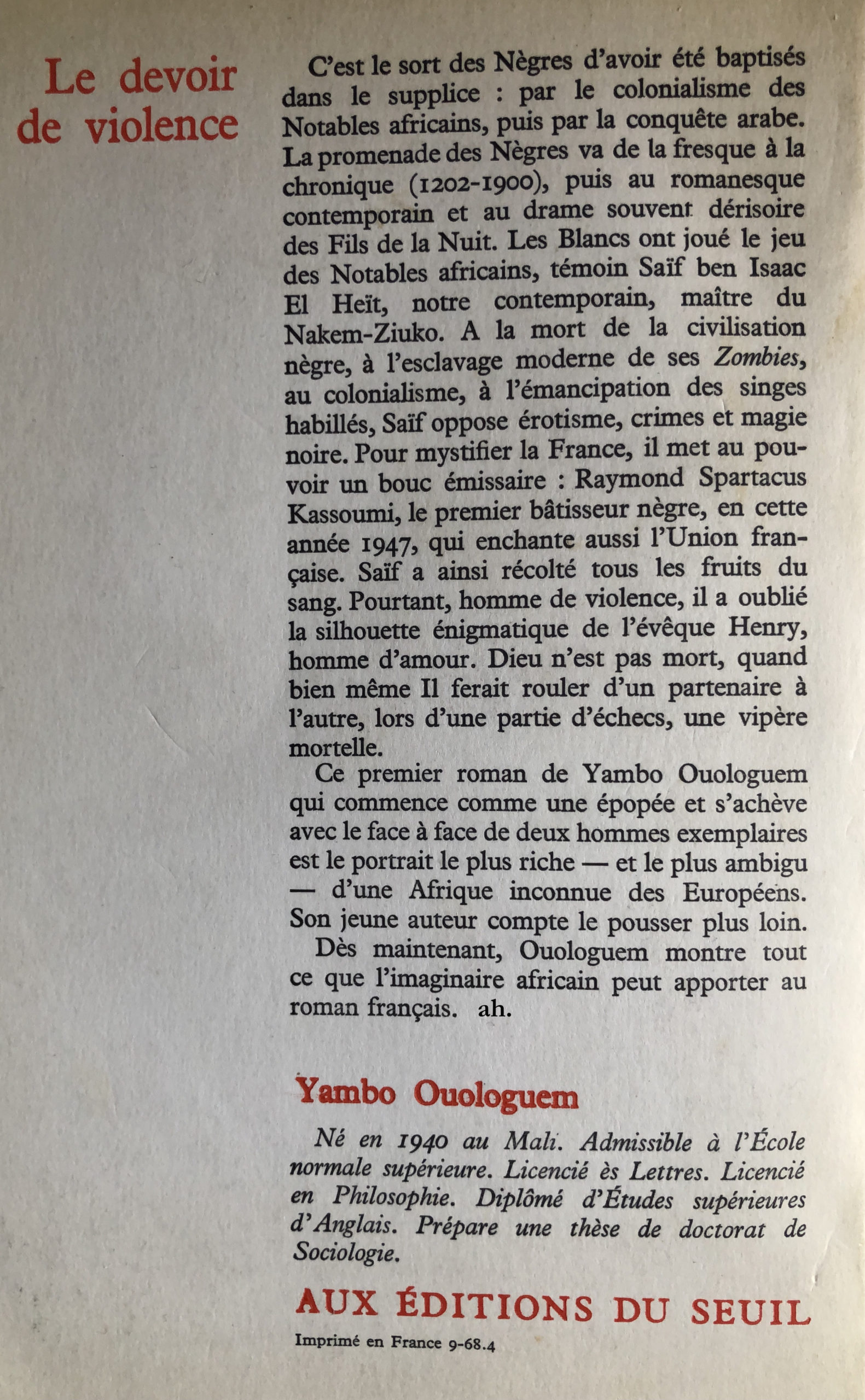

____________________________
°
CLIQUER ICI POUR LIRE DES EXTRAITS DU ROMAN DE MOHAMED MBOUGAR SARR
°
____________________________________________________________
Bibliobs.
10 choses à savoir sur Mohamed Mbougar Sarr
L’inattendu lauréat du Goncourt 2021 est un jeune auteur sénégalais coédité par deux petites maisons d’édition indépendantes.
Par Arnaud Gonzague
3 novembre 2021
1. Surprise
Sur le papier, le Goncourt 2021 n’avait rien pour décrocher ce Graal. Natif de Dakar (Sénégal) en 1990, Mohamed Mbougar Sarr n’appartient pas au « milieu », n’habite pas Paris, mais Beauvais (Oise) et son roman, « la Plus Secrète Mémoire des hommes », est copublié par Philippe Rey et Jimsaan – deux maisons d’édition indépendantes fort éloignées des habituels favoris du prix.
2. Sang-froid
Là où le journaliste s’attend à rencontrer un tout jeune écrivain, surexcité d’avoir été reconnu, il tombe sur un vieux sage de 31 ans, sourire discret, phrasé choisi : « Il faut accueillir les choses comme elles viennent, avec joie mais lucidité. Ce qu’on appelle le succès est très relatif. Je m’inspire des stoïciens : n’agir que sur ce qui dépend de nous. Et moi, je ne peux agir que sur l’écriture. »
3. Carton
Pourtant, sa « Plus Secrète Mémoire des hommes », qui lui a réclamé trois ans de travail, a connu une fortune commerciale et critique inattendues. Après plusieurs réimpressions, il a déjà été diffusé à 30 000 exemplaires grâce à un vif bouche-à-oreille. « Nous avons reçu vingt-trois demandes de traductions et plusieurs coups de fil de producteurs, c’est un record pour notre maison ! », s’exclame son éditeur Philippe Rey.
4. Enquête
Comment expliquer pareil succès ? Le récit est porté par une enquête, menée par un jeune écrivain africain sur les traces d’un autre auteur africain, le mystérieux T.C. Elimane. Ce dernier a publié en 1938 un chef-d’œuvre, « le Labyrinthe de l’inhumain », qui lui vaut le surnom de « Rimbaud nègre ». Hélas, Elimane a sombré dans le déshonneur après qu’un expert a trouvé son roman trop copié-collé sur une cascade d’auteurs classiques. Que s’est-il passé au juste et qu’est devenu l’auteur maudit ? C’est tout le nœud de l’intrigue.
5. Histoire vraie
Si Elimane est inventé, Mbougar Sarr s’est inspiré de la figure de Yambo Ouologuem, auteur malien récompensé par le Renaudot et accusé en 1972 d’avoir trop « emprunté » à d’autres, notamment Graham Greene. « Ouologuem est rentré au pays, humilié et n’a plus parlé. C’est un sort injuste, car il n’a plagié personne. Il s’agissait d’un jeu littéraire plein d’ironie. Mais un auteur africain a-t-il le droit de jouer avec les classiques de l’ancien colon ? »
6. Labyrinthe
Qu’on n’attende pas avec « la Plus Secrète Mémoire des hommes « un « roman africain » : Mbougar Sarr s’inscrit plutôt dans la lignée des grands bâtisseurs de labyrinthes narratifs, comme Jorge Luis Borges, Roberto Bolaño ou Witold Gombrowicz. L’intrigue repose ainsi sur une succession de récits enchâssés, dans divers formats (journal intime, articles de presse, mail…), à diverses périodes historiques et sur plusieurs continents. Pourtant, petit miracle : le lecteur ne s’y perd jamais !
7. Militaire
Mbougar Sarr, fils de médecin généraliste, a passé son enfance à Diourbel, petite ville à l’ouest du Sénégal, avant d’intégrer l’établissement le plus prestigieux du pays, le Prytanée militaire de Saint-Louis. « J’ai hésité à devenir officier avant de me décider pour la littérature. Les deux vocations ont des points communs, d’abord une certaine discipline morale. En littérature, cette éthique vous fait refuser toutes les facilités et ce qui réduit un roman à un produit de consommation. »
8. Saint-Cyr
Le jeune bachelier se paie même le luxe de dédaigner Saint-Cyr, l’école militaire française d’élite, pour intégrer une classe prépa littéraire. Il quitte le Sénégal et atterrit donc au lycée Pierre d’Ailly, à Compiègne (Oise). « Un ami de mon oncle, qui vivait en France, pensait que je ne supporterais pas l’ambiance cannibale des grandes parisiennes. Je lui en sais gré ! J’ai été très bien accueilli, je tiens à le souligner. »
9. Etranger
Bien que vivant dans l’Oise depuis une douzaine d’années et ayant pour compagne une Française, il ne songe pas à demander la nationalité française. « Je ne suis pas en couple avec la France, plutôt en relation libre. Etre étranger est la position idéale pour toujours redécouvrir ce pays, même si ça ne simplifie pas les choses, notamment quand vous devez prendre l’avion ! » Il caresse même le projet de retourner vivre au Sénégal.
____________

Entrée de la bibliothèque l’Alcazar (Marseille) (exceptionnellement quelques travaux…)
(lire en bas de texte la vidéo réalisée à partir de la soirée)
_______________________________________________________
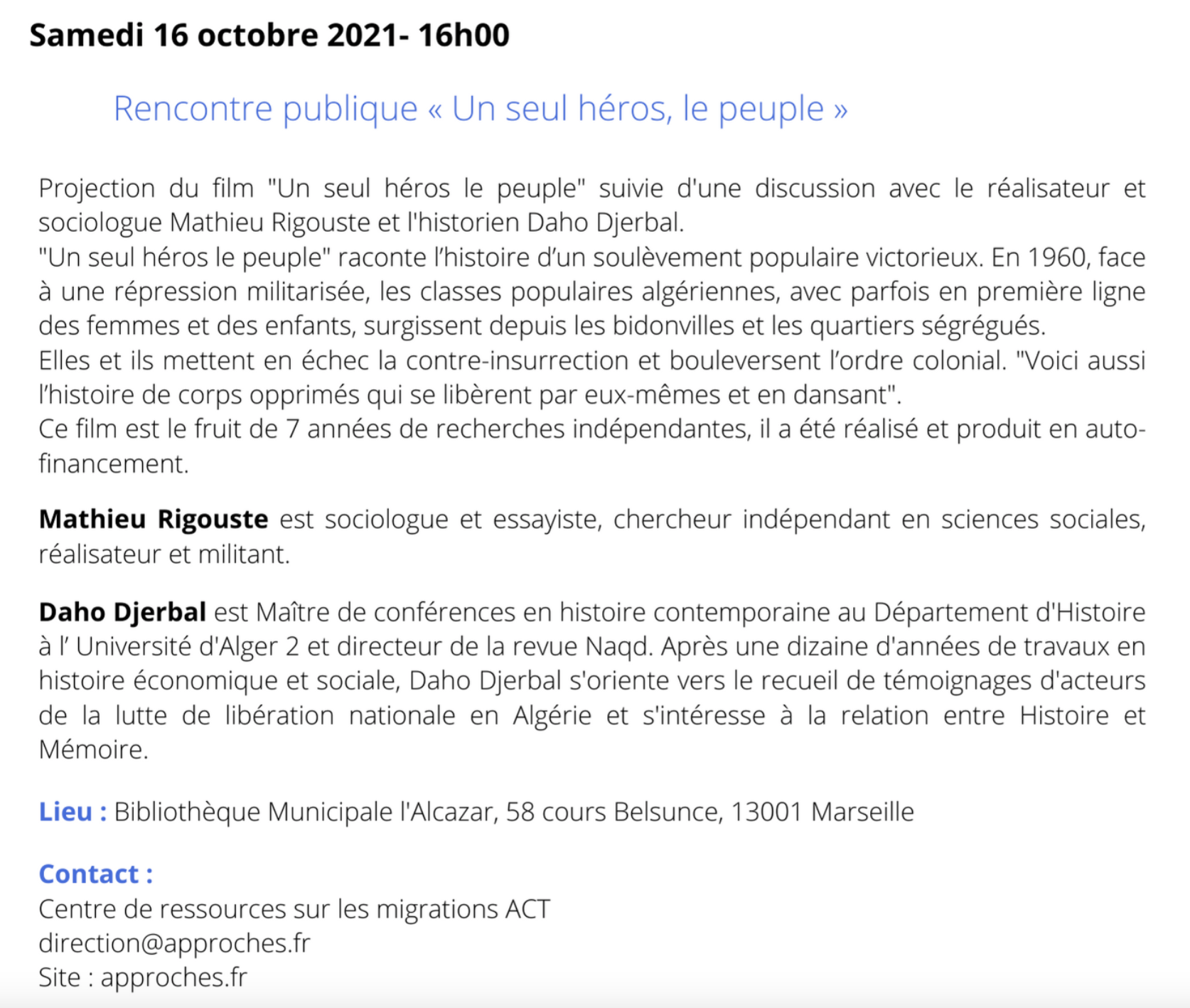
______________________________________________________

Nous avons assisté hier samedi 16 octobre 2021 à la projection du film « Un seul héros, le peuple » (détail en regardant la vidéo) à la bibliothèque l’Alcazar (Marseille). Nous étions entre 100 et 150 personnes. Il y eut une courte présentation, puis la projection du film (80 minutes) et enfin ont suivi les questions et réponses.
Ma question, adressée à Mathieu Rigouste réalisateur du film, a été celle-ci : Vous montrez dans votre film des manifestations du Hirak en 2019 (contre le régime algérien). Est-ce un clin d’œil aux manifestations de décembre 1961 (pour l’indépendance) objet de votre film ? Est-ce que l’Histoire bégaie ? La réponse c’est Daho Djerbal qui s’y colle : « L’histoire ne se répète pas. Il y a quelqu’un que vous connaissez tous qui a dit ‘‘l’histoire ne se répète jamais, et si ça arrive, la première fois c’est sous forme de tragédie, la seconde fois sous forme de farce’’ (a). Donc tout historien qui fait un travail, il y a une mise en contexte et chaque contexte plaide pour lui-même sans faire des extrapolations, donc l’histoire ne bégaie pas.
Ce qui reste c’est le regard du dominant sur le dominé. Et donc la dialectique quand je parlais tout à l’heure du maître et de l’esclave se poursuit y compris après l’indépendance.
À l’indépendance il y a eu une bouffée d’angoisse, ce qui a été très bien décrit (dans le film), et cette bouffée d’angoisse c’est quoi ? On a chassé ‘‘les autres’’ qui étaient sur notre terre, mais ‘‘l’autre’’ après l’indépendance est toujours en nous.
Alors le problème c’est comment se débarrasser de ‘‘l’autre’’ qui est en nous ? Et donc c’est tout une autre histoire qui n’est pas encore finie. »
Sur des œufs notre ami Daho.
________
(a) Au début de ‘‘Le Dix-huit brumaire de Napoléon Bonaparte’’ (1852) Karl Marx écrit : « Hegel fait remarquer quelque part que, dans l’histoire universelle, les grands faits et les grands personnages se produisent, pour ainsi dire, deux fois. Il a oublié d’ajouter : la première fois comme tragédie, la seconde comme farce. » Ou comment des bouffons peuvent devenir des « héros » – ah.
_____________________________________
.
CLIQUER ICI POUR VOIR LA VIDÉO RÉALISÉE À PARTIR DE CETTE SOIRÉE À L’ALCAZAR
.
____________________________________
Pour le fun…




Depuis quelques jours, le quotidien algérien LIBERTÉ ouvre ses feuilles aux gens de lettes, qu’ils soient libraires, éditeurs, auteurs, critiques… Nous reproduisons ci-dessous ces interventions.


Par Hana Menasria, le 23-09-2021
SELMA HELLAL, COFONDATRICE DES ÉDITIONS BARZAKH
“La littérature nourrit l’imaginaire et façonne un individu libre”
“Alors que les espaces de liberté se réduisent comme peau de chagrin, ici en Algérie, et que notre aptitude à penser, à rêver, semble comme neutralisée, sous l’effet de l’épuisement, du désenchantement, de la peur aussi. La littérature nourrit l’imaginaire et, ce faisant, façonne un individu libre.”
Liberté : Vous êtes la cofondatrice des éditions Barzakh, qui viennent de célébrer leur 20e anniversaire. Pourquoi avoir choisi l’édition ?
Selma Hellal : Était-ce une vocation ? Pour Sofiane Hadjadj, mon compagnon et partenaire dans l’aventure, assurément. Quant à moi, le métier est venu à moi comme je suis venue à lui par une série de concours de circonstances – dont celle, décisive, de ma rencontre avec Sofiane. En guise de boutade, je serais tentée de détourner la fameuse formule de Samuel Beckett, qui, à la question “Pourquoi écrivez-vous ?” répondait : “Bon qu’à ça.” Nous pourrions également faire nôtres ces mots de l’éditeur Jean-Jacques Pauvert, extraits de ses mémoires(1) : “Les livres, c’est un monde à part. Un monde de fête. Un monde secret. Chacun, je suppose, a le sien, comme moi.”
Est-il commode de vivre de ce métier en Algérie ?
Non, surtout quand on est un éditeur indépendant qui, de surcroît, ne peut compter ni sur des mécanismes rodés et récurrents de soutien à l’édition pensés par une politique publique du livre, ni sur la manne du livre scolaire et parascolaire. D’ailleurs, il n’est pas étonnant que, souvent, dans l’histoire de l’édition, les éditeurs indépendants viennent d’un milieu relativement aisé. Il n’est que de citer deux éditeurs français : François Maspero (il paraît qu’il se plaisait à se décrire comme “un bourgeois qui trahit la bourgeoisie”) ou Jérôme Lindon des éditions de Minuit.
Ils n’ont pu mener à bien leur aventure, au début du moins, que parce qu’ils avaient un capital économique et social leur permettant de faire face à l’adversité consubstantielle à l’exercice de la profession.
Nos trajectoires et catalogues ne sont en rien comparables, d’autant que nous ne nous sommes pas construits aux mêmes époques et dans le même pays, mais c’est bel bien un métier dont il est difficile de vivre, plus que jamais en Algérie. Il reste que Sofiane et moi sommes conscients de la chance que nous avons, celle d’avoir pu faire d’une passion un métier. C’est un luxe.
Les libraires ont du mal à “survivre”. Cette situation est-elle due à l’absence d’un lectorat ou à d’autres raisons ?
Il faudrait des études, des recherches, des sondages pour donner une réponse étayée et documentée. (Je salue ici l’initiative de Hadj Miliani, décédé il y a quelques jours, qui, secondé par un collectif, menait depuis des années, avec endurance, une enquête d’envergure sur le secteur de l’édition et le lectorat en Algérie.) Le lectorat existe sans aucun doute, en tout cas il est plus nombreux que celui qui fréquente la librairie : c’est un lectorat “dormant”, pour ainsi dire, qui se révèle, se donne à voir, lors du Sila, des conférences à l’université (où les amphis sont souvent pleins), des trop rares rencontres organisées dans les maisons de la culture, des salons du livre locaux.
Mais la librairie (comme tant d’autres maillons de la chaîne du livre) est en danger : elle aurait besoin d’être soutenue, de bénéficier d’allègements fiscaux, elle aurait besoin que son personnel soit formé, que son essaimage à l’échelle du pays soit encouragé par des mécanismes d’aide systématiques et finement réfléchis. Est-il concevable que le plus grand pays d’Afrique en termes de superficie, peuplé de 44 millions d’habitants, n’ait que 15 à 20 librairies dignes de ce nom sur tout son territoire ? Nous sommes loin de la librairie considérée, sous d’autres cieux, comme un “commerce de première nécessité”.
Selon vous, quel est l’intérêt de la littérature dans la société ?
C’est une réponse bateau, mais je ne crains pas de la marteler encore et encore, aujourd’hui plus que jamais, alors que les espaces de liberté se réduisent comme peau de chagrin, ici en Algérie, et que notre aptitude à penser, à rêver, semble comme neutralisée, sous l’effet de l’épuisement, du désenchantement, de la peur aussi. La littérature nourrit l’imaginaire et, ce faisant, façonne un individu libre.
Elle crée un espace inaliénable, inviolable, où un “je” peut rêver, se confronter à l’altérité, à une infinité de mondes possibles, et donc cultiver sa liberté de pensée, son autonomie, sa capacité à réfléchir, à interroger – et donc remettre en question – les contraintes et les cadres que sa société, le système politique dans lesquels il vit lui imposent. N’est-ce pas d’une puissance inouïe ? Je me rappelle certains vendredis de mars-avril 2019, alors que nous vivions ces jours d’allégresse et d’effroi mêlés, j’étais, devant le déploiement des forces de sécurité, les fourgons anti-émeutes, les hélicoptères, les policiers en civil avec leur talkie-walkie, ceux en tenue – avec leurs casques, matraques, protège-tibia et protège-bras, tels des tatous androïdes –, hantée par le texte de Qui se souvient de la mer ? de Mohammed Dib. J’avais, de façon troublante, la sensation d’être un personnage de ce roman halluciné et extraordinairement subversif. Je convoque cette anecdote personnelle pour illustrer de manière très concrète, peut-être triviale, l’influence de la littérature sur l’intimité d’une conscience individuelle (avant même d’appréhender son impact sur la “société” en général), à l’origine d’une expérience intime où poétique et politique coïncident de manière vertigineuse. C’est la grâce de la littérature.
À votre avis, les auteurs algériens sont-ils assez impliqués dans les questions politiques, culturelles ou économiques du pays ?
Nous militons, Sofiane et moi, pour une littérature affranchie de toute idéologie et de tout message à délivrer. Nous aimons les eaux troubles de la complexité, les récits polyphoniques et diffractés, où tentent de se dire, de se mettre en mots, avec un souci de la langue et du style, plusieurs vérités et non une Vérité.
Selon nous, ces bruissements, ces grésillements ne peuvent se capter et se transcrire (comme on dit d’un sismographe qu’il transcrit les secousses et les grondements de la Terre) que si l’écrivain, dégagé de toute assignation, se concentre sur son œuvre d’écriture et exclusivement elle.
Ce qui, pour autant, ne l’empêche pas de se sentir intimement atteint par l’état du monde et de son pays, intimement re-lié aux autres et à l’humanité et de faire œuvre de citoyen et/ou de militant – oui, comment ne pas à être affecté par le caractère proprement indéchiffrable de ce que nous expérimentons aujourd’hui en Algérie, et de si difficile, de si douloureux à cerner et nommer ? C’est encore Mohammed Dib que je convoque, dont la trajectoire est à cet égard exemplaire : de l’engagement assumé de la Trilogie Algérie (1952-1957, période de la colonisation et de la guerre d’Indépendance) au “désengagement” radical (exemple de La Trilogie nordique, fin des années 1980, début des années 1990), avec des interventions intermittentes de textes à la forme singulière, éclats, constellations, plus ou moins aux prises avec des questions contemporaines (exemple, entre autres, de La Nuit sauvage, 1995).
Je le cite encore : “Je m’embarquais pour un voyage qui, sans me faire quitter ma terre encore, allait me conduire en terre inconnue et, dans cette terre, de découverte en découverte, et que plus je pousserais de l’avant, et plus j’aborderais de nouvelles contrées, plus je ferais, en même temps mais sans m’en douter, route vers moi-même.”(3) C’est ce qu’il nomme “Les voies de l’écriture”, lesquelles frayent bel et bien ailleurs loin des “questions politiques, culturelles ou économiques du pays” citées dans votre question.
Entretien réalisé par : Hana MENASRIA
1- Jean-Jacques Pauvert, La Traversée du livre, Viviane Hamy, 2004.
2- Tlemcen ou les lieux de l’écriture, Barzakh, 2020 (1re édition : La Revue Noire, 1994).
3- Idem.
_____________________
Elle fut Rock, mais aujourd’hui plutôt écrivaine, poète (plus qu’hier)
___________________________
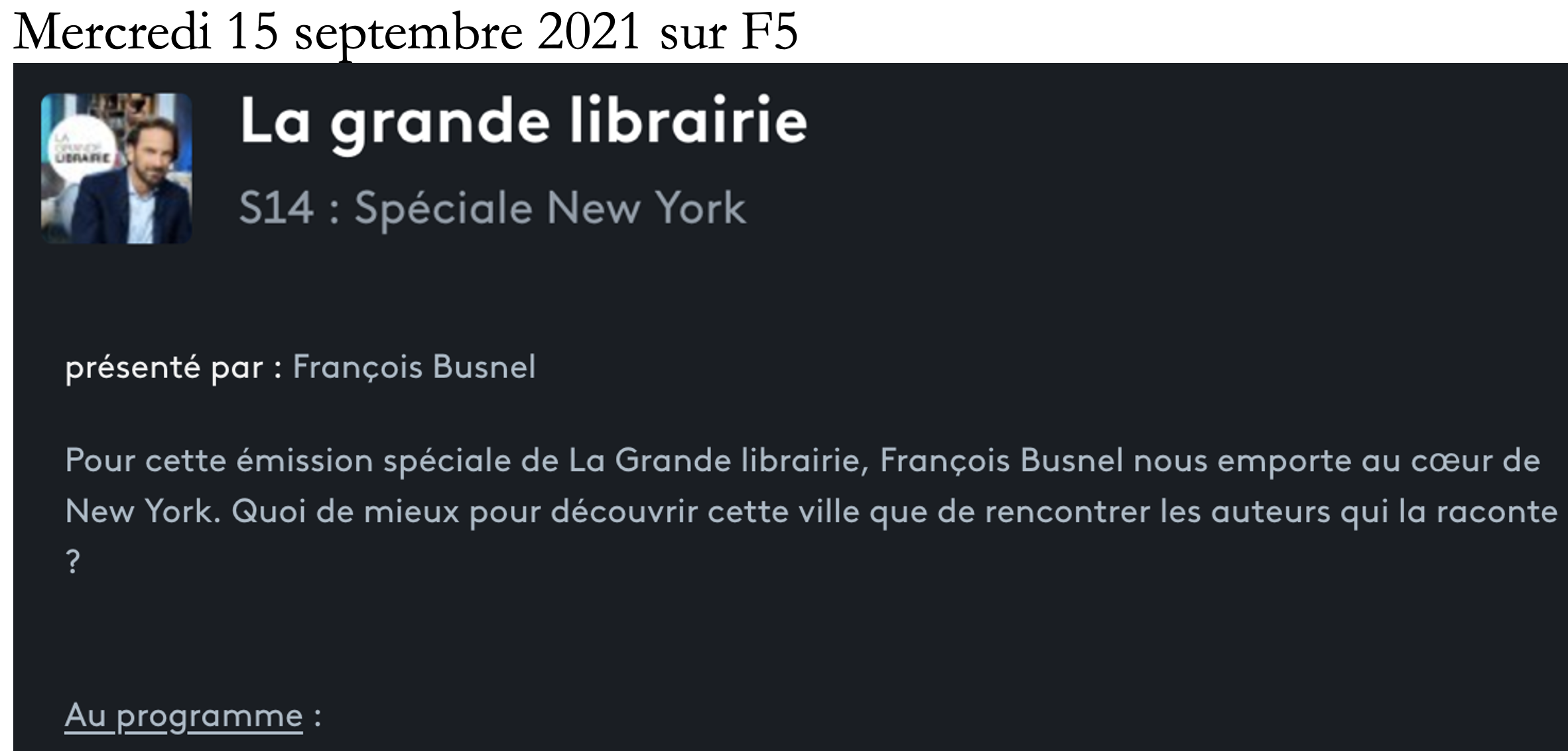

______________________________
.
CLIQUER ICI POUR ÉCOUTER/VOIR PATTY SMITH DANS LA GRANDE LIBRAIRIE
.
______________________________
.
CLIQUER ICI POUR ÉCOUTER « BECAUSE THE NIGHT » (c’était en 1977) FABULEUX
.
______________________________
les paroles
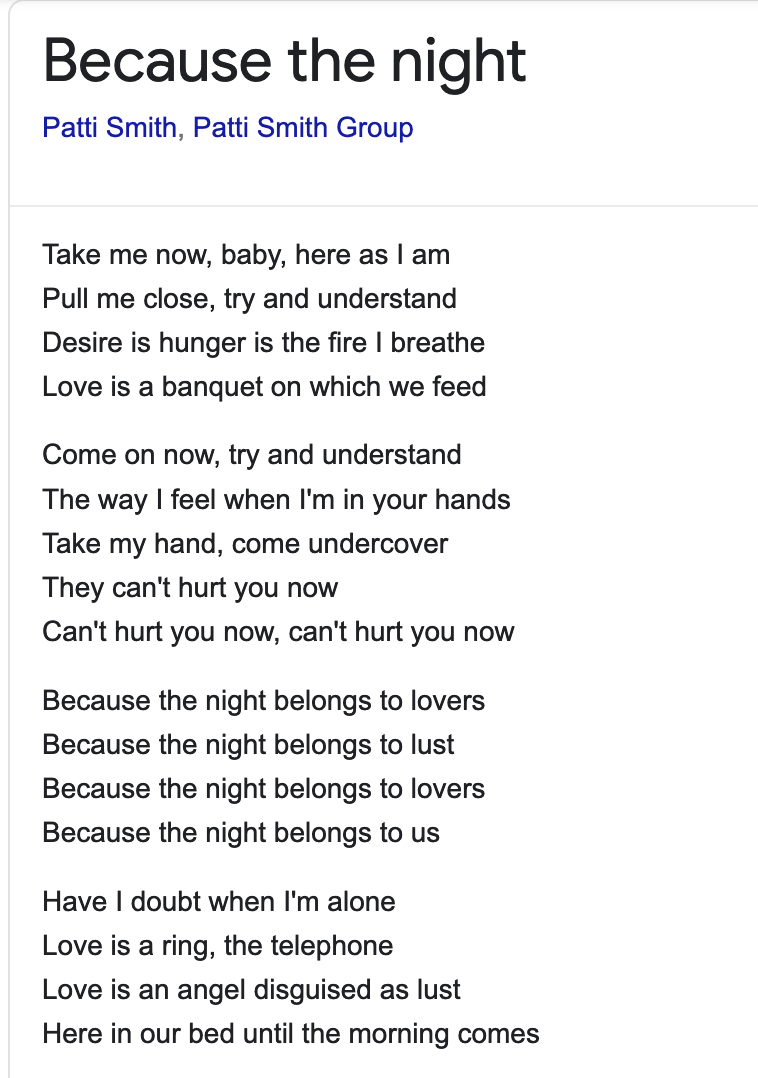
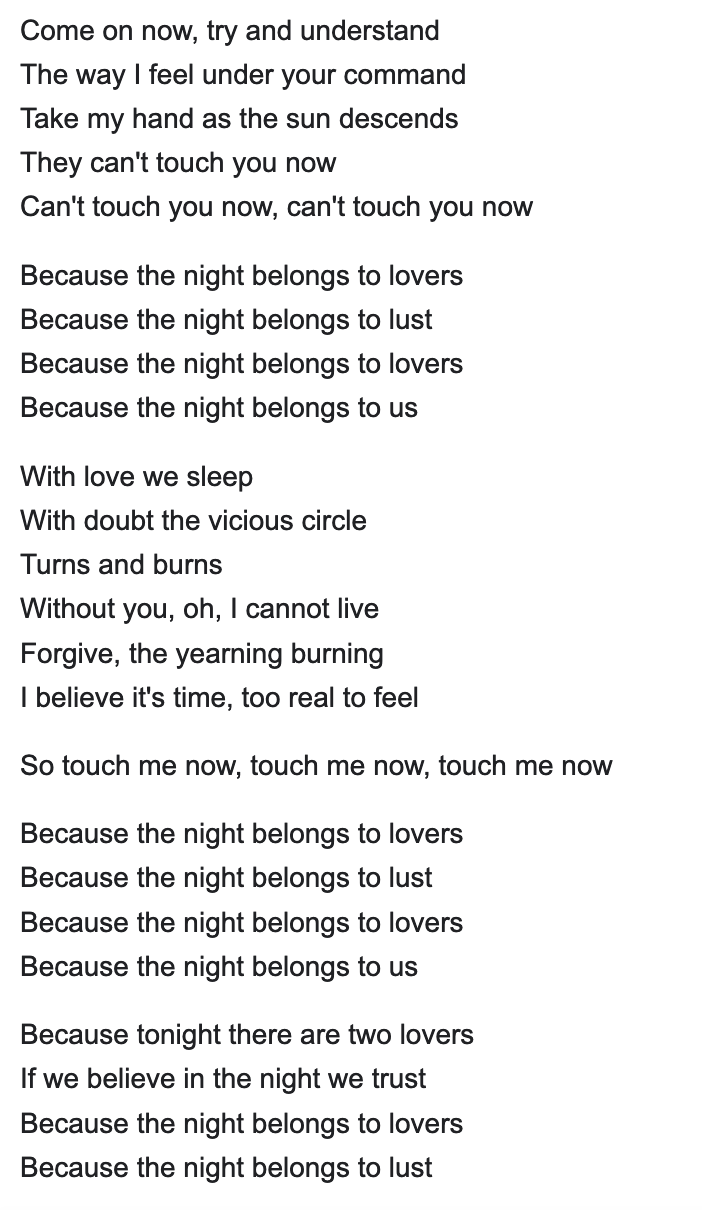
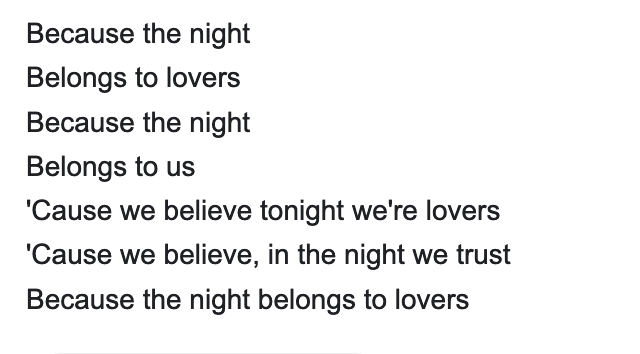
________ Source: LyricFind.______________
____________________________
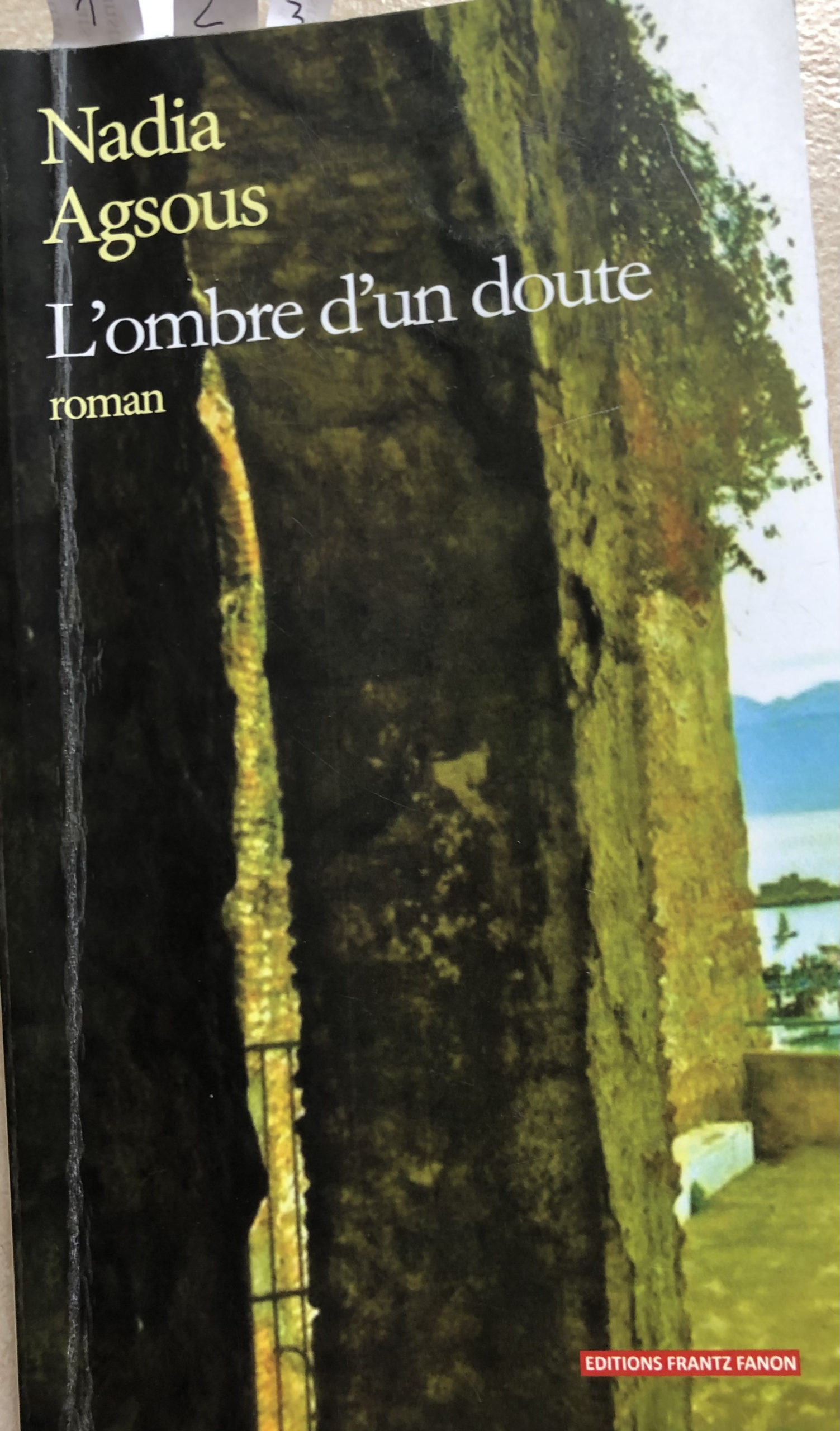
Ahmed Hanifi,
Jeudi 9 septembre 2021
« L’Ombre d’un doute » est un roman de Nadia Agsous. Édité par les Éditions Frantz Fanon, Boumerdès, 12. 2020. 147 pages. La photo de couverture a été prise devant le mausolée Sidi Abdelkader à Bejaïa, l’un des 99 saints de la région. On peut lire en quatrième de couverture : « Bent’Joy est une ville-légende qui traîne son passé comme un boulet. Toute idée de renouveau y est vécue comme une menace à son identité. « L’Ombre d’un doute », est un véritable conte moderne, qui se lit comme un poème épique ». Il est composé de sept courts chapitres et 17 sous-chapitres. Il développe l’intrigue sur quatre temporalités : la première marque l’arrivée de Sidi Akadoum en 1602 et le règne du « bon prince », la 2° est celle de Sa Majesté Le Pouilleux qui « haïssait Sidi Akadoum et qu’il a démis de ses fonctions et exilé », la 3° couvre le règne du fils de Sa Majesté Le Pouilleux « qui ne pense qu’à faire la fête », jusqu’à la fuite de la famille royale. La dernière enveloppe notre réalité. Le discours n’est pas linéaire, et les périodes et événements s’entrecroisent tout le long du livre. Il y a donc une difficulté pour qui s’attend à une intrigue simple, tels les composants d’une quelconque pièce de métier à tisser. Non, les fils de chaîne et de trame sont nombreux. Et les patrons divers et parfois complexes.
Ces temporalités ne sont pas linéaires donc. Ce qui est mis en avant ce sont les personnages et les événements qui les articulent et stimulent sur une trajectoire, un spectre de quatre siècles. Il y a de nombreux personnages, les principaux étant le narrateur, sa mère qui ne comprend pas son fils : « ah cette génération, il faut que vous le sachiez, cet homme (Sidi Akadoum) est notre sauveur » ; une autre femme dont la « voix est rocailleuse, une femme habitée par la folie blanche ». Nous ne connaissons pas leur nom. Et Sidi Akadoum. Ils traversent tous le roman sans trop insister sur la diachronie. Ce qui importe est l’événement.
Le cœur territorial est la ville de Bent’Joy (Bejaïa ?), embellie par une Montagne sacrée… et la pluie. La ville est repliée sur elle-même et « sa mémoire est engourdie, enlisée dans les sables mouvants de son histoire. » Sans difficulté, derrière la métaphore nous reconnaissons l’Algérie et les sempiternelles interrogations qui jaillissent dès que son nom est prononcé. Sont posées les questions de l’appropriation des identités nationales, leur construction, leur falsification « à outrance »… Mais pourquoi ce nom de Bent’Joy qui sent plus le vieux far west américain que la bougie éponyme (parfumée à la rose d’Austin) fierté des bougiotes.
Des créatures étranges apparaissent ici et là, à côté des autres personnages dans ce « conte moderne, de ce poème épique » (4° de couverture) dans des réalités fantasmées, dans une possibilité fardée d’ombres, sous le déluge : nous croisons des hommes « accoutrés de longues robes noires, arborant sur leurs fronts des bandeaux rouge-vermillon », ainsi que Athina et Amjah, deux êtres « à l’apparence fragile », toutes les inhumanités du monde,se concentraient dans leurs gros intestins… la pluie cinglait leurs visages… Ils burent goulûment leurs maux, en silence sans mot dire… Et ils avalèrent leurs mots, sans maudire… », mais aussi un « chat mort pourri, des crânes vomis, d’os se transformant en aigle noire », et enfin des anges de la Bienvenue à travers des spectacles de magie noire…
Des créatures étranges qui apparaissent également au travers les divagations du narrateur qui, pris de doute au milieu de la nuit, quitte sournoisement ou ‘‘ à bas bruit’’ (locution répétée) son lit pour s’installer dans la terrasse familiale où l’attendait « un petit être étrange ». Le narrateur vit une expérience fantastique. Le voilà errant « dans la nuit de mes rêves. Je traversais les âges. Je chevauchais les siècles… J’avançais lentement dans les dédales souterrains de mes errances existentielles lorsque surgit, devant mes yeux emplis de sommeil visqueux, le passé de Bent’Joy. » En son for intérieur il entendait la voix enjouée de sa mère qui « dissipait ma crainte, apaisait ma peur, distillait dans mon cœur l’envie d’affronter l’imprévisible et d’éclairer les zones d’ombres de l’histoire de Sidi Akadoum ».
Car il s’agit bien d’une paisible ville, Bent’ Joy, qui d’une part a été bouleversée par l’arrivée « à dos de chameau » d’un homme, Alââ di Paya el Mandouli, alias Sidi Akadoum, et de sa philosophie « qui aliène en douceur » et d’autre part va refuser que son identité soit emportée par la tempête de ce « prophète sans barbe, À la vie ! À la mort ! »
Sidi Akadoum arriva à dos de chameau, à l’aube du 20° jour de l’été de l’an 1602 (aucun lien à faire – ici – avec le 16.02 de l’an 19). « Sur la Côte d’Argent. D’abord un Boum ! On aurait dit un tremblement de terre. Un homme… et un animal… s’affalèrent sur le rivage ». Le vacarme fut tel qu’il ébranla la Montagne sacrée et effraya les habitants. Sidi Akadoum est « un être absent, sans visage, profondément ancré dans les confins de la mémoire collective ». Nous sommes amenés par le choix de mots, de lieux… à faire un rapprochement avec « un ensorceleur qui possédait des pouvoirs divinatoires », un Marabout, un idéologue islamiste, peut-être même Le prophète (la grotte, l’araignée, le Livre Saint, certains versets détournés… : « de la fragilité nous naissons. Dans la fragilité nous vivons. À la fragilité nous retournerons. »
Au lever du jour, Sidi Akadoum, inconnu alors, « baragouina quelques mots dans une langue étrangère aux habitants », il cligna des yeux et aboya. Son cauchemar prit l’allure d’un ‘‘verre de terre’’ qu’un oiseau de mer emporta. Trois mois après son arrivée, un « orage diluvien s’abattit sur la ville ». Il a plu nuit et jour durant une semaine. « Le ciel noir porta le lourd fardeau de la colère divine ». Les oracles convoqués par le prince prièrent, le roi sacrifia « une tonne de poules et de moutons ». En vain. Jusqu’à l’apparition de Sidi Akadoum. « Soudain, tout redevint calme. La mer se reconstitua en présence des habitants qui assistèrent à la scène en s’exclamant d’étonnement et de joie. » Le roi saisit cette occasion pour faire connaissance de Sidi Akadoum. « Aux yeux de la population, cet homme, qui était de plus en plus apprécié, était un faiseur de miracles, un sauveur. » « Cette intervention inaugura le début d’une amitié » qui mènera Sidi Akadoum jusqu’à la fonction de Vizir du « bon prince ». Sidi Akadoum « apprit la langue locale dans ses moindres détails et étudia minutieusement l’histoire, les mœurs des habitants. Partout il répandait la joie, il éblouissait, il séduisait ». Dans un livre il consignerait ses mémoires : « Le parchemin de mes années à Bent’Joy ».
Une des rares fausses notes sur le tableau d’accueil de Sidi Akadoum est une vieille femme, une folle, à la voix particulière. La « voix rocailleuse d’une femme habitée par la folie blanche irait dans les ruelles de Bant’Joy, mettant en garde contre « la prophétie de l602 », celle de Sidi Akadoum. « Ô gens de peu ! Maudissez le nid nuptial vide de Sidi Akadoum, Ô gens de rien ! Il étouffera votre parole !… » Elle le poursuivra longtemps. Cette femme habitée par la folie a-t-elle jamais côtoyé Léon-Gontran ? « Qu’attendons-nous/ les gueux/ les peu/ les rien…/ pour jouer aux fous/ pisser un coup/ tout à l’envi/ contre la vie/ stupide et bête/ qui nous est faite… » Peut-être.
La voix de la folle traverse le livre en italique et avec conviction et des mots lourds, appelant les citoyens de la ville à réagir, à ouvrir les yeux, à sortir de leur léthargie, à dénoncer « cet homme voleur de lumière », « la supercherie des siècles, il vous engloutira dans les ténèbres envoûtantes. » Nous renouons ici avec les temporalités indiquées plus haut. Le prince est mort, vive le Prince. Sa Majesté Le Pouilleux, qui succéda à son père « le bon prince », était exécrable, autoritaire. Il haïssait Sidi Akadoum qu’il a démis aussitôt de ses fonctions et exilé. Pour accélérer son départ il lui offrit biens et bétail que le bénéficiaire donna à son tour à des pauvres préférant vivre dans la discrétion. Mais « Pendant que Sa Majesté Le Pouilleux était persuadée qu’il avait quitté la ville, alors que les descendants de la lignée royale se faisaient la guerre, lui, Sidi Akadoum, ralliait à sa cause la population de Bent’Joy. » En deux ans ils adoptèrent sa philosophie « qui aliénait en douceur ». Les habitants édifièrent sur le Rocher flou, là même où il vivait, un mausolée en son honneur. Et il fut proclamé « Saint de tous les Saints ». Le lieu devint un lieu de pèlerinage où on venait chercher un « soulagement aux désordres intérieurs » attribués aux djinns.
Le Pouilleux, comme son père, mourut d’une chute. Il tomba du haut de la Montagne sacrée et mourut dans sa chute. Sa disparition fut accueillie « dans la joie et la liesse » par la population. « Les femmes investirent la rue annonçant la fin d’une ère et l’avènement d’une époque qu’elles embelliraient » Sidi Akadoum écrivit sur son cahier « Un Monde humanisé est désormais possible ! » Et les habitants y crurent. « La ville n’allait pas tarder à vivre des changements radicaux ».
La mère du narrateur (il y a là un saut temporel) se rend au mausolée de Sidi Akadoum avec d’autres femmes pour « offrir leurs corps et leurs âmes à l’absent vénéré ». Lui ne comprend pas qu’on puisse porter tant de dévotion à un être « Messie, Rassoul, Prophète » dont on ne sait « ce qu’il a fait pour Bent’Joy ? » « il y a fixé son existence », mais il n’en est pas originaire. La mère et son fils ne se comprennent pas. Pour elle, « cet homme est notre sauveur, il est le symbole de notre unité, il nous a rendu notre dignité, va vite te recueillir sur sa tombe ». Le narrateur, comme la femme à la voix rocailleuse, s’opposait à l’idéologie de cet homme vénéré par sa mère. Un jour il lui dirait : « Je la regarderais droit dans les yeux et lui avouerais ce que je pensais de Sidi Akadoum, cet homme qui avait emprisonné tant d’âmes, bluffé les plus crédules… »
« Une procession d’hommes et de femmes marchaient sous la pluie battante. Je les voyais avancer main dans la main, piétinant leurs traumatismes et conjurant le malheur des années passées sous le règne de la médiocrité obscure. » Vingt et unième siècle. « L’aube des jours heureux faisait son entrée dans la légende primitive. Je m’agrippai au sommeil qui m’emportait jusqu’aux confins de mes origines lointaines. » Bent’ Joy « toujours belle et désormais rebelle », se purifiait sous la pluie battante, de ses impuretés primitives. Son avenir radieux se dessinait. Dès que les premières lueurs du jour caresseraient son visage, la femme à la voix rocailleuse irait boire le lait de dattes pour célébrer l’ensevelissement de la Prophétie de l’Aube 1602 dans le terreau des ténèbres.
Il faut seulement être patient et ne jamais rien lâcher comme dit la chanson « Notre réalité est la même/ et partout la révolte gronde/ Dans ce monde on n’avait pas notre place/… On lâche rien, on lâche rien…walou !… (HK et les Saltimbanks). Ne dit-on pas que la patience est mère de toutes les vertus ? Voilà donc un beau livre, hommage aux luttes des femmes et des hommes pour la réappropriation de leur réelle histoire, pour la vérité, pour la dignité, pour le futur. L’écriture est fluide. Le roman est agréable à lire.
Nadia Agsous utilise beaucoup l’énumération avec répétition de possessifs, de prépositions, de substantifs … pour appuyer une idée, mettre en relief une pratique, un déroulé d’action… exemple : « … après avoir erré pendant plus de deux années, de dune en dune, d’oasis en oasis, d’étendue de sable en étendue de sable, de bourgade en bourgade… », « il découvrait ses habits, leurs modes de vie, leurs mœurs, leurs atouts, leurs faiblesses… », « la ville perdit sa joie, ses couleurs, sa beauté, son allégresse, sa clémence », « chacun portait sur son dos un instrument de musique : un violon, une harpe, une mandoline, une derbouka, un tambourin », « ce jour-là j’avais osé, j’avais parlé, j’avais dit, j’avais usé du verbe, je n’avais pas mâché mes mots », « elle courait, elle allait et venait, elle portait, elle cuisinait, elle goûtait, elle donnait, elle comptait, elle sermonnait, elle félicitait, elle s’emportait, elle me lançait des regards chargés d’amour. »
Les personnages sont touchants, particulièrement La folle à la voix rocailleuse, même s’ils manquent d’épaisseur. Ici, nous basculons dans les réserves et il y en a d’autres. Nombre de fois il y a indistinction ou plutôt des va-et-vient délibérés entre le système du présent et celui du passé de sorte que la narration parfois nous échappe (je devrais relire le roman). Nous avons parfois cette sensation que la narration s’appuie sur une succession de faits froids au détriment de la description (portraits, états d’âme…) C’est peut-être un choix. Heureusement qu’il y a de nombreuses pages au discours direct (les paragraphes en italique). Par contre l’utilisation de mots généralement peu usités ou éruditsalourdit le texte. Je cite pour exemple : valétudinaires, animadversion, déhiscence, obombrer, à la venvole… Il y a aussi des expressions ou jeux de mots malheureux ou fautes d’inattention : de bouche en bouche, mâles en mal d’amour, elles acceptèrent ‘‘sans mot dire’’ ou ‘‘sans maudire’’ (avec répétition), L’architecture de ces résidences ‘‘étaient’’…, leur ‘‘héro’’, « ils dormaient à ‘‘points’’ fermés », son allure et sa démarche ‘‘fascinait’’…
Mais, heureusement, les passages poétiques qui glissent dans le roman sont nombreux et nous font vite oublier les écarts ci-dessus :- « J’errais dans les nuits de mes rêves. Je traversais les âges, je chevauchais les siècles, je comptais les années, je déréglais les ressorts du temps… j’avançais lentement dans les dédales souterrains de mes errances existentielles lorsque surgit devant mes yeux le passé de Bent’Joy. » – « L’aube des jours heureux faisait son entrée dans la légende primitive. Je m’agrippai au sommeil qui m’emportait jusqu’aux confins de mes origines lointaines. » – « Allez-vous-en ! votre vue nous est insupportable ! Allez cheminer…, Vos vies sont des tragédies…, Allez, disparaissez… » – « Une femme marchait à mes côtés. Le silence de ses pas apaisait. Il agissait sur mon âme comme une douce caresse aux senteurs de l’enfance heureuse et insouciante. Des effluves d’ambre se répandaient dans l’air. L’ambre de ma mère. L’ambre de ma jeunesse heureuse passée à courir après une promesse de magie ; cette senteur envoûtante qui dit l’ardeur de l’amour maternel résonnait dans mon corps avec une étonnante familiarité. L’ambre blanc avait le pouvoir de transformer la vanité du monde en promesse d’épanouissement. »
– À la lecture de la page 116, sans pouvoir me l’expliquer (le rythme, les mots ?), notamment de la longue tirade d’un des Grands Frères de la P’tite Mort « le plus âgé, le plus puissant, le plus pernicieux », je fus transporté dans les années 70, avec les paroles de La solitude de Léo ferré (qui fut un de nos marqueurs) .
Tirade du grand Frère : « Nous portons nos vies comme un haillon ravaudé. Nous avons été témoins du ravissement du cœur battant de vos esprits vifs, et dans l’aurore de vos vies à peine rougeoyantes, nous avons assisté au dépouillement de vos entrailles bouillonnantes. Nous avons surpris des mains drapées dans un tissu vert oindre vos corps d’huile du pessimisme… »
La solitude de Léo Ferré : « Les flics du détersif, Vous indiqueront la case, Où il vous sera loisible de laver, Ce que vous croyez être votre conscience, Et qui n’est qu’une dépendance de l’ordinateur neurophile, Qui vous sert de cerveau, Et pourtant… »
Poésie pour poésie, une attention particulière est à porter aux mots de la femme à la voix rocailleuse. On peut comprendre le combat de ces femmes et de ces hommes (ou même adhérer à leurs convictions) pour atteindre la vérité, retrouver leur véritable histoire, écrire leur Roman national inclusif. Le nôtre. Reste le cheminement et là…
Le lecteur algérien (mais pas seulement) a besoin de ce type de roman. C’est le premier de Nadia Agsous, une belle performance, sans l’ombre d’un doute.
Ahmed HANIFI
Marseille, jeudi 9 septembre 2021
ahmedhanifi@gmail.com
_______________________________
.
CLIIQUEZ ICI POUR ÉCOUTER NADIA AGSOUS PRÉSENTER SON ROMAN
.
______________________________
ET AUSSI…
LE QUOTIDIEN D’ORAN

L’ombre d’un doute de Nadia Agsous: Une ville, un mythe destructeur
par Faris Lounis
in Le Quotidien d’Oran, samedi 22 mai 2021
Quand les mythologies s’installent, lever le voile sur de telles occultations devient une gageure. La vérité est mensonge et l’histoire n’est qu’une berceuse qui veille gracieusement sur les aveugles qui ne veulent pas voir.
Ecrire une nouvelle histoire, par-delà le mensonge et la mythologie, n’est possible qu’à travers la remise en question du passé, d’une manière totale et absolue. Un nouveau regard est un nouveau départ. Nietzsche disait qu’ «il faut encore porter du chaos en soi pour pouvoir donner naissance à une étoile dansante» et le créateur doit faire danser, voire trembler, ceux qui voient l’avenir comme une répétition statique et religieuse du passé.
Le récent roman de Nadia Agsous, L’ombre d’un doute, aborde la trajectoire des étoiles dansantes, afin de démythifier certaines légendes enkystées. Ces légendes dont le poids est devenu insupportable ont fait régner, pendant un temps considérable, une léthargie innommable sur la ville et le peuple de Bent’joy.
La ville de Bent’Joy
Bent’Joy est une ville à la mémoire engourdie. Une ville amnésique repliée sur elle-même. Elle est paranoïaque et toute tentative de renouveau y est vécue comme une menace à son identité. Le mensonge ancestral ronge le ciment de ses murs. De quel mensonge s’agit-il ? De celui de Sidi Akadoum, érigé en élu de Dieu. Il est devenu un être omniprésent dans l’histoire et la mémoire collective de la ville. Il repose sous une tombe en pierre de taille sur une plateforme surplombant la mer : « Femmes et hommes, grands et petits, implorent sa bénédiction dans leurs moments de doute et de malheur. Les jours de semaine, ils se remémorent ses actes et ses paroles. Tous ensemble, d’une seule voix, main dans la main, ils l’adulent, louent ses vertus, célèbrent son courage et son sens d’abnégation et de sacrifice »1.
Par la force du hasard, cet individu devient le personnage principal d’une histoire défigurée et combien de fois réécrite. Lors des préparations précédant la célébration du centième anniversaire de sa disparition, le narrateur, s’interrogeant sur le sens du faste commémoratif dédié à Sidi Akadoum, demande à sa mère quel rôle a-t-il joué réellement dans le développement et l’épanouissement de la ville de Bent’Joy. Remontée par les questionnements de son fils, la mère réplique : « Comment oses-tu, fils indigne ? Hein ? Aurais-tu oublié que cet homme s’est sacrifié pour nous ? Qu’il nous a débarrassés des tyrans ? Qu’il nous a libérés des chaînes de l’inféodation ? Qu’il a enchaîné nos démons ? Qu’il nous a rendu notre dignité ? Ah, nos ancêtres doivent se retourner dans leurs tombes ! S’ils étaient encore de ce monde, ils châtieraient les incrédules de ta graine ! Va ! Va vite te recueillir sur sa tombe et implorer son pardon. Va, vite, fils de Satan ! »2.
Sidi Akadoum avait tout pour plaire et persuader. Une chevelure longue et noire. Des yeux couleur miel luisant comme le sable du désert. Il est venu de loin, sur sa monture, portant un Livre Sacré: «Cet homme que le vent sec et brûlant du désert expulsa vers les contrées douces et clémentes du nord fut subjugué par Bent’Joy et ses paysages qui dégoulinaient de beauté sauvage. La mer et ses tremblements, qui exaltaient une plainte douce et capricieuse, l’intriguèrent. La quiétude des nuits éthérées l’éblouit; elle raviva son envie de vivre et alimenta son désir de graver son empreinte sur des sépultures sans noms »3. Son installation à Bent’Joy fut saluée par tous, y compris les anges qui gardent la ville.
Le verbe de Sidi Akadoum
Son discours était superstitieux. Il ne parlait que du monde invisible. Il voyait de petits êtres malins partout et nulle part. Il glosait absurdement sur la relation pathologique des djinns avec la lumière. Ce discours absurde et bien enchaîné séduisait une foule largement naïve et crédule : «Durant ces nuits, à l’aide du miroir qu’il cacha dans la grotte du Rocher flou, Sidi Akadoum s’improvisait exorciste. Il avait réussi à faire croire qu’il possédait des pouvoirs lui permettant d’expulser les esprits malins des corps des femmes, des hommes et des enfants frappés par le destin maléfique. Ses prétendus dons de guérisseur des désordres psychiques étaient appréciés par la population bent’joyienne qui venait nombreuse solliciter son aide, lui, le mage adulé et glorifié sans modération »4. La charlatanerie de Sidi Akadoum ne faisait pas l’unanimité mais, hélas ! ceux qui contestaient son endoctrinement obscurantiste ne purent guère pallier la crédulité de la majorité de la ville.
Le jour où tout a basculé
Vendredi, journée sainte. La mère du narrateur prépare, avec les femmes de la ville, la grande célébration de l’ancêtre qui a sauvé leur ville, Sidi Akadoum. Les festivités se déroulent à Tiguemmi N’Ouguellid el Kheir. Comme tout parent désireux de transmettre ses rites et legs ancestraux, la mère du narrateur a trouvé l’occasion d’exprimer son mécontentement à l’égard de son fils. Voyant la révolte de ce dernier à l’égard de la tradition ancestrale, elle l’admoneste, tout en rappelant que le Saint de la ville est sacré et que cette dernière doit sa conservation à sa prédication, son Livre Sacré et sa bénédiction dont la source est son tombeau, lieu de pèlerinage et point névralgique de Bent’Joy.
Impassible, le fils ne cède rien à la tradition qui sacralise l’ignorance : « Je la regarderais droit dans les yeux et lui avouerais sans détour ce que je pensais de Sidi Akadoum, cet homme du hasard inopiné qui avait envoûté plusieurs générations, emprisonné tant d’âmes, bluffé les plus incrédules, trompé les plus malicieux, amadoué les plus tenaces et les avait enfermés dans un monde étriqué où la vie prenait l’allure d’un cercueil dans lequel chaque âme attend son départ ultime »5. Le constat du fils est le suivant : les Bent’Joyiens sont les prisonniers de la mémoire d’un fantôme, Sidi Akadoum. Et cet asservissement mémoriel et dogmatique ne pourra pas durer : « Le passé n’est pas une prison : il n’est pas une demeure éternelle. C’est un lieu mémoriel où chacun vient puiser des forces, méditer, se ressourcer, se reposer, trouver des réponses à des questions qui taraudent l’esprit, et prendre de la distance avec le présent pour mieux appréhender l’avenir. Aujourd’hui ne sera pas hier. Demain ne sera pas aujourd’hui. Lorsque le soleil se lèvera, la graine prendra. Une nouvelle génération naîtra »6. Mettre le passé au repos et dessiner les voies du renouveau, c’est ainsi que le narrateur décide de s’opposer à sa mère et aux obscurantistes de Bent’Joy.
La ville de Bent’Joy avait non seulement des personnes éveillées, mais aussi une ombre blanche qui veillait, depuis un temps immémorial, sur sa prospérité. Le jour où le narrateur a décidé de rompre avec la coutume commémorative et cultuelle qui ronge sa ville, l’ombre blanche fait son apparition, comme si par miracle, elle avait entendu l’appel au renouveau. Durant la procession du vendredi, la foule des croyants dociles a rompu avec sa léthargie : «Le lendemain à l’aube, dès que les premières lueurs du jour caresseraient son visage, elle irait boire le lait de dattes qu’Ang’Ava, la messagère des jours bénis, lui offrirait pour célébrer l’ensevelissement de la Prophétie de l’Aube 1602 dans le terreau des ténèbres. Lorsqu’elle aurait étanché sa soif, elle lui confierait un sac de mots multicolores, et chaque jour, elle jouerait au troubadour sur la place centrale de la ville. Sa voix gutturale répandrait le lot de verbes, de noms, de conjonctions, d’adjectifs contenus dans le sac. Les araignées laborieuses s’empareraient de ces perles finement ciselées, et à l’aube de chaque jour nouveau, elles tisseraient l’histoire renouvelée de Bent’Joy, fontaines de nos joies. Oasis de nos passions heureuses »7.
Vers l’avenir comme ouverture
Le progrès est une imitation infidèle, transfigurée. Surpassement. L’imitation totale et rigide est une mort. Une mort dans la lassitude et la sclérose. C’est ainsi que les habitants de Bent’Joy ont décidé de réécrire leur Histoire, en regardant vers l’avenir. Leur créativité a cassé ses chaînes, regardant vers le ciel et mer, se tenant sur le tombeau du Saint-Corrupteur des générations, désormais dépassé et jeté dans les oubliettes de l’histoire.
Faris Lounis
Notes:
1- Nadia Agsous, L’ombre d’un doute, Boumerdès, Editions Frantz Fanon, 2020, p. 9.
2- Ibid., p. 10-11.
3- Ibid., p. 23.
4- Ibid., p. 73.
5- Ibid., p. 141.
6- Ibid., p. 142.
7- Ibid., p. 144.
EL WATAN 02 MARS 2021

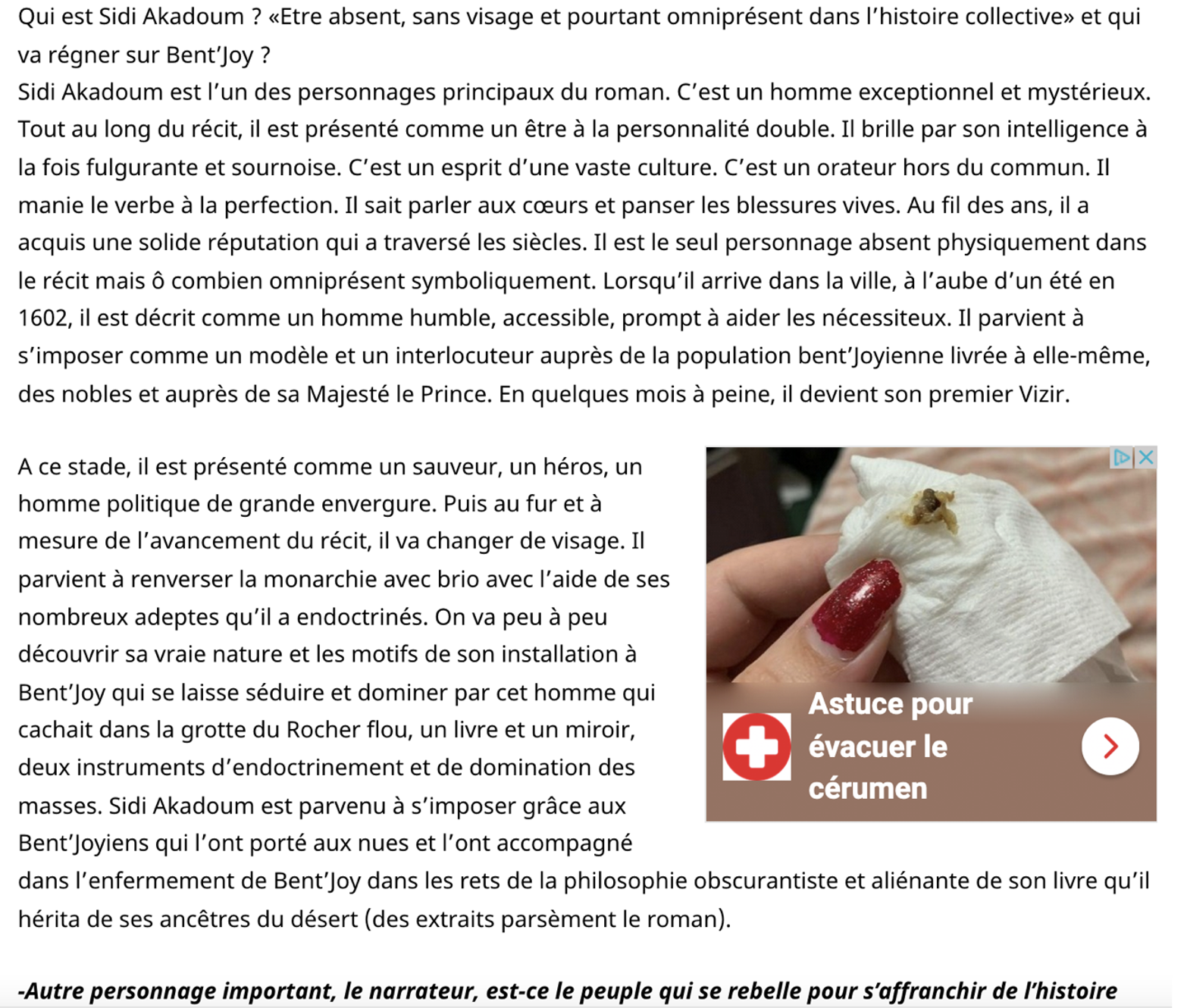
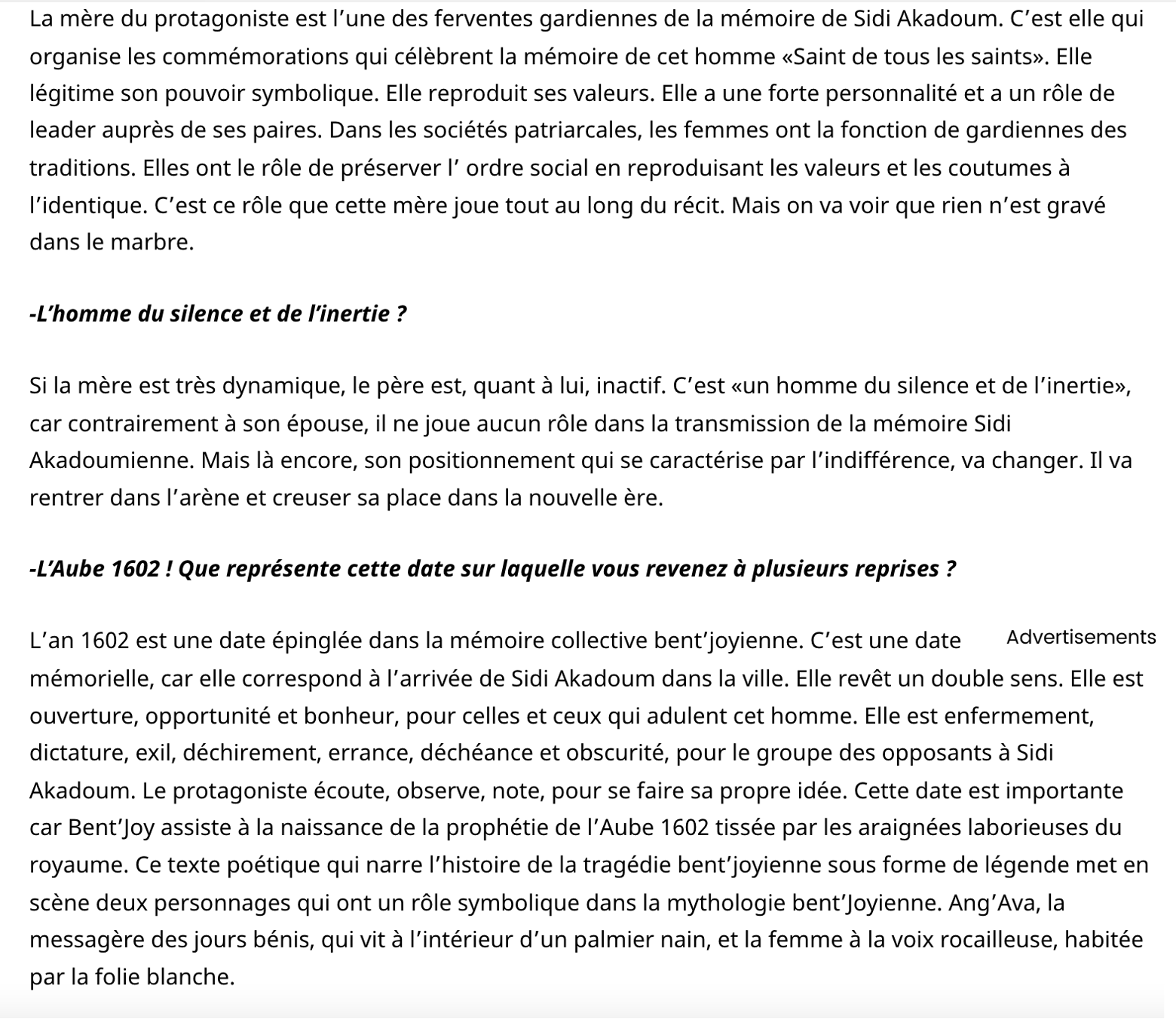
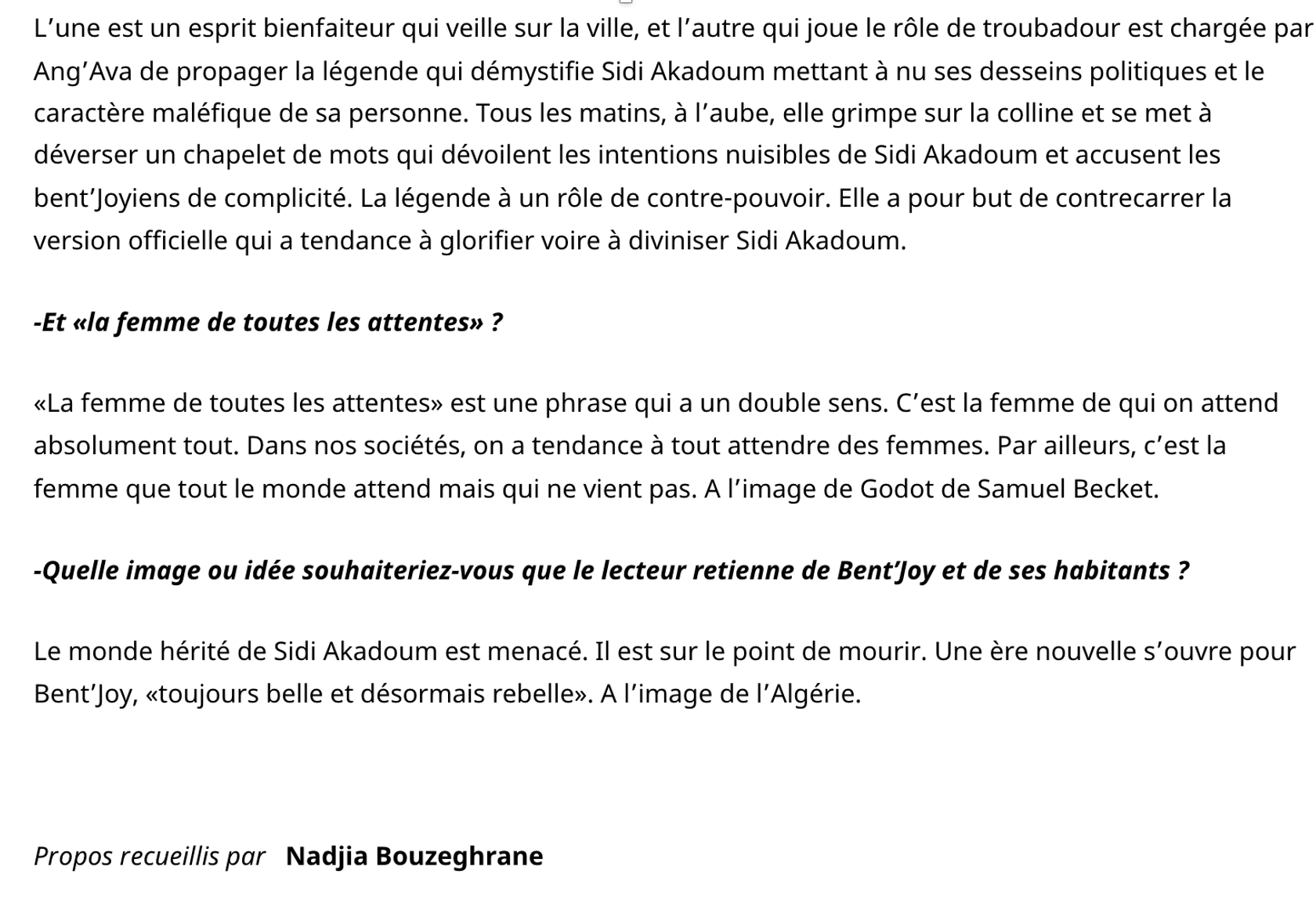
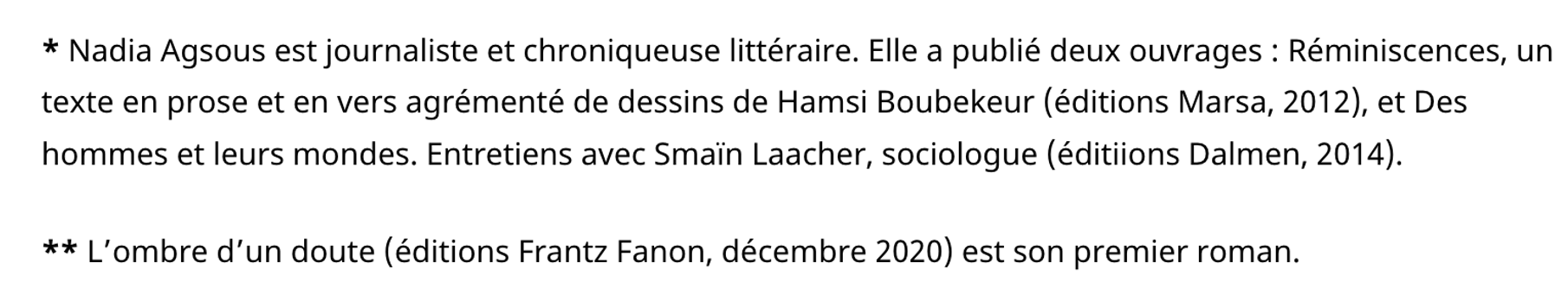
___________________
LIBERTÉ, 9 mars 2021

Dans cet entretien, la journaliste et autrice revient sur l’écriture de son dernier ouvrage, dont l’action se déroule dans la ville Bent’Joy. Une ville fictive et néanmoins très similaire à l’Algérie,“comme la métaphore de son enfermement sur son passé”, dit-elle.
Liberté : Quel était le point de départ de votre roman publié le mois dernier chez Frantz-Fanon ?
Nadia Agsous : À l’origine, L’ombre d’un doute était un mini-roman. C’est sur les conseils bienveillants de mon éditeur qu’il est devenu un roman. Les trois personnages principaux : le narrateur, sa mère et Sidi Akadoum existaient dans la première version. Bent’Joy, le cadre spatial du roman, était une ville sans grande envergure.
Au fur et à mesure de l’élaboration du récit, elle est devenue une ville millénaire. Puis, des personnages secondaires sont venus se greffer autour du noyau qui constitue le socle du roman. J’ai gardé la dimension fantastique (rêves, ambiance crépusculaire, pluie diluvienne, vents…) du récit.
Cet exercice d’écriture et de réécriture fut formateur. La similitude avec l’Algérie est apparue au fil des pages. “Bent’Joy a émergé comme la métaphore de l’Algérie et de son enfermement sur son passé. À la fin
du récit, à l’instar de l’Algérie, Bent’Joy qui au début n’était jamais rebelle, est devenue rebelle, un écho criant à la Révolution du sourire (Hirak)”.
Qui sont les personnages de L’ombre d’un doute ?
Le roman oscille entre les genres réaliste et fantastique. Il est “habité” par deux types de personnages : le lieu-personnage représenté par Bent’Joy, et les personnages humains qui se divisent en deux catégories.
D’une part, les personnages principaux qui sont au cœur de l’intrigue : le personnage-narrateur, sa mère et Sidi Akadoum. Et d’autre part, les personnages secondaires : Athina, Amjah, la foule, le Dieu des eaux ruisselantes… Les deux premiers, par exemple, ont un rôle de figurants. Leur fonction est de servir la quête de vérité relative à Sidi Akadoum menée par le protagoniste lors de son incursion nocturne et onirique dans le passé de Bent’Joy.
Comment décririez-vous le personnage-narrateur ?
C’est lui qui dynamise le récit, il va endosser un double rôle. Il est un précieux témoin du présent de Bent’Joy, et il va œuvrer pour se renseigner sur son passé au point d’émerger comme un historien, voire un archéologue qui fouille dans le passé pour éclairer le présent. C’est un jeune homme au tempérament curieux. Il est lucide, il voit et entend tout. Il est un observateur actif des mœurs de Bent’Joyiens. Lorsqu’il parle du passé, il adopte un point de vue narratif raconté à la troisième personne.
Puis, il va changer de point de vue narratif pour devenir un personnage actant qui emploie la première personne (je). Il va s’inscrire à contre-courant des valeurs dominantes et s’attribuer le rôle de “sauveur” de Bent’Joyen se lançant dans une quête pour découvrir la véritable nature de Sidi Akadoum, le saint vénéré et adulé.
L’emploi du “je” renforce le caractère intime du récit qui sera consolidé par une expérience mystique vécue dans un mausolée où il assiste à l’engloutissement de Sidi Akadoum dans les abysses de son inconscience. C’est lors de ce baptême du feu qu’il se débarrasse de ses peurs, purifie ses sentiments et affirme sa détermination d’œuvrer pour le renouveau de Bent’Joy, “ville de – ses – tourments”.
Sidi Akadoum est omniprésent dans la mémoire collective. Qui est cet homme qui subjugue les Bent’Joyiens ?
Ah, Seigneur Visage ! C’est un homme à part. Il est absent physiquement, mais il a une forte présence symbolique, car il est omniprésent dans la mémoire collective bent’joyienne. Il a une personnalité double et trouble. Lorsqu’il arrive à Bent’Joy, il ensorcelle les Bent’Joyiens et gagne leur confiance, y compris celle de son altesse, le prince qui, rapidement, le nomme son homme de confiance.
Puis, un changement de personnalité s’opère, car, au fur et à mesure de l’avancement de l’histoire, on découvre sa vraie nature. Il est fourbe et roublard. Il présente des caractéristiques similaires à celles d’un dictateur. Il a réussi à fabriquer des femmes et des hommes obéissants et incapables de réfléchir par eux-mêmes.
L’ombre d’un doute,
éditions Frantz-Fanon, Alger, janvier 2021, 147 pages, 600 DA / 15 euros.
Entretien réalisé par : KAMAL OUHNIA
________________________
EXTRAITS….
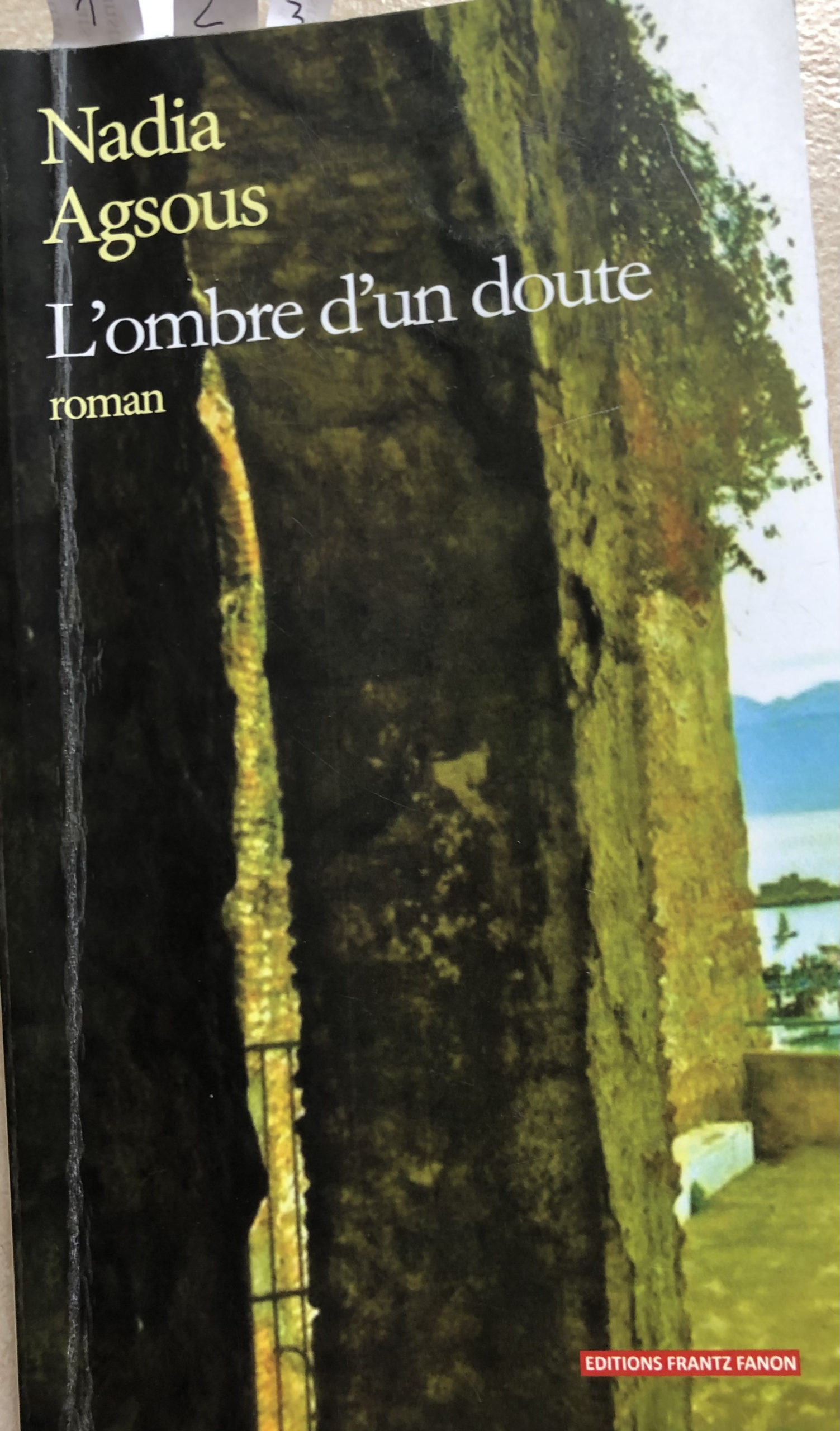
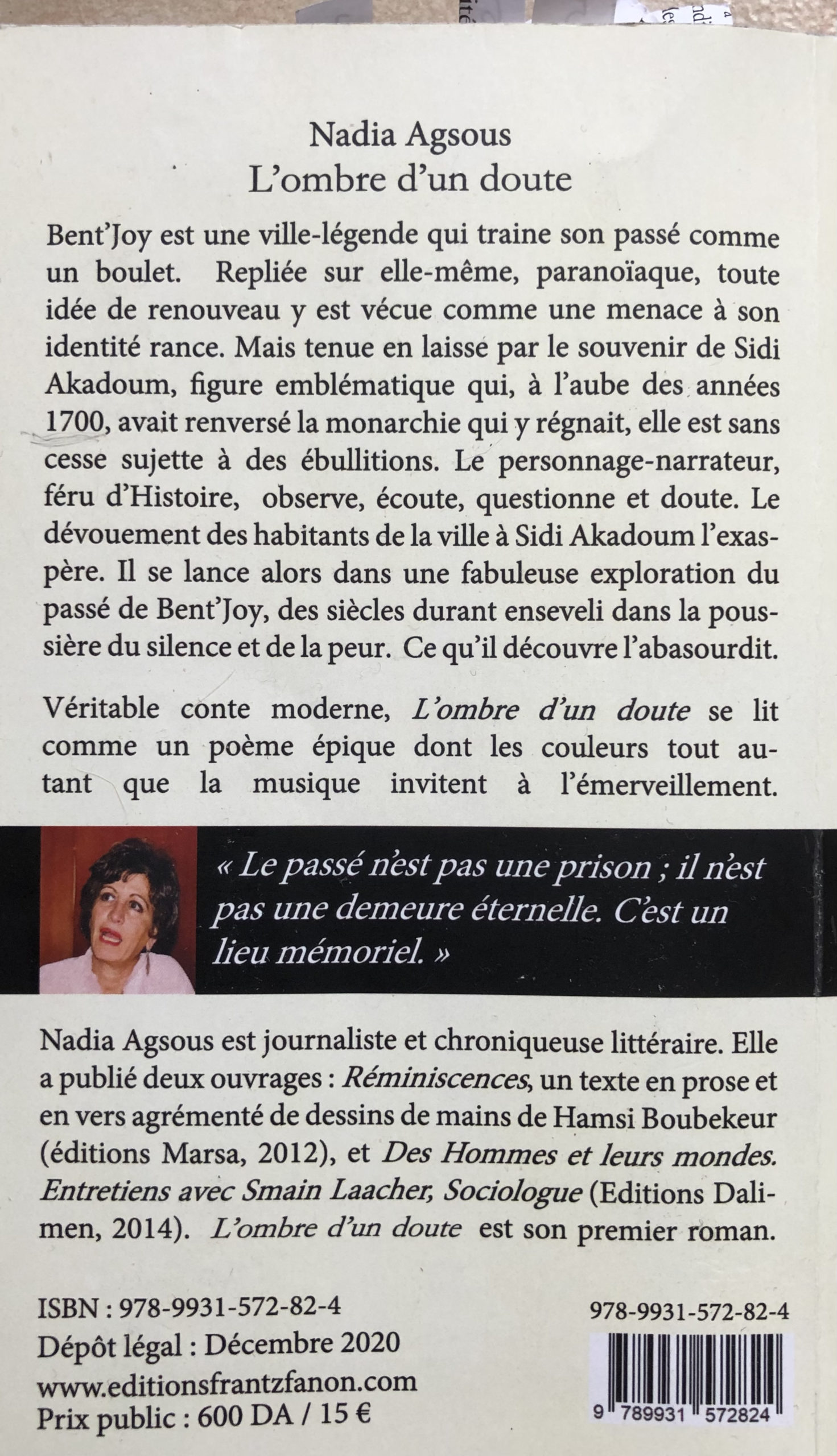
La folle…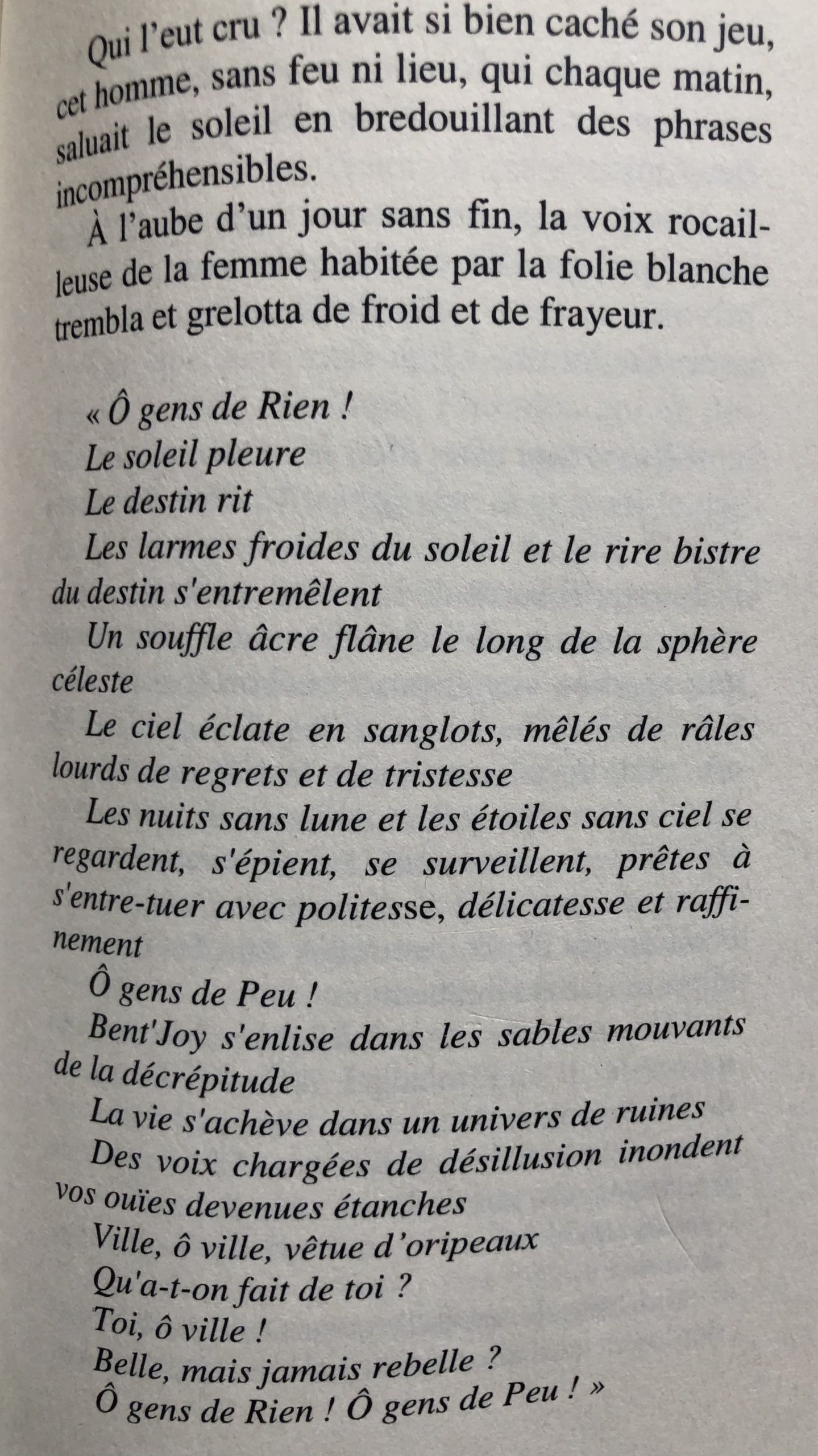
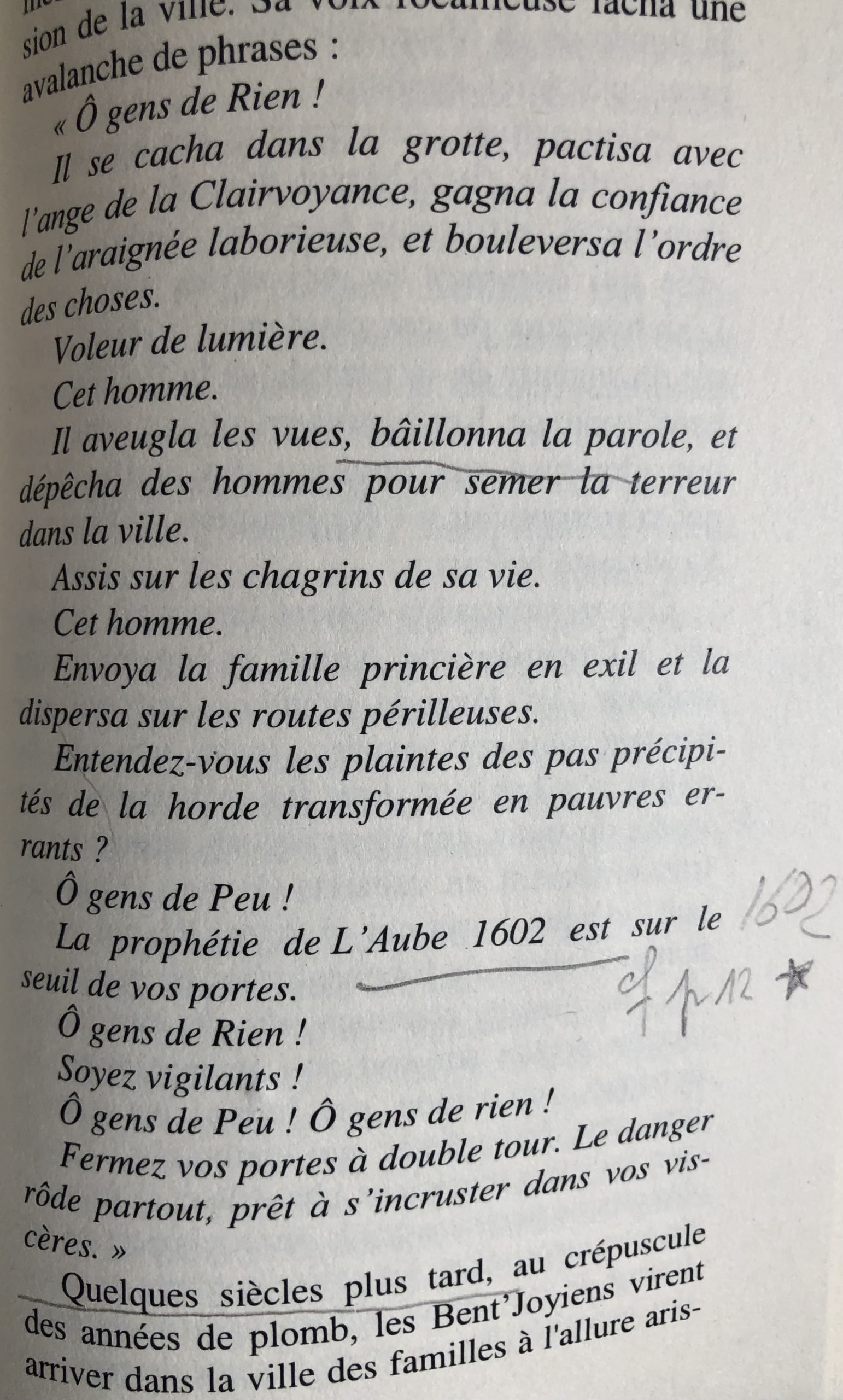
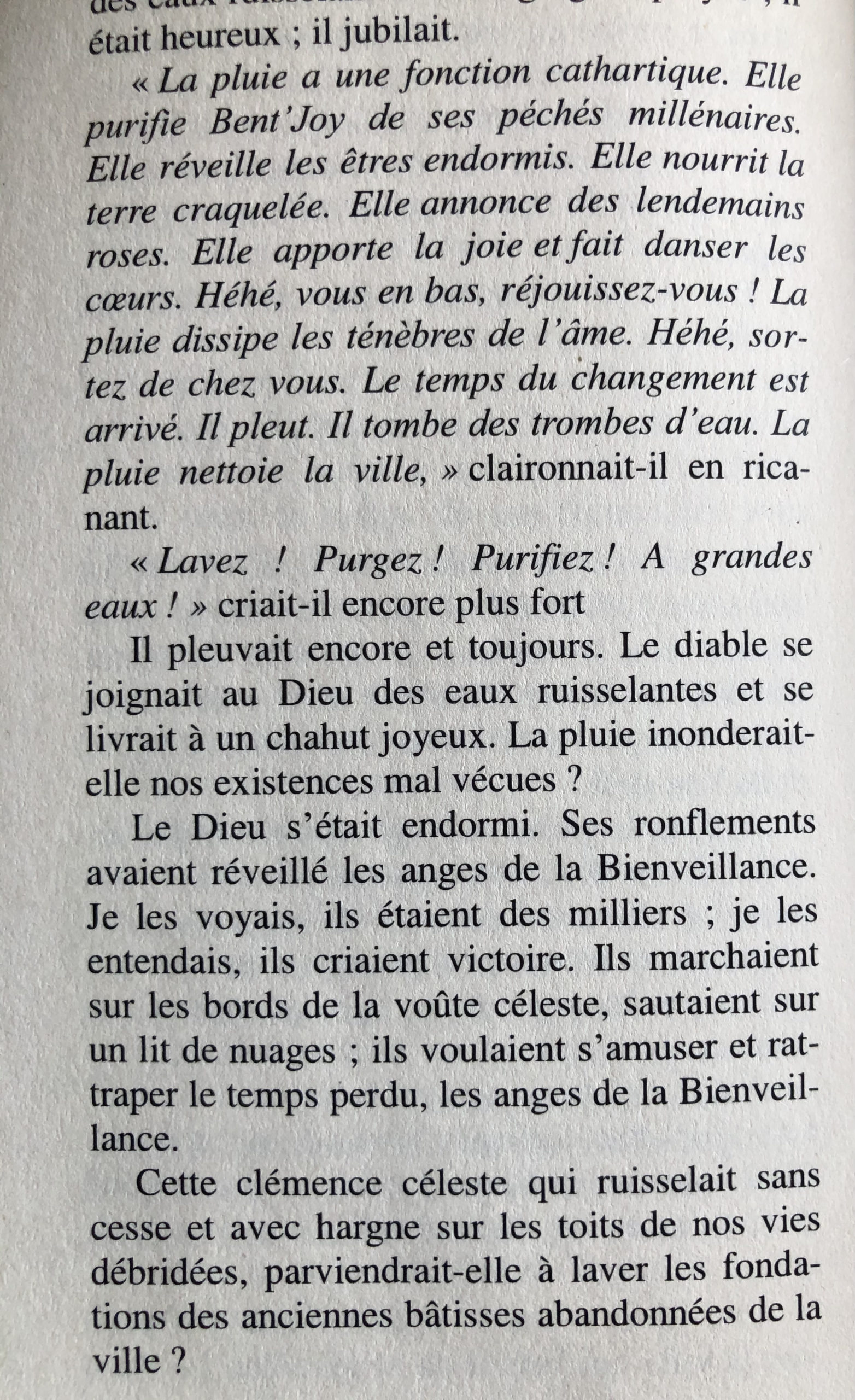

Dernières pages
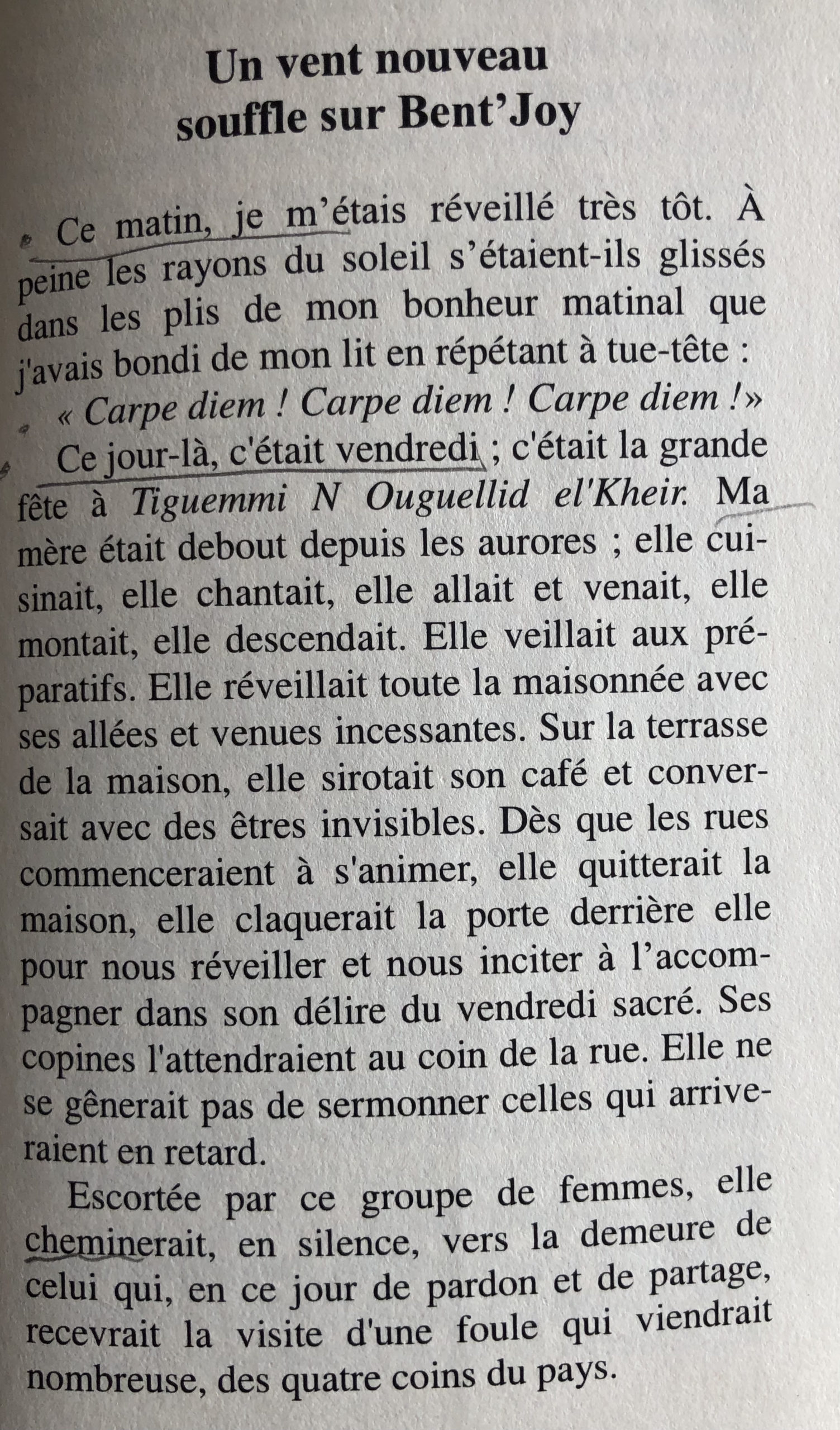
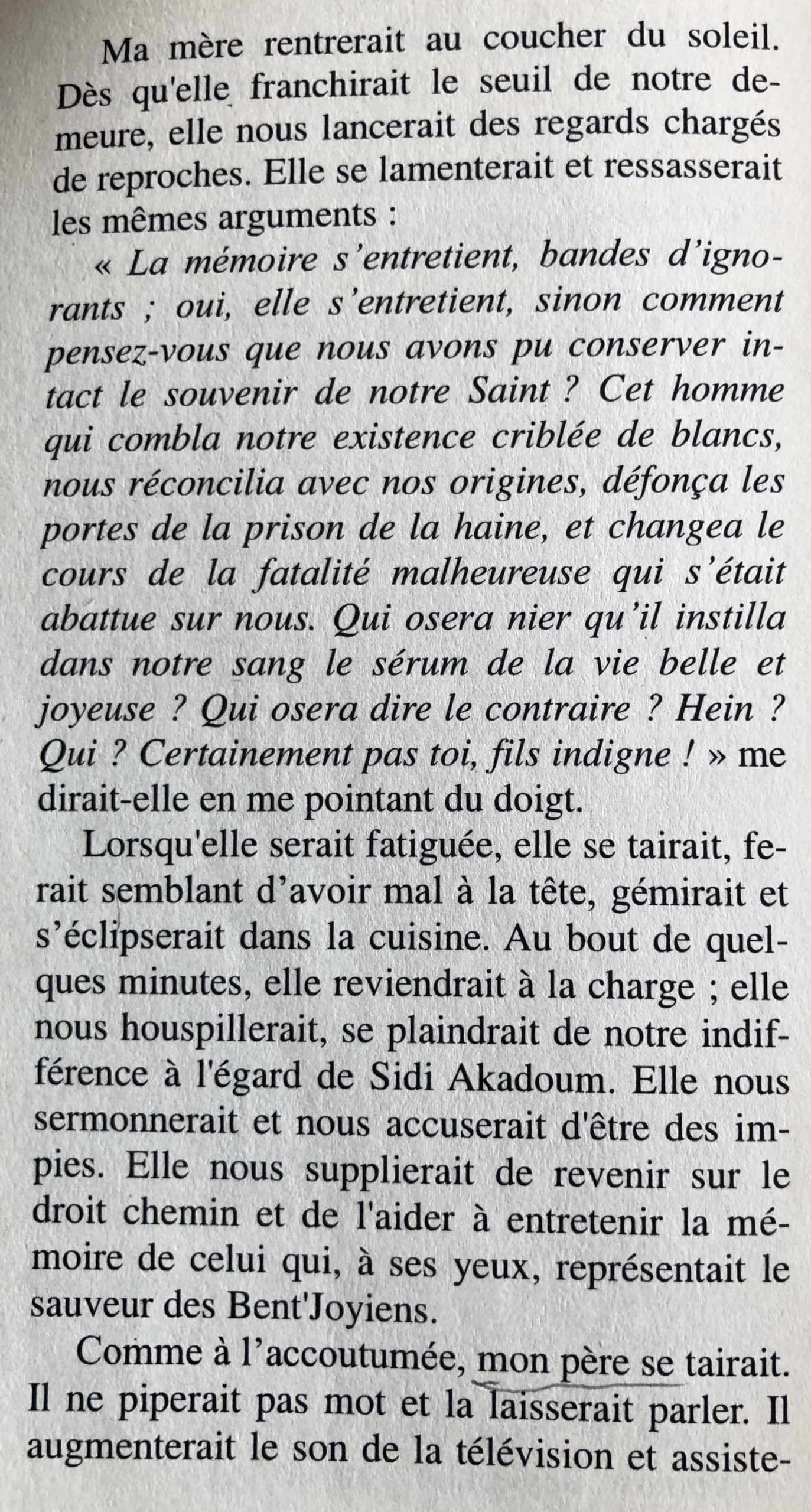
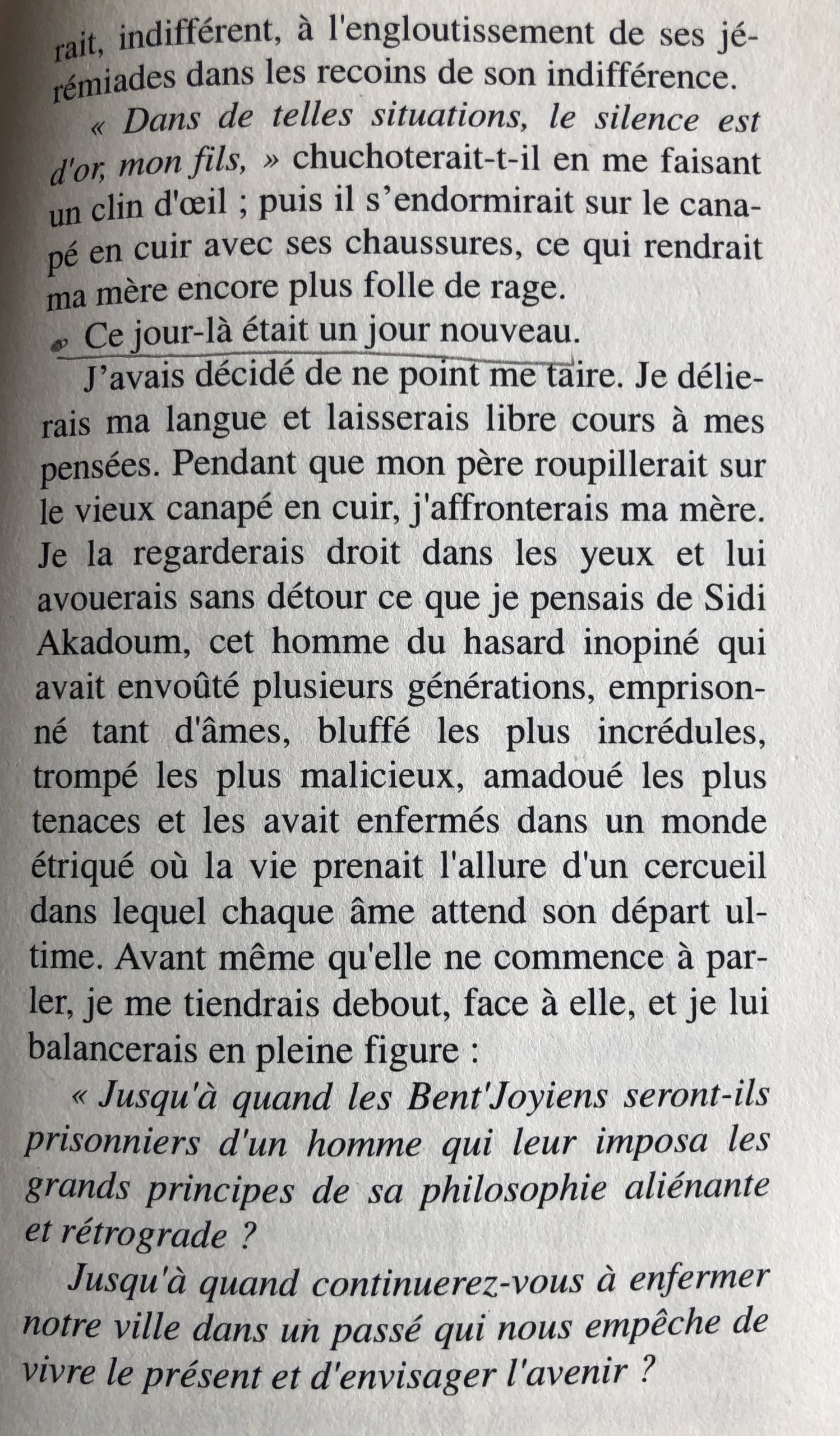
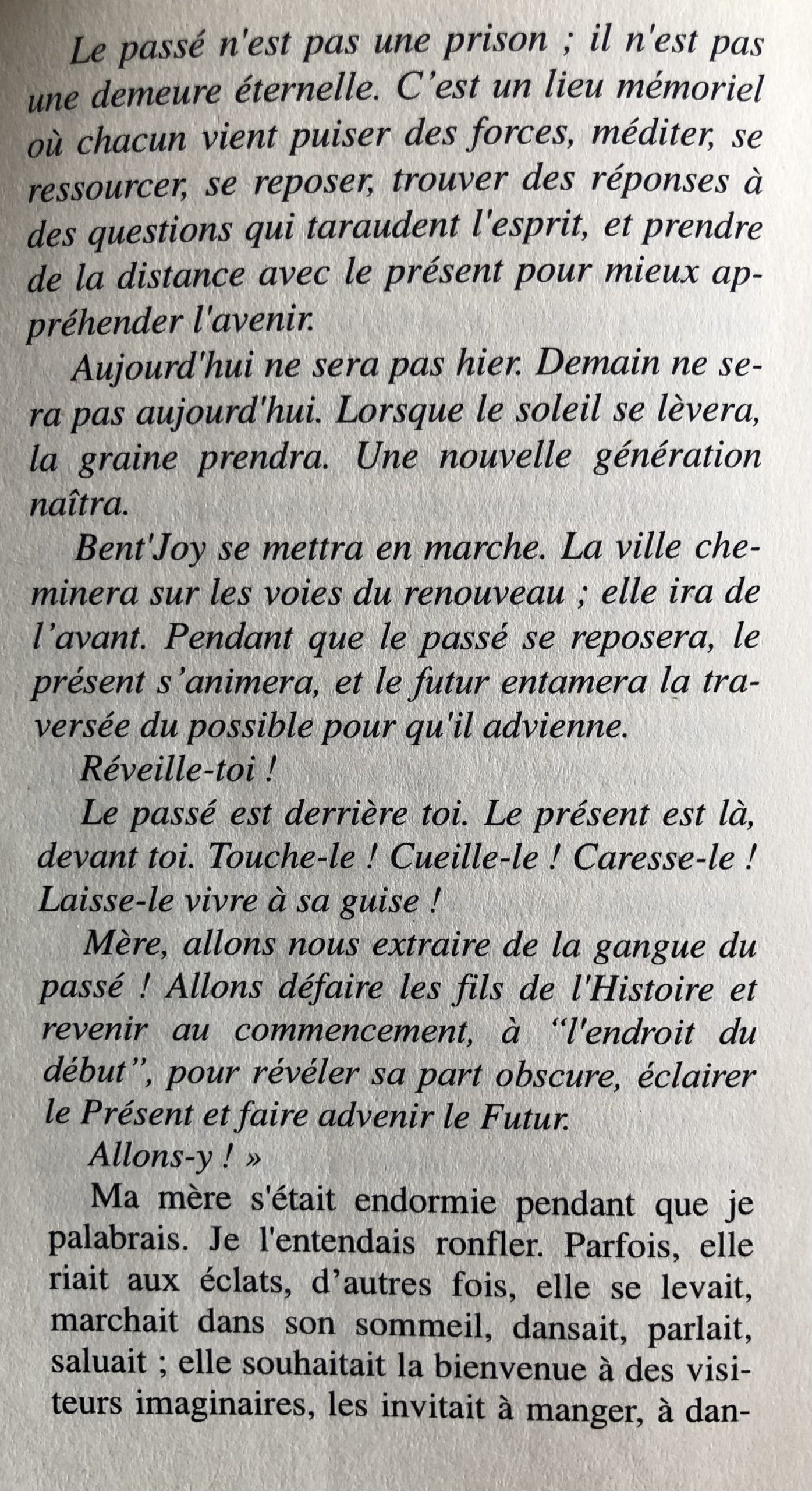
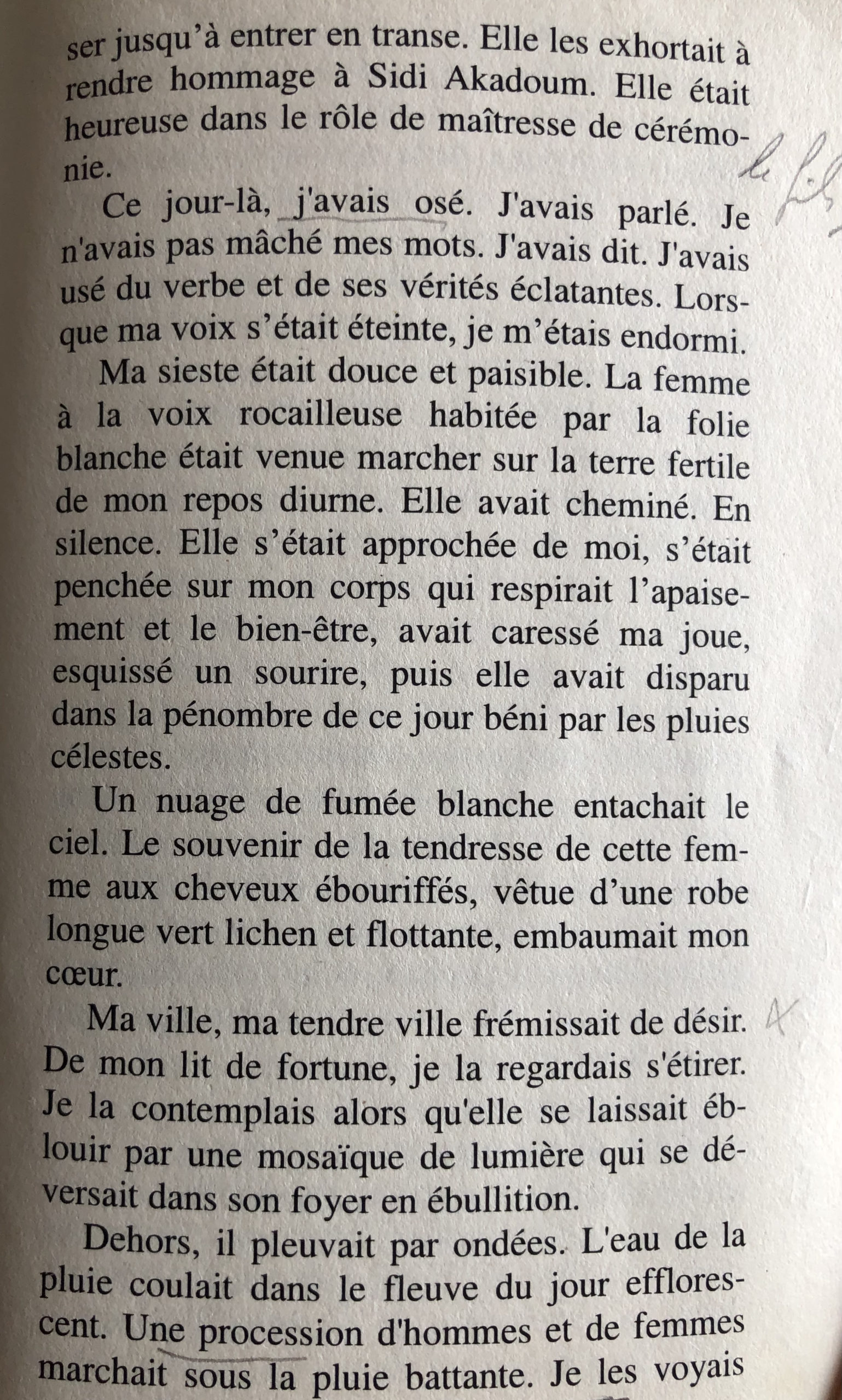
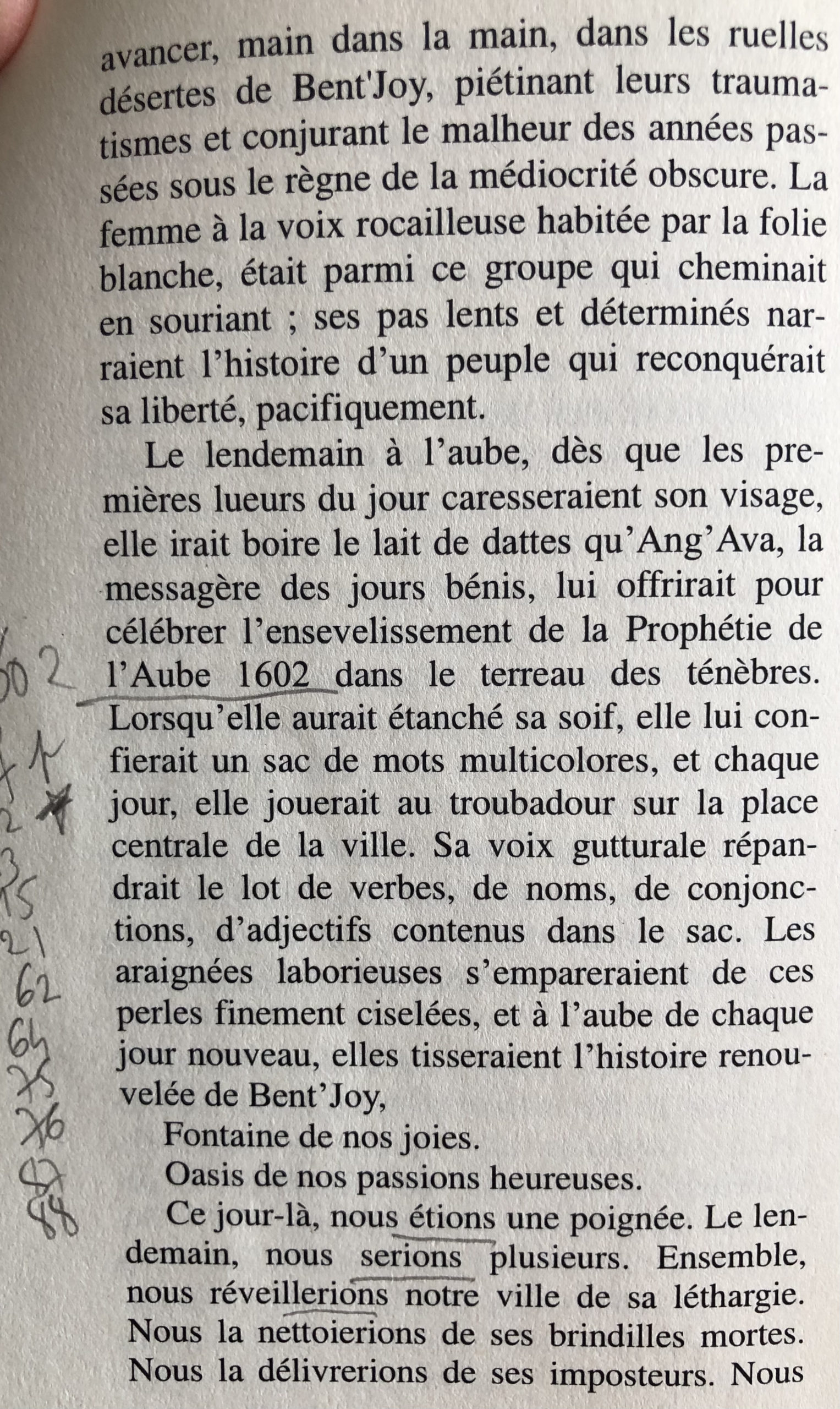
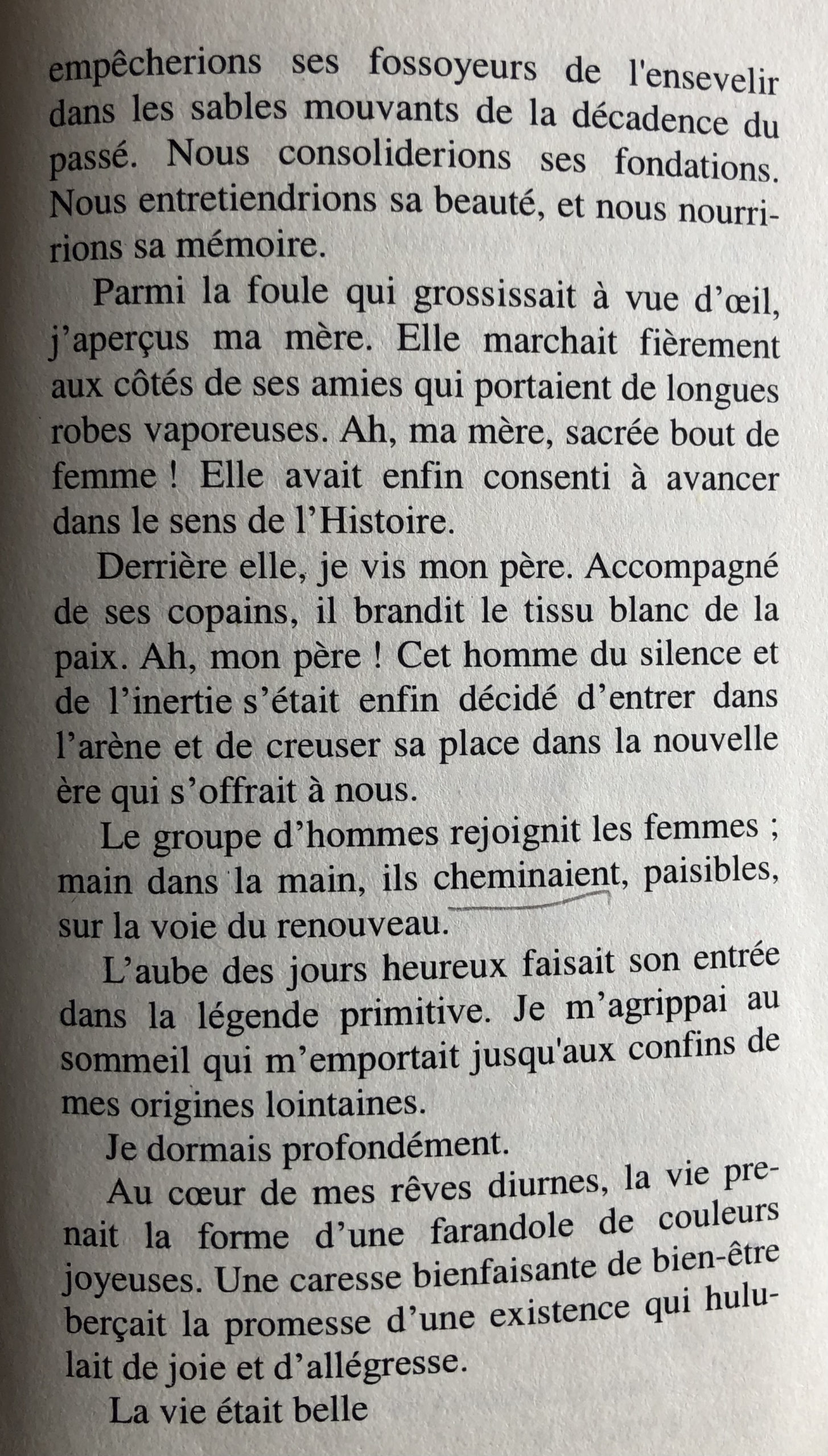


CLIQUER ICI POUR LIRE L’ARTICLE SUR MEDIAPART
.
____________________

L’ombre d’un doute de Nadia Agsous: Une ville, un mythe destructeur
par Faris Lounis
in Le Quotidien d’Oran, samedi 22 mai 2021
Quand les mythologies s’installent, lever le voile sur de telles occultations devient une gageure. La vérité est mensonge et l’histoire n’est qu’une berceuse qui veille gracieusement sur les aveugles qui ne veulent pas voir.
Ecrire une nouvelle histoire, par-delà le mensonge et la mythologie, n’est possible qu’à travers la remise en question du passé, d’une manière totale et absolue. Un nouveau regard est un nouveau départ. Nietzsche disait qu’ «il faut encore porter du chaos en soi pour pouvoir donner naissance à une étoile dansante» et le créateur doit faire danser, voire trembler, ceux qui voient l’avenir comme une répétition statique et religieuse du passé.
Le récent roman de Nadia Agsous, L’ombre d’un doute, aborde la trajectoire des étoiles dansantes, afin de démythifier certaines légendes enkystées. Ces légendes dont le poids est devenu insupportable ont fait régner, pendant un temps considérable, une léthargie innommable sur la ville et le peuple de Bent’joy.
La ville de Bent’Joy
Bent’Joy est une ville à la mémoire engourdie. Une ville amnésique repliée sur elle-même. Elle est paranoïaque et toute tentative de renouveau y est vécue comme une menace à son identité. Le mensonge ancestral ronge le ciment de ses murs. De quel mensonge s’agit-il ? De celui de Sidi Akadoum, érigé en élu de Dieu. Il est devenu un être omniprésent dans l’histoire et la mémoire collective de la ville. Il repose sous une tombe en pierre de taille sur une plateforme surplombant la mer : « Femmes et hommes, grands et petits, implorent sa bénédiction dans leurs moments de doute et de malheur. Les jours de semaine, ils se remémorent ses actes et ses paroles. Tous ensemble, d’une seule voix, main dans la main, ils l’adulent, louent ses vertus, célèbrent son courage et son sens d’abnégation et de sacrifice »1.
Par la force du hasard, cet individu devient le personnage principal d’une histoire défigurée et combien de fois réécrite. Lors des préparations précédant la célébration du centième anniversaire de sa disparition, le narrateur, s’interrogeant sur le sens du faste commémoratif dédié à Sidi Akadoum, demande à sa mère quel rôle a-t-il joué réellement dans le développement et l’épanouissement de la ville de Bent’Joy. Remontée par les questionnements de son fils, la mère réplique : « Comment oses-tu, fils indigne ? Hein ? Aurais-tu oublié que cet homme s’est sacrifié pour nous ? Qu’il nous a débarrassés des tyrans ? Qu’il nous a libérés des chaînes de l’inféodation ? Qu’il a enchaîné nos démons ? Qu’il nous a rendu notre dignité ? Ah, nos ancêtres doivent se retourner dans leurs tombes ! S’ils étaient encore de ce monde, ils châtieraient les incrédules de ta graine ! Va ! Va vite te recueillir sur sa tombe et implorer son pardon. Va, vite, fils de Satan ! »2.
Sidi Akadoum avait tout pour plaire et persuader. Une chevelure longue et noire. Des yeux couleur miel luisant comme le sable du désert. Il est venu de loin, sur sa monture, portant un Livre Sacré: «Cet homme que le vent sec et brûlant du désert expulsa vers les contrées douces et clémentes du nord fut subjugué par Bent’Joy et ses paysages qui dégoulinaient de beauté sauvage. La mer et ses tremblements, qui exaltaient une plainte douce et capricieuse, l’intriguèrent. La quiétude des nuits éthérées l’éblouit; elle raviva son envie de vivre et alimenta son désir de graver son empreinte sur des sépultures sans noms »3. Son installation à Bent’Joy fut saluée par tous, y compris les anges qui gardent la ville.
Le verbe de Sidi Akadoum
Son discours était superstitieux. Il ne parlait que du monde invisible. Il voyait de petits êtres malins partout et nulle part. Il glosait absurdement sur la relation pathologique des djinns avec la lumière. Ce discours absurde et bien enchaîné séduisait une foule largement naïve et crédule : «Durant ces nuits, à l’aide du miroir qu’il cacha dans la grotte du Rocher flou, Sidi Akadoum s’improvisait exorciste. Il avait réussi à faire croire qu’il possédait des pouvoirs lui permettant d’expulser les esprits malins des corps des femmes, des hommes et des enfants frappés par le destin maléfique. Ses prétendus dons de guérisseur des désordres psychiques étaient appréciés par la population bent’joyienne qui venait nombreuse solliciter son aide, lui, le mage adulé et glorifié sans modération »4. La charlatanerie de Sidi Akadoum ne faisait pas l’unanimité mais, hélas ! ceux qui contestaient son endoctrinement obscurantiste ne purent guère pallier la crédulité de la majorité de la ville.
Le jour où tout a basculé
Vendredi, journée sainte. La mère du narrateur prépare, avec les femmes de la ville, la grande célébration de l’ancêtre qui a sauvé leur ville, Sidi Akadoum. Les festivités se déroulent à Tiguemmi N’Ouguellid el Kheir. Comme tout parent désireux de transmettre ses rites et legs ancestraux, la mère du narrateur a trouvé l’occasion d’exprimer son mécontentement à l’égard de son fils. Voyant la révolte de ce dernier à l’égard de la tradition ancestrale, elle l’admoneste, tout en rappelant que le Saint de la ville est sacré et que cette dernière doit sa conservation à sa prédication, son Livre Sacré et sa bénédiction dont la source est son tombeau, lieu de pèlerinage et point névralgique de Bent’Joy.
Impassible, le fils ne cède rien à la tradition qui sacralise l’ignorance : « Je la regarderais droit dans les yeux et lui avouerais sans détour ce que je pensais de Sidi Akadoum, cet homme du hasard inopiné qui avait envoûté plusieurs générations, emprisonné tant d’âmes, bluffé les plus incrédules, trompé les plus malicieux, amadoué les plus tenaces et les avait enfermés dans un monde étriqué où la vie prenait l’allure d’un cercueil dans lequel chaque âme attend son départ ultime »5. Le constat du fils est le suivant : les Bent’Joyiens sont les prisonniers de la mémoire d’un fantôme, Sidi Akadoum. Et cet asservissement mémoriel et dogmatique ne pourra pas durer : « Le passé n’est pas une prison : il n’est pas une demeure éternelle. C’est un lieu mémoriel où chacun vient puiser des forces, méditer, se ressourcer, se reposer, trouver des réponses à des questions qui taraudent l’esprit, et prendre de la distance avec le présent pour mieux appréhender l’avenir. Aujourd’hui ne sera pas hier. Demain ne sera pas aujourd’hui. Lorsque le soleil se lèvera, la graine prendra. Une nouvelle génération naîtra »6. Mettre le passé au repos et dessiner les voies du renouveau, c’est ainsi que le narrateur décide de s’opposer à sa mère et aux obscurantistes de Bent’Joy.
La ville de Bent’Joy avait non seulement des personnes éveillées, mais aussi une ombre blanche qui veillait, depuis un temps immémorial, sur sa prospérité. Le jour où le narrateur a décidé de rompre avec la coutume commémorative et cultuelle qui ronge sa ville, l’ombre blanche fait son apparition, comme si par miracle, elle avait entendu l’appel au renouveau. Durant la procession du vendredi, la foule des croyants dociles a rompu avec sa léthargie : «Le lendemain à l’aube, dès que les premières lueurs du jour caresseraient son visage, elle irait boire le lait de dattes qu’Ang’Ava, la messagère des jours bénis, lui offrirait pour célébrer l’ensevelissement de la Prophétie de l’Aube 1602 dans le terreau des ténèbres. Lorsqu’elle aurait étanché sa soif, elle lui confierait un sac de mots multicolores, et chaque jour, elle jouerait au troubadour sur la place centrale de la ville. Sa voix gutturale répandrait le lot de verbes, de noms, de conjonctions, d’adjectifs contenus dans le sac. Les araignées laborieuses s’empareraient de ces perles finement ciselées, et à l’aube de chaque jour nouveau, elles tisseraient l’histoire renouvelée de Bent’Joy, fontaines de nos joies. Oasis de nos passions heureuses »7.
Vers l’avenir comme ouverture
Le progrès est une imitation infidèle, transfigurée. Surpassement. L’imitation totale et rigide est une mort. Une mort dans la lassitude et la sclérose. C’est ainsi que les habitants de Bent’Joy ont décidé de réécrire leur Histoire, en regardant vers l’avenir. Leur créativité a cassé ses chaînes, regardant vers le ciel et mer, se tenant sur le tombeau du Saint-Corrupteur des générations, désormais dépassé et jeté dans les oubliettes de l’histoire.
Faris Lounis
Notes:
1- Nadia Agsous, L’ombre d’un doute, Boumerdès, Editions Frantz Fanon, 2020, p. 9.
2- Ibid., p. 10-11.
3- Ibid., p. 23.
4- Ibid., p. 73.
5- Ibid., p. 141.
6- Ibid., p. 142.
7- Ibid., p. 144.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lire ma critique ici:
Vous la connaissez peut-être. Amina Alaoui est une belle chanteuse marocaine de musique classique arabo-andalouse. Elle a édité plusieurs albums dont « Alcantara » dont je vous propose deux très beaux titres : Ode d’Ibn Arabi et Ya racha fattan. Écoutez… c’est magnifique. Perso je peux l’écouter sans discontinuer « durant des heures » en exagérant un peu, et plus encore en ces jours de ramadan. À la fin de la vidéo je vous ai glissé un texte, voici un extrait. Amina Alaoui parle de cet album : « Alcàntara constitue un témoignage de ces moments privilégiés (ah : Andalousie arabo-berbère) de coexistence, de convivialité, de communion de savoir et de dialogue dus au respect des différences, malgré les aléas de l’histoire, et non pas simplement une élégie posthume aux illustres figures du passé. Cet âge d’or fut !
Cela nous renvoie actuellement au problème moral du déni des différences, du racisme et du repli sur une identité autarcique. Serions-nous capables de réinventer un nouvel âge d’or de tolérance ? Cette évocation lyrique peut-elle être une relecture symbolique de l’histoire à travers l’art vers une nouvelle Renaissance à l’aube du 21e siècle ? » »
________________________
L’Ode d’IBN ARABI
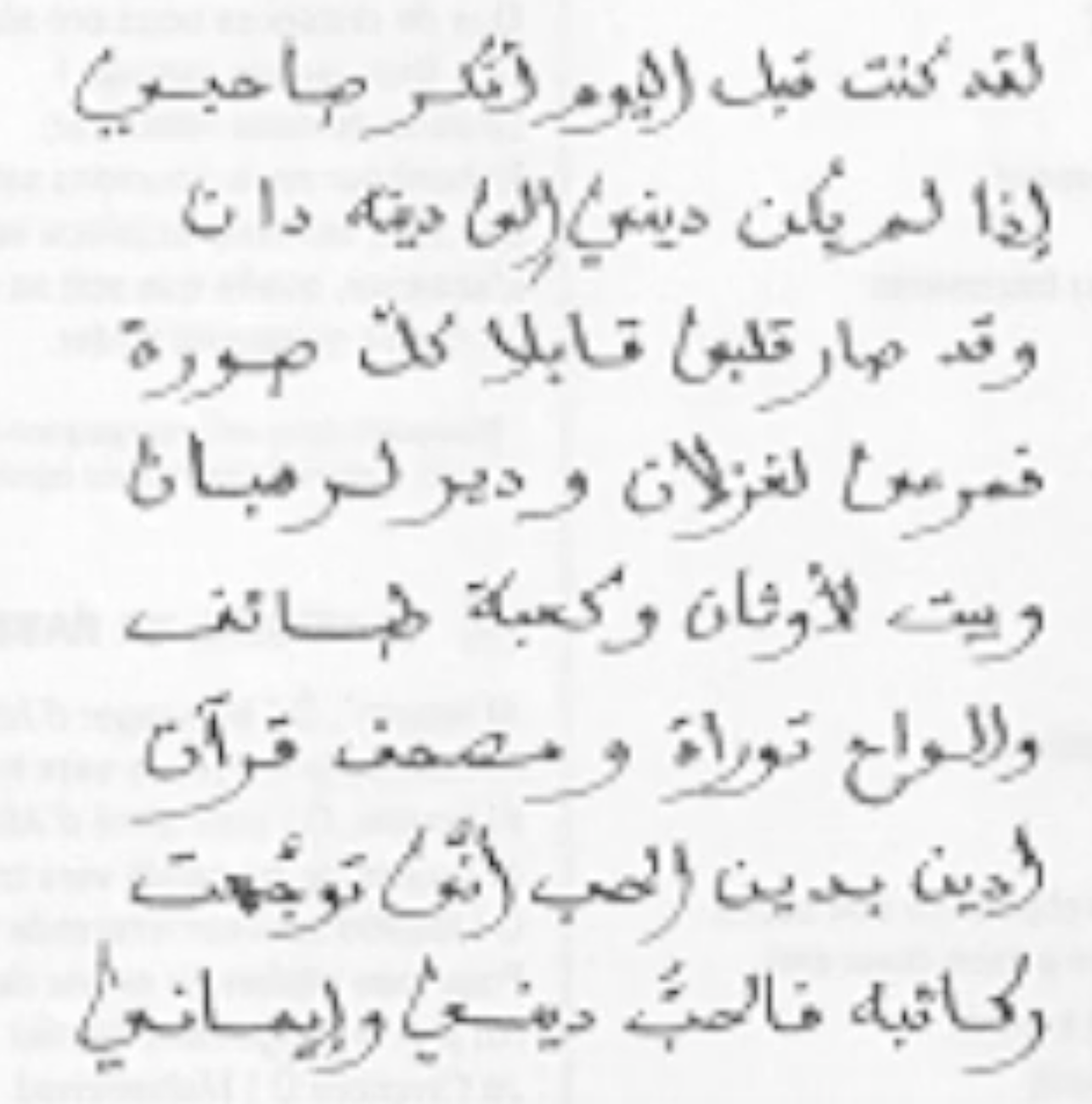
________________________
.1
POUR ÉCOUTER AMINA ALAOUI, CLIQUER ICI
.
_______________________
.2
CLIQUER ICI POUR LIRE UN ARTICLE SUR AMINA ALAOUI
.
_______________________
.3
CLIquer ici pour écouter l’album ALCANTARA en entier (Youtube)
.
_______________________
.4
CLIQUER ICI pour l’écouter avec AHMED PIRO et son orchestre Gharnati (Youtube)
.
_____________________
Jorge Luis Borges
(traduit par Roger Caillois)
S’imaginant que la tragédie n’était autre chose que l’art de louer…
Ernest Renan, Averroës,48 (1851).
Abulgualid Mohammad Ibn Ahmad ibn-Mohammad ibn-Rushd (un siècle passera avant que ce nom interminable devienne Averroës, à travers Benraist et Avenryz, sans oublier Aben-Rassad et Filius Rosadis) rédigeait le onzième chapitre de son œuvre Tahafut-ul-Tahafut (Destruction de la Destruction), dans lequel il maintient, contre l’ascète persan Ghazali, auteur de Tahafut-ul-Falasifa (Destruction des Philosophes), que la divinité connaît seulement les lois générales de l’Univers, ce qui concerne les genres et non les individus. Il écrivait avec une lente sécurité, de droite à gauche ; son application à former des syllogismes et à enchaîner de vastes paragraphes ne l’empêchait pas de sentir comme un bien-être la fraîche et profonde maison qui l’entourait. Au fond de ce repos, s’enrouaient d’amoureuses colombes ; de quelque patio invisible, montait le bruit d’une fontaine ; quelque chose dans la chair d’Averroës, dont les ancêtres venaient des déserts arabes, était reconnaissant à cette continuité de l’eau. En bas, se trouvaient les jardins, le potager ; en bas, le Guadalquivir absorbé par sa tâche ; plus loin, Cordoue, la ville chère à son cœur, aussi lumineuse que Bagdad et Le Caire, comme un instrument complexe et délicat, et alentour (Averroës le percevait aussi) s’élargissait jusqu’à l’horizon la terre d’Espagne, où il y a peu de chose, mais où chaque chose paraît exister selon un mode substantif et éternel.
La plume courait sur le papier ; les arguments s’entrelaçaient, irréfutables ; mais une légère préoccupation compromettait la béatitude d’Averroës. Le Tahafut, travail de hasard, n’en était pas le motif, mais un problème de nature philosophique dépendant de l’œuvre monumentale qui justifierait Averroës devant les générations : le commentaire d’Aristote. Ce Grec, source de toute philosophie, avait été accordé aux hommes pour leur enseigner tout ce qui se peut savoir ; interpréter ses ouvrages comme le font les ulémas le Coran, était la difficile entreprise que se proposait Averroës. L’histoire consignerait peu d’événements aussi beaux et aussi pathétiques que ce médecin arabe se consacrant à la pensée d’un homme dont quatorze siècles le séparaient ; aux difficultés intrinsèques s’ajoutait le fait qu’Averroës, ignorant du syriaque et du grec, travaillait sur la traduction d’une traduction. La veille, deux mots douteux l’avaient arrêté au seuil de la Poétique. Ces mots étaient tragoedia etcomoedia. Il les avait déjà rencontrés, des années auparavant, au livre troisième de la Rhétorique ; personne dans l’Islam n’entrevoyait ce qu’ils voulaient dire. En vain, il avait fatigué les traités d’Alexandre d’Aphrodésie. En vain, compulsé les versions du nestorien Hunain ibn-Ishaq et de Abu Bashar Meta. Les deux mots arcanes pullulaient dans le texte de la Poétique : impossible de les éluder.
Averroës laissa la plume. Il se dit (sans trop y croire) ce que nous cherchons est souvent à notre portée, rangea le manuscrit du Tahafut et se dirigea vers le rayon où étaient alignés, copiés par les calligraphes persans, les nombreux volumes du Mohkam de l’aveugle Abensida. C’était ridicule d’imaginer qu’il ne les avait pas consultés, mais il était tenté par le vain plaisir d’en tourner les pages. Il fut tiré de cette distraction studieuse par une espèce de mélodie. Il regarda à travers les grilles du balcon : des enfants demi-nus s’amusaient en bas, dans l’étroite cour de terre. L’un, debout sur les épaules de l’autre, jouait évidemment le rôle d’un muezzin. Les yeux bien fermés, il psalmodiait : Il n’y a pas d’autre dieu que Dieu. Celui qui le portait, immobile, représentait le minaret ; un autre, prosterné dans la poussière et agenouillé, l’assemblée des fidèles. Le jeu s’interrompit vite : tous voulaient être muezzin, personne la tour ou les fidèles. Averroës les entendit discuter en dialecte grossier, c’est-à-dire dans l’espagnol naissant de la plèbe musulmane de la Péninsule. Il ouvrit le Qutab-ul-aïn de Jalil et pensa avec orgueil que dans la Cordoue entière, peut-être dans toute l’Andalousie, il n’y avait pas de copie de l’œuvre parfaite supérieure à celle-ci, que l’émir Yacoub Al-Mansour lui avait donné à Tanger. Le nom de ce port lui rappela que le voyageur Aboulkassim Al-Ashari, de retour du Maroc, devait dîner avec lui, le même soir, chez le coraniste Farach. Aboulkassim devait avoir atteint les royaumes de l’Empire de Sin (de la Chine) ; ses détracteurs, avec cette logique spéciale que donne la haine, juraient qu’il n’avait jamais foulé le sol de la Chine et que, dans les temples de ce pays, il avait blasphémé le nom d’Allah. Sans aucun doute, la soirée durerait plusieurs heures ; Averroës, promptement, repris le texte du Tahafut. Il travailla jusqu’au crépuscule de la nuit.
La conversation, dans la maison de Farach, passa des incomparables vertus du gouverneur à celles de son frère l’émir ; ensuite, dans le jardin, ils parlèrent des roses. Aboulkassim, qui ne les avait pas regardés, affirma qu’il n’y a pas de roses comparables à celles qui ornent les villes andalouses. Farach ne se laissa pas corrompre ; il signala que le docte Ibn Qutaiba décrit une superbe variété de la rose perpétuelle, qui croît dans les jardins de l’Indoustan et dont les pétales rouges incarnat portent des caractères qui disent : il n’y a pas d’autre dieu que Dieu. Mohammed est son prophète. Il ajouta qu’Abdoulkassim connaissait sûrement ces roses. Abdoulkassim le regarda, assez alarmé. S’il répondait oui, tous le tiendraient avec raison pour le plus disponible et le plus occasionnel des imposteurs ; s’il répondait non, ils le tiendraient pour un Infidèle. Il choisit de susurrer que le Seigneur détenait les clés des choses cachées et qu’il n’existe pas sur terre une seule chose verte ou flétrie qui ne soit pas mentionnée dans Son livre. Ces mots appartenaient à l’une des premières sourates. Un murmure de respect les accueillit. Rendu vaniteux par cette victoire dialectique, Aboulkassim allait dire que le Seigneur est parfait et impénétrable dans ses voies, quand Averroës déclara, anticipant les lointains arguments d’un Hume encore problématique :
– J’ai moins de peine à admettre une erreur du docte Ibn Qutaiba ou de ses copistes que l’idée que la terre donne des roses qui confessent la Foi
-C’est vrai ! Grandes et véridiques paroles ! dit Aboulkassim.
-Un voyageur, rappela le poète Abdalmalik, parle d’un arbre dont les fruits sont des oiseaux verts. Il m’est plus facile de croire à cet arbre qu’à des roses avec des lettres.
-La couleur des oiseaux, dit Averroës semble faciliter le miracle. En outre, les oiseaux et les fruits appartiennent au monde de la nature, alors que l’écriture est un art. Passer des feuilles aux oiseaux est plus facile que de passer des roses aux lettres.
Un autre invité nia avec indignation que l’écriture fût un art, puisque l’Original du Coran — La Mère du Livre — antérieur à la Création, est conservé au ciel. Un autre parla de Chahiz de Basrah qui affirme que le Coran est une substance qui peut prendre la forme d’un homme ou d’un animal, opinion qui paraît s’accorder avec celles des théologiens qui lui attribuent deux faces. Farach exposa longuement la doctrine orthodoxe. Le Coran (dit-il) est un des attributs de Dieu, comme sa piété ; on le copie en livre, on le prononce avec la langue, on s’en souvient avec le cœur : l’idiome, les signes et l’écriture sont l’œuvre des hommes, mais le Coran est irrévocable et éternel. Averroës, qui avait commenté La République, aurait pu dire que La Mère du Livre est quelque chose comme son modèle platonicien. Il nota que la théologie était un domaine absolument inaccessible à Aboulkassim. `
D’autres, qui l’avaient aussi remarqué, demandèrent à Aboulkassim de narrer quelque merveille. Alors, comme aujourd’hui, le monde était atroce ; les audacieux pouvaient le parcourir et aussi les misérables, ceux qui se pliaient à tout. La mémoire d’Aboulkassim était un miroir d’intimes lâchetés. Que pouvait-il raconter ? En outre, on exigeait de lui des merveilles et la merveille est peut-être incommunicable ; la lune du Bengale n’est pas identique à la lune du Yémen, mais on la décrit avec les mêmes mots. Aboulkassim hésita, puis il parla.
-Celui qui parcourt les climats et les villes, affirma-t-il avec onction, voit beaucoup de choses dignes de foi. Celle-ci, que je n’ai racontée qu’une fois, au roi des Turcs. Elle arriva à Sin Kalan (Canton) où le fleuve de l’Eau de la Vie se jette dans la mer.
Farach demanda si cette ville se trouvait loin de la muraille qu’Iskander Zul Qarnain (Alexandre Bicorne de Massédoine) avait élevée pour contenir Gog et Magog.
-Des déserts l’en séparent, répondit Aboulkassim avec un orgueil involontaire. Une caravane cheminerait quarante jours avant d’en apercevoir les tours et autant, paraît-il, pour l’atteindre. À Sin Kalan, je n’ai entendu parler d’aucun homme qui l’eût vue ou qui eût vu quelqu’un qui l’eût vue.
La crainte de l’épaisseur de l’infini, du pur espace, de la simple matière émut un instant Averroës. Il regarda le jardin symétrique ; se sentit vieilli, inutile, irréel. Aboulkassim disait :
– Un soir, les marchands musulmans de Sin Kalan me conduisirent à une maison de bois peint, où vivaient beaucoup de gens. On ne peut pas raconter comment était cette maison, qui était bien plutôt une seule pièce avec des rangées de réduits ou de balcons placés les uns à côté des autres. Dans ces enfoncements, il y avait des gens qui mangeaient et buvaient, de même que sur le sol et aussi sur une terrasse. Les gens de la terrasse jouaient du tambour et du luth, sauf quinze ou vingt environ (avec des masques de couleur cramoisie) qui priaient, chantaient et conversaient. Ils étaient punis de prison, mais personne ne voyait les cellules ; ils étaient à cheval, mais personne ne voyait leurs montures ; ils combattaient, mais les épées étaient en roseau ; ils mouraient, mais ils se relevaient ensuite.
– Les actes des fous, dit Farach, dépassent les prévisions du sage.
-Ils n’étaient pas fous, dut préciser Aboulkassim. Ils étaient en train, me dit un marchand, de représenter une histoire.
Personne ne comprenait, personne ne paraissait vouloir comprendre.
Confus, Aboulkassim passa d’une narration bienvenue à d’ennuyeuses explications. Il dit, en s’aidant avec les mains :
– Imaginons que quelqu’un figure une histoire au lieu de la raconter. Supposons qu’il s’agisse de l’histoire des Dormants d’Éphèse. Nous les voyons alors se retirer dans la caverne, nous les voyons prier et dormir, nous les voyons dormir avec les yeux ouverts, nous les voyons réveillés au bout de trois cent neuf ans, donner au commerçant une monnaie antique, se réveiller au paradis, nous les voyons se réveiller avec leur chien. C’est un spectacle de ce genre que nous montrèrent ce soir-là les gens de la terrasse.
– Ces personnes parlaient-elles ? demanda Farach.
– Bien sûr, elles parlaient, dit Aboulkassim converti en avocat de cette séance dont il se souvenait à peine et qui l’avait fort ennuyé. Elles parlaient et chantaient et discouraient.
– Dans ce cas, conclut Farach, il n’était pas besoin de vingt personnes. Un seul narrateur peut raconter n’importe quoi, quelle qu’en soit la complexité.
Tous approuvèrent ce verdict. On loua les vertus de l’arabe qui est la langue dont Dieu se sert pour commander aux anges ; puis de la poésie des Arabes. Abdalmalik, après l’avoir approuvée comme il se doit, censura comme retardataires les poètes qui, à Damas et à Cordoue, s’acharnaient à employer des images d’éleveurs et un vocabulaire bédouin. Il dit qu’il était absurde qu’un homme devant qui s’étalait le Guadalquivir célébrât l’eau d’un puits. Il estima urgent de rénover les anciennes métaphores ; il dit que quand Zuhair compara le destin à un chameau aveugle, cette figure avait pu étonner les gens, mais que cinq siècles d’admiration l’avait usée. Tous approuvèrent cette opinion qu’ils avaient déjà souvent entendue de nombreuses bouches. Averroës se taisait. À la fin, il parla, moins pour les autres que pour lui-même.
– Avec moins d’éloquence, dit Averroës, mais avec des arguments analogues, il m’est arrivé de défendre la proposition que soutient Abdalmalik. À Alexandrie, il fut avancé que seul est incapable d’une faute, qui déjà l’a commise et déjà s’en est repenti. Ajoutons que, pour s’affranchir d’une erreur, il est bon de l’avoir professée. Zuhair, dans une moallaka, dit qu’au cours de quatre-vingts ans de douleur et de gloire, il a vu souvent le destin renverser soudain les hommes comme ferait un chameau aveugle ; Abdalmalik en tant que cette figure ne peut plus nous émerveiller. À cette observation, on peut opposer beaucoup de choses. La première, que si le but d’un poème était de nous étonner, sa durée ne se mesurerait pas en siècles, mais en jours et en heures, peut-être en minutes. La seconde, qu’un grand poète est moins celui qui invente que celui qui découvre. Pour louer Ibn Sharal de Berja, on a répété que seulement lui pouvait imaginer que les étoiles, à l’aube, tombent lentement du ciel comme des feuilles tombes des arbres ; ce qui, si c’était vrai, démontrerait que l’image ne vaut rien. L’image qu’un seul homme a pu concevoir est celle qui ne touche personne. Il est infiniment de choses dans le monde ; chacune peut être comparée toutes les autres. Comparer des étoiles à des feuilles n’est pas moins arbitraire que les comparer à des poissons ou à des oiseaux. En revanche, il n’est personne qui n’ait éprouvé, au moins une fois, que le destin est puissant et stupide, qu’il est à la fois innocent et inhumain. Le vers de Zuhair se réfère à cette conviction, qui peut être passagère ou permanente, mais que personne n’élude. On ne dira pas mieux ce qu’il a dit là. En outre (et ceci est peut-être l’essentiel de mes réflexions), le temps qui ruine les palais enrichit les vers. Celui de Zuhair, quand il l’écrivit en Arabie, servait à confronter deux images : celle du chameau, vieilli et celle du destin. Répété aujourd’hui, il sert la mémoire de Zuhair et confond notre affliction avec celle du poète mort. La figure avait deux termes, maintenant elle en a quatre. Le temps argumente le contenu des vers et j’en sais qui, à l’égal de la musique, sont tout pour tous les hommes. Ainsi il y a des années, poursuivi à Marrakech par le souvenir de Cordoue, je me plaisais à répéter l’apostrophe qu’Abdourrahman adressa dans les jardins de Rouzafa, à une palme africaine :
Toi aussi, tu es, ô palme !
en terre étrangère
Singulier privilège de la poésie : des mots écrits par un roi qui regrettait l’Orient me servir à moi, exilé en Afrique, pour exprimer ma nostalgie de l’Espagne.
Averroës, ensuite, parla des premiers poètes, de ceux qui dans le Temps de l’Ignorance, avant l’islam, avaient déjà dit toutes choses dans le langage infini des déserts. Alarmé, non sans raison, par les futilités d’Ibn-Sharaf, il avança que, dans les Anciens et dans le Coran, toute la poésie était inscrite : l’ambition d’innover venait de l’ignorance, elle était condamnée à l’échec. Les assistants l’écoutèrent avec plaisir, parce qu’il prônait le passé.
Les muezzins appelaient à la prière de la première aube quand Averroës rentra dans sa bibliothèque. (Dans le harem, les esclaves brunes avaient torturé une esclave rousse, mais il ne devait pas la prendre avant l’après-midi.) Quelque chose lui avait révélé le sens des deux mots obscurs. D’une ferme et soigneuse calligraphie, il ajouta ces lignes à son manuscrit : « Aristû (Aristote) appelle tragédie les panégyriques et comédie les satires et anathèmes. D’admirables tragédies et comédies abondent dans les pages du Coran et dans les moallakas du sanctuaire. »
Il eut sommeil et un peu froid. Il détacha son turban et se regarda dans un miroir de métal. Je ne sais ce que virent ses yeux, car aucun historien n’a décrit son visage. Je sais qu’il disparut brusquement comme si un feu sans lumière l’avait foudroyé et qu’avec lui disparurent la maison et l’invisible jet d’eau et les livres, les manuscrits et les colombes, et la multitude des esclaves brunes et la tremblante esclave rousse, et Farach et Aboulkassim et les rosiers et peut-être le Guadalquivir.
Dans le récit antérieur, j’ai voulu raconter l’histoire d’un échec. J’ai pensé, d’abord, à l’archevêque de Canterburry qui se proposa de démontra qu’il existe un Dieu ; puis aux alchimistes qui recherchèrent la pierre philosophale ; puis aux vains trissecteurs de l’angle et équarrisseurs du cercle. Je réfléchis ensuite qu’apparaîtrait plus poétique le cas d’un homme qui se proposerait un but qui ne serait pas caché aux autres, mais à lui seul. Je me souvins d’Averroës qui, prisonnier de la culture de l’Islam, ne put jamais savoir la signification des mots tragédie et comédie. Je racontai son aventure ; à mesure que j’avançai, j’éprouvai ce que dut ressentir ce dieu mentionné par Burton qui voulut créer un taureau et créa un buffle. Je compris que mon œuvre se moquait de moi. Je compris qu’Averroës s’efforçant de s’imaginer ce qu’est un drame, sans soupçonner ce qu’est un théâtre, n’était pas plus absurde que moi, m’efforçant d’imaginer Averroës, sans autre document que quelques miettes de Renan, de Lane et d’Asin Palacios. Je compris, à la dernière page, que mon récit était un symbole de l’homme que je fus pendant que je l’écrivais et que, pour rédiger ce conte, je devais devenir cet homme et que, pour devenir cet homme, je devais écrire ce conte, et ainsi de suite à l’infini. (« Averroës » disparaît à l’instant où je cesse de croire en lui.)
___________
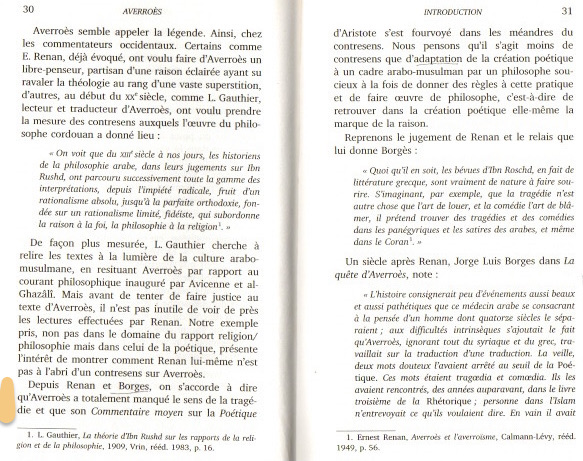
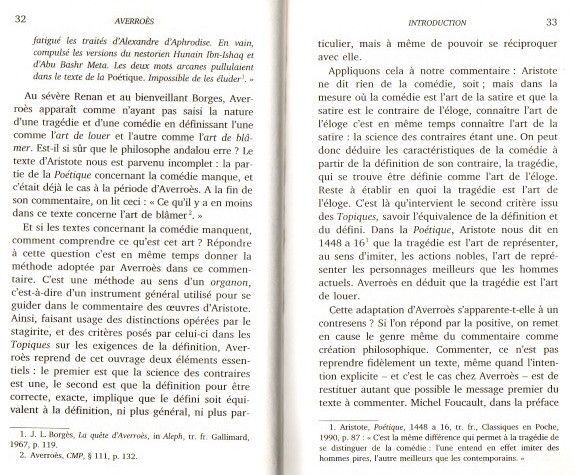
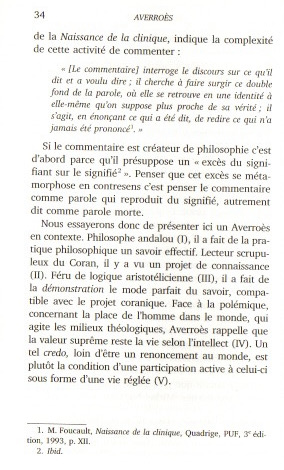
–
Photo « 28′ »
Khadra a plusieurs fois été qualifié d’imposteur. Des critiques littéraires le dénoncent plus ou moins régulièrement. La dernière fois « Le Masque et la plume » l’a descendu en flamme (cf nos articles antérieurs).
TSA_
Un écrivain algérien critique Yasmina Khadra et prend la défense de Ben Jelloun
Par: Rédaction 27 Févr. 2021
Les écrivains algériens continuent de s’entredéchirer sur les réseaux sociaux. Rebondissant sur les déclarations polémiques de Yasmina Khadra sur l’écrivain marocain Tahar Ben Jelloun, le romancier algérien Salim Bachi a clairement pris position.
L’auteur de « Chien d’Ulysse », qui a obtenu le prix Goncourt du premier roman, a sévèrement critiqué ce samedi son compatriote Yasmina Khadra, le qualifiant d’ « écrivain médiocre » et prenant la défense de l’écrivain Tahar Ben Jelloun.
«Yasmina Khadra est un écrivain médiocre, il n’a pas besoin de « nègre » (ghostwriter est un meilleur mot) pour l’être », estime M. Bachi dans une publication sur le réseau social Facebook.
« J’ai rencontré à de nombreuses reprises le personnage et il m’a toujours rebuté par ses vantardises jusqu’au point de se comparer à Tolstoï », fustige l’écrivain algérien.
« J’ai aussi rencontré à de nombreuses reprises Tahar Ben Jelloun qui m’a toujours témoigné du respect et de l’amitié. Je ne peux pas en dire autant de Khadra ou de Boudjedra par exemple. Je préfère mille fois l’auteur de La nuit sacrée à celui de L’Imposture des mots », tranche Salim Bachi.
La prise de parole publique de M. Bachi intervient alors que Yasmina Khadra a provoqué la polémique en s’attaquant publiquement le 6 février dernier à l’écrivain marocain Tahar Ben Jelloun. « Après vingt ans de silence, ne voyant personne s’assagir et tenter de renoncer à la vilénie, j’ai été contraint de dénoncer les manœuvres inqualifiables d’un écrivain que j’ai toujours respecté et qui s’est avéré être indigne de considération. J’ai nommé Tahar Ben Jelloun », a affirmé Yasmina Khadra dans un entretien sur TV5 Monde.
« Quand vous avez un écrivain de renom, connu dans le monde entier, prix Goncourt, membre influent de l’Académie Goncourt, qui s’appelle Tahar Ben Jalloun, qui raconte partout depuis 20 ans, de janvier 2001 jusqu’à ce matin, que je suis un imposteur, que ce n’est pas moi qui écris mes livres, qu’il connait mon nègre », a dénoncé l’écrivain algérien, de son vrai nom Mohammed Moulessehoul.
Yasmina Khadra a accusé l’écrivain marocain de lui avoir barré les portes des institutions littéraires françaises et des médias français. « Tahar Ben Jelloun est tellement bas, qu’il n’y a pas de débat », a fustigé Yasmina Khadra.
Ce n’est pas la première fois que des écrivains algériens se critiquent mutuellement. Dans son pamphlet « Les Contrebandiers de l’histoire » édité en 2017, Rachid Boidjedra n’a pas été tendre avec ses pairs. Il a classé dans la même case, celle des « contrebandiers de l’Histoire », Yasmina Khadra, Kamel Daoud, Boualem Sansal, Wassyla Tamzali, Feriel Furon et d’autres. À Khadra, il reproche « d’avoir déformé la réalité coloniale » dans son roman Ce que le jour doit à la nuit où « il se fait le défenseur fervent de la cohabitation heureuse et enchanteresse entre les Français et les Algériens durant la colonisation ».
___________________________________
Cliquer ici pour voir vidéo TV5 Monde et Khadra s’emporter contre Tahar Ben Djelloun (absent)
Ben Djelloun ne peut pas lui répondre et le journaliste ne dit rien.
____________________________________
Cliquer ici pour lire d’autres articles sur le sujet
____________________________________
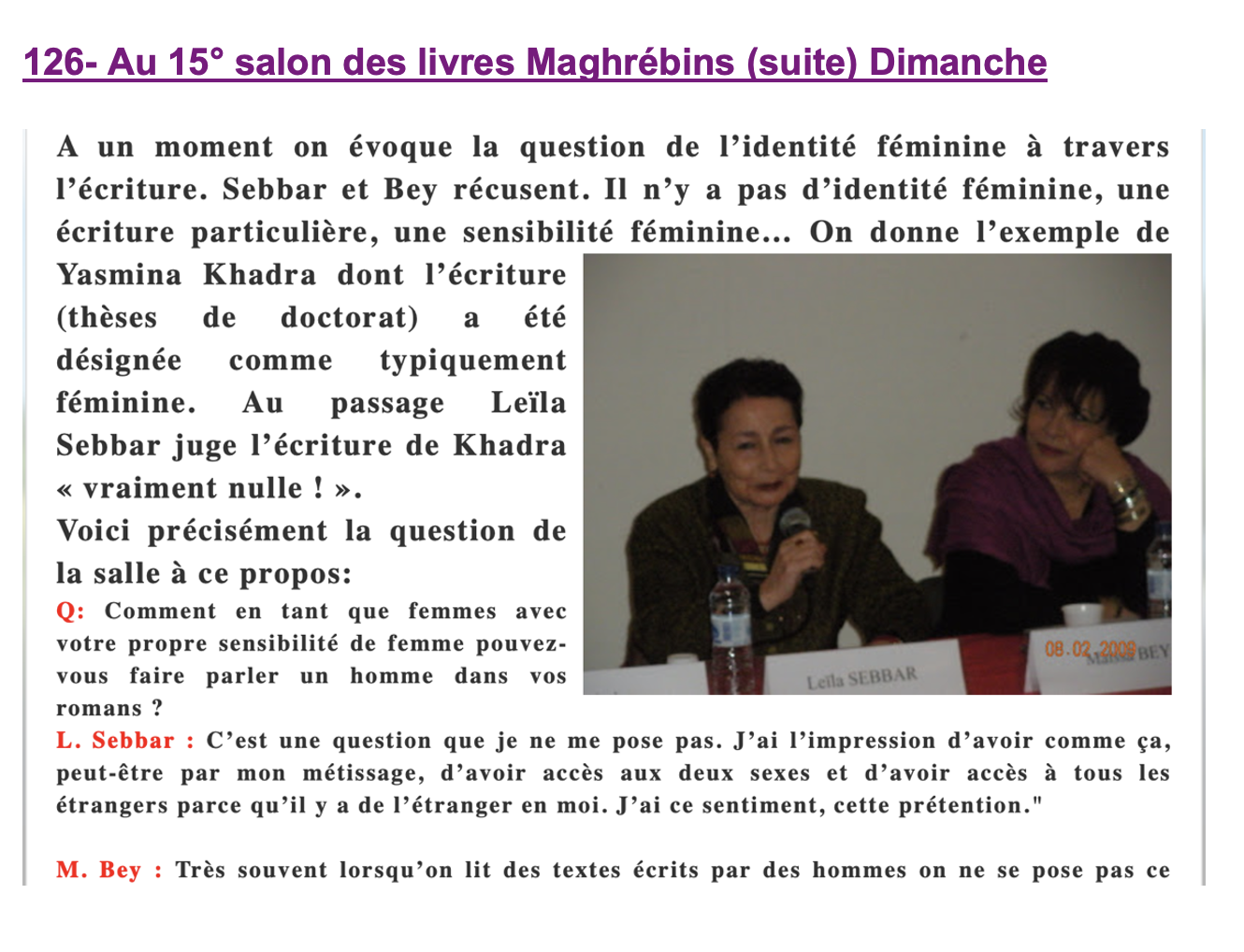

___________________________________________________
CLIQUER ICI POUR LIRE LE MÉMOIRE _ PDF _ (Merci Karim Sarroub)
______________________________________________
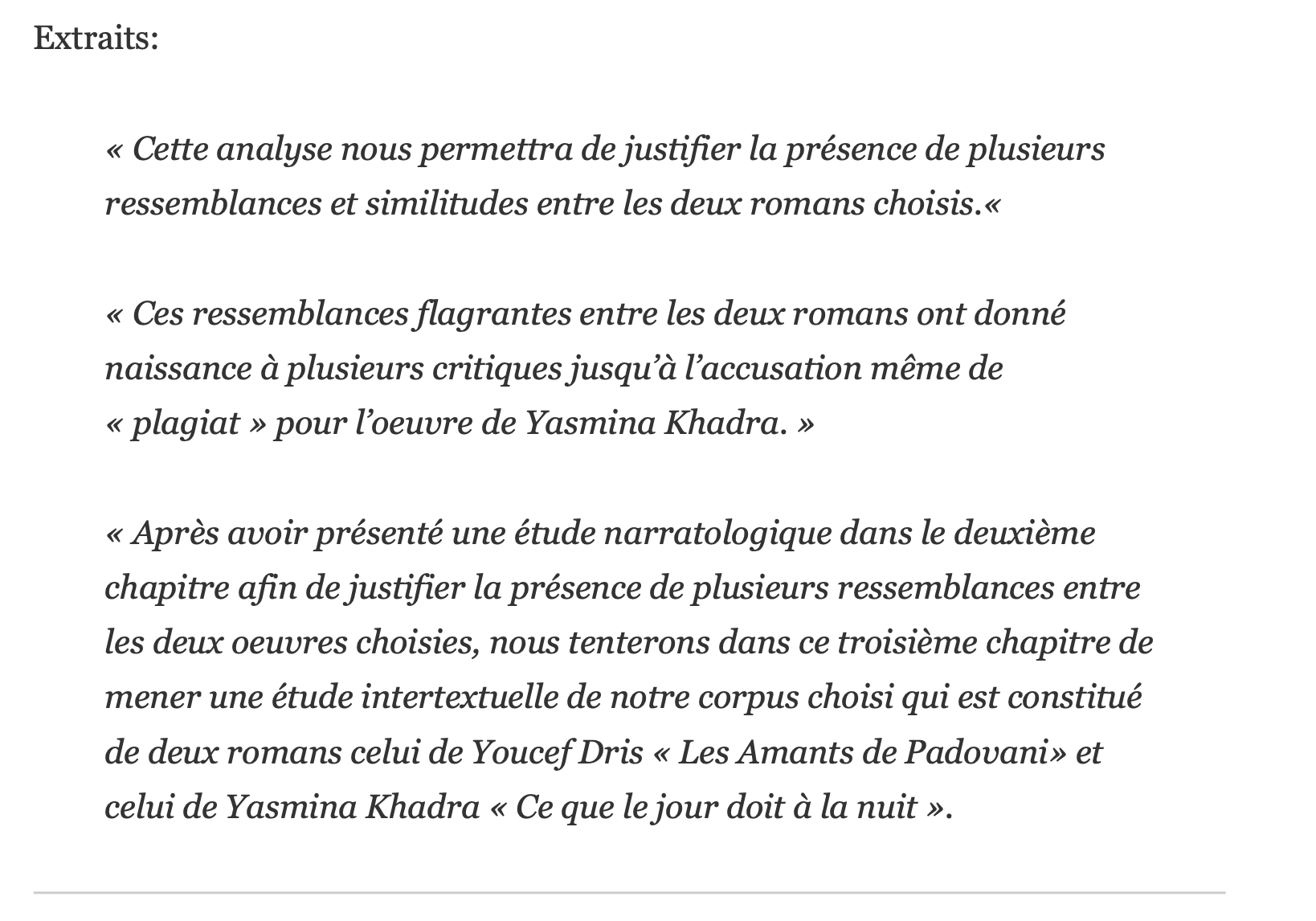
___________________________________________________

Merci à Jean-Jacques Reboux – Cliquer ici
__________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
CLIQUER ICI POUR LIRE LETTRE DU PREMIER ÉDITEUR FRANÇAIS DE Y. KHADRA
« Comment je me suis fait entuber par Yasmina Khadra (pour solde de tout compte) »
____________________________________________________
Extraits proposés par rkhettaoui- 22 décembre 2016
Les mots étaient semblables à de jolies hirondelles qui glissaient dans le ciel, puis montaient , montaient encore , et soudain , plongeaient jusqu’au ras du sol.Ou encore, quelques fois ces paroles ressemblaient à des papillons légers qui battaient des ailes , immobiles au -dessus d’une fleur.
Apres tout un petit garçon de trois ans n’est pas une lourde responsabilité pour nous deux ! On s’en occupera,et puis deux femmes seules ont besoin de compagnie.
La chanson passait dans l’ombre, douce comme une caresse .Et Dahmane , immobile , appréciait cet instant merveilleux qu’il souhaitait ne jamais se terminer.
Le cœur humain est pareil aux pendules , elles s’usent en servant ,mais se détraquent en ne servant pas.
Quelque fois ma chère sœur , il vaut mieux lâcher sa valise que de manquer la calèche.
____________
www-babelio-com
_______________________________
N’en jetez plus, la cour est pleine !


_
Une pétition circule pour dénoncer la censure israélienne contre le film « Jenin, Jenin » du Palestinien Mohamed BAKRI

Levez l’interdiction du film « Jenin, Jenin » de Mohammed Bakri !
20 janvier 2021
Membres de la communauté mondiale du cinéma, nous dénonçons la décision d’un tribunal israélien d’interdire toute projection ou diffusion du film documentaire “Jenin, Jenin”, et nous exprimons notre solidarité avec son auteur, notre collègue Mohammed Bakri, éminent réalisateur et acteur palestinien. En défense de la liberté d’expression, nous vous demandons de vous associer à notre appel à lever cette interdiction révoltante.
C’est avec consternation et indignation que nous avons appris la décision du tribunal d’instance de la ville de Lod d’interdire toute projection ou diffusion du film documentaire “Jenin, Jenin”, tourné en 2002 par Mohammed Bakri, réalisateur et acteur palestinien renommé.
Dans sa décision scandaleuse, le tribunal affirme que certaines allégations du film – qui décrit des évènements ayant eu lieu dans le camp de réfugiés palestiniens de Jénine au long d’une période de deux semaines en avril 2002 – sont fausses. Outre qu’il interdit toute projection du film en Israël, le tribunal rend une ordonnance de confiscation de 24 copies du film et ordonne au réalisateur du film de payer 175 000 shekels (55 000 dollars étasuniens) de dommages et intérêts à un officier israélien qui apparaît dans le film, ainsi que 50 000 shekels (15 500 dollars étasuniens) de frais de justice.
Mohammed Bakri, qui n’a cessé depuis 17 ans d’être harcelé et persécuté par le gouvernement israélien, montre de façon documentaire, sans commentaire, sans voix off, les suites de la destruction brutale du camp de réfugiés de Jénine commise par l’armée israélienne en 2002. Il dédie le film à son producteur Lyad Samoudi, tué par des soldats israéliens dans le gouvernorat de Jénine peu après la fin du tournage.
Nous demandons instamment à la communauté mondiale, et en particulier à la famille globale du cinéma, de s’associer à nous pour dénoncer cette tentative flagrante de censure. Les autorités israéliennes responsables, y compris le ministre de la Culture, doivent répondre de cet acte.
La subjectivité est un aspect essentiel de l’expression artistique et cinématographique. Nous demandons donc à nos collègues et camarades de s’associer à nous pour dénoncer les allégations portées contre Bakri et les efforts des autorités israéliennes pour compromettre la liberté d’expression et la liberté artistique des cinéastes et des artistes palestiniens.
Nous exigeons enfin l’annulation de la décision inacceptable du tribunal israélien, qui menace le droit fondamental des cinéastes et des artistes à exprimer librement leur point de vue.
Rejoignez Ken Loach, Aki Kaurismaki, Mike Leigh, Alia Shawkat, Liam Cunningham, Vanessa Redgrave, Hany Aby Assad, Mai Masri, Michel Khleifi, AnneMarie Jacir, Eyal Sivan, Robyn Slovo, Asif Kapadia, Rasha Salti, Raed Andoni, May Odeh, Ali Suliman, Orwa Nyrabia, Christoph Terhechte, Henrique Goldman, Paul Laverty, Rebecca O’Brien, Ola Alsheikh, David Riker, Asia Kapadia, Brian Eno, Miriam Margolyes, Sawsan Asfari…
——————-
+ Ahmed Hanifi ahmedhanifi@gmail.com
_________________________

CE QUE DIT CETTE MAGNIFIQUE ADOLESCENTE EST TRÈS ÉMOUVANT
ET INCITE À L’ESPOIR POUR LE PEUPLE PALESTINIEN
TRADUCTION EN FRANÇAIS
« Ils ne réalisent pas ce qu’ils font, combattre l’ennemi, cela ne veut pas dire que je suis cruelle. Je défends ma patrie. Je défends mon camp. Nous ne ferons jamais la paix avec eux. Même si notre président la fait. Je ne ferai jamais la paix avec eux. C’est vrai que je suis une bonne personne, mais les juifs sont odieux. Ils nous ont envahis. Nous défendons notre terre. S’ils capturent votre fils, ne feriez-vous rien pour le récupérer? Nous ressentons donc la même chose pour notre terre. Notre terre signifie tout pour nous. Comme nous le disions, nos femmes existent toujours. Nous continuerons d’avoir des enfants. Ils deviendront plus forts et plus courageux que jamais. Je n’ai pas peur de ces lâches. Ils sont comme des souris. Malgré leurs grandes armes. Ils se cachent toujours derrière leurs chars, effrayés par les civils comme nous. Leur lâcheté est légendaire. Nous n’avons pas peur d’eux quoi qu’ils fassent. Leurs bombes sont tombées sur nous comme de l’eau car ce sont des perdants et des lâches…
Quand j’ai appris que Sharon venait au camp, j’étais tellement en colère que j’ai éclaté en sanglots. Parce que j’avais un grand désir de me venger de lui, de le torturer pour ainsi dire.
– Croyez-vous que vous pouvez vaincre Sharon?
Oui je peux, pourquoi pas?
– Il est plus fort que vous, comment pourriez-vous le faire?
Je suis plus forte que lui, grâce à ma volonté. Je peux le vaincre grâce à ma volonté. Parce que je défends ma nation, parce qu’il a tué des innocents que je connaissais très bien. Je peux le vaincre parce qu’il a dispersé notre peuple. Il a détruit chaque coin du camp sans épargner une seule maison. »
——————
TRADUCTION EN ANGLAIS
They don’t realize what they’re doing, fighting the enemy, this doesn’t mean that I am cruel. I defend my motherland. I defend my camp. We will never make peace with them. Even if our President does so. I will never make peace with them. It’s true that I’m a good person but Jews are hateful. They invaded us. We are defending our land. If they capture your son, wouldn’t you do anything to get him back? So we feel the same for our land. Our land means everything to us. As we used to say, our women still exist. We’ll keep on having children. They’ll become stronger and braver than ever. I’m not afraid of these cowards. They’re like mice. Despite their great weapons. They still hide behind their tanks, afraid of civilians like us. Their cowardice is legendary. We are not afraid of them no matter what they do. Their bombs came down on us like water because they’re losers and cowards…
When I heard that Sharon was coming to the camp, I was so angry that I burst, into tears. Because I had a great desire to take revenge on him, to torture him so to speak.
_ Do you beleave you can defeat Sharon?
Yes I can, why not?
_ He’s stronger than you, how would you be able to?
I’m stronger than him, thanks to my will. I can defeat him thanks to my will. Because I’m defending my nation, because he murdered innocent people whom I knew very well. I can defeat him because he has dispersed our people. He destroyed each corner in the camp without sparing one single house.
——————
________________________________________________
1° PARTIE
CLIQUER ICI POUR VOIR LA PARTIE 1 DU FILM
.
.______________________________________________
2° PARTIE
CLIQUER ICI POUR VOIR LA PARTIE 2 DE « JENIN, JENIN »
.
_______________________________________________
ARTICLES
Dix-huit ans après sa sortie, la justice israélienne décide d’interdire le documentaire Jenin, Jenin
13 janvier 2021
Situé au nord de la Cisjordanie occupée, le camp de réfugiés palestiniens de Jénine a été le théâtre de graves violences du 3 au 11 avril 2002. 52 Palestiniens et 23 soldats israéliens ont été tués lors de l’opération « Rempart » lancée par Tsahal après une série d’attentats commis en Israël dont celui du 27 mars 2002 à l’hôtel Park de Netanya.
Le documentaire Jenin, Jenin (Mohammed Bakri, 2002), qui raconte cette histoire tragique, a été jugé « biaisé » par la justice israélienne le 12 janvier 2021, laquelle a décidé de l’interdire – en exigeant même la remise des copies – et de condamner pour diffamation son réalisateur à payer 175 000 shekels (environ 43 000 euros) au lieutenant-colonel Nissim Magnagi que l’on peut identifier dans le film de 54 minutes.
Le réalisateur a qualifié ce jugement « d’injuste », précisant à l’AFP qu’il allait faire appel. Pour Hussein Abou Hussein, son avocat, « il s’agit d’une décision politique » qui a pour finalité de « faire taire toute voix qui diffère de la position officielle ». Selon le ministre palestinien de la Culture, Atef Abou Seif, « les autorités militaires israéliennes ont peur de voir les faits qui exposent leur brutalité et la souffrance des Palestiniens ». Pour sa part, le chef d’état-major de l’armée israélienne, Aviv Kochavi, a salué « un soutien clair et net adressé aux combattants de l’armée ».
Notons que des réservistes avaient déjà porté plainte en 2008 pour diffamation, des plaintes alors rejetées par la justice qui a toutefois considéré que le réalisateur avait fait preuve de « mauvaise foi », lui reprochant notamment de ne pas avoir présenté la version de l’armée pour contrebalancer les témoignages des habitants du camp de réfugiés.
Rappelons enfin la polémique soulevée en France en 2003 après qu’Arte a annulé la diffusion du documentaire initialement programmée sur la chaîne publique le 1er avril à 21h40 dans la soirée Thema, « Dialogues israélo-palestiniens » en raison « de la situation internationale » et pour « ne pas accroître les tensions entre les communautés ». Des cinéastes israéliens et palestiniens avaient alors adressé une lettre ouverte à Jérôme Clément, président d’Arte :
« Les cinéastes israéliens et palestiniens participants actuellement, à Paris, au Festival « Israéliens – Palestiniens, que peut le cinéma ? », ont appris avec stupéfaction votre décision de déprogrammer le film Jenine, Jenine, du réalisateur palestinien Mohamad Bakri, annoncé dans le cadre de la soirée thématique du mardi 1er avril « Dialogues israélo-palestiniens », l’ennemi à mes côtés. Nous protestons vigoureusement contre cet acte de censure, probablement dû à des pressions politiques exercées par des éléments extérieurs à la direction d’Arte. En cédant à ces pressions, Arte emboîte malheureusement le pas à la censure officielle exercée en Israël contre ce film. Tous les films, fictions ou documentaires, sont des représentations de la société dans laquelle nous vivons. Avec nous, Arte se doit de partager et de discuter les différentes versions qui existent de cette même réalité, plutôt que de les interdire ou de réduire leurs auteurs au silence. Nous tenons à vous faire savoir que la réalisatrice Yulie Gerstel et le réalisateur Nitzan Giladi, auteurs des films israéliens programmés dans le cadre de cette même soirée thématique, nous ont demandé de joindre leurs noms à cette protestation. »
www-darkness-fanzine-over-blog-com-2021-01
—————
« Jenine, Jénine » : laissez-vous censurer par Arte
Par Germinal Pinalie, lundi 7 avril 2003
Autocensure : Arte en repasse une couche sur « Jénine, Jénine », film déprogrammé par la chaîne.
Le magazine Metropolis diffusé par Arte ce samedi 5 avril 2003 comportait un reportage sur le film « Jénine, Jénine » de Mohammed Bakri, réalisé à Tel Aviv par une équipe allemande semble-t-il (le magazine en question est réalisé alternativement par les rédactions parisienne et allemande de la chaîne je crois). Ce reportage se terminait sur ce commentaire :
« Comme documentaire, c’est à dire comme représentation de la réalité, le film de Bakri n’est pas crédible. Mais en le censurant, les autorités israéliennes se dont mis une partie de l’opinion publique à dos, et en ont fait un film culte, ce qu’il ne serait jamais devenu sans cela. »
Ce reportage est scandaleux, d’abord pour ce qu’il montre, à savoir qu’Arte met en scène l’info comme tout le monde, et pour ce qu’il cache, à savoir qu’Arte ne parle pas de son autocensure dans un reportage sur la censure…
Non seulement nous n’aurons pas pu voir ce film, mais en plus ils auront craché dessus… « Lassen sie sich von Arte überaschen », qu’ils disaient…
Germinal Pinalie
——————
« Arte a déprogrammé le documentaire « Jénine, Jénine » qui devait être diffusé mardi 1er avril à 21H40 dans une soirée Thema, « Dialogues israélo-palestiniens », en raison « de la situation internationale » et pour « ne pas accroître les tensions entre les communautés ».
« Jénine, Jénine » est un documentaire réalisé par Mohammed Bakri, Arabe israélien, sur les violences dans le camp de Jénine au printemps 2002, qui ont fait une cinquantaine de morts [Chiffre contesté (note d’Acrimed)].
[…] La diffusion de ce documentaire, précise ARTE dans un communiqué, sera reportée à une date ultérieure et accompagnée d’un débat. »
WWW_acrimed-org
_______________________________________




La jeune poétesse Amanda Gorman (22 ans) lors de la cérémonie
d’investiture de Joe Boden, 46° président des États-Unis,
le mercredi 20 janvier 2021 _ Elle lit un poème qu’elle a écrit pour la circonstance :
The Hill We Climb.
Nous l’avons tous vue, entendue, hier.
____________________________________________
.
.
CLIQUER ICI POUR ÉCOUTER, VOIR, AMANDA GORMAN. (VIDÉO)
.
.
___________________________________________
www.franceculture.fr
20/01/2021 – Par Maïwenn Bordon
Amanda Gorman, 22 ans, été choisie pour composer et réciter un poème sur l’unité nationale lors de la cérémonie d’investiture de Joe Biden à la présidence des États-Unis, ce mercredi 20 janvier. C’est la plus jeune poétesse jamais invitée à cette cérémonie dans l’histoire du pays.
« When day comes we ask ourselves, / where can we find light in this never-ending shade? / The loss we carry, / a sea we must wade » : c’est par ces mots que commence le poème lu par Amanda Gorman, la plus jeune poétesse jamais invitée à une cérémonie d’investiture dans l’histoire des États-Unis. Originaire de Los Angeles, elle a été choisie par Joe Biden pour composer et réciter un poème lors de sa prise de fonction à la Maison Blanche, ce mercredi 20 janvier. Selon la presse américaine, la Première Dame, Jill Biden, apprécie beaucoup le travail de cette poétesse de 22 ans, originaire de Los Angeles, et a convaincu le comité chargé de la cérémonie d’investiture de la choisir. Cette tradition démocrate du poète inaugural remonte à l’investiture du président John Fitzgerald Kennedy : le 20 janvier 1961, le poète Robert Frost avait alors récité The Gift Outright. En 2009, Barack Obama avait par exemple choisi Elizabeth Alexander, qui avait récité Praise Song for the Day pour sa première cérémonie d’investiture. Le poème lu par Amanda Gorman pour l’investiture du 46e président des États-Unis, est intitulé The Hill We Climb (La colline que nous gravissons), et aborde le thème de l’unité nationale.
Selon le New York Times, le comité d’organisation de la cérémonie d’investiture de Joe Biden a contacté Amanda Gorman à la fin du mois dernier. Elle a appris à ce moment-là que Jill Biden avait vu, à la Bibliothèque du Congrès en 2017, une lecture de son poème In This Place : An American Lyric, dans lequel la jeune poétesse condamne la marche raciste de Charlottesville en Virginie. La future Première Dame avait alors suggéré que la poétesse lise un poème lors de l’investiture. Aucune consigne ne lui a été donnée, mais elle a été encouragée à insister sur l’unité et l’espoir. « Gorman a commencé le processus, comme elle le fait toujours, avec des recherches. _Elle s’est inspirée des discours des leaders américains qui ont essayé de rassembler les citoyens pendant des périodes de division intense_, comme Abraham Lincoln et Martin Luther King. Elle a également parlé à deux des précédents « poètes inauguraux », (Richard) Blanco et (Elizabeth) Alexander« , affirme le New York Times.
Le poème d’Amanda Gorman fait référence au quartier de Washington, Capitol Hill, où se situe le siège du Congrès américain. Selon le New York Times, la poétesse de 22 ans était arrivée environ à la moitié de son poème lors que les militants pro-Trump ont envahi le Capitole : elle est restée éveillée cette nuit-là et a ajouté des vers au poème pour décrire ces scènes apocalyptiques qui ont ébranlé les États-Unis.
“We’ve seen a force that would shatter our nation rather than share it / Would destroy our country if it meant delaying democracy / And this effort very nearly succeeded / But while democracy can be periodically delayed, / It can never be permanently defeated / In this truth, in this faith we trust.
Nous avons vu une force qui détruirait notre nation plutôt que de la partager / Détruirait notre pays si cela veut dire retarder la démocratie / Et cet effort était à deux doigts de réussir / Mais pendant que la démocratie peut être ponctuellement retardée / Elle ne peut être vaincue de façon définitive / Nous croyons en cette vérité, en cette foi », écrit Amanda Gorman dans cet extrait du poème dévoilé par le New York Times, avant l’investiture. »
Dans The Hill We Climb, Amanda Gorman évoque son parcours, qui fait écho à celui de Kamala Harris, devenue la première femme à accéder au poste de vice-présidente des États-Unis. « We the successors of a country and a time / Where a skinny Black girl / descended from slaves and raised by a single mother / can dream of becoming president / only to find herself reciting for one (Nous les héritiers d’un pays et d’une époque / où une fille noire maigre / descendante des esclaves et élevée par une mère célibataire / peut rêver de devenir présidente / seulement parce qu’elle se retrouve à réciter pour l’un d’eux)« , a déclaré Amanda Gorman à travers son poème.
Contrairement à ses prédécesseurs, la jeune poétesse a dû relever un défi de taille : composer un poème qui appelle à l’unité et à l’espoir, alors que les Américains sont plus divisés que jamais au sortir de la présidence de Donald Trump. Son poème reflète donc cette Amérique « en désordre« . « Je dois reconnaître cela dans le poème. Je ne peux pas l’ignorer ou l’effacer. Et donc, j’ai élaboré un poème inaugural qui reconnaît ces cicatrices et ces blessures. J’espère qu’il nous fera progresser vers leur guérison« , a confié Amanda Gorman au Los Angeles Times.
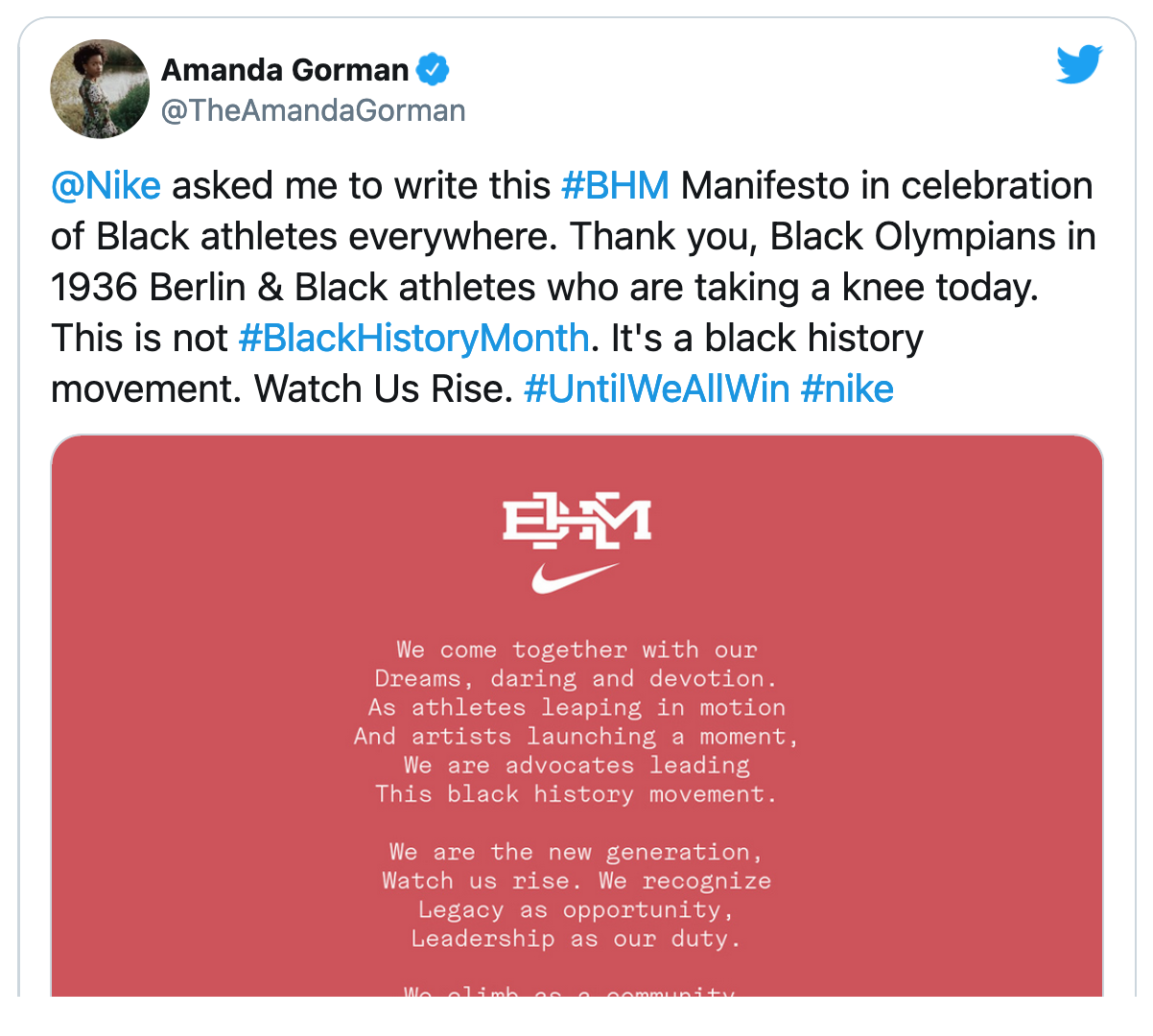
Selon le journal Los Angeles Times, la jeune poétesse a écouté de la musique pour l’aider à composer son poème et avoir un « état d’esprit historique et épique« , avec notamment les bandes originales des séries The Crown, Lincoln, Darkest Hour et Hamilton. Lors de la cérémonie d’investiture, Amanda Gorman a lu son poème pendant six minutes, d’une voix assurée alors qu’elle savait que des millions d’Américains avaient les yeux rivés sur elle et son message.
« We are striving to forge a union with purpose / To compose a country committed to all cultures, colors, characters and / conditions of man / And so we lift our gazes not to what / stands between us / but what stands before us / We close the divide because we know, to put our future first, / we must first put our differences aside / We lay down our arms / so we can reach out our arms / to one another (Nous nous battons pour forger une union avec un but / Pour composer un pays engagé dans toutes les cultures, couleurs, personnages et / conditions de l’homme / Et nous levons nos regards non pas vers / ce qui se tient entre nous / mais vers ce qui se tient face à nous / Nous mettons fin au clivage parce que nous savons, mettre notre futur en premier, / nous devons mettre nos différences de côté / Nous déposons nos armes / pour atteindre nos bras / et en former un autre », invite Amanda Gorman dans The Hill We Climb.
Amanda Gorman est tombée amoureuse des mots et de la poésie quand elle était petite. Elle grandit à Los Angeles, élevée avec sa soeur jumelle par sa mère célibataire, qui enseigne l’anglais au collège. Elle écrit dans des journaux dans la cour de récréation. À l’âge de 16 ans, elle remporte le concours des jeunes poètes de Los Angeles. En 2017, alors qu’elle étudie la sociologie à l’université d’Harvard, elle devient lauréate du premier concours national des jeunes poètes : c’est la première personne à détenir ce titre.
Depuis cette période, Amanda Gorman a acquis une certaine notoriété et a été conviée par des personnalités comme Lin-Manuel Miranda, Al Gore ou encore Hillary Clinton. Elle a également récité des poèmes lors des célébrations du Jour de l’Indépendance ou lors de l’investiture du nouveau président de l’université d’Harvard en octobre 2018.
Amanda Gorman est une poétesse militante, qui s’inspire de la société américaine. Elle a par exemple composé We the People pour décrire le choc qu’elle a ressenti après l’élection de Donald Trump. Elle a écrit We Rise, en écoutant le témoignage de Christine Blasey Ford, la psychologue qui a accusé Brett Kavanaugh d’agression sexuelle, alors qu’il était candidat à la Cour suprême des États-Unis. L’année dernière, elle s’est inspirée de la crise sanitaire pour écrire The Miracle of Morning, poème dans lequel elle tente d’insuffler de l’espoir : « In this chaos, we will discover clarity. / In suffering, we must find solidarity (Dans ce chaos, nous découvrirons la clarté / Dans la souffrance, nous trouverons la solidarité) ».
En février 2020, la poétesse a été sollicitée par Nike pour rédiger une tribune en faveur des athlètes noirs.
Consciente du succès des messages qu’elle véhicule dans ses poèmes, Amanda Gorman a déjà beaucoup d’ambition. Dans une interview au New York Times en 2017, elle ne cachait d’ailleurs pas qu’elle avait la Maison Blanche dans le viseur. « C’est un objectif très lointain, mais en 2036, je présenterai ma candidature pour devenir présidente des États-Unis« , affirmait la poétesse. Avant d’ajouter, à l’intention du journaliste : « Vous pouvez ajouter cela à votre calendrier iCloud« .


Attention: traduction olé olé… si la vôtre est meilleure, n’hésitez pas à me la communiquer…
The Hill We Climb
La colline que nous escaladons
When day comes we ask ourselves,
Quand le jour vient nous nous demandons,
where can we find light in this never-ending shade?
où trouver la lumière dans cette teinte sans fin?
The loss we carry,
La perte que nous portons,
a sea we must wade
une mer qu'il faut patauger
We’ve braved the belly of the beast
Nous avons bravé le ventre de la bête
We’ve learned that quiet isn’t always peace
Nous avons appris que le calme n'est pas toujours la paix
And the norms and notions
Et les normes et notions
of what just is
de ce qui est juste
Isn’t always just-ice
N'est pas toujours juste de la glace
—-
And yet the dawn is ours
Et pourtant l'aube est à nous
before we knew it
avant de le savoir
Somehow we do it
D'une manière ou d'une autre, nous le faisons
Somehow we’ve weathered and witnessed
D'une certaine manière, nous avons résisté et été témoins
a nation that isn’t broken
une nation qui n'est pas brisée
but simply unfinished
mais simplement inachevée
We the successors of a country and a time
Nous les successeurs d'un pays et d'un temps
Where a skinny Black girl
Où une fille noire maigre
descended from slaves and raised by a single mother
descendant d'esclaves et élevée par une mère célibataire
can dream of becoming president
peut rêver de devenir présidente
only to find herself reciting for one
seulement pour se retrouver à réciter pour quelqu’un
And yes we are far from polished
Et oui on est loin d'être poli
far from pristine
loin d'être vierge
but that doesn’t mean we are
mais cela ne veut pas dire que nous nous
striving to form a union that is perfect
efforçons de former une union parfaite
We are striving to forge a union with purpose
Nous nous efforçons de forger une union avec un but
To compose a country committed to all cultures, colors, characters and
Pour composer un pays engagé pour toutes les cultures, couleurs, personnages et
conditions of man
conditions de l'homme
And so we lift our gazes not to what stands between us
Et donc nous levons nos regards pas vers ce qui se tient entre nous
but what stands before us
mais ce qui nous attend
We close the divide because we know, to put our future first,
Nous fermons le fossé parce que nous savons, pour mettre notre avenir en premier,
we must first put our differences aside
nous devons d'abord mettre nos différences de côté
We lay down our arms
Nous déposons nos armes
so we can reach out our arms
pour que nous puissions tendre les bras
to one another
à un autre
We seek harm to none and harmony for all
Nous ne cherchons le mal à personne et l'harmonie pour tous
Let the globe, if nothing else, say this is true:
Laissons le globe, à tout le moins, dire que c'est vrai:
That even as we grieved, we grew
Que même en pleurant, nous avons grandi
That even as we hurt, we hoped
Que même si nous souffrions, nous espérions
That even as we tired, we tried
Que même si nous étions fatigués, nous avons essayé
That we’ll forever be tied together, victorious
Que nous serons à jamais liés ensemble, victorieux
Not because we will never again know defeat
Pas parce que nous ne connaîtrons plus jamais la défaite
but because we will never again sow division
mais parce que nous ne sèmerons plus jamais la division
Scripture tells us to envision
L'Écriture nous dit d'envisager
that everyone shall sit under their own vine and fig tree
que chacun s'assoit sous sa vigne et son figuier
And no one shall make them afraid
Et personne ne leur fera peur
If we’re to live up to our own time
Si nous voulons vivre à la hauteur de notre temps
Then victory won’t lie in the blade
Alors la victoire ne sera pas dans la lame
But in all the bridges we’ve made
Mais dans tous les ponts que nous avons créés
That is the promised glade
C'est la clairière promise
The hill we climb
La colline que nous gravissons
If only we dare
Si seulement nous osons
It’s because being American is more than a pride we inherit,
C'est parce qu'être américain est plus qu'une fierté dont nous héritons,
it’s the past we step into
c'est le passé dans lequel nous entrons
and how we repair it
et comment nous le réparons
We’ve seen a force that would shatter our nation
Nous avons vu une force qui briserait notre nation
rather than share it
plutôt que de le partager
Would destroy our country if it meant delaying democracy
Détruirait notre pays si cela signifiait retarder la démocratie
And this effort very nearly succeeded
Et cet effort a presque réussi
But while democracy can be periodically delayed
Mais alors que la démocratie peut être périodiquement retardée
it can never be permanently defeated
elle ne peut jamais être vaincue définitivement
In this truth
Dans cette vérité
in this faith we trust
dans cette foi nous avons confiance
For while we have our eyes on the future
Pendant que nous avons les yeux sur l'avenir
history has its eyes on us
l'histoire nous regarde
This is the era of just redemption
C'est l'ère de la juste rédemption
We feared at its inception
On craignait à sa création
We did not feel prepared to be the heirs
Nous ne nous sentions pas prêts à être les héritiers
of such a terrifying hour
d'une heure si terrifiante
but within it we found the power
mais en elle nous avons trouvé le pouvoir
to author a new chapter
pour rédiger un nouveau chapitre
To offer hope and laughter to ourselves
Pour s'offrir de l'espoir et du rire
So while once we asked,
Alors une fois que nous avons demandé,
how could we possibly prevail over catastrophe?
comment pourrions-nous vaincre la catastrophe?
Now we assert
Maintenant nous affirmons
How could catastrophe possibly prevail over us?
Comment la catastrophe pourrait-elle prévaloir sur nous?
We will not march back to what was
Nous ne retournerons pas à ce qui était
but move to what shall be
mais passer à ce qui sera
A country that is bruised but whole,
Un pays meurtri mais entier,
benevolent but bold,
bienveillant mais audacieux,
fierce and free
féroce et libre
We will not be turned around
Nous ne serons pas retournés
or interrupted by intimidation
ou interrompus par l'intimidation
because we know our inaction and inertia
parce que nous connaissons notre inaction et notre inertie
will be the inheritance of the next generation
sera l'héritage de la prochaine génération
Our blunders become their burdens
Nos maladresses deviennent leurs fardeaux
But one thing is certain:
Mais une chose est certaine:
If we merge mercy with might,
Si nous fusionnons la miséricorde avec la puissance,
and might with right,
et pourrait avec le droit,
then love becomes our legacy
alors l'amour deviendrait notre héritage
and change our children’s birthright
et changer le droit de naissance de nos enfants
So let us leave behind a country
Alors laissons derrière nous un pays
better than the one we were left with
mieux que celui qui nous reste
Every breath from my bronze-pounded chest,
Chaque souffle de ma poitrine martelée de bronze,
we will raise this wounded world into a wondrous one
nous élèverons ce monde blessé en un monde merveilleux
We will rise from the gold-limbed hills of the west,
Nous nous élèverons des collines dorées de l'ouest,
we will rise from the windswept northeast
nous nous élèverons du nord-est balayé par les vents
where our forefathers first realized revolution
où nos ancêtres ont réalisé la première révolution
We will rise from the lake-rimmed cities of the midwestern states,
Nous nous élèverons des villes bordées de lacs des États du Midwest,
we will rise from the sunbaked south
nous nous lèverons du sud ensoleillé
We will rebuild, reconcile and recover
Nous reconstruirons, réconcilierons et récupérerons
and every known nook of our nation and
et chaque recoin connu de notre nation et
every corner called our country,
chaque coin a appelé notre pays,
our people diverse and beautiful will emerge,
notre peuple diversifié et beau émergera,
battered and beautiful
battue et belle
When day comes we step out of the shade,
Quand le jour vient nous sortons de l'ombre,
aflame and unafraid
enflammé et sans peur
The new dawn blooms as we free it
La nouvelle aube fleurit alors que nous la libérons
For there is always light,
Car il y a toujours de la lumière,
if only we’re brave enough to see it
si seulement nous sommes assez courageux pour le voir
If only we’re brave enough to be it
Si seulement nous sommes assez courageux pour l'être
____________________________________________
Par L’Obs avec AFP
Publié le 22 janvier 2021
Records de vente, couronnes de lauriers : les Etats-Unis se passionnent pour la jeune poétesse noire Amanda Gorman depuis sa prestation très remarquée à la cérémonie d’investiture de Joe Biden.
Trois de ses ouvrages – un recueil de poèmes, un livre pour enfants et une édition spéciale des vers déclamés pour le nouveau président américain – étaient ce vendredi 22 janvier en tête des ventes de livres sur Amazon.
Pourtant aucun n’est encore publié : ils ne sortiront qu’en avril, voire en septembre pour « Change Sings », des odes illustrées pour les plus jeunes.
Ce qui n’a pas empêché les acheteurs de les précommander en masse, si bien que la jeune artiste et militante dépasse désormais Barack Obama, dont les mémoires, « Une Terre promise », ne sont qu’en 5e position dans cette liste de best-sellers.
L’ancien président a été impressionné par la jeune femme qui, à 22 ans seulement, a récité mercredi avec grâce et une assurance stupéfiante une ode de sa création : « The Hill we climb » (la colline que nous gravissons).
Elle « a fait plus qu’incarner le moment. Les jeunes gens comme elle sont la preuve qu’“il y a toujours de la lumière, si nous sommes assez courageux pour la voir. Si nous sommes assez courageux pour être cette lumière” », a-t-il tweeté en lui empruntant ses vers.
L’ex-candidate démocrate à la présidentielle Hillary Clinton et même la Nobel de la Paix pakistanaise Malala ont également salué son travail.
En une journée, elle a gagné deux millions d’abonnés sur Instagram et plus d’un million sur Twitter. Ses vers ont même été mis en musique par le musicien Rostam Batmanglij.
Originaire de Los Angeles, élevée par une mère célibataire, elle souffrait de bégaiement dans son enfance – comme le 46e président – ce qui l’a encouragée à se tourner vers l’écriture.
Enfant prodige, elle a remporté son premier prix de poésie à 16 ans, et a été couronnée du titre de « meilleur jeune poète » du pays trois ans plus tard, alors qu’elle étudiait la sociologie à la prestigieuse université Harvard.
Avant elle, cinq autres poètes, dont Robert Frost et Maya Angelou, ont participé aux cérémonies d’investiture de présidents américains, mais aucun n’était aussi jeune.
Son nom avait été soufflé aux organisateurs de la cérémonie par Jill Biden, l’épouse du président, qui avait assisté à une de ses lectures. Leur commande, passée en décembre : qu’elle rédige une ode à l’« Amérique unie », en écho au discours du démocrate.
Elle n’avait rédigé que la moitié du texte quand des partisans de Donald Trump ont envahi le Capitole le 6 janvier. Horrifiée, elle a écrit d’une seule traite la fin de son poème qui, sans nier les maux du pays, prône l’unité pour avancer. « Nous ne sommes pas une Nation brisée, seulement une Nation pas finie. »
www.nouvelobs.com/joe-biden/20210122

________________________________
.
.
CLIQUER ICI POUR LIRE « J’ai rêvé l’Algérie »
.
.
________________________________
J’ai découvert par hasard (via un tweet de Laïla B.) ce récent livre édité par les Éditions Barzakh d’Alger. Un livre collectif de témoignages, de récits et de fictions.
Voici ce qu’écrit en Avant-Propos de cet ouvrage Amina Izerouken, Chargée des programmes Fondation Friedrich Ebert Algérie:
« J’avoue que j’ai rêvé !
J’ai rêvé éveillée : assise, debout, en marchant, en m’endormant… Mon rêve était palpable, il frôlait le réel, il se matérialisait !
J’ai rêvé pour moi, pour que mes sœurs ne soient plus jamais violentées, nos libertés plus jamais confisquées ; j’ai rêvé que la presse ne serait plus muselée, le champ politique barri- cadé, notre patrimoine délaissé, saccagé…
Puis, je me suis interrogée sur nos responsabilités, notre démission, notre rôle dans ce marché conclu à huis clos, mais au vu et au su de tous et de toutes, sur nos futurs accomplis- sements, et sur l’idée que les rêves personnels devraient s’emboîter dans les rêves collectifs pour avoir une chance de devenir réalité. C’est la somme de tous ces rêves, de toutes ces interrogations, de toutes ces aspirations laissés en suspens faute d’espaces dédiés au vrai débat de fond, qui ont suscité en moi le désir d’accompagner la réalisation de cet ouvrage collectif. Celui-ci ne changera peut-être rien à notre réalité, mais trouvera, sans nul doute, écho auprès de celles et ceux qui s’acharnent encore à vouloir être libres de penser, de rêver et de bâtir ensemble.
Au départ, alors que le Hirak battait son plein et que les rêves semblaient accessibles, l’idée première consistait à amener des jeunes à rêver l’algérie par le biais de l’écrit dans le cadre des cycles d’ateliers d’écriture organisés par le bureau de la Fondation Friedrich Ebert en Algérie, depuis 2005. Dans un contexte de crise sanitaire peu propice aux rencontres physiques, nous avons vite dû y renoncer. C’est alors que nous avons fait cette belle rencontre avec Barzakh. ensemble, nous avons remodelé le projet, enthousiastes à l’idée de relever un pari aussi risqué car, comment déjouer les stéréotypes et les poncifs, comment se donner les moyens d’un ouvrage original, iconoclaste mais d’abord utile, autour d’une Algérie rêvée ? aussi avons-nous décidé d’inviter des personnes, militantes ou non, journalistes, écrivain.e.s, architectes, psychologues, étudiant.e.s, médecins, citoyens et citoyennes ayant un rap- port amateur ou confirmé à l’écriture, à par- tager leur rêve, chacun et chacune à partir de sa place, de sa subjectivité, de son domaine d’intervention. La question semble élémentaire : « De quelle algérie rêvez-vous, et pourquoi ? ». Elle n’est simple qu’en apparence. Si on la sonde vrai- ment, elle accule, elle oblige, elle nous enjoint de dépasser généralités et banalités expéditives. Si le rêve est une activité cérébrale incontrô- lée (en tout cas, le rêve nocturne), il demeure, en algérie, lorsqu’il est éveillé et volontariste, un exercice pour le moins complexe. Dans un contexte qui verrouille les perspectives, il n’est pas simple de se projeter et de galvaniser son énergie pour construire l’avenir.
Or, comment penser et bâtir une algérie meil- leure si l’on ne sait pas la rêver ? interrogation en écho aux vers de Habiba Djahnine dans son texte « Terre inconnue » (Cf. p. 52) : « Comment rêver le futur sans le présent ? / Comment vivre le présent sans rêver à demain ? ».
Loin des sentiers battus, des débats politiques, des propositions de programmes et feuilles de route, cet ouvrage se veut l’expression subjec- tive d’une projection de l’algérie que l’on aime- rait voir se réaliser.
Des voix singulières nous entraînent dans des combinaisons infinies: fictions, autofictions, récits d’anticipation, témoignages, réflexions. Une seule ambition, un seul mot d’ordre : pro- poser une projection intime, réaliste ou non, d’une algérie meilleure. Quatorze textes, qua- torze subjectivités, à travers lesquels miroite la possibilité de construire une société de libertés, de progrès et de vivre-ensemble.
Cet ouvrage, plein d’espoirs, mais aussi de mises au point franches et sans concession, de vérités crues et courageuses – dites avec humour souvent –, nous raconte qu’une autre Algérie est possible. »
Amina Izarouken
______________________
Le livre est constitué de quatorze textes (7 fictions et 7 témoignages et récits) écrits par: Wiame Awres, Hajar Bali, Atiqa Belhacene, Habiba Djahnine, Sarah Haidar, Mohamed Larbi Merhoum, Samir Toumi, Chawki Amari, Salah Badis, Khadidja Boussaid, Bouchra Fridi, Fériel Kessaï, Zaki Kessaï, Arab Izar, Louisa Mankour, Akçil Ticherfatine.
Voici un extrait du livre tiré de « La balade du centenaire » par Samir Toumi
« … Tous les matins, je traverse la place du 22 février, premier rituel de ma marche matinale et dans ma tête j’entends résonner la même clameur surgie du passé : celle des escaliers de la grande Poste, bruissant de cris, de chants et de slogans, déclamés pour la première fois, ici-même, sur cette place, le 22 février 2019, ce jour où tout a commencé. Je venais d’avoir vingt ans, mais pour moi, ce fut une seconde naissance. Je devins un citoyen ! et pour mes parents, enfants désabusés d’octobre 1988, ce fut une renaissance !
Nous avons été des millions à battre le pavé, en foules compactes et déterminées, dans toutes les villes d’Algérie, d’abord incrédules, puis ébahis, heureux, et résolus à en finir avec un système indigne, médiocre et corrompu, qui étranglait notre pays et nous privait d’avenir. Hommes, femmes, enfants, riches, pauvres, tous différents, chantions et clamions ensemble les mêmes slogans, dans une incroyable harmonie, avec le fol espoir, qu’enfin, les choses changent. La lutte fut longue et ardue, et les sacrifices nombreux. Activistes, simples citoyens ou journalistes, combien de personnes furent emprisonnées, combien de provocations visant à nous diviser furent tentées, par une gouvernance sournoise et manipulatrice. Mais rien, ni personne ne nous fit basculer, ni dans la division ni dans la violence. Notre arme ultime, le pacifisme, finit par triompher et un véritable régime démocratique fut enfin instauré. Une Algérie diverse, engagée et responsable, a fini par émerger, puis évoluer et s’épanouir, pour devenir l’Algérie d’aujourd’hui, celle où je vis un heureux crépuscule, et où mes jeunes com- patriotes et où mes jeunes compatriotes envisagent, avec sérénité, leur avenir… »
_____________________________
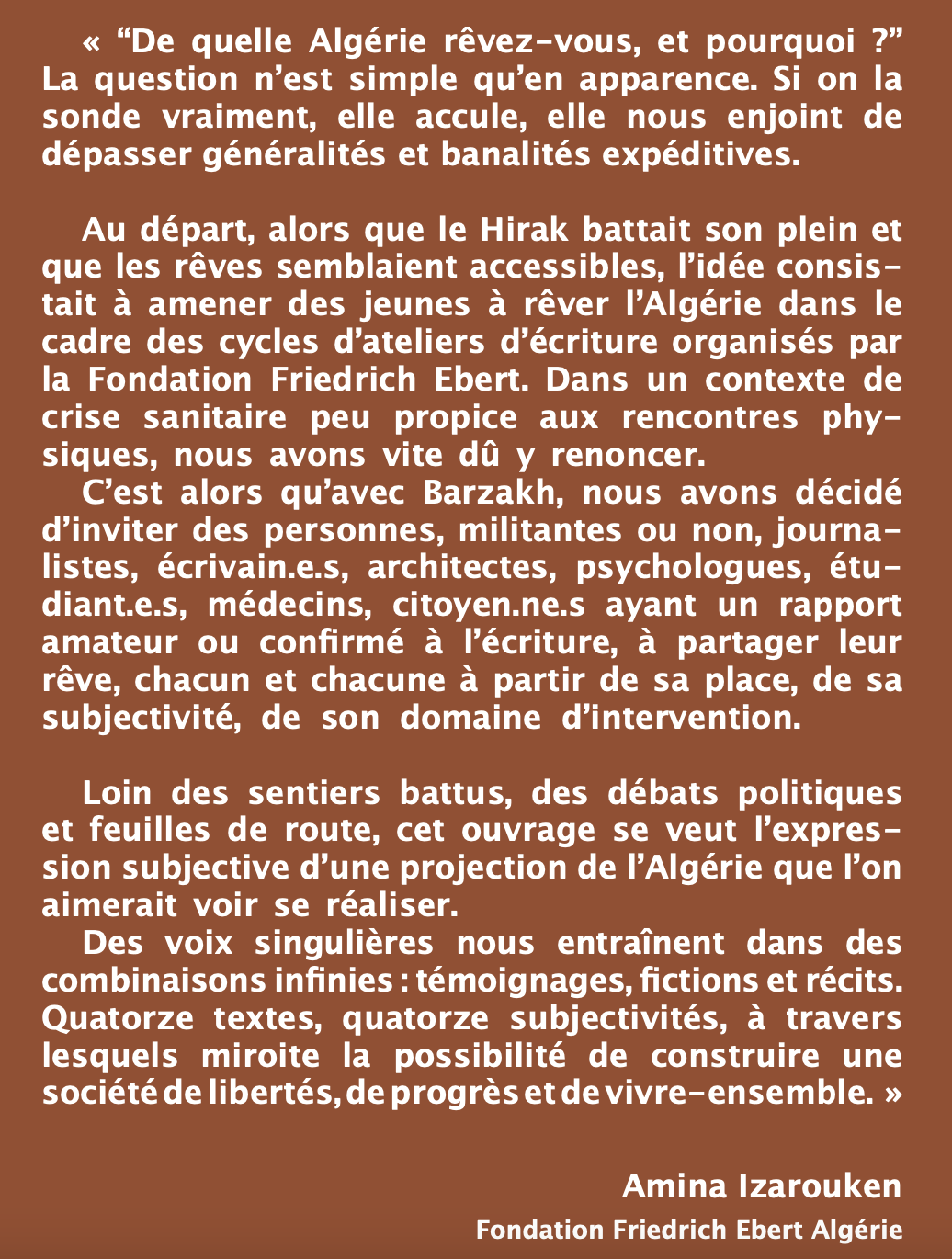

Quatrième de couverture


Cette vidéo n’a pour objet que de nous rappeler qu’Oran fut une ville de grande tolérance. Qui ne veut voir en ces images que le rappel d’une mémoire de débauche se trompe lourdement. Les bars, (parfois hôtels-bars-restaurants) ont hélas, pour une part non négligeable disparu. Ils furent au même titre que les salons, les marchés et autres placettes de quartiers d’Oran, des lieux de rencontre et d’échange, où s’exprimaient sans retenue, ni tabou, les vérités et fantasmes des uns et des autres autour d’un verre au pluriel majoré, surtaxé, parfois sans nuances. Ils sont les témoins d’une époque aujourd’hui révolue que ne connaissent ni les moins de vingt ans ni ceux de trente.
Les chanteurs qui rehaussent la vidéo sont uniques par leur voix, leur capacité à faire renaître ou remonter en chacun de nous, à partir de mots enracinés en « nous » (ce nous global) depuis les temps immémoriaux, ce qu’il y a de plus profond, de plus émouvant. Ils prirent d’assaut (avec d’autres bien sûr) les bars d’Oran et de sa région dès les premières des années 1980 (durant l’abjecte censure) et plus tard… tous les lieux (ou presque). Ces chanteurs sont Cheikha el Djenia el kebira el haqaniya bent Saïda (1954-2004) (ne pas oublier son compagnon El berrah Zouaoui mort en 2003) et Cheb Mami (de Saïda lui aussi).
10 janvier 2021

______________________________
.
.
CLIQUER ICI POUR VOIR LA VIDÉO
.
.
_____________________________


EL WATAN _ 30 avril 2015
Un événement qui verra la participation d’une vingtaine de chioukhs venant de l’Ouest de l’Algérie comme Boutaïba dit « Saïdi », Tahar, Fati, Smail, Chadli, Mohamed Saïd, Krimo de Saïda, Okacha de Mascara, Miloud de Tissemssilt, Hatab et Kada de Tlemcen, El Ouahddani de Ch’lef, Dehane de Naâma ou encore Lechlech et Hamid Baroudi d’Oran.
La wilaya de Saïda-en collaboration avec la direction de la culture, le comité de l’action culturelle et le mouvement associatif- lors de cette intéressante rencontre, rendra un hommage posthume à la diva du raï « rural », Cheikha Djenia. Cette grande dame, cette diablesse du raï, qui revendiquait haut et fort son titre de « cheikha Djenia el hakania el kebira bent Saïda (la vraie, la grande, l’authentique et fille de Saïda) ». Et ce, pour se distinguer de Cheikha Djénia Sghira ayant usurpé le nom de scène.Advertisements
Elle est décédée, une certaine journée du 1er avril 2004, un jeudi, à l’issue d’un tragique accident de la circulation sur la route de Sidi Bel Abbès menant vers Tlemcen, et ce, prématurément, à l’âge de 50 ans. Soit neuf mois après la disparition de son mari «El berrah» (aminateur et dédicassseur), le fameux Zouaoui, lui aussi mort tragiquement. Il a été abattu par méprise lors d’un barrage de nuit par les forces de sécurité. De son vrai nom Fatma Mebarki, Djenia est née en 1954, à Marhoun, dans les environs de Saïda.
Obnubilée par cheikha Rimitti, Farid El Attrache, Abdelhalim Hafez et Oum Kalsoum, elle quittera le giron familial et conjugal, à 17 ans, à la suite d’un mariage forcé. Remarquée par cheikh Aïssa, elle se produira à ses côtés pour faire et parfaire ses premières armes. Elle signera son premier album en 1970 sous l’impulsion de Hadj Mazou lequel la baptisera «La diablesse» (Djenia) pour son timbre de voix rock (rauque). Cependant Djenia se distinguera avec le raï synthétique en duo avec cheb Abdelhak avec Rah Egaber (Il drague).
Djenia s’est illustrée avec des hits comme Kayen Rabi, Trig Bidou, Dertou fina Djournan, Trab el Ghadar, Ha Nounou, et Kin Dir Ouan Dirleh repris par cheb Abdou et bien d’autres, sans percevoir les droits d’auteurs, bien sûr. Djenia était la digne héritière de cheikha Rimitti.
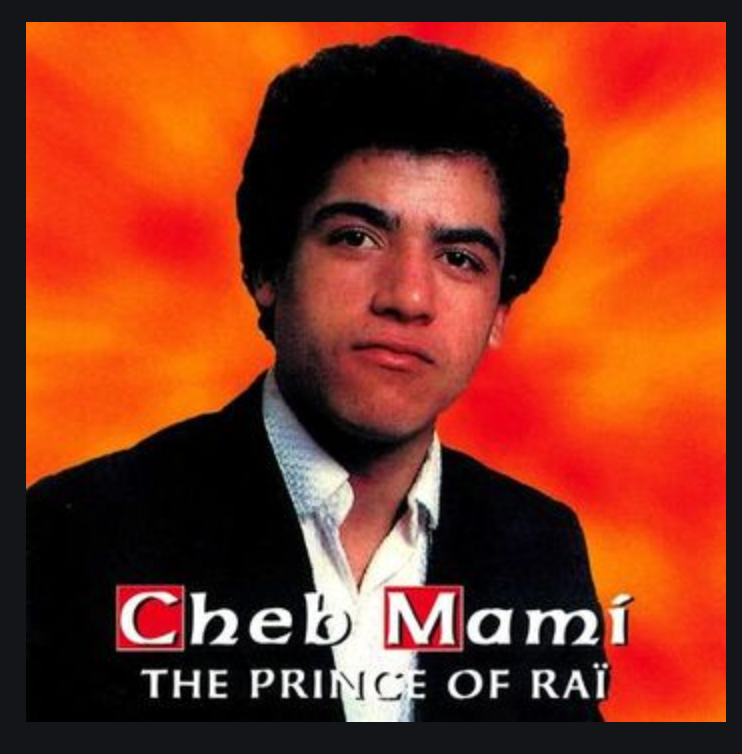

LIBERTÉ _ 22 Décembre 2020 _ par M. Laradj

La jeune poétesse Latachi Imène a été sélectionnée pour le prix Maurice-Koné pour son poème Différente dans votre monde. Elle a dû faire face à une redoutable concurrence où, selon les organisateurs, les textes reçus pour cette édition 2020, qui a par ailleurs couronné le Malien Serges Cyrille Koko, se sont avérés denses et très difficiles à départager pour les catégories adultes. Les écrits ont été notés sur le respect du thème, l’originalité, l’orthographe et la grammaire, les qualités esthétiques et stylistiques.
“Pour cette édition unique sous Covid-19, les concurrents se sont exprimés poétiquement sur la notion de différence sous un angle bien particulier, dans cette édition tout aussi particulière où tous les textes sont parvenus cette année exclusivement en français, de poètes d’Afrique, d’Europe et des Amériques.” Les organisateurs ont constaté que les poètes auront relevé le défi, et certains seront allés véritablement en profondeur, sondant une notion de la différence comme elle est rarement perçue.
Pour la première fois depuis la création du concours, la différence décrite dans les poèmes dépassait le cadre des relations entre humains. Tout heureuse de cette nomination, la jeune Imène Latachi expliquait sur le site du prix poétique : “J’écris, car je ressens une sorte de soif. J’écris, car ‘vivre’ me fait ‘souffrir’ et qu’‘écrire’ me ‘délivre’.” Et de poursuivre : “L’université a changé ma façon de voir les choses, notamment grâce à mes enseignants de littérature. J’ai, de ce fait, commencé à écrire pour faire ressortir le meilleur de moi-même. Il me semble que j’écris aujourd’hui pour m’épanouir, et pour faire passer en revue les maux de ma société.” Imène Latachi a déjà à son actif deux recueils de poésie Lumière dans les ténèbres, publié en 2017 à l’âge de
20 ans, et Mirage, édité deux ans après. Rappelons que Latachi est licenciée en littérature française à l’université Belhadj-Bouchaïb de Aïn Témouchent et directrice du magazine Dya. L’édition d’une version en papier et la création d’un site pour ce magazine, ainsi qu’une bibliothèque numérique de 12 000 ouvrages font partie de ses projets. M. Laradj
_____________________________________________
POUR ÉCOUTER « Le Masque et la plume » CLIQUER ICI
______________________________________________
L’éminente émission « Le Masque et la plume » qui se consacre depuis des décennies au cinéma, au théâtre et au livre (sur France Inter) assassine l’écriture de Yasmina Khadra, précisément son livre « L’Équation africaine » que ces spécialistes radiophoniques démolissent sans peine et dans l’esprit de l’émission, la bonne humeur et non sans faire un commun mea culpa sur leurs critiques antérieures sur cet écrivain qu’ils ont « à tort » (ils le reconnaissent) encensé. C’était une mode peut-être, un besoin d’exotisme peut-être encore de cette Algérie mal, très mal en point des années noires dont certains ont opportunément tiré profit, hélas, les « réseaux » aidant. L’émission date du dimanche 18 septembre 2011. Je la découvre aujourd’hui.
Des phrases plates sont ainsi relevées telles que « Une sueur froide me verglace le dos… Une couche verglacée me cimente le dos… Un livre écrit avec des phrases de série B et toutes les phrases de série B font des livres Z… Un livre accablant, épuisant, sidérant. » Etc. Je vous laisse écouter. Les critiques vont jusqu’à se demander « Y a-t-il un éditeur et que fait-il ? »
Très dur.
D’autres, bien avant ces critiques, comme Leïla Sebbar avaient dit que « Yasmina Khadra écrit comme ses pieds. » (Maghreb des Livres, Paris) D’autres ont écrit (thèse universitaire) que cet écrivain fait dans l’intertextualité et en abuse. Un peu trop au goût d’autres encore qui pensent qu’il pousse le bouchon de l’intertextualité un peu trop loin, jusqu’au plagiat. J’ai rencontré cet écrivain à Aix-en-Provence au début des années 2000, et je lui avais dit alors tout le mal que je pensais de ses tromperies et autres aventures opportunistes.
Je regrette beaucoup l’absence d’émissions algériennes sur la littérature (notamment sur Canal Algérie et la radio en français). Elles nous permettraient (si possible sans copinage évidemment) de mettre et d’émettre nos gros points noirs ou colorés sur nos propres i sans être obligés de passer par des émissions étrangères, très intéressantes par ailleurs.
CLIQUER ICI POUR ÉCOUTER ANNE SYLVESTRE
On l’appelait Anne, elle habitait Paris. Elle écrivait des chansons et les chantait munie de ses seules voix et guitare. Lorsque j’ai débarqué, tout jeune, à Paris, au milieu des années 70, c’est elle, et d’autres bien sûr, qui m’a fait aimer cette France, la sienne et celle de Tachan, de Ferré, de Moustaki, de Béranger et d’Arlette et Alain aussi à leur manière à Presles, à la Courneuve ou à Paris même. On a tort d’ignorer (quelle bêtise !) cette partie importante de la France faite de bonté, d’amour, de générosité. Cette partie de la France si proche des peuples du sud. Anne et les autres étaient mon autre pays, celui qui m’a accueilli. Ils étaient ma France. J’avais vingt ans et le cœur rempli de ressentiment et de pleurs. Anne et les autres nous invitaient à leurs tables et estrades que nous n’avons jamais désertées. La table des luttes de l’amitié, de la fraternité. Certes il y eut des hauts et des bas. Anne est restée dans nos cœurs, comme Tachan, Ferré et les autres, avec, le temps aidant des relectures imposées par les expériences individuelles et globales, mais le socle est toujours là, vivace. Je me souviens du concert qu’Anne Sylvestre avait donné au cœur de Levallois-Perret, juste en face du « Grand Bazar » (place Henri Barbusse, aujourd’hui grand marché couvert) où j’avais été embauché à temps partiel (pour cause d’études). Je venais d’arriver d’un pays qu’un dictateur barbelait à tout va. Je buvais ses paroles, tout autour de moi c’étaient sourires de bienvenu : José, Fernand, Mustapha, Catherine L. et Catherine P, Anne (une autre), Katherine D. et Alain (un autre), Denis et Lisbeth. Je ne vous oublierai pas. Vous m’avez tous accueilli les bras grands ouverts. Cette France-là que vous portiez est aussi la mienne. Aujourd’hui Anne n’est plus. Elle est partie avant-hier lundi 30 novembre. Elle avait 86 ans.
« Je n’ai plus personne à Paris
L’un après l’autre ils sont partis
Partis de corps ou bien de cœur
Partis se faire aimer ailleurs
Et c’est dommage »
———–
Je n’ai plus personne à Paris
Je n’ai plus personne à Paris (2 fois)
Je croyais avoir des amis
Oui, de ceux que ne déracine
Aucun orage
Je n’ai plus personne à Paris
L’un après l’autre ils sont partis
Partis de corps ou bien de cœur
Partis se faire aimer ailleurs
Et c’est dommage
Qu’ils aient laissé ce vide en moi
Et tout ce froid
Tant va l’ami, tant va l’amour
Tant vont les nuits, tant vont les jours
Qu’à peine les a-t-on connus
Qu’à peine les a-t-on tenus
À peine avait-on commencé
De les faire coïncider
Avec ses rêves, avec sa vie
Qu’il faut, avant d’avoir servi,
Plier la nappe
Je n’ai plus personne à Paris (2 fois)
Moi, j’aimais tant les inviter
L’un après l’une ont déserté
Vers d’autres tables
Qui leur servira ces repas
Que sans eux, je ne ferai pas ?
Et ma tendresse, avec mes vins
Resteront à vieillir en vain
Inconsolables
De n’avoir pas su leur donner
Goût de rester
Tant sont tissés de tous nos jours
Que le moindre de nos détours
Nous fait perdre un ami, souvent
Et ce n’est jamais le suivant
Qui le remplace
Et l’on apprend, avec le temps,
À faire taire en soi l’enfant
Qui, pour qu’on veuille l’écouter,
Aimait partager son goûter
Après la classe
Je n’ai plus personne à Paris
Et je crois que j’ai bien compris
Je garde mes chagrins pour moi
Et je crois, je crois cette fois
Bien être adulte
De vous, je n’attendrai plus rien
Mais si vous trouvez le chemin
Qui vous ramènerait chez moi
Il est possible que la joie
Qui en résulte
Emplisse les rues de Paris
Me rende quelqu’un à Paris
Un article de LIBERTÉ, 29 novembre 2020
Une battante s’en va

L’auteur de Sonia, le calvaire au féminin s’est éteinte dans la soirée de vendredi 27 novembre à Annaba, au lendemain de la Journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, son combat de toujours. Yasmina Gharbi Mechakra s’en est allée à l’âge de 82 ans non sans avoir apposé une empreinte indélébile dans la narration poignante des supplices subis par ses semblables et sans pour autant manquer à son devoir et sa vocation première, l’enseignement de la langue française, qu’elle épousa dès 1958 dans son village natal Meskiana, dans la wilaya d’Oum El-Bouaghi. Pendant 34 ans, elle sillonnera avec son défunt mari, également cadre de l’éducation nationale, pas moins d’une dizaine de bourgades avant de s’installer définitivement à Constantine où elle conclura une carrière affirmée d’éducatrice dispensant la formation et la bonne littérature à plusieurs générations.
Son implication dans son environnement social pour ce bout de femme a été totale, afin de briser le silence sur les atrocités des harcèlements et violences subis par les femmes. D’abord, en s’investissant dans le mouvement associatif voué à la prise en charge des femmes victimes de violences verbales et physiques, exclues du domicile familial ou encore harcelées sur leur lieu de travail. Et ensuite, à travers la narration par le trait aussi émouvant qu’accessible, le don de la pédagogue qu’elle fut pendant plus de trois décades y est perceptible, qui accoucha en 2017 de son roman Sonia, le calvaire au féminin. Un livre qu’elle dédia à toutes les femmes qui ont fréquenté le centre d’écoute Nedjma : “Celles qui sont venues pour ‘vider leur sac’ parce qu’elles n’en pouvaient plus…” L’ouvrage qui recèle “une transposition d’histoires vécues pour tenter de faire toucher du doigt, à tous les négateurs, la réalité de la violence faite aux femmes et aux filles”. “J’ai tenté de donner une histoire à ces femmes anonymes qui ne veulent pas subir, j’ai d’ailleurs voulu l’appeler La rebelle, je voulais un personnage qui s’indigne et proteste”, avait-elle commenté son propre écrit.
En 2015, Yasmina Gharbi Mechakra avait également écrit un premier roman Le chemin des lumières, un témoignage sur la ville de Meskiana d’où elle est originaire, à travers l’histoire d’une famille happée par un drame de la vie. La défunte, qui a été inhumée hier au cimetière de Zouaghi à Constantine, n’est autre que la belle-sœur de l’écrivaine de renom, la regrettée Yamina Mechakra.
Kamel Ghimouze
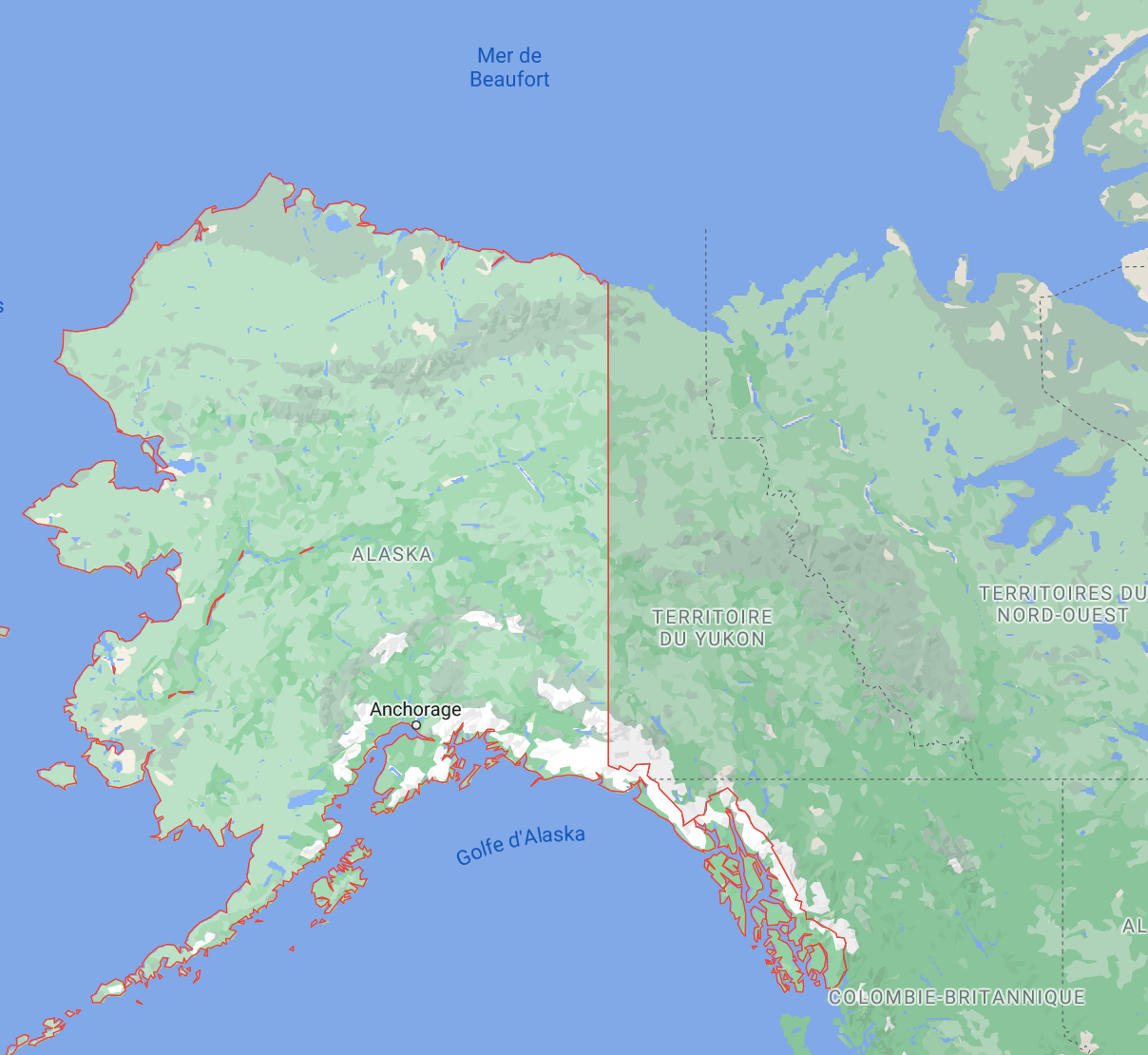

Yukon et Alaska
_____________________________________

Jack London
Le 22 novembre 1916, disparaissait Jack London. Un célèbre écrivain américain, connu pour ses formidables histoires, souvent en lien avec la nature, le Grand Nord américain… Je citerais le plus célèbre de ses romans, « L’Appel de la forêt ». Il a écrit « Croc Blanc » et le récit poignant de certains quartiers de Londres (où il est correspondant pour un journal américain) « Le Peuple de l’abîme ». Sans oublier d’innombrables nouvelles dont « Le Fils du loup ». Jack London a vécu une vie (une partie) tumultueuse et très difficile qu’il a comblée par l’écriture. Pendant près de vingt ans, il fut très attaché au socialisme d’abord révolutionnaire puis réformiste.

J’arrive à Dawson City
____________
Lorsqu’il y a 9 ans, à une distance d’un peu plus d’un siècle du Klondike de London je me rendais dans l’extrême nord-ouest américain, j’ai tenu à me rendre en Alaska et dans le Yukon, notamment à Dawson city où vécut Jack London, le chercheur d’or (il y fut même hospitalisé pour cause de scorbut). De cette virée j’ai écrit une nouvelle « Sur les traces de la petite mosquée des Inuits » qui est une autre histoire.
Je vous propose le premier chapitre de « L’Appel de la forêt »
_____________________________

« Buck ne lisait pas les journaux et était loin de savoir ce qui se tramait vers la fin de 1897, non seulement contre lui, mais contre tous ses congénères. En effet, dans toute la région qui s’étend du détroit de Puget à la baie de San Diégo on traquait les grands chiens à longs poils, aussi habiles à se tirer d’affaire dans l’eau que sur la terre ferme…
Les hommes, en creusant la terre obscure, y avaient trouvé un métal jaune, enfoncé dans le sol glacé des régions arctiques, et les compagnies de transport ayant répandu la nouvelle à grand renfort de réclame, les gens se ruaient en foule vers le nord. Et il leur fallait des chiens, de ces grands chiens robustes aux muscles forts pour travailler, et à l’épaisse fourrure pour se protéger contre le froid.

Buck habitait cette belle demeure, située dans la vallée ensoleillée de Santa-Clara, qu’on appelle « le Domaine du juge Miller ».
De la route, on distingue à peine l’habitation à demi cachée par les grands arbres, qui laissent entrevoir la large et fraîche véranda, régnant sur les quatre faces de la maison. Des allées soigneusement sablées mènent au perron, sous l’ombre tremblante des hauts peupliers, parmi les vertes pelouses. Un jardin immense et fleuri entoure la villa, puis ce sont les communs imposants, écuries spacieuses, où s’agitent une douzaine de grooms et de valets bavards, cottages couverts de plantes grimpantes, pour les jardiniers et leurs aides ; enfin l’interminable rangée des serres, treilles et espaliers, suivis de vergers plantureux, de gras pâturages, de champs fertiles et de ruisseaux jaseurs.

Le monarque absolu de ce beau royaume était, depuis quatre ans, le chien Buck, magnifique animal dont le poids et la majesté tenaient du gigantesque terre-neuve Elno, son père, tandis que sa mère Sheps, fine chienne colley de pure race écossaise, lui avait donné la beauté des formes et l’intelligence humaine de son regard. L’autorité de Buck était indiscutée. Il régnait sans conteste non seulement sur la tourbe insignifiante des chiens d’écurie, sur le carlin japonais Toots, sur le mexicain Isabel, étrange créature sans poil dont l’aspect prêtait à rire, mais encore sur tous les habitants du même lieu que lui. Majestueux et doux, il était le compagnon inséparable du juge, qu’il suivait dans toutes ses promenades, il s’allongeait d’habitude aux pieds de son maître, dans la bibliothèque, le nez sur ses pattes de devant, clignant des yeux vers le feu, et ne marquant que par un imperceptible mouvement des sourcils l’intérêt qu’il prenait à tout ce qui se passait autour de lui. Mais apercevait-il au-dehors les fils aînés du juge, prêts à se mettre en selle, il se levait d’un air digne et daignait les escorter ; de même, quand les jeunes gens prenaient leur bain matinal dans le grand réservoir cimenté du jardin, Buck considérait de son devoir d’être de la fête. Il ne manquait pas non plus d’accompagner les jeunes filles dans leurs promenades à pied ou en voiture ; et parfois on le voyait sur les pelouses, portant sur son dos les petits-enfants du juge, les roulant sur le gazon et faisant mine de les dévorer, de ses deux rangées de dents étincelantes. Les petits l’adoraient, tout en le craignant un peu, car Buck exerçait sur eux une surveillance sévère et ne permettait aucun écart à la règle. D’ailleurs, ils n’étaient pas seuls à le redouter, le sentiment de sa propre importance et le respect universel qui l’entourait investissant le bel animal d’une dignité vraiment royale.
Depuis quatre ans, Buck menait l’existence d’un aristocrate blasé, parfaitement satisfait de soi-même et des autres, peut-être légèrement enclin à l’égoïsme, ainsi que le sont trop souvent les grands de ce monde. Mais son activité incessante, la chasse, la pêche, le sport, et surtout sa passion héréditaire pour l’eau fraîche le gardaient de tout alourdissement et de la moindre déchéance physique : il était, en vérité, le plus admirable spécimen de sa race qu’on pût voir. Sa vaste poitrine, ses flancs évidés sous l’épaisse et soyeuse fourrure, ses pattes droites et formidables, son large front étoilé de blanc, son regard franc, calme et attentif, le faisaient admirer de tous.
Telle était la situation du chien Buck, lorsque la découverte des mines d’or du Klondike attira vers le nord des milliers d’aventuriers. Tout manquait dans ces régions neuves et désolées ; et pour assurer la subsistance et la vie même des émigrants, on dut avoir recours aux traîneaux attelés de chiens, seuls animaux de trait capables de supporter une température arctique.

Buck semblait créé pour jouer un rôle dans les solitudes glacées de l’Alaska ; et c’est précisément ce qui advint, grâce à la trahison d’un aide-jardinier. Le misérable Manoël avait pour la loterie chinoise une passion effrénée ; et ses gages étant à peine suffisants pour assurer l’existence de sa femme et de ses enfants, il ne recula pas devant un crime pour se procurer les moyens de satisfaire son vice.
Un soir, que le juge présidait une réunion et que ses fils étaient absorbés par le règlement d’un nouveau club athlétique, le traître Manoël appelle doucement Buck, qui le suit sans défiance, convaincu qu’il s’agit d’une simple promenade à la brume. Tous deux traversent sans encombre la propriété, gagnent la grande route et arrivent tranquillement à la petite gare de Collège-Park. Là, un homme inconnu place dans la main de Manoël quelques pièces d’or, tout en lui reprochant d’amener l’animal en liberté. Aussitôt Manoël jette au cou de Buck une corde assez forte pour l’étrangler en cas de résistance. Buck supporte cet affront avec calme et dignité ; bien que ce procédé inusité le surprenne, il a, par habitude, confiance en tous les gens de la maison, et sait que les hommes possèdent une sagesse supérieure même à la sienne. Toutefois, quand l’étranger fait mine de prendre la corde, Buck manifeste par un profond grondement le déplaisir qu’il éprouve. Aussitôt la corde se resserre, lui meurtrissant cruellement la gorge et lui coupant la respiration. Indigné, Buck, se jette sur l’homme ; alors celui-ci donne un tour de poignet vigoureux : la corde se resserre encore ; furieux, surpris, la langue pendante, la poitrine convulsée, Buck se tord impuissant, ressentant plus vivement l’outrage inattendu que l’atroce douleur physique ; ses beaux yeux se couvrent d’un nuage, deviennent vitreux… et c’est à demi mort qu’il est brutalement jeté dans un fourgon à bagages par les deux complices.
Quand Buck revint à lui, tremblant de douleur et de rage, il comprit qu’il était emporté par un train, car ses fréquentes excursions avec le juge lui avaient appris à connaître ce mode de locomotion.
Ses yeux, en s’ouvrant, exprimèrent la colère et l’indignation d’un monarque trahi. Soudain, il aperçoit à ses côtés l’homme auquel Manoël l’a livré. Bondir sur lui, ivre de rage, est l’affaire d’un instant ; mais déjà la corde se resserre et l’étrangle… pas sitôt pourtant que les mâchoires puissantes du molosse n’aient eu le temps de se refermer sur la main brutale, la broyant jusqu’à l’os…
Un homme d’équipe accourt au bruit :
– Cette brute a des attaques d’épilepsie, fait le voleur, dissimulant sa main ensanglantée sous sa veste. On l’emmène à San Francisco, histoire de le faire traiter par un fameux vétérinaire. Ça vaut de l’argent, un animal comme ça… son maître y tient…
L’homme d’équipe se retire, satisfait de l’explication.
Mais quand on arrive à San Francisco, les habits du voleur sont en lambeaux, son pantalon pend déchiré à partir du genou, et le mouchoir qui enveloppe sa main est teint d’une pourpre sombre. Le voyage, évidemment, a été mouvementé.
Il traîne Buck à demi mort jusqu’à une taverne louche du bord de l’eau, et là, tout en examinant ses blessures, il ouvre son cœur au cabaretier.
– Sacré animal !… En voilà un enragé !… grommelle-t-il en avalant une copieuse rasade de gin ; cinquante dollars pour cette besogne-là !… Par ma foi, je ne recommencerais pas pour mille !
– Cinquante ? fait le patron. Et combien l’autre a-t-il touché ?
– Hum !… il n’a jamais voulu lâcher cette sale bête pour moins de cent… grogne l’homme.
– Cent cinquante ?… Pardieu, il les vaut ou je ne suis qu’un imbécile, fait le patron, examinant le chien.
Mais le voleur a défait le bandage grossier qui entoure sa main blessée.
– Du diable si je n’attrape pas la rage ! exclame-t-il avec colère.
– Pas de danger !… C’est la potence qui t’attend… ricane le patron. Dis donc, il serait peut-être temps de lui enlever son collier…
Étourdi, souffrant cruellement de sa gorge et de sa langue meurtries, à moitié étranglé, Buck voulut faire face à ses tourmenteurs. Mais la corde eut raison de ses résistances ; on réussit enfin à limer le lourd collier de cuivre marqué au nom du juge. Alors les deux hommes lui retirèrent la corde et le jetèrent dans une caisse renforcée de barreaux de fer.
Il y passa une triste nuit, ressassant ses douleurs et ses outrages. Il ne comprenait rien à tout cela. Que lui voulaient ces hommes ? Pourquoi le maltraitaient-ils ainsi ? Au moindre bruit il dressait les oreilles, croyant voir paraître le juge ou tout au moins un de ses fils. Mais lorsqu’il apercevait la face avinée du cabaretier, ou les yeux louches de son compagnon de route, le cri joyeux qui tremblait dans sa gorge se changeait en un grognement profond et sauvage.
Enfin tout se tut. À l’aube, quatre individus de mauvaise mine vinrent prendre la caisse qui contenait Buck et la placèrent sur un fourgon.
L’animal commença par aboyer avec fureur contre ces nouveaux venus. Mais s’apercevant bientôt qu’ils se riaient de sa rage impuissante, il alla se coucher dans un coin de sa cage et y demeura farouche, immobile et silencieux.
Le voyage fut long. Transbordé d’une gare à une autre, passant d’un train de marchandises à un express, Buck traversa à toute vapeur une grande étendue de pays. Le trajet dura quarante-huit heures.
De tout ce temps il n’avait ni bu ni mangé. Comme il ne répondait que par un grognement sourd aux avances des employés du train, ceux-ci se vengèrent en le privant de nourriture. La faim ne le tourmentait pas autant que la soif cruelle qui desséchait sa gorge, enflammée par la pression de la corde. La fureur grondait en son cœur et ajoutait à la fièvre ardente qui le consumait ; et la douceur de sa vie passée rendait plus douloureuse sa condition présente.
Buck, réfléchissant en son âme de chien à tout ce qui lui était arrivé en ces deux jours pleins de surprises et d’horreur, sentait croître son indignation et sa colère, augmentées par la sensation inaccoutumée de la faim qui lui tenaillait les entrailles. Malheur au premier qui passerait à sa portée en ce moment ! Le juge lui-même aurait eu peine à reconnaître en cet animal farouche le débonnaire compagnon de ses journées paisibles ; quant aux employés du train, ils poussèrent un soupir de soulagement en débarquant à Seattle la caisse contenant « la bête fauve ».
Quatre hommes l’ayant soulevée avec précaution la transportèrent dans une cour étroite et noire, entourée de hautes murailles, et dans laquelle se tenait un homme court et trapu, la pipe aux dents, le buste pris dans un maillot de laine rouge aux manches roulées au-dessus du coude.
Devinant en cet homme un nouvel ennemi, Buck, le regard rouge, le poil hérissé, les crocs visibles sous la lèvre retroussée, se rua contre les barreaux de sa cage avec un véritable hurlement.
L’homme eut un mauvais sourire : il posa sa pipe, et s’étant muni d’une hache et d’un énorme gourdin, il se rapprocha d’un pas délibéré.
– Dis donc, tu ne vas pas le sortir, je pense ? s’écria un des porteurs en reculant.
– Tu crois ça ?… Attends un peu ! fit l’homme, insérant d’un coup sa hache entre les planches de la caisse.
Les assistants se hâtèrent de se retirer, et reparurent au bout de peu d’instants, perchés sur le mur de la cour en bonne place pour voir ce qui allait se passer.
Lorsque Buck entendit résonner les coups de hache contre les parois de sa cage, il se mit debout, et mordant les barreaux, frémissant de colère et d’impatience, il attendit.
– À nous deux, l’ami !… Tu me feras les yeux doux tout à l’heure !… grommela l’homme au maillot rouge.
Et, dès qu’il eut pratiqué une ouverture suffisante pour livrer passage à l’animal, il rejeta sa hache et se tint prêt, son gourdin bien en main.
Buck était méconnaissable ; l’œil sanglant, la mine hagarde et farouche, l’écume à la gueule, il se rua sur l’homme, pareil à une bête enragée… Mais au moment où ses mâchoires de fer allaient se refermer en étau sur sa proie, un coup savamment appliqué en plein crâne le jeta à terre. Ses dents s’entrechoquent violemment ; mais se relevant d’un bond, il s’élance, plein d’une rage aveugle ; de nouveau il est rudement abattu. Sa rage croît. Dix fois, vingt fois, il revient à la charge, mais, à chaque tentative, un coup formidable, appliqué de main de maître, arrête son élan. Enfin, étourdi, hébété, Buck demeure à terre, haletant ; le sang dégoutte de ses narines, de sa bouche, de ses oreilles ; son beau poil est souillé d’une écume sanglante ; la malheureuse bête sent son cœur généreux prêt à se rompre de douleur et de rage impuissante…
Alors l’Homme fait un pas en avant, et froidement, délibérément, prenant à deux mains son gourdin, il assène sur le nez du chien un coup terrible. L’atroce souffrance réveille Buck de sa torpeur : aucun des autres coups n’avait égalé celui-ci. Avec un hurlement fou il se jette sur son ennemi. Mais sans s’émouvoir, celui-ci empoigne la gueule ouverte, et broyant dans ses doigts de fer la mâchoire inférieure de l’animal, il le secoue, le balance et, finalement, l’enlevant de terre à bout de bras, il lui fait décrire un cercle complet et le lance à toute volée contre terre, la tête la première.
Ce coup, réservé pour la fin, lui assure la victoire. Buck demeure immobile, assommé.
– Hein ?… Crois-tu… qu’il n’a pas son pareil pour mater un chien ?… crient les spectateurs enthousiasmés.
– Ma foi, dit l’un d’eux en s’en allant, j’aimerais mieux casser des cailloux tous les jours sur la route, et deux fois le dimanche, que de faire un pareil métier… Cela soulève le cœur…
Buck, peu à peu, reprenait ses sens, mais non ses forces ; étendu à l’endroit où il était venu s’abattre, il suivait d’un œil atone tous les mouvements de l’homme au maillot rouge.
Celui-ci se rapprochait tranquillement.
– Eh bien, mon garçon ? fit-il avec une sorte de rude enjouement, comment ça va-t-il ?… Un peu mieux, hein ?… Paraît qu’on vous appelle Buck, ajouta-t-il en consultant la pancarte appendue aux barreaux de la cage. Bien. Alors, Buck, mon vieux, voilà ce que j’ai à vous dire : Nous nous comprenons, je crois. Vous venez d’apprendre à connaître votre place. Moi, je saurai garder la mienne. Si vous êtes un bon chien, cela marchera. Si vous faites le méchant, voici un bâton qui vous enseignera la sagesse. Compris, pas vrai ?… Entendu !…
Et, sans nulle crainte, il passa sa rude main sur la tête puissante, saignant encore de ses coups. Buck sentit son poil se hérisser à ce contact, mais il le subit sans protester. Et quand l’Homme lui apporta une jatte d’eau fraîche, il but avidement ; ensuite il accepta un morceau de viande crue que l’Homme lui donna bouchée par bouchée.
Buck, vaincu, venait d’apprendre une leçon qu’il n’oublierait de sa vie : c’est qu’il ne pouvait rien contre un être humain armé d’une massue. Se trouvant pour la première fois face à face avec la loi primitive, envisageant les conditions nouvelles et impitoyables de son existence, il perdit la mémoire de la douceur des jours écoulés et se résolut à souffrir l’Inévitable.
D’autres chiens arrivaient en grand nombre, les uns dociles et joyeux, les autres furieux comme lui-même ; mais chacun à son tour apprenait sa leçon. Et chaque fois que se renouvelait sous ses yeux la scène brutale de sa propre arrivée, cette leçon pénétrait plus profondément dans son cœur : sans aucun doute possible, il fallait obéir à la loi du plus fort…
Mais, quelque convaincu qu’il fût de cette dure nécessité, jamais Buck n’aurait imité la bassesse de certains de ses congénères qui, battus, venaient en rampant lécher la main du maître. Buck, lui, obéissait, mais sans rien perdre de sa fière attitude, en se mesurant de l’œil à l’Homme abhorré…
Souvent il venait des étrangers qui, après avoir examiné les camarades, remettaient en échange des pièces d’argent, puis emmenaient un ou plusieurs chiens, qui ne reparaissaient plus. Buck ne savait ce que cela signifiait.
Enfin, son tour vint.
Un jour, parut au chenil un petit homme sec et vif, à la mine futée, crachant un anglais bizarre panaché d’expressions inconnues à Buck.
– Sacrrré mâtin !… cria-t-il en apercevant le superbe animal. V’là un damné failli chien !… Le diable m’emporte !… Combien ?
– Trois cents dollars. Et encore ! C’est un vrai cadeau qu’on vous fait, répliqua promptement le vendeur de chiens. Mais c’est l’argent du gouvernement qui danse, hein, Perrault ? Pas besoin de vous gêner ?
Perrault se contenta de rire dans sa barbe. Certes, non, ce n’était pas trop payer un animal pareil, et le gouvernement canadien ne se plaindrait pas quand il verrait les courriers arriver moitié plus vite que d’ordinaire. Perrault était connaisseur. Et dès qu’il eut examiné Buck, il comprit qu’il ne rencontrerait jamais son égal.
Buck, attentif, entendit tinter l’argent que le visiteur comptait dans la main de son dompteur. Puis Perrault siffla Buck et Curly, terre-neuve d’un excellent caractère, arrivé depuis peu, et qu’il avait également acheté. Les chiens suivirent leur nouveau maître.
Perrault emmena les deux chiens sur le paquebot Narwhal, qui se mit promptement en route ; et tandis que Buck, animé et joyeux, regardait disparaître à l’horizon la ville de Seattle, il ne se doutait guère que ses yeux contemplaient pour la dernière fois les terres ensoleillées du Sud.
Bientôt Perrault descendit les bêtes dans l’entrepont et les confia à un géant à face basanée qui répondait au nom de François. Perrault était un Franco-Canadien suffisamment bronzé ; mais François était un métis indien franco-canadien beaucoup plus bronzé encore.
Buck n’avait jamais rencontré d’hommes du type de ceux-ci ; il ne tarda pas à ressentir pour eux une estime sincère, bien que dénuée de toute tendresse ; car, s’ils étaient durs et froids, ils se montraient strictement justes ; en outre, leur intime connaissance de la race canine rendait vain tout essai de tromperie et leur attirait le respect.
Buck et Curly trouvèrent deux autres compagnons dans l’entrepont du Narwhal. L’un, fort mâtin d’un blanc de neige, ramené du Spitzberg par le capitaine d’un baleinier, était un chien aux dehors sympathiques, mais d’un caractère faux. Dès le premier repas, il vola la part de Buck. Comme celui-ci, indigné, s’élançait pour reprendre son bien, la longue mèche du fouet de François siffla dans les airs et venant cingler le voleur, le força de rendre le butin mal acquis. Buck jugea que François était un homme juste et lui accorda son estime.
Le second chien était un animal d’un caractère morose et atrabilaire ; il sut promptement faire comprendre à Curly, qui multipliait les avances, sa volonté d’être laissé tranquille. Mais lui, du moins, ne volait la part de personne. Dave semblait penser uniquement à manger, bâiller, boire et dormir. Rien ne l’intéressait hors de lui-même.
Quand le paquebot entra dans la baie de la Reine-Charlotte, Buck et Curly pensèrent devenir fous de terreur en sentant le bateau rouler, tanguer et crier comme un être humain sous les coups de la lame. Mais Dave, témoin de leur agitation, levant la tête, les regarda avec mépris ; puis il bâilla et, se recouchant sur l’autre côté, se rendormit tranquillement.
Les jours passèrent, longs et monotones. Peu à peu la température s’abaissait. Jamais Buck n’avait eu si grand froid.
 CABANE ET MUSEE JACK LONDON À DAWSON-CITY (TNO_ CANADA)
CABANE ET MUSEE JACK LONDON À DAWSON-CITY (TNO_ CANADA)
Enfin l’hélice se tut ; et le navire demeura immobile ; mais aussitôt une agitation fébrile s’empara de tous les passagers. François accoupla vivement les chiens et les fit monter sur le pont. On se bousculait pour franchir la passerelle ; et tout à coup Buck se sentit enfoncer dans une substance molle et blanche, semblable à de la poussière froide et mouillée. Il recula en grondant ; d’autres petites choses blanches tombaient et s’accrochaient à son poil. Intrigué, il en happa une au passage et demeura surpris : cette substance blanche brûlait comme le feu et fondait comme l’eau…
Et les spectateurs de rire.
Buck était excusable pourtant de manifester quelque surprise en voyant de la neige pour la première fois de sa vie… » J.L.

Devant le Centre Jack LONDON


L’intérieur du Centre
L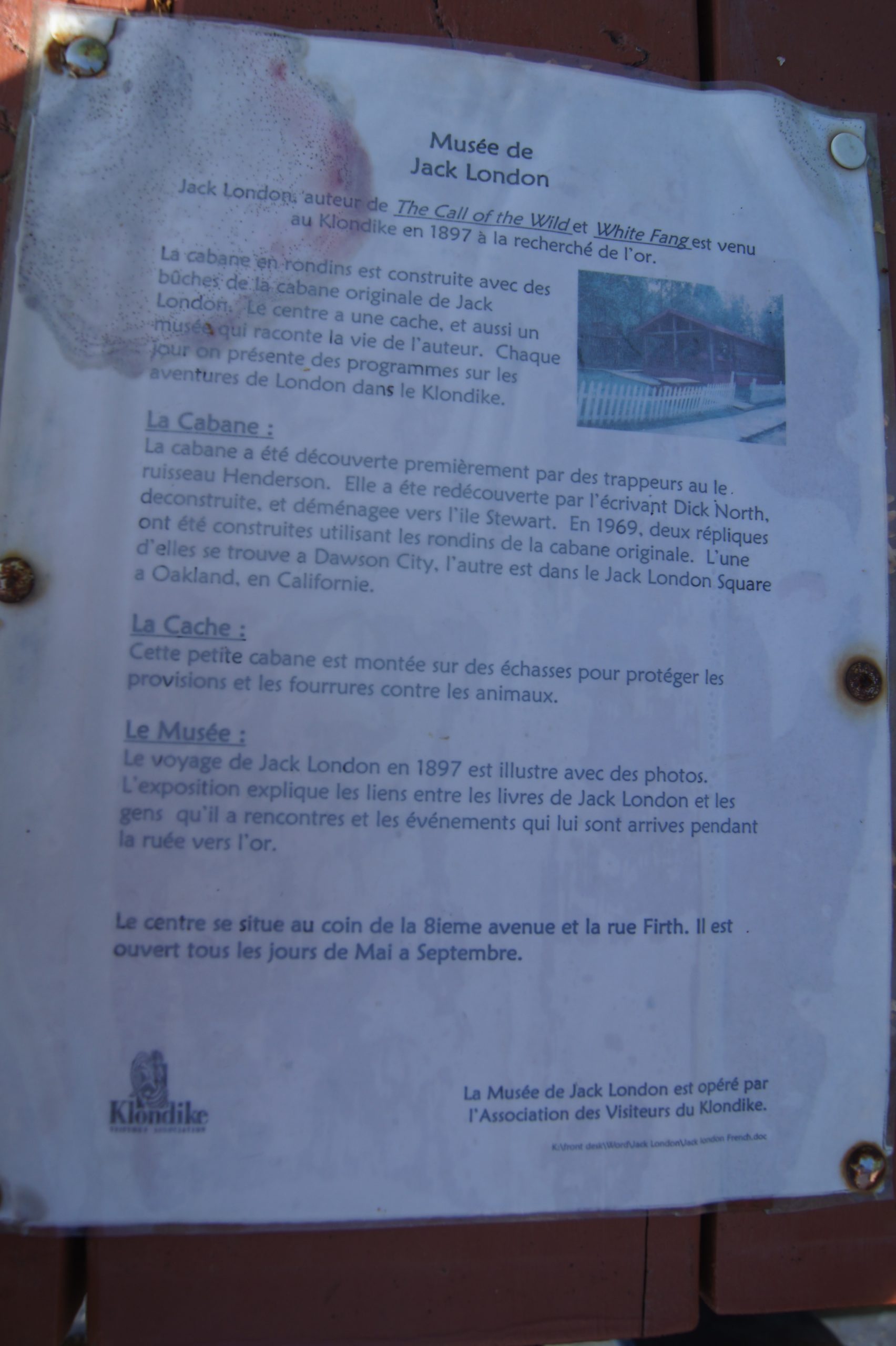

Jack London au début du 20° s- photo Wikipedia
__________________
Article de presse:
Martine Laval _ Publié par Télérama le 03/12/10 mis à jour le 09/10/20
Dans cette cité voisine de San Francisco, tout est à l’enseigne de Jack London, né ici en 1876. Mais l’âme de l’écrivain tempétueux, alcoolique, qui a brûlé sa vie et s’est essayé à tous les genres, semble s’être envolée des lieux.
Tourner le dos à Sa Majesté San Francisco. Mettre le cap sur Oakland, la cité du labeur. Traverser l’immense baie en laissant au large Alcatraz, l’île de tous les malheurs. S’accrocher au bastingage et tenir tête aux bourrasques. Longer des kilomètres de quais, plus d’une trentaine, où s’agglutinent des collines de ferraille. Compter – en vain – les énormes containers aux couleurs vives, posés là comme des Lego. Regarder s’agiter, au-dessus des cargos gros comme des montagnes et en partance pour le bout du monde, des grues tentaculaires. Et se demander si cet Oakland-là, que l’on va découvrir en accostant, garde aujourd’hui quelques traces d’un de ses fils de la rue, un chenapan devenu écrivain, Jack London (1876-1916). Un acharné de l’écriture – mille mots chaque jour, quoi qu’il arrive -, malgré les infortunes, froid, pauvreté, solitude, colères et désespoirs.
Ici, à Oakland, il y a plus d’un siècle, « la vie n’offrait que laideur et misère », raconte, en 1909, un Jack London révolté (1). Il poursuit : « Je suis né dans la classe ouvrière. Très tôt, j’ai découvert l’enthousiasme, l’ambition, les idéaux : et les satisfaire devint le problème de mon enfance. » Son enfance, il la brûle sur les docks d’Oakland, où grouillent des durs à cuire, de mauvais garçons, des matelots bagarreurs, des dépenaillés menteurs. Crieur de journaux, ouvrier dans une conserverie, pilleur d’huîtres dans cette baie où chacun survit comme il peut, puis patrouilleur à la poursuite de ses anciens compagnons voleurs, celui qui deviendra plus tard marin sous toutes les latitudes, chercheur d’or dans le Klondike, vagabond sur les routes parmi les crève-la-faim (2), militant socialiste et journaliste sous la défroque d’un clochard dans les bas-fonds de Londres (3), trime douze heures par jour pour quelques sous, qu’il donne à sa mère. Le soir, dès l’âge le plus tendre, il largue sa volonté de fer, et, pour oublier l’épuisement, s’encanaille, face à la baie, au First and Last Chance, le bar de la première et dernière chance : un premier verre en posant pied à terre, un dernier verre avant d’appareiller.
Jack London boit : « La première fois que je m’enivrai, j’avais 5 ans », avoue-t-il dans John Barleycorn (4), un récit dans lequel il raconte son enfer avec l’alcool. Le texte est publié en 1912, quatre ans avant sa mort – à 40 ans tout rond -, et fait un tabac, comme nombre de ses livres.
Jack London crache à la gueule du destin sa soif de vivre – de tout vivre – et n’a qu’un seul désir, en découdre, à la force des poings s’il le faut, pratiquant la boxe comme une métaphore de la vie (5). Il interdit à quiconque, femme ou patron, de lui dicter son avenir. Se contenter de trimer, de rester un gosse de pauvres, une bête de somme, un analphabète ? Non. London – le nom de son père adoptif – sera Jack London : « J’aime mieux être un météore superbe plutôt qu’une planète endormie. La fonction de l’homme est de vivre, non d’exister. Je ne gâcherai pas mes jours à tenter de prolonger ma vie. Je veux brûler tout mon temps. »
Ces mots, entre poésie et grandiloquence, sont gravés sur une plaque de cuivre posée sur le Jack London Waterfront, à Oakland, un lieu sans âme, aseptisé comme savent l’être les constructions modernes, planté sur les anciens docks, que l’on imagine jadis grouillants de vie et désormais déserts. La salle de cinéma (close), l’hôtel (endormi), les immeubles (sans le moindre quidam à la fenêtre), la marina, où s’ennuient quelques voiliers, et même les bouches d’incendie (résurgence du passé ?) : tout ici est à l’enseigne du célèbre Jack London. Mais célèbre pour qui ? A deux pas de l’eau, une statue – la sienne. Il semble seul, perdu, oublié, pas à sa place. A ses pieds, un Croc-Blanc de bronze.
Le First and Last Chance, ce bar où il traîna tout jeune,
est écrasé par les tours de verre
qui le surplombent. Un décor de pacotille.
D’autres clichés : sa cabane de chercheur d’or, façon Jeremiah Johnson, soi-disant ramenée du Grand Nord, gît là comme une verrue entre des palmiers trop soignés ; le fameux First and Last Chance, ce bar où il traîna tout jeune, une minuscule chose faite de rondins, est écrasé par les tours de verre qui le surplombent. Un décor de pacotille. Un affront pour l’écrivain. Surprise ! Le barman est français, « échoué là depuis vingt ans ». Un rien laconique, il se force : « Quelques buveurs le soir, des habitués, quelques étrangers la journée, sans plus. C’est calme. » Il n’a pas lu Jack London, ou il y a longtemps, peut-être Croc-Blanc, il ne sait plus. Il vend des bières et des bricoles (tee-shirts, cartes postales, verres, tous à l’effigie de l’écrivain). Notre barman n’a pas eu la chance de croiser miss Ina Coolbrith, la bibliothécaire d’Oakland qui mit entre les mains de Jack, alors gamin, quelques livres qu’il avala comme si le monde s’ouvrait à lui.
Viennent alors à l’enfant des idées de grand large, d’aventures, des envies d’écriture. Il veut étudier, passe le concours d’entrée à la prestigieuse université de Berkeley. Contre toute attente, il y est admis, y reste quatre mois – sans le sou, pas à sa place (encore !) parmi les fils de riches, il capitule, se politise avec ardeur et rejoint le Socialist Labor Party.
Il serait prétentieux de vouloir tout dire ici sur Jack London. Il a épuisé les biographes (6). Les bibliographies françaises sont incomplètes et s’annoncent clairement « sélectives » ! Aurait-il trop écrit ? Trop brûlé ses doigts à raturer, trop consumé son âme à dire la vie ? Les éditions Phébus ont entrepris de republier, dans leur collection de semi-poches Libretto et dans des traductions revues, l’intégralité de son oeuvre. Ecrivain culte pour les Français, Jack London est en revanche farouchement oublié de ses compatriotes. A Oakland, le Barnes & Noble, supermarché du livre, affiche trois ou quatre titres estampillés « intérêt local »… Idem à San Francisco, au City Lights Bookstore, le fief de la Beat Generation. Et au Bound Together, la librairie anarchiste, rien de l’illustre rebelle. Etrange. Car Jack London n’est pas – pas uniquement – l’écrivain du « grand dehors », de la nature sauvage, dans la lignée d’un Henry David Thoreau (1817-1862), chantre de l’écologie avant l’heure et auteur de Walden ou la vie dans les bois. Certes, Croc-Blanc, L’Appel sauvage, Construire un feu ont fait pleurer des générations d’enfants. Mais n’oublions pas que, même dans ces textes-là, Jack London, avec romantisme, insuffle sa rage contre l’injustice, l’inhumanité de la société. Il se revendique, sans honte, écrivain politique.
En littérature, Jack London fraye avec tous les genres, de la nouvelle cinglante au roman au long cours. Tout l’émerveille. Tout le révolte. Tout l’inspire. Récit autobiographique, texte d’anticipation et même fantastique, roman d’aventures, pamphlet politique, dont un virulent Grève générale ! – titre, en français, d’un recueil de deux histoires ouvertement anticapitalistes (7)… L’oeuvre se construit, fait du bruit. L’aventurier a des rêves de grandeur, se fait bâtir une demeure qui serait celle du bonheur. Sa Maison du loup, à Genn Helen, dans la Sonoma Valley, opulente région de vignobles prisée par le touriste aisé au nord de San Francisco, est partie en fumée en 1913. Elle n’est aujourd’hui que ruines, comme le sont ses livres, dans ce pays qui, pourtant, l’a vu naître…
Dépité, aigri, London voyage encore, fait le chroniqueur, puis, malade, retourne se terrer dans son bercail en cendres. Il quitte le Socialist Labor Party. Et meurt, en 1916. La légende veut qu’il se soit suicidé, comme son personnage emblématique, cette force de la nature terrorisé par l’injustice, Martin Eden, son double, celui qui se laisse couler dans les flots noirs : « Cette souffrance n’était pas la mort, se dit-il dans une demi-inconscience. La mort ne faisait pas mal. Non, c’était la vie, cette atroce sensation d’étouffement – le dernier mauvais coup que lui portait la vie. »
Admiré par Lénine et Trotski, adulé par nombre d’auteurs français(de Linda Lê à Fred Bernard…) et quelques auteurs américains, dont Eric Miles Williamson, auteur du fabuleux Gris-Oakland (éd. Gallimard), Jack London n’était pas un pur. Un peu machiste, un peu raciste, un peu séducteur, un peu fier-à-bras, un peu buveur… Mais aussi un homme rebelle, qui crut en la littérature, la bouscula, se servit d’elle pour mettre au grand jour ses tripes de rêveur de lune. Et s’il ne fallait lire, aujourd’hui, expressément, qu’un seul livre de cet homme au coeur trop grand pour une seule vie, ce serait Le Talon de fer, titre sans doute négligé mais d’une actualité folle (9). Jack London y montre ses talents d’imagination, fait plier la narration à son bon vouloir, assume à mots clairs ses convictions antilibérales. Et surprend le lecteur, car le narrateur est… une femme. Fille de la bourgeoisie intellectuelle, elle connaît le coup de foudre pour un homme, sorte de petit frère de Martin Eden à l’allure gauche mais séduisant, à la parole rare mais limpide, prolo qui a tout lu, tout compris, militant socialiste forcené, Ernest Everhard. L’amoureuse change de camp, raconte ses années de guerre militante contre le capitalisme aux côtés d’Ernest, bientôt leader, un héros – mi-Zorro, mi-Che Guevara – tel qu’il n’en existe plus… Jack London, comme dans un dernier défi à l’injustice, y énonce des vérités éclatantes sur l’égalité, la liberté, les droits les plus élémentaires pour chacun de vivre digne. Avec ardeur, il invente ou réinvente l’histoire, sous formes de notes comme dans les plus parfaits ouvrages de sciences humaines. Il anticipe la révolution russe, le nazisme, la Seconde Guerre mondiale. De là à penser qu’il est visionnaire…
Qui se soucie du Talon de fer, ici, sur les docks d’Oakland ? De l’oeuvre entière d’un de ses gamins ? Ernest Everhard est mort. Martin Eden est mort. Jack London est mort. Les clients boudent toujours le First and Last Chance. Le barman va-t-il encore longtemps servir ses bières aux rares amoureux de la littérature qui s’y perdent ? Ou fermer ses portes, renonçant au monde comme Martin Eden, comme Jack London…
(1) Ce que la vie signifie pour moi, éd. Le Sonneur, 48 p., 6 €.
(2) La Route, éd. Phébus, 192 p., 7,50 €.
(3) Le Peuple d’en bas, éd. Phébus, 256 p., 10 €.
(4) John Barleycorn, éd. Phébus, 256 p., 8,99 €.
(5) Sur le ring, éd. Phébus, 160 p., 6,90 €.
(6) Signalons Jack London ou l’écriture vécue, de Francis Lacassin, éd. Christian Bourgois.
(7) Grève générale ! éd. Libertalia, 160 p., 8 €.
(8) Martin Eden, éd. Phébus, 448 p., 7,40 €.
(9) Le Talon de fer, éd. Phébus, 320 p., 9,90 €.
A lire
Face de lune, trad. de l’anglais (États-Unis) par Louis Postif, éd. Phébus, coll. Libretto, 185 p., 11 EUR
Bonnes adresses
Un bar : le First and Last Chance, le bar où le petit Jack écoutait les récits des marins. Un lieu de culte pour les fans de l’écrivain, qui viennent y boire à sa postérité. 48 Webster St. in Jack London Sq., Oakland. Tél. : 510/839-6761.
Une promenade : de San Francisco à Oakland, traversée de la baie en ferry, un spectacle surprenant. Et aussi le Golden Gate, l’île d’Alcatraz et Oakland.
Blue & Gold Fleet (www.blueandgoldfleet.com). 15 $ aller et retour.
Une librairie : peu de livres de Jack London à la librairie City Lights, fondée en 1953, mais, point de ralliement de la Beat generation, elle vaut le détour ! 261 Columbus Av., San Francisco. Tél. : 415/362-8193.
Une visite : the Wolf House (La maison du loup), petit musée à la mémoire de Jack London.
Jack London State Historic Park, 2400 London Ranch Rd., Glen Ellen. Tél. : 707/938-5216.
__________________
POUR EN SAVOIR PLUS:
FRANCE CULTURE _ 1ère diffusion : 14 décembre 1989
Jack London (1876-1916) : Une vie, une oeuvre [1989 / France Culture]
En 1989, l’émission “Une vie, une oeuvre”, proposait un documentaire radiophonique pour éclairer l’oeuvre imposante, aussi célèbre que mal connue, de l’écrivain américain Jack London. Un documentaire produit et réalisé par Geneviève Ladouès et Isabelle Yhuel, diffusé pour la première fois sur France Culture le 14 décembre 1989. Jack London écrivait : « J’aime mieux être un météore superbe, chacun de mes atomes rayonnants d’un magnifique éclat plutôt qu’une planète endormie. La fonction de l’homme est de vivre non d’exister. Je ne gâcherai pas mes jours à tenter de prolonger ma vie, je veux brûler tout mon temps. » S’il est bien un auteur dont l’oeuvre et la vie sont indissociables c’est London. Une vie sur l’origine et la fin de laquelle planera d’ailleurs toujours un mystère. La vie d’un homme exceptionnel sans doute plus qu’aucun autre de son temps dans une Amérique à la croisée de deux siècles. Jack London l’enfant du rêve américain, mais aussi de son cauchemar, a vécu une vie courte, d’à peine quarante années. Avec Jacques Darras, Simone Chambon et Pierre Lagayette. Production : Geneviève Ladouès Réalisation : Isabelle Yhuel “Une vie, une oeuvre” – Jack London 1ère diffusion : 14 décembre 1989 Indexation web : Sandrine England, documentation sonore de Radio France Source : France Culture
__________________
Lire Wikipedia: https://fr.wikipedia.org/wiki/Jack_London
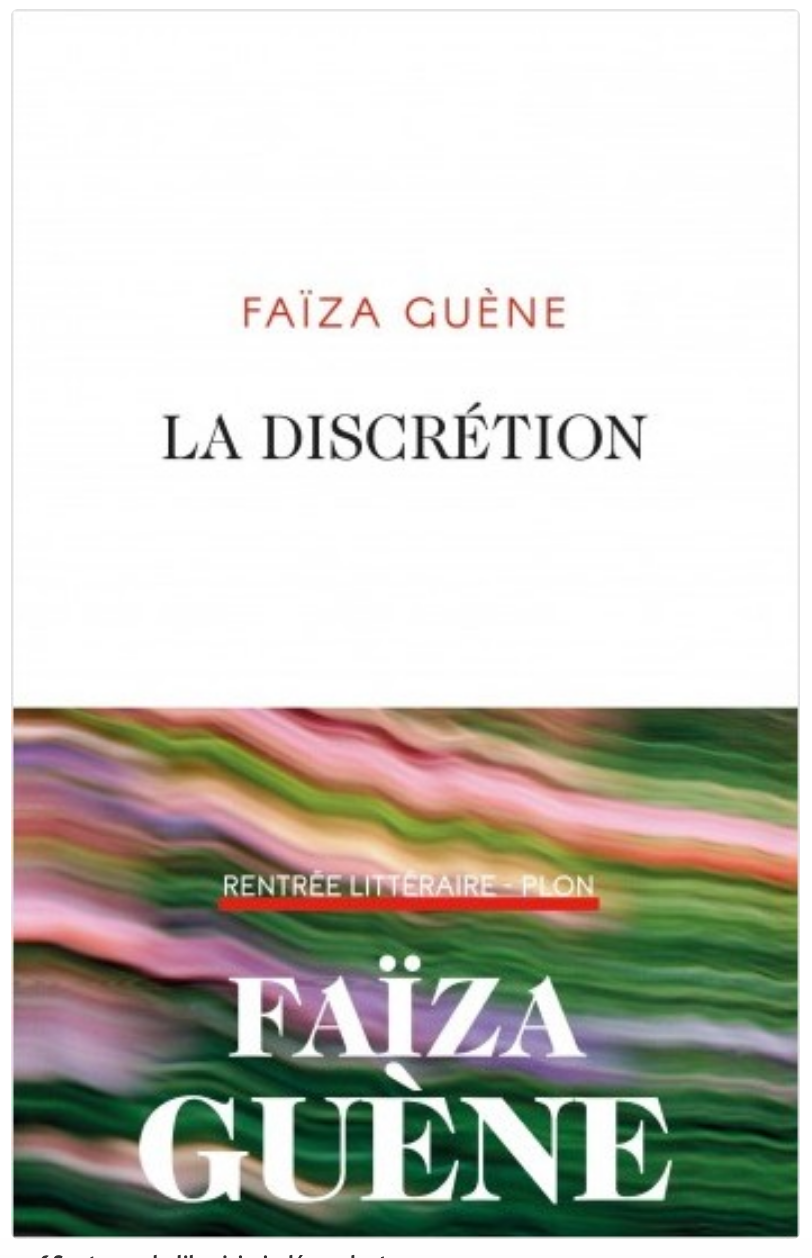
Faïza Guène, La Discrétion (Plon, août 2020)
C’est plus un compte rendu (long) de lecture qu’une académique recension du livre de Faïza Guène, La Discrétion (Plon, août 2020) que je vous propose ci-après.
Voici un livre qui, quelque part, me réconcilie avec moi-même, avec mon passé, mon présent, ici en France. J’ai trouvé un certain réconfort à la lecture de ce roman qui dépeint « une famille française » et algérienne et musulmane, pleine d’une histoire chargée, de noms, de culture, de présent dont le pays, la France, n’a d’autre choix – si elle veut sérieusement incarner comme elle le proclame sur tous les frontons l’égalité, la fraternité – que de reconnaître, de revendiquer même, de prendre cette famille (et toutes les autres familles maghrébines) comme elle est, avec ses complexités. De lui attribuer les mêmes droits et d’attendre d’elle de se plier aux mêmes devoirs que tous les autres citoyens, ni plus, ni moins. Le pays doit s’abstenir de vouloir continuer d’« effacer » une part de ces hommes et femmes qui participent à sa construction, de leur soustraire une part de leur être profond. Si la France a procédé ainsi avec les anciens qui se sont éreintés dans les chantiers dans la discrétion, dans le silence, dans l’effacement, elle devra, pour son propre devenir national, écouter les enfants de ces êtres oubliés et plus encore leurs petits-enfants qui donnent de la voix sans complexe aucun pour un égal traitement républicain. Avec raison.
Le roman de Faïza Guène, La Discrétion, est léger et agréable, se lit d’une traite.
La Discrétion est le sixième roman de Faïza Guène. Le premier, Kiffe kiffe demain, est publié en 2004 chez Hachette. Elle a 19 ans. Il aura un grand succès et sera traduit dans plus d’une vingtaine de langues. Deux ans plus tard, elle publie Du rêve pour les oufs (Hachette, 2006), puis Les Gens du Balto (Hachette, 2008), Un homme, ça ne pleure pas (Fayard, 2014), Millénium Blues (Fayard, 2018). La page Faïza Guène de Wikipedia fourmille d’informations et sur l’autrice et sur ses écrits et films, car elle est également scénariste.
———————————— CLIQUER ICI ——————————-
http://ahmedhanifi.com/wp-content/uploads/2020/10/Faiza-Guene-La-Grande-librairie-Mer-23-09-2020.mp4
Faïza Guène à La grande librairie, le mercredi 23 septembre 2020
_____________________________________________________
Comment se présente le roman ?
La Discrétion est composé de 35 parties que j’ai numérotées (c’est pratique). Il comporte 253 pages. Ce sont de courts chapitres allant de deux à seize pages. Vingt chapitres sont constitués de moins de six pages. Les chapitres 1 et 26 sont ceux qui comportent le plus de pages : 15 chacun.
Au cœur de l’ouvrage, en page 137, entre le 17° et 18° chapitre, Faïza Guène cite Frantz Fanon. « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » (Les Damnés de la terre).
Elle dédie le roman « à ma mère et à toutes nos mères ». En fin d’ouvrage elle renouvelle sa reconnaissance et en ajoute d’autres « À la mémoire de mon père, mort de discrétion… À ma mère, à son cœur qui déborde, à tous les héritiers d’une histoire en fragments, à Djamila Bouhired, à ma fille, à l’unique que j’aime et qui m’a portée… »
La page 9 porte en exergue une citation de James Baldwin extraite de son essai La prochaine fois, le feu. »
Chaque chapitre porte un titre. Et chaque titre porte le nom d’un lieu, du pays (France, Algérie ou Maroc) et l’année du déroulement des faits. Plus le numéro du département lorsqu’il s’agit du territoire français. Un seul titre porte les numéros de départements non français, il s’agit de « Wilaya d’Oran (31), d’Aïn Témouchent (46) et de Tlemcen (13)… »
Quelles sont les communes dont il est question dans les titres (et dans le livre évidemment) ? :
Pour le Maroc : Ahfir.
Pour l’Algérie : douar Atochène, village d’Arbouze, commune d’Aïn Kihal, villes d’Oran, Témouchent, Tlemcen.
Pour la France : Aubervilliers, Bobigny, Les Lilas, Pillac et Paris (plusieurs arrondissements).
23 des 35 titres de chapitres comprennent des noms de villes françaises : Aubervilliers fait l’objet de onze titres, Paris, de huit… Neuf titres comportent les noms de villes algériennes, et trois, marocaines (Ahfir).
Quinze titres portent en sus une précision, ainsi :
« Marché du boulevard de Oujda, (Ahfir, chapitre 8),
« les vacances » (Wilaya d’Oran (31)…, chap. 26),
« Brasserie Le coq français » (Les Lilas, chap. 7),
« Mairie » (Bobigny, chap. 28)
« Chemin des vignes (Bobigny, chap. 15),
« Les jardins familiaux », (Aubervilliers, chap. 21)
« Rue du Moutier », (Aubervilliers, chap. 24)
« Bar Joséphine » (Paris 6°, chap. 29)
« Renault Talisman » (Paris 6°, chap. 3)
« Cabinet de madame Aït Ahmad » (Paris 11°, chap. 31)
« Service stomatologie et chirurgie maxillo-faciale » (Paris 13°, chap. 30)
« Lav-Story » (Paris 18°, chap. 13)
« Impasse saint François » (Paris 18°, chap. 5 et 33)
« Maxi Toys » (Paris 19°, chap. 25)
Le roman déroule une histoire qui s’étend de l’année 1949 à 2020
Les années suivantes ne sont évoquées que par un seul titre : 1949 (chap. 2), 1954 (chap. 4),
1956 (chap. 6), 1959 (chap. 8), 1962 (chap. 10), 1963 (chap. 12), 1964 (chap. 14), 1967 (chap. 16), 1978 (chap. 18), 1990-2000 (chap. 26).
L’année 2018 est évoquée dans trois titres : chap. 1, 3 et 5.
L’année 2019, dans les dix chapitres impairs de 7 à 25
Enfin, l’année 2020 est traitée dans les titres 27 à 33 et le dernier, 35.
Comment sont ventilées les années par chapitre. Les chapitres ne comportent pas de numéro. Je leur en ai attribué un pour la facilité de l’analyse.
Le 1° chapitre s’ouvre sur l’année 2018
Le 2° chapitre renvoie à l’année 1949 (année de naissance de Yamina). Avec le 3° chapitre on revient à 2018. Le 4° se déroule en 1956. Le 5° de nouveau traite de 2018.
Les chapitres impairs suivants : du 7° au 25° se passent en 2019. Chacun d’eux est suivi d’un chapitre pair pour évoquer les années 1959 à 1981 (2019-1959-2019-1962-2019-1963 etc.)
Le chapitre 26 évoque les années 1990-2000.
Les chapitres 27 à 33 se situent en 2020. Le chapitre 34 en 2012 et le dernier, le 35°, en 2020 à Pillac. (C’est la première fois que la famille prend de vraies vacances. « Ils sont émus de se dire qu’ils font partie de l’histoire de France »)
J’ai développé l’analyse ci-dessous en respectant l’étendue temporelle allant de 1949 à 2020.
La quatrième de couverture fait bien de se concentrer sur Yamina, la mère, car elle est au cœur de la famille Taleb et du livre. Tout ou presque se fait, se pense, se positionne à partir d’elle. Yamina, dans l’Algérie en guerre « À peine adolescente, elle a brandi le drapeau de la liberté… » et aujourd’hui en France « Quarante ans plus tard, à Aubervilliers, elle vit dans la discrétion. N’est-ce pas une façon de résister ? »
La question de la liberté, de la dignité, de la résistance face au mépris, à la condescendance, traverse tout le roman. Les enfants de Yamina et de Brahim Taleb sont d’ici, de France aussi, maintenant plus qu’hier. Ils portent en eux une histoire de plusieurs générations, leur histoire, qu’ils revendiquent la tête haute, hic et nunc.
Maintenant que l’architecture du roman est posée, j’en viens au contenu.
Ce compte rendu-rendu je le réalise à partir d’une lecture du roman respectueuse de la ligne du temps (de 1949 à 2020), et non tel qu’il se présente à la lecture au premier abord avec ses chapitres qui vont et viennent d’une année vers une autre, du passé au présent avec plusieurs retours vers telle ou telle autre année du passée pour revenir une nouvelle fois vers 2020.
Le point de départ. Dans une maison en argile, le « tlakht », l’atmosphère est fébrile. Nous sommes en Algérie en 1949 dans le douar d’Atochène. Province de Msirda Fouaga. L’autrice suggère que la guerre a déjà commencé, ce qui n’est pas le cas. « Le soldat est à son 19° mois de mobilisation… » il bouscule une jeune femme enceinte et fait tomber son balluchon… mais elle ne montre pas qu’elle a peur. La peur elle la garde pour elle. « Rahma accouche dans une grande douleur, sa souffrance est telle qu’elle se confond avec la mort ». Le nourrisson s’appelle Yamina.
Quelques années ont passé. À cette époque, en 1954, il était imprudent de dormir dans la cour en été, car « les soldats français pouvaient faire irruption à tout moment ». La précision est inutile, car s’il y a soldats, ils ne peuvent qu’être français. Et puis nous sommes en été et Faïza Guène anticipe la guerre qui ne commencera réellement que l’année suivante, bien après l’automne dans un certain nombre de régions, certainement pas dans une mechta isolée et « sans intérêt » pour les colons et l’État français.
La guerre est déclarée depuis deux ans. La famille fuit le douar à l’aube « sous le regard embrumé de jeddi Ahmed, le grand-père, pour se réfugier au Maroc, à Ahfir, accueillis par la grand-mère de Yamina. Son père est au front. C’est un résistant. Deux des frères de Yamina, sans autre précision, sont nés en exil. Des inconnues passaient voir les réfugiés algériens au Maroc et donnaient des instructions « ne parlez pas de vos maris, de vos frères ».
Yamina a grandi. C’est maintenant une petite fille de dix ans. Des femmes portent d’immenses plateaux de pain à faire cuire. Des enfants cirent des chaussures d’adultes ou mendient. Une fillette, à peine plus âgée que Yamina, mendie. « Personne ne s’arrête pour lui donner une pièce ou un bout de pain. » Yamina a mal à une dent « qui lui donne le vertige ». L’arracheur de dents pratique une médecine ancestrale. Il lui arrache la dent avec « une petite pince de forgeron en métal, non stérilisée. C’est pire que dans le pire des cauchemars. » Pendant 14 ans, jusqu’en 1973, « elle souffrira d’abcès et de migraines, régulièrement. »
Sept ans de guerre ont passé. La famille de Yamina se trouve toujours à Ahfir chez la grand-mère. C’est l’indépendance de l’Algérie. Yamina, 13 ans, « portait une tenue aux couleurs du pays : jupette verte, chemise blanche et cravate rouge. » Yamina n’en avait jamais voulu à sa mère, Rahma, « plutôt froide, voire inaccessible et verrouillée. Yamina avait bien compris que manifester ses sentiments n’était pas une évidence. » Les sentiments demandent de l’espace pour s’exprimer, mais « le problème c’est qu’avec la guerre et la misère, c’est que la guerre et la misère prennent toute la place. » Faïza Guène exprime formidablement bien cette pudeur qui plombe de très nombreux (la majorité ?) Maghrébins. Yamina, tout comme sa mère, se retenait naturellement de déborder. Les émotions restaient coincées à l’intérieur de leur corps. « Le corps ne coopère pas toujours avec le cœur, même si le cœur brûle, exulte, le corps doit rester là, figé, inapte. Ils finissent parfois comme deux étrangers qui ne parlent pas la même langue. »
Yamina a été obligée d’arrêter l’école « pour aider ses parents à la ferme » et élever ses nombreux frères et sœurs dont cinq deviendront des professeurs. Elle en est l’aînée. On ne connaît pas le nom de tous les frères et sœurs de Yamina. Leurs parents sont Rahma et Mohamed Madouri qui vivent à Aïn Témouchent. Dans la fratrie il y a Moussa, Norah, Nabil, Djamila « dernier né des enfants ». Cette dernière porte le prénom d’une révolutionnaire. Plus tard (en mars 2015 ?), Yamina emportera avec elle une photo du journal algérien Liberté sur laquelle on pouvait voir la splendide révolutionnaire Djamila Bouhired, à l’occasion d’une visite officielle en Égypte » en juillet 1962.

La famille est retournée dans le village ancestral d’Arbouze, à Msirda Fouaga. Le figuier de Yamina est mort. Elle se lamente à son pied. La pauvreté est un lot quotidien « Yamina et ses frères ont été longtemps sous-alimentés. » Après l’indépendance, le père est sans emploi et « les gens de la campagne ont tout perdu. » Le père « traîne dans les cafés. » La guerre a volé sa gentillesse et sa sérénité ». Il est devenu violent « et Yamina déteste la violence… Sa mère culpabilise sa fille – « c’est ta faute, tu ne sais pas parler, tu n’es bonne à rien » – qui n’a pu acheter à crédit. « L’épicier refuse de faire crédit, car l’ardoise est trop chargée ». L’année suivante, le choléra a touché plusieurs familles du village. Yamina s’en remet à peine. L’autrice écrit « quelques semaines plus tôt », mais sans préciser la date de référence.
Yamina fuit la tatoueuse du village, « elle n’accepte pas ce tatouage (sur le front), elle refuse d’être marquée à vie ». Faïza Guène fait un hasardeux parallèle entre le front et le front. Elle écrit que le front de Yamina est « son front de libération personnel. Elle le gardera libre jusqu’à la tombe. »
« Une dizaine de familles vivent dans la vieille ferme d’Aïn Kihal », près de Aïn Témouchent. Yamina a 18 ans, « elle a un regard de miel. Elle est belle mais elle ne le sait pas, il n’y a pas de miroir. » Mohamed Madouri, le père de Yamina « a été choisi par ses collègues agriculteurs pour les représenter au Syndicat régional des agriculteurs. C’est un analphabète, mais un orateur doué. » Le travail est dur, « de l’aube à la dernière prière du soir. » Yamina passe une partie de ses journées à coudre. « Elle confectionne des jupons et des robes pour les femmes », mais également et surtout elle « s’occupe de nourrir les animaux, faire le ménage, préparer ses jeunes frères et sœurs pour l’école. » Chaque matin, le vieux voisin, Tayeb, transporte les enfants sur son tracteur jusqu’à l’école, à 5 km.
Le chapitre suivant est long de 22 lignes. Nous sommes en 1978, année de la mort du dictateur Boumediene. Yamina vivait encore en Algérie, « elle eut la sensation que l’Algérie perdait son père. » J’aurais tendance à penser qu’il était plutôt détesté dans cette région frontalière de l’ouest, nonobstant sa politique implacable. Le dictateur était de l’Est et le coup d’État qu’il a mené l’a été contre un président issu d’un de ces villages frontaliers avec le Maroc. Le « régionalisme » est très profond en Algérie et cela est étonnant d’écrire « pour la famille, Boumediene était un sauveur », mais possible.
Yamina a accepté à contre-cœur d’épouser un émigré de dix ans plus âgé qu’elle. Le mariage avec Brahim a lieu à la mairie de la Daïra de Aïn Kihal. Brahim réside en France où Yamina ne veut pas vivre. Mitterrand préside désormais et depuis peu aux destinées de la France. Yamina était devenue « la vieille fille du coin. » Elle ne s’est pas mariée auparavant car son père avait besoin d’elle, elle dont il disait qu’elle « valait au moins les six garçons. »
En juillet de la même année, on organisa une fête chez le frère aîné de Brahim, au 17° étage d’un immeuble du quartier de Bel-Air, à Oran. Les parents de Yamina viennent de quitter les lieux après la fête. « Sur le boulevard, la mère ne s’est pas retournée, son père a levé la tête vers le balcon. Elle se sent abandonnée. » Elle a envie de retourner chez eux, « de tout annuler ».
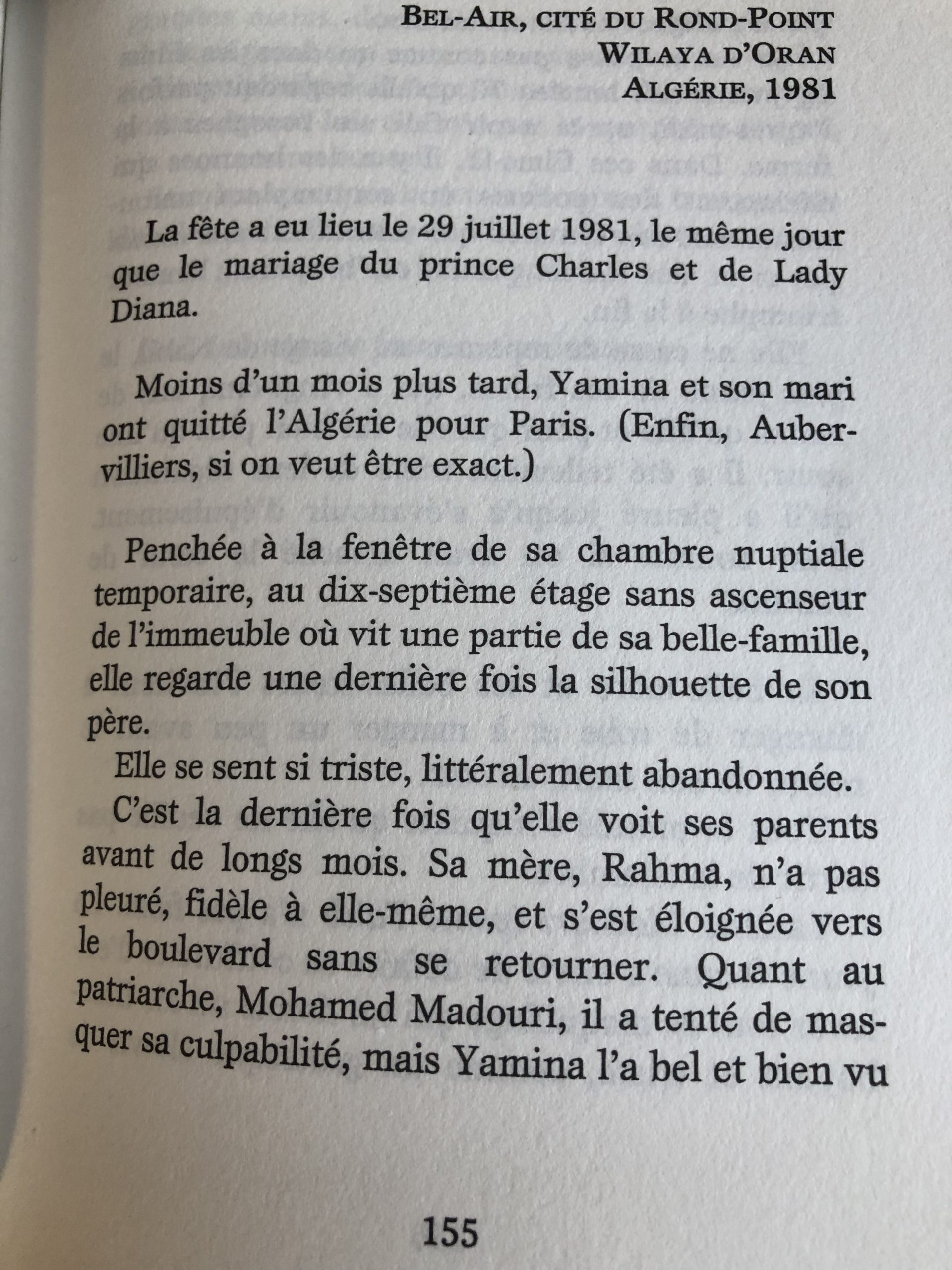
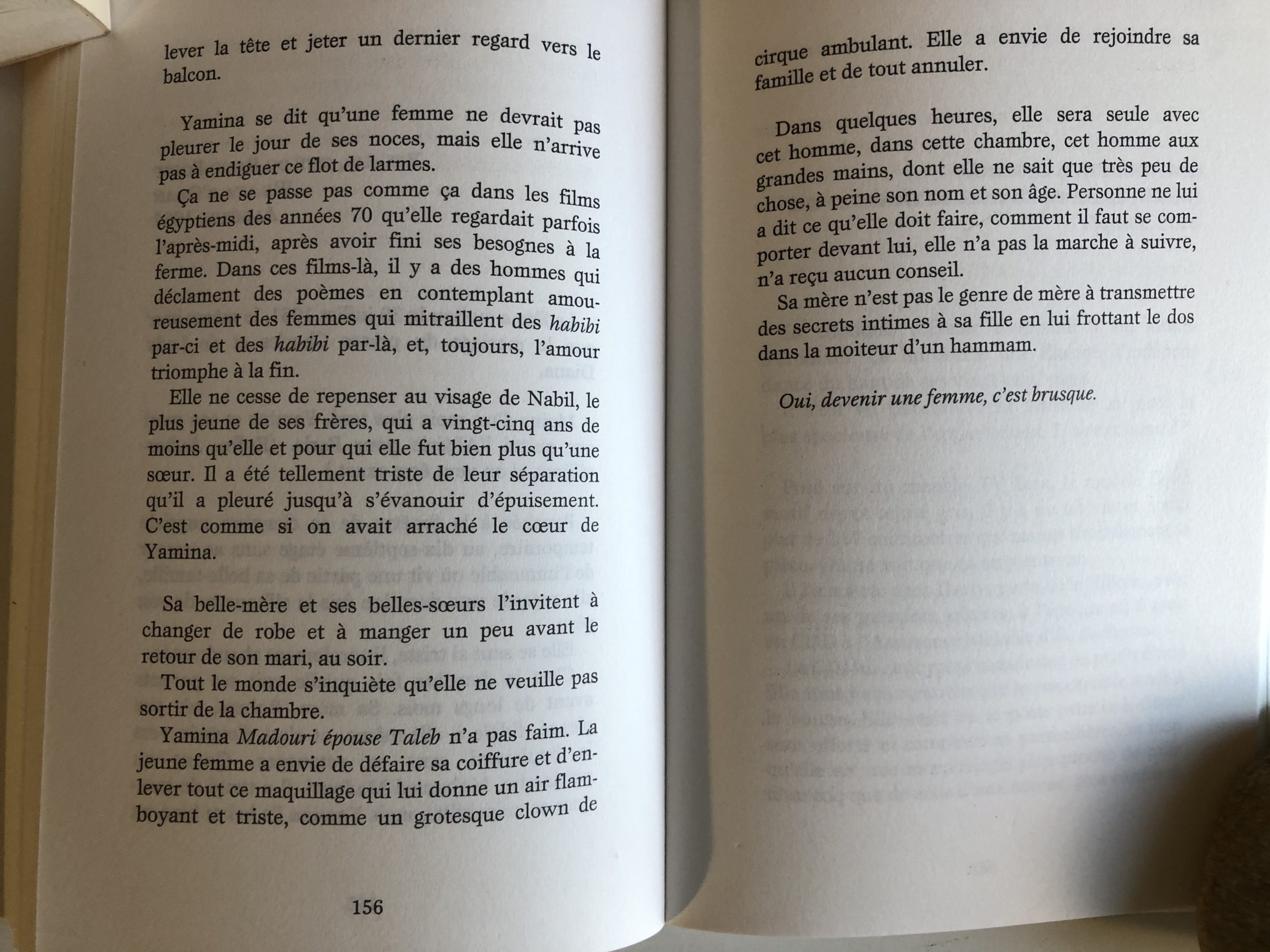
Ce n’est pas facile de devenir une femme « c’est brusque, elle n’a pas la marche à suivre. »
Yamina passera ici 4 mois avant de rejoindre Brahim. Ils partirent pour la France en août.
Voilà Yamina en France. « Brahim n’a eu que deux semaines pour trouver (grâce à des amis Kabyles) un logement. Jusque-là il a toujours vécu seul dans des foyers de travailleurs, dans des cafés-hôtels, dans des baraquements, dans des préfabriqués, chez des cousins dans les bidonvilles de Nanterre. » Faïza Guène rappelle le rouge octobre 1961, « Brahim se souvient de celui qui n’est jamais revenu, que la police française avait jeté dans la Seine » et la proposition faite par Giscard d’Estaing aux Algériens pour quitter la France « avec cette aide de 10.000 pauvres et pitoyables francs. Une honte plus qu’une aide. » C’était difficile à Brahim de faire oublier l’exil à son épouse. Elle pleurait tout le temps. Il la trouve « tellement douce et gracieuse »
Nous faisons un saut de plus de dix années. Nous sommes dans « la décennie noire » à la fois dans la région d’Oran, de Aïn Témouchent et de Tlemcen. Yamina et Brahim ont quatre enfants dont rien n’a été dit jusque-là, sinon que Omar est né « à la clinique de La Roseraie à Aubervilliers ». Tous nés dans la décennie 80 : Malika est née en 1980, Hannah en 1985, Imane en 1987 et Omar en 1988. Pour Yamina et Brahim « élever des enfants » c’est « avant toute chose, qu’ils ne manquent de rien » Pour les générations suivantes, celles du « bien-être » comme celles de leurs propres filles et fils c’est s’accroupir et parler avec leurs enfants « d’une voix mielleuse en regardant l’enfant dans les yeux ».
Pour Malika, Hannah, Imène et Omar et leurs parents, les vacances c’était en Algérie, une semaine à Oran chez l’oncle et à la mer. « Une ville magnifique Oran, baignée par une lumière qui n’existe nulle part ailleurs. » Hannah se demandait comment faisaient les Oranais pour deviner qu’elle venait de France, « à croire qu’ils ont un détecteur ‘d’immigrés’ ». Le week end ils se rendaient au village de vacances Les Andalouses, ils écoutaient le raï de Cheb Hasni « pourquoi a-t-il été tué, il ne faisait pas de politique ». Puis ils se rendaient à Aïn Témouchent chez les parents de Yamina. « Omar était chanceux ‘comme un garçon’ » Faïza Guène n’explique pas pourquoi « comme un garçon ? »
« À Oran, alors qu’il a 8 ans, Omar demande à son père ‘papa, pourquoi il y a que des Arabes ici ?’ Poser une telle question à 8 ans, cela paraît difficile à croire. Il n’était peut-être jamais venu en Algérie avant 1996 ? Peut-être également que ses parents et ses sœurs ne lui ont rien dit non plus des habitants de ce pays ? En Algérie, l’espace public est largement occupé par les hommes écrit justement l’autrice. « Les femmes sont obligées de trouver des stratagèmes pour se frayer des passages et, furtivement, passer sans trop déranger. » Les vacances familiales s’achevaient à Msirda Fouaga. De Aïn Témouchent à Msrida ils ont mis « 4 heures à saigner le goudron » alors qu’il y a à peine 135 km. Brahim préfère-t-il les pistes à la route nationale ? Dans la mechta de la tante paternelle Fatima, l’aînée, « il n’y avait ni montre, ni miroir, ni télévision ». Cela est difficilement imaginable alors que nous sommes dans les années 1990-2000. « Les enfants n’avaient d’autres activités que de dormir, marcher, grimper aux arbres, attraper des scarabées, monter à dos d’âne. Ils faisaient leurs besoins, avant le coucher de soleil, derrière les cactus, au milieu des poules, pour éviter d’avoir à faire ça en pleine nuit parce que ça leur foutait la trouille toutes ces histoires de vipères et de chacals. L’ennui c’est que les figues de barbarie à longueur de journée ça donne la diarrhée »
Le chapitre suivant évoque les attentats terroristes qui ont pris la France pour cible durant les années 2012 à 2016, et l’angoisse qui saisit les Maghrébins, plus encore les Algériens à cause du climat nauséeux, voire délétère qui les vise périodiquement, eux plus que toute autre communauté, du fait de la guerre d’indépendance. « Les Taleb se soutiennent le front, les yeux hagards, devant les images terribles et les bandeaux qui défilent sous l’écran ». Un attentat. Effroi d’abord puis l’empathie pour les victimes et leurs familles. Et un vœu : « faites que le terroriste ne soit pas un ‘‘Arabe’’. » Exactement comme en cette quinzaine de fin octobre 2020, à la suite de l’assassinat de Samuel Paty le vendredi 16. Quel Algérien n’a pas, au plus profond de lui, imploré « faites que le terroriste ne soit pas un Algérien. » Lorsque le lendemain j’ai appris que l’assassin de l’enseignant n’était ni Algérien, ni Maghrébin, j’ai respiré profondément, très profondément. Il était néanmoins musulman, et une partie de la société, de la classe politique à l’affût, plus encore des médias, particulièrement des commentateurs et invités de la télévision, exigèrent (exigent toujours) des musulmans de se « désolidariser ». Mais je ne suis plus vraiment dans l’analyse. J’y reviens.
« Les enfants Taleb savent qu’ils seront écartés du deuil national. » Ils sont habitués. Ils sont aussitôt rangés du côté des accusés. « On les somme de descendre dans la rue dans un cortège à part. » De sortir du rang pour se désolidariser des terroristes. » Les Taleb, réunis en famille comme tous les samedis, parlent de la tragédie. Ils se demandent s’il leur faut chanter plus fort la Marseillaise, changer de prénom, ou adhérer à un parti d’extrême droite pour qu’on leur accorde l’autorisation de faire partie de la communauté nationale.
En 2018, Yamina a 69 ans et vit à Aubervilliers. Chaque samedi matin, elle se rend au marché de la ville, « c’est un rituel ». Dans le bus on lui cède la place mais elle refuse car « elle n’aime pas qu’on se dérange pour elle ». Yamina ne se plaint jamais « comme si cette option lui avait été retirée à la naissance ». Lorsque son médecin traitant la tutoie, lorsqu’il lui demande de dégager ses oreilles de son foulard « Allez, madame Yamina, on enlève sa petite burqa pour montrer ses petites oreilles », elle n’y voit aucune condescendance, ou mépris. Elle ne voit pas cette échelle invisible (sic) sur laquelle il se perche chaque fois qu’il s’adresse à elle ». À moins qu’elle ait choisi « de ne pas se laisser abîmer par le mépris ou envahir par le ressentiment », sa façon de résister.
Elle enfouie sa colère, contrairement à sa fille Hannah qui la laisse exploser comme devant la guichetière de la préfecture de Bobigny « qui blesse les gens avec son comportement » sa façon de parler avec eux « très fort en articulant lentement » Malika est divorcée. Les trois autres sœurs et Omar sont célibataires. Les samedis, ils se retrouvent chez leurs parents qui sont heureux de les recevoir pour le rituel couscous.
Omar n’a jamais fait la moindre remarque à ses sœurs qui étaient pour lui comme « trois petites mères ». Il est le chouchou de Yamina, qui peut faire se lever l’une de ses filles pour que lui, le garçon de la famille, s’assoit « ma fille, lève-toi, c’est la place de ton frère »
Les sœurs considèrent que Omar est le préféré de leur mère. « Imène, détachée, lâche en haussant les sourcils « Inch’Allah que j’ai pas d’enfants, si c’est pour faire des différences, c’est pas la peine ! » Lorsque Brahim, le père, rentre des courses et qu’il a oublié les Chocapic, les céréales préférées de Omar, « Yamina le boude ». Suit une liste d’actions de Yamina montrant combien Yamina chouchoute Omar. Pourtant, Si Omar est la fierté de sa maman, Malika est la fierté de la famille, « Elle travaille au service de l’état civil de la mairie de Bobigny. » Elle se fait discrète, « elle ne fait jamais de vague. » Yamina rappelle à tous qu’elle ne fait aucune différence entre ses enfants « qui sont comme les doigts de ma main, je peux pas en couper un. » Mais Imane est persuadée qu’elle est « l’auriculaire de Yamina, ce doigt inutile. » alors elle quitte la pièce peinée.
La famille habite à Aubervilliers, « rue du Moutier », non loin du cirque Zingaro, à quelques kilomètres de Paris et du stade de France.
Yamina se lève à l’aube pour faire sa prière. Une fois, alors qu’elle allait faire ses ablutions, elle s’est rappelée d’un rêve dans lequel elle se voit se rendre à l’école qu’elle trouve fermée. Elle crie « ouvrez-moi, je veux rentrer », mais en vain. Elle est ramenée à la maison par son père « qui fronce les sourcils ». Yamina a dû arrêter l’école pour aider ses parents. Ses enfants à elle ont tous été à l’école. Malika, sa fille aînée, divorcée, intellectualise tout. Elle ajoute toujours « à ce qu’il paraît » lorsqu’elle avance une citation d’un auteur « ce qui affaiblit malheureusement la crédibilité de son propos. »
Les phrases sont en italiques lorsqu’elles reprennent les échanges entre par exemple l’employée de la préfecture et Hannah, mais aussi lorsque l’autrice s’adresse au lecteur « peut-être que ça ne vous frapperait pas immédiatement en la regardant, mais derrière Yamina il y a une histoire comme derrière tout un chacun. » Faïza Guène utilise l’humour, parfois de manière subtile, « Sur les boites de Chocapic, sous la date de péremption, on devrait ajouter l’âge limite pour en manger », parfois de manière incongrue ou trop légère, sans pertinence ainsi ces formules à l’emporte-pièce, ces formules qu’on entend parfois ou d’autres inutiles ainsi « il gare sa voiture toujours au même endroit, sous le lampadaire devant Chez Akfadou, la boucherie halal des Kabyles, juste en face de la rôtissoire à gaz (capacité trente-quatre poulets). »
Yamina a de bonnes relations avec sa voisine, « elle lui tient la porte, lui envoie une assiette de msemen ou de crêpes mille trous », mais elle est gênée quand son chien la renifle. La voisine croit qu’elle en a peur, « Il va pas vous mordre ». Yamina comprend que d’autres gens aiment les chiens « c’est leur façon de vivre ». Pourtant, des chiens elle en a vu dans la mechta de son enfance. Ils étaient libres d’aller et venir dans la ferme. Elle pense que « l’appartement ce n’est pas un destin acceptable pour un chien. » Yamina évite le chien, non parce qu’elle en a peur, mais c’est que pour prier il faut être pur, c’est-à-dire avoir fait ses ablutions. Or, tout contact avec un chien invalide cette pureté et Yamina sera obligée de refaire ses ablutions. C’est donc mieux d’éviter. Elle pourrait expliquer tout cela à sa voisine, mais « quelque chose empêche Yamina d’avoir ce dialogue. Aujourd’hui on ne peut pas dire qui on est. » L’atmosphère a changé depuis les années Zidane et les années 80, la décennie de la Grande marche citoyenne de Marseille à Paris « Pour l’égalité et contre le racisme ». Mais peut-être que Yamina « a tendance à embellir ses souvenirs ». Yamina dit vrai. L’atmosphère s’est alourdie. Elle n’aime pas écouter « les polémistes islamophobes à qui on donne la parole pour beugler leur haine, la bave aux lèvres, ces faces de chien, Woujah el kelb » Les Woujah el kelb comme le Zemmour prolifèrent à la radio, à la télé et même dans les quartiers. Hannah, elle, n’a pas la patience de sa mère. Elle, elle dit à la voisine « tenez votre chien là s’il vous plaît ». Mais lorsque sa mère lui demande d’user de patience « c’est comme ça benti, ma fille, on doit accepter, on est comme leurs invités, on est chez eux » Hannah ne supporte pas. « On n’est pas des invités ! t’as reçu un carton d’invitation toi ? Ça suffit, ça fait 35 ans que j’entends ça ! Nous on est chez nous ! on est nés ici ! » Et gare donc à qui ose lui barrer le chemin. Elle n’a pas froid aux yeux et elle a raison.
La famille possède depuis plus de dix ans un jardin ouvrier près de la nationale, du cirque Zingaro et du cimetière, à deux, trois kilomètres de l’appartement. Il est entouré d’autres jardins et des villes de Drancy, La Courneuve, Pantin et Bobigny. Dans ce jardin ouvrier il y a un figuier qui fait penser à Yamina à celui de son enfance à Msirda et qui a péri. « Désormais, l’arbre de Yamina, sa baraka, n’est plus en Algérie, il est ici, à Aubervilliers, bien enraciné. » La famille a pour voisin un vieil espagnol avec lequel Brahim échange fièrement en portugais, mais Brahim fait erreur.
Lorsqu’elle jardine, Yamina est comme transportée dans son enfance, « elle oublie tout et ne s’arrête que pour prier dans la cabane du jardin… Avant, elle priait même sur l’herbe fraîche, mais aujourd’hui elle ne se sent plus en sécurité. Elle se cache. »
Omar est chauffeur Uber depuis deux ans. Il porte un costume de grande marque en guise de tenue de travail. Sa nuit de travail touche à sa fin, l’aube pointe. Il dépose des clients devant le luxueux hôtel Lutétia. Omar peut se donner les moyens pour prendre un verre dans le bar de l’hôtel, mais « il y a dans sa tête une frontière nébuleuse qui lui raconte qu’il ne peut pas y entrer… Il y a des choses qui ne sont pas faites pour nous » mais pour les dominants « qui font à peine l’effort de nous exclure. Nous le faisons très bien nous-mêmes. » Il prend les derniers clients, deux touristes américaines qu’il dépose sur la place de la Bastille, avant de rentrer se coucher, mais avant « avec un peu de chance, il arrivera à temps pour prier el fajr à la mosquée d’Aulnay-sous-Bois. » Yamina est fière de son fils. Elle trouve qu’il s’en sort mieux que nombre de jeunes comme « ceux qui mendient avec leurs chiens, ceux qui ont fait de la prison ».
Une autre fois, Omar prend une cliente à la gare Montparnasse pour la déposer à Romainville. « Ils ont parlé de tout et ‘d’autre chose’. Il aurait voulu que la course dure jusqu’à l’aube. » Que devient-elle à la fin du roman, cette cliente ? est-ce la meuf qu’évoquera Hannah dans la grande maison de Pillac ?
« Omar pense aux vacances qu’il a passées à Marseille l’année dernière, avec sa serviette de plage FC Barcelone, achetée au bled en 2012, à Tlemcen. » Je n’ai réellement pas saisi le sens, y en a-t-il un, de cette phrase, même si Faïza Guène précise « Il se souvient que le vendeur aussi s’appelait Omar » Très bien, mais quand même « passer ses vacances avec une serviette », quand-même…
La cliente qu’il a prise à la gare Montparnasse s’appelle Nadia. « Ses yeux sont si noirs qu’on distingue à peine le contour de ses pupilles… elle est plutôt bavarde. Omar souhaite la revoir. « Elle lui donne son pseudo Facebook » Omar n’est pas sûr de lui. Il pense qu’elle a accepté par politesse. « Il a des fourmillements dans sa poitrine, chaque fois qu’elle rit. »
Il pense qu’« elle plairait bien à maman ». N’est-ce pas là un cliché du garçon maghrébin accroché aux jupons de sa maman ? Omar est timide, « il peine à trouver sa place dans le monde. C’est un garçon arabe qui ne se conforme pas à ce que le monde attend de lui, c’est-à-dire devenir dominant, brutal, conquérant, viril et, si possible, fourbe, voire dangereux. » À Port Say, il y a quelques années, son cousin lui a appris qu’il fallait draguer les filles mal fagotées » pour avoir plus de chance de conquête. Il a échoué. Suivent trois pages sur la virilité telle que développée dans les westerns américains.
En 2018, Omar « va bientôt passer les 30 piges » indique l’autrice (page 36). Un an plus tard, en 2019, « Omar a 29 piges » (page 159). Petit problème donc. La chambre de Omar ressemble à celle d’un étudiant. Lorsqu’il était en CDD à l’Assurance-Maladie Omar a acheté un très grand téléviseur « qui mange littéralement la pièce » qui supporte aussi d’autres meubles, « une armoire, une table basse, une banquette, un bureau », et surtout une Play-Station 4. Il passe des heures à jouer ce que ne comprend pas son père « Jouer ? à 30 ans ? » Brahim pense que son fils fait partie de cette « génération à l’enfance prolongée et aux responsabilités réduites » « Lui, Brahim, à 16 ans il descendait à la mine, la gueule noire, du côté de Roche-la-Molière et Firminy, dans la Loire ». Yamina ne comprend pas pourquoi son mari « s’entête à endurcir Omar ». Elle s’interroge, « les chauffeurs Uber d’aujourd’hui, comme leur fils, ne sont-ils pas les mineurs d’hier ? » Yamina souhaite que Omar se marie et « qu’il ne suive pas le chemin de ses sœurs demeurées célibataires. L’aînée est divorcée. Omar y songe peut-être.
Tout en nettoyant sa belle voiture de travail à la station de lavage, « Omar pense à inviter Nadia, la cliente qu’il a ramenée de Montparnasse à Romainville. Elle lui a plu. Pour échanger avec elle il a créé un compte Facebook et envoyé quelques messages.
Sa sœur Imane, 31 ans, est la troisième enfant. Elle habite seule dans un studio. Lorsqu’elle a annoncé à ses parents qu’elle projetait d’habiter seule, ils ont eu peur du « qu’en dira-t-on » des gens. Imane fuit le regard de son père qui est déçu par elle. Aucune des filles Taleb n’est mariée. « Malika, l’aînée, avait été mariée quelque temps », aujourd’hui elle est divorcée. Brahim avait dansé au mariage de sa fille (en août 1999, elle avait 18 ans). Mais celui-ci ne tint qu’un temps et comme les parents des mariés se connaissaient bien, le divorce ou « ‘l’arrangement’, s’était déroulé à merveille. » À cette époque, Brahim rodait avec le père Ammouri (mort d’un cancer de la gorge). L’auteure use d’une image qui s’apparenterait à un stéréotype pour décrire l’ami et voisin de Brahim « Avec son long corps de Berbère qui avait des airs de Jacques Brel trempé dans de l’huile d’olive. » Pas vraiment pertinent. « Les aînés de la fratrie, comme Malika, acceptaient les règles désuètes » des parents, car à leurs yeux ils faisaient de leur mieux. Il y a lieu ici de parler plutôt des fratries en général car, s’agissant de la famille Taleb, même Malika, née en 1980, est jeune pour avoir à « accepter » ces règles anciennes. Pourtant « décevoir les parents c’est pire que tout. » Comme on vivait « ici » il fallait bien trouver des règles. « C’est ainsi qu’ils avaient inventé instinctivement des lois hybrides ». Mais les parents, « avaient peur de tout perdre. Ils tenaient à rester qui ils sont. Ils ont refusé d’être effacés »
De nombreux passages, comme en page 60 et 61, sont marqués par une graphie particulière avec des phrases courtes de trois à neuf mots et retour à la ligne.
« Malgré eux, les parents, par les sacrifices énormes qu’ils leur ont consentis, ont fait de leurs enfants des gamins écrasés, accablés et les enfants accablés font comme leurs parents, ils marchent la tête baissée. » Pas toujours, on le constate bien avec Imène et Hannah. Celle-ci a 34 ans et elle se sent épuisée. C’est une adulte indignée. Elle semble regretter « la bonne époque, celle d’avant le 11 septembre 2001, d’avant Charlie. Au moment où les Arabes avaient été à la mode, grâce à Zidane, à Djamel Debbouze et à Rachid Arhab. C’était cool d’être rebeu à cette période ». Mais des malheurs étaient passé par là, et Charlie avait brisé le cœur du coeur de millions de Français musulmans « au nom de la liberté ».
Hannah a rendez-vous avec un homme « pas très beau, il a de l’embonpoint, des poils sur les doigts » et porte « un jean qui épouse ses hanches. Si Hannah remarque les hanches d’un homme, automatiquement il devient une sœur. » Généralement les garçons arabes s’intéressent plus « à la femme blanche, aux cheveux raides. » Hannah méprise les gens qui souffrent de la haine de soi. Elle déteste par-dessus tout, les gens qui se détestent. Une fois elle est tombée amoureuse d’un type, Samy, « qui s’est mis à vouloir la contrôler. Il n’avait pas assez d’amour pour en donner convenablement. Elle l’a quitté à contre-cœur. »
Maintenant Hannah est avec Hakim. Il parle beaucoup et elle, « son esprit s’évade. » Il n’a aucune originalité Hakim. Hannah se lasse des choses, des gens et, dans la vie, s’ennuyer constamment n’est pas de tout repos. » Elle décroche lorsqu’il lui détaille son voyage en Thaïlande « son plus beau voyage qu’il a jamais réalisé ». Hakim voulait pratiquer la boxe thaïe, mais il a été découragé par un ami. « Frère, Wallah, t’as pas la condition physique pour ça. Le prends pas mal mais t’es sacrément dodu, t’as des seins mon frérot. » Ce type d’humour très drôle n’est pas rare dans le roman. Entre massage et boxe thaïe, les vacances à vingt ans en Thaïlande peut être un excellent rite initiatique. Ce pays avait fait de Hakim et de ses semblables, des hommes. Hakim voulait retourner une 4° fois au Salon de massage, mais le même ami avait essayé de l’en empêcher, « Eh Wallah frère c’est chaud. Elle t’a fait une marabouterie asiatique ou quoi ? Fais belek, j’crois qu’tu tombes amoureux frère. »
La petite sœur, Imane, se trouve dans un Lavomatic au nom de « Lav’ Story », tenu par un Chinois qui force les sourcils en permanence. Imane aime le lavomatic « ça lui permet de rêvasser tranquille dans une atmosphère de linge humide ». Puis-je écrire qu’il s’agit là par contre d’un humour, disons bon enfant ? Le nom de la laverie renvoie Imane à un célèbre film américain, un film qu’elle a vu en cassette avec sa grande sœur Malika « une bonne centaine de fois. »
Cette année encore Imane, à Noël, intègrera l’équipe de vente de ‘Maxi Toz’. Le travail la fatigue « elle en a assez de la hiérarchie et de la pression qu’elle lui inflige. » Elle ne peut arrêter, il lui faut payer le loyer de son 20 m2, et il est cher. Ses parents lui feraient un scandale s’ils l’apprenaient « quoi ? 850 € ? ça fait 8 millions et demi » en Algérie, de quoi louer 7 appartements à Aïn Témouchent ! » Et Faïza Guène n’est pas vraiment généreuse ! Aujourd’hui on offrirait le double aux parents, 17 millions de centimes.
L’autrice imagine une suite de propos entre Imane et son père « cette histoire aurait possiblement mal fini. Imane aurait quitté l’appartement en claquant la porte. » Elle serait allée faire un tour « et se serait sentie incomprise dans cette famille « de toute façon y en a que pour les grandes et pour Omar ».
Une fois par semaine, en cette année 2020, Hannah se rend chez une psychologue. « Elle en a honte. Elle fait croire à sa famille qu’elle s’est inscrite à un cours de zumba ». Cela n’a pas été facile car il lui a fallu « déconstruire les fiertés mal placées qu’elle portait en elle, ‘‘je suis algérienne ! je n’ai pas besoin d’aide !’’ » en levant le poing si nécessaire ou en agitant un drapeau algérien. Y a-t-il un seul Algérien qui ne reconnaîtrait pas chez tel ou tel de ses proches ce nif tellement « mal placé ? » et au nationalisme démesuré ? L’esprit de Hannah est taraudé par la question de la LÉGITIMITÉ (en lettres majuscules).
Depuis dix ans, elle est éducatrice spécialisée auprès de jeunes en réinsertion professionnelle. « Elle côtoie les psy dans le cadre de son travail », mais ce n’est pas la même chose. Un jour de septembre elle s’est adressée à une psychologue dans le 11° arrondissement de Paris, madame Aït-Ahmad – le troisième « a » n’est pas un « e », aurais-je commenté. Hannah a honte, mais « elle doit franchir la frontière pour ses enfants à peine en projets, même pas nés, encore flous. Les impacts de la vie sont dans la chair de Hannah. » Si un jour elle a des enfants « elle ne veut pas qu’ils héritent de cette colère qui dévore ses tripes et qu’ils soient fiers de qui ils seront. » Elle leur racontera sa propre histoire, celle de ses parents, celle de Djamila Bouhired, l’Histoire, sans ambages.
Malika se doit en sa qualité d’officier d’état civil d’incarner l’impartialité et la neutralité de l’État. Mais elle peine. Comment rester neutre devant un chibani « qui se noie dans son charabia sans lui tendre une main compatissante. » Ce que ne comprend pas du tout, et ne peut peut-être pas comprendre, l’employée de la préfecture de Bobigny qui s’en était prise à Yamina. Quand Hannah s’adresse au vieux monsieur dans son propre dialecte, ses yeux fatigués s’illuminent. Même sa hiérarchie ne la comprend pas et « lui a remonté les bretelles », ni même sa propre mère qui lui demande de « rester discrète. » Dans les moments d’accalmie, Malika fait des micro-siestes ou surfe sur l’Internet. Elle recherche et trouve le village de « Sidi Ben Adda ex Les trois marabouts », près de Aïn Témouchent où ont vécu ses aïeux. Elle trouve un site qui relate la période coloniale, mais rien des anciens de sa famille « leurs vies se sont discrètement éparpillées dans la poussière ». Ils sont absents du site. Malika n’a reçu qu’une « histoire fragmentée, un puzzle ». Il reste à ses propres enfants d’en assembler les fragments, de le reconstituer.
Omar n’est pas à l’aise. Il sue. Il s’est habillé comme « lors du mariage de son copain »
Il se trouve au bar du Lutétia. En attendant Nadia, la cliente de Romainville il commande un cocktail « alcohol free ». Suit cet échange sensé nous faire rire. Omar se remémore d’une discussion qu’il a eue avec une fille lors d’une fête. « – tu fais quoi dans la vie – je suis Uber – c’est marrant t’as pas une tête à t’appeler Hubert. » Bon.
Nadia arrive, « sa façon de traverser le bar, de slalomer entre les tables… c’est sûr, Omar est amoureux de cette fille. » Elle préfère aller ailleurs, ce bar ne lui plaît pas « on va pas payer 24 balles pour six accras de morue. » Ils se rendent chez un traiteur libanais « beaucoup plus accessible. »
Imane se rend à l’hôpital Salpétrière, « il paraît qu’ils ont de bons stomatos ». À 31 ans, Imane a besoin de sa maman à ses côtés, « c’est une douillette ». Elle a des difficultés à avoir une demi-journée « à croire que sa responsable a un problème personnel avec elle ». « Sa responsable est toujours à la surveiller, à chronométrer ses temps de pause. » Là encore cet humour est un peu lourd. Imane pense que si elle se trouve ici en stomatologie c’est à cause de sa responsable, « elle a une dent contre moi ».
Hannah raconte à la psy ses cauchemars. Tout le texte est en en italiques. Hannah se voit avec ses copines de lycée dans un restaurant chinois. Elles mangent, rigolent… lorsque tout à coup arrivent des cars de CRS. Le patron, Sofiane, est terrorisé. Du dessous de la caisse, « il sort vite une tondeuse, il la branche et se met à tondre sa barbe. » Les CRS, cagoulés, tirent en l’air, mais l’un d’eux, un vieux militaire d’extrême droite, haineux avec un bandeau de pirate sur l’œil, « tire sur les jeunes en riant ». Arrive un autre de ses acolytes, de la même veine, qui écrase la tête de Yamina. Hannah hurle. « Il me tire dessus dans le front. Boum. » C’est ce qu’elle raconte à la psychologue, madame Aït Ahmad. Elle lui raconte d’autres cauchemars, des corps d’Algériens dont celui de son père qui flottent sur la Seine. Hannah ne sait quoi faire de « toutes ces histoires qui la hantent ». La psy trouve les mots qui réconfortent. « C’est normal, cette violence fait partie de votre histoire, et les humiliations vécues avant vous, vous en héritez… mais vous ne pouvez réparer seule, l’offense. » Ces mots lui font du bien car Hannah « a toujours le sentiment de devoir réparer l’offense subie par les parents » qui seront, certainement, « enterrés sans avoir la reconnaissance méritée. » Son père en se rappelant son arrivée en région parisienne en 1961, pensait « à Nasser, celui d’entre eux qui n’est jamais revenu » jeté dans la Seine en octobre 1961. Il a dû raconter ce vécu à Hannah.
Ce père qui offre des fleurs à Yamina chaque année à la Saint- Valentin. De tout temps il « glisse un billet de 20 € dans les pages du Coran de Yamina. Elle a fini par l’aimer, lui et ses manières gauches. » Brahim a arrêté de jouer au tiercé et de fumer, mais il a gardé des petits plaisirs, comme « mettre du parfum, se rendre au café Casanova, écouter Dahmane el Harrachi, regarder des westerns à la télévision. »
Thomas, le petit ami de Imane, sanglote dans cette impasse du 18°. Elle l’avait prévenu qu’il ne fallait pas compter sur elle pour qu’elle s’engage. Imane ne supporte pas de le voir dans cet état. « Elle est au degré zéro de l’empathie… Même si elle déteste leurs pensées archaïques, leur autorité, leurs manières trop viriles, Imane préfère chez les garçons arabes le trop de virilité que le pas assez. » « Thomas était gentil avec Imane, mais malheureusement, l’électrocardiogramme est resté plat. Tout s’est évaporé lorsqu’elle l’a vu se dégonfler et baisser les yeux lorsqu’un mec leur a cherché bagarre dans un bar. Tout à coup il l’a dégoûtée, littéralement. » Thomas gagne bien sa vie, il est propriétaire de son appartement, mais il est trop près de ses sous. « Toujours à tout compter, à mettre sa part, à donner l’appoint, toujours avec ses ‘‘on fait moit’-moit’ »
Imane est indépendante. « Elle soutient la liberté d’expression, mais elle n’est pas Charlie pour autant. Elle est musulmane et féministe. Elle est française et algérienne. Quand la viande n’est pas halal, Imane est végane (c’est-à-dire ne consomme pas de produit d’origine animale. Ne porte pas de laine, de fourrure ou du cuir). En un mot ou en treize, elle vit dans un monde qui n’est pas prêt à accueilli sa complexité. »
Le roman s’achève en Charente, dans une grande maison. C’est la première fois que la famille prend de vraies vacances. Les grands-parents sont morts. Les enfants se sont cotisés pour louer « une maison de 170m2 à Pillac, au nord de Bordeaux, avec piscine, ping-pong et balançoire. » Tout autour, des champs à perte de vue, Yamina ne se lasse pas de les regarder. Hannah apprend involontairement à ses sœurs que Omar « a une meuf ». Peut-être est-ce Nadia, sa cliente de Romainville ? La famille est heureuse, elle profite du lieu, Brahim somnole à l’étage.
« Yamina a six ans, elle rit aux éclats, elle se sent libre ». Malika, Hannah, Imène et Omar sont bouleversés. Ils sont heureux de « découvrir un nouveau visage du pays où ils sont nés, et plus heureux encore de le faire découvrir à leurs parents. » Ils sont émus de se dire qu’ils font partie de l’histoire de France, d’une manière ou d’une autre, ‘‘qu’ils le veuillent ou non’’. »
Voilà une famille qui remplit au quotidien sa mission, sans colère, dans la lignée des anciens et dans un environnement pas toujours bienveillant. Et lorsqu’ils manifesteront, ils ne descendront plus dans la rue « dans un cortège à part » qu’on le veuille ou non.
La Discrétion est un beau roman, malgré quelques imperfections, quelques lourdeurs. Il soulève plutôt avec subtilité nombre de questionnements liés au mal-être, à l’identité, à l’intégration, à l’altérité, au racisme banal, au travers l’évolution d’une famille algéro-française vivant en France. Un roman agréable à lire.
Ahmed Hanifi,
mercredi 27 octobre 2020
____________________________________________________________________________
FAIZA GUENE in WIKIPEDIA:
Wikipedia
Faïza Guène, née le 7 juin 1985 à Bobigny en France, est une romancière et scénariste française. Son premier roman Kiffe Kiffe Demain, publié à l’âge de 19 ans, rencontre un succès mondial. Vendu à plus de 400 000 exemplaires en France et à l’étranger, il est traduit dans vingt-six langues. L’écrivaine publie par la suite cinq romans, des comédies sociales, qui explorent l’identité, notamment des Français issus de l’immigration maghrébine.
Origine et trajectoire
Faïza Guène naît en 1985 à Bobigny de parents algériens et grandit avec son frère et sa sœur à Pantin1. Son père, Abdelhamid Guène (1934-2013), arrivé en France en 1952, sera mineur dans la région de Saint-Etienne puis maçon en région parisienne. Sa mère, Khadra, émigrera en France en 19812. Pour Faïza Guène, les récits d’immigration de ses parents sont « complètement différents ». Son père arrive en France alors que l’Algérie est encore française, et sa mère rejoint ce dernier plusieurs années après l’indépendance. Elle vit une « enfance heureuse » bien qu’elle réside dans un logement insalubre, qui contraint sa famille à se laver dans les bains publics de la municipalité3.
Enfant précoce, elle saute la classe du CP pour intégrer directement le CE1 ayant appris les lettres de l’alphabet et la lecture en regardant l’émission télévisée La Roue de la fortune2. Elle sera également initiée à la lecture et à l’écriture par un oncle venu d’Algérie4 et se met à griffonner des petites histoires qu’elle troque contre des bonbons, promettant à chacune de ses copines qu’elle en sera la princesse5.
Ses parents déménagent aux Courtillères, un quartier populaire de Pantin, en Seine-Saint-Denis, alors qu’elle a 8 ans.
Après son baccalauréat, elle s’engage dans des études de sociologie à l’Université Paris VIII qu’elle abandonne par la suite6.
Écriture
À 13 ans, Faïza Guène écrit dans la gazette de son collège. Son professeur de français, Boris Seguin, décèle en elle « une bosseuse qui a du talent »2. Elle se passionne pour les sessions de lecture qu’organise ce professeur. Notamment lorsque ce dernier lisait à haute voix le polar La Vie de ma mère ! de Thierry Jonquet3.
Il lui propose d’intégrer un atelier d’écriture dirigé par l’association Les Engraineurs. Fondée par le producteur et réalisateur Julien Sicard et lui-même7, cette association créée en 1998 a pour objet de « faire émerger une parole artistique » de Pantin8notamment à travers l’écriture de scénarios.
Jusqu’à l’âge de 17 ans, elle écrit et réalise cinq courts-métrages. À 18 ans, elle obtient une subvention du CNC pour réaliser Rien que des mots dans lequel elle fait jouer sa mère.
Faïza Guène décrit son entrée dans l’univers de la littérature comme un « accident ». Pour elle, ce n’est pas le fruit d’un système qui « marche »9. Cet accident est sa rencontre avec Boris Seguin. Au début des années 1990, et à la surprise du rectorat, Boris Seguin demande à être muté en Seine-Saint-Denis, où il se présente comme un « fantassin de la fracture sociale » avec l’ambition d’être « le prof que je n’avais pas eu. Devenir ce qui m’avait manqué »10.
Qualifié en 1996 de « hussard noir de la République » par le quotidien Libération10, il porte une attention particulière au langage de ses élèves. Il est d’ailleurs coauteur de l’ouvrage Les Céfrans parlent aux Français (1996), dans lequel il élabore avec ses élèves du Collègue Jean Jaurès de Pantin un lexique de leur vocabulaire. L’ouvrage, qualifié par Le Monde de « formidable »11, est avant tout une véritable « entreprise sociale » pour Seguin car « décortiquer ce langage populaire, c’est le reconnaître comme langue digne d’intérêt »12.
C’est à travers Les Engraineurs que Faïza Guène prend goût à l’écriture. « Dès le premier cours, j’ai adoré. Je venais tout le temps. Je peux dire aujourd’hui que je dois une partie de mon parcours à ce prof [Boris Seguin] »13. Elle écrit « des tas de petites histoires sur des cahiers de brouillon […] pas pour en faire un livre, c’était plutôt un loisir ». C’est en lisant les quelques pages de ce qui deviendra Kiffe kiffe demain que Boris Seguin décide de les envoyer à sa sœur, Isabelle Seguin, éditrice chez Hachette Littératures. Cette dernière propose immédiatement un contrat d’édition à Guène, pour en publier 1 500 exemplaires.
En septembre 2004, à la sortie de Kiffe kiffe demain, Le Nouvel Observateur lui consacre une double page et encense le livre. La tornade médiatique commence et ce premier roman se vend à plus de 400 000 exemplaires et est traduit dans vingt-six langues.
En 2007, l’attachée de presse de Hachette Littératures reconnaissait que si Boris Seguin n’avait pas présenté les écrits de Faïza Guène à sa sœur « nous serions sans doute passés à côté du personnage, bloqués dans nos préjugés sur les jeunes des quartiers »14.
L’écrivaine publiée par Hachette Littératures, puis Fayard depuis ses débuts a rejoint Plon15 en 2020 pour la publication de son sixième roman La discrétion.
Créations littéraires
Les romans de Faïza Guène sont principalement des comédies sociales. Ses écrits sont construits sur des séries de personnages lucides sur leur position au sein de la société française. Ils racontent le vécu des classes populaires issues de l’immigration maghrébine. Faïza Guène utilise une langue revigorée et souvent argotique, « une langue vivante et drôle »16. Ce style particulier, assez courant dans de nombreux autres pays comme en témoignent les livres du romancier Irvine Welsh, est plutôt rare et déconsidéré dans la littérature française17.
Son premier roman Kiffe kiffe demain (2004) est le monologue de Doria, une adolescente de 15 ans vivant à Livry-Gargan, un témoignage sur lequel s’appuie l’écrivaine pour traiter de l’identité18. Pour le linguiste Marc Sourdot, la langue utilisée dans ce roman est celle du « je » et du « jeu », et les textes sont portés par des personnages qui distillent un regard frais, drôle et sans misérabilisme sur leur vie19.
Dans Du rêve pour les oufs (2006), l’héroïne, Ahlème, est une jeune adulte de 24 ans vivant à Ivry-sur-Seine. Sa mère est tuée en Algérie lors de la décennie noire et, entre son père accidenté du travail qui perd la tête et son frère attiré par la délinquance, elle doit faire face à l’effondrement de sa structure familiale.
Les Gens du Balto (2008) décrit une autre facette des habitants de banlieue. Dans ce polar, l’écrivaine met en scène des personnages dans une ville de banlieue pavillonnaire en fin de ligne RER appelée Joigny-les-Deux-Bouts. Le meurtre du patron du Balto, un bar miteux, est le prétexte à un roman chorale où témoignent différents personnages potentiellement coupables, face à un lieutenant de police. Les personnages sont issus de trois familles : « la franco-arménienne qui bat de l’aile, l’algérienne travaillée par des bifurcations générationnelles ou la française laminée par l’ennui et la « beaufitude » »20.
Dans le drame familial Un homme, ça ne pleure pas (2014), l’écrivaine raconte l’histoire d’une famille issue de l’immigration algérienne, installée dans une maison avec jardin dans la ville de Nice. Les parents rêvent de voir leurs trois enfants grandir dans le respect des traditions familiales, infusées dans la culture algérienne et la religion musulmane. Les enfants ont une double culture et sont tiraillés sur leurs identités. Deux visions radicales s’opposent, celle de Dounia, l’ainée, qui croit en l’égalitarisme républicain, et celle de Mina, qui reste loyale à la culture de ses parents. Entre les deux, le frère cadet et narrateur, Mourad, ne veut pas choisir21.
Millénium Blues (2018), un roman nostalgique sur les milliéniaux, retrace une histoire d’amitié entre deux femmes, Carmen et Zouzou, que l’on voit grandir à travers les événements marquants du tournant du millénaire, avec ses joies et ses traumatismes. Qu’ils soient individuels ou collectifs (coupe du monde 1998, le 11 septembre 2001, les élections de 2002, la canicule, la grippe A, etc. 22. La Libre Belgique note que « Toutes proportions gardées, la plume de Faïza Guène fait penser à celle d’Yves Simon qui, dans nombre de ses romans, captait si bien l’époque et ses tumultes »23.
Dans La discrétion (2020), Faïza Guène raconte l’histoire de Yamina, une algérienne qui a connu un double exil, l’un à Ahfir au Maroc pendant la guerre d’Algérie, l’autre en France, à Aubervilliers. À l’aube de ses 70 ans, elle refuse de se laisser envahir par le ressentiment, « elle ne parle pas de son passé, de ses relations conflictuelles avec la France, de la douleur de son exil »24. Ses quatre enfants « ne comprennent pas cette discrétion, héritent d’un sentiment d’humiliation. Et rien ne peut empêcher la colère, à un moment ou à un autre, de sourdre… »25.
Thèmes
Classe et culture populaire
Pour Faïza Guène « être pauvre et avoir des origines étrangères est une double malédiction »17. Elle précise que ce qui est important dans ses écrits est sa classe sociale : « ce sont mes origines modestes, banlieusardes, prolo, populaires, cela me donne tellement de matière, ce que l’on a appelé « la France d’en bas ». C’est là que je me situe »26. L’écrivaine raconte « des histoires de gens ordinaires, des antihéros aux revenus modestes »17.
La banlieue parisienne est le cadre des trois premiers romans de Faïza Guène. Dans un article intitulé Paris et ses banlieues dans les romans de Faïza Guène et Rachid Djaïdani27, l’universitaire Mirna Sindičić Sabljo explique que les romans de ces deux auteurs permettent de saisir la complexité des espaces périphériques. Elle note une diversité du type de banlieues, celle des barres HLM dans Kiffe kiffe demain et celle de la banlieue pavillonnaire dans Les gens du Balto. Pour Mirna Sindičić Sabljo, ces espaces sont à l’opposé des stéréotypes diffusés par les médias français. Dans les romans de Guène, elle note que ces espaces sont des « communautés fraternelles », « lieux d’une interaction sociale forte ». Les romans de Faïza Guène et de Rachid Djaïdani « contestent l’image mythifiée de Paris » et « démontrent l’hétérogénéité des banlieues » ainsi que leur relation avec la capitale.
Cette analyse sur la représentation de la banlieue dans le premier roman de Guène, loin des clichés, est également partagée par l’universitaire Mirka Ahonen28. Aussi, les femmes du roman ne sont pas victimes d’un ordre patriarcal, elles parviennent à améliorer leur condition matérielle et sont solidaires.
Lors d’une conférence donnée en 200929, à l’occasion de la sortie de la traduction anglaise de Du rêve pour les oufs (Dreams from the Endz), Faïza Guène déplore la déshumanisation de la banlieue. Elle fait remarquer que les noms donnés aux Grands ensemblessont souvent ceux d’insectes ou ceux évoquant la multitude. Elle donne comme exemple le quartier des Courtilières (une espèce d’insectes orthoptères) à Pantin où elle a grandi mais aussi « La Ruche » de Bobigny, la « Cité des 3000 » à Aulnay-sous-Bois ou encore la « Cité des 4000 » à La Courneuve. Elle explique avoir choisi pour cadre de son deuxième roman dont le sujet est la précarité, la « Cité de l’Insurrection » d’Ivry-sur-Seine. Pour l’universitaire Mirelle Le Breton, Faïza Guène « ré-humanise » la banlieue contre les représentations stéréotypées30. Elle change d’échelle, passant des « Grands ensembles » à une communauté qui s’apparente à un petit village où les individus vivent dans la fraternité.
À 15 ans déjà, Faïza Guène avait exploré dans son court-métrage RTT la précarité sociale et affective qui survient dans les classes populaires dès lors que la cellule familiale éclate. Ce thème est récurrent dans l’ensemble de ses romans.
Dans Kiffe Kiffe demain, Du rêve pour les oufs et Millénium Blues elle explore les conséquences de la précarité de la cellule familiale monoparentale. Dans Un homme, ça ne pleure pas, la cellule familiale est ébranlée par le départ de la sœur ainée, qui coupe toute relation avec son milieu social et culturel d’origine.
Le concept du mektoub (qui signifie le « destin » en arabe) revient en filigrane dans les textes de Faïza Guène. Dès son premier roman, la narratrice, Doria, est abandonnée par son père. Seule avec sa mère, son destin parait tout tracé. Pour Doria, le mektoubest le « scénario » d’un film qu’elle n’a pas écrit et dont elle est simple actrice. « Le problème, c’est que notre scénariste à nous, il a aucun talent. Il sait pas raconter de belles histoires ».
Dans un premier temps, le mektoub rend Doria impuissante face à l’avenir. Pour elle, demain sera kif-kif (« pareil ») qu’aujourd’hui. Cependant, le fatalisme initial laisse la place à de l’optimisme dès lors qu’elle croit en sa capacité à agir sur sa vie. Elle peut espérer et kiffe kiffe (« aimer ») demain18.
Chez l’écrivaine, le mektoub est une notion polysémique, il est tantôt un fatalisme qui vient s’opposer à la liberté individuelle, tantôt un déterminisme social, qui fige la trajectoire de ses personnages issus des classes populaires en bas de l’échelle sociale. La liberté et le droit au rêve sont revendiqués dans Kiffe kiffe demain mais aussi dans Du rêve pour les oufs par la voix de son héroïne Ahlème (dont le prénom signifie « rêve » en arabe).
Dans Kiffe kiffe demain la culture populaire est très présente avec des références au cinéma et aux émissions télévisées31. D’ailleurs, l’héroïne du roman décrit la télévision comme « le Coran du pauvre ». En 2007, Faïza Guène déclare que son roman n’est pas autobiographique mais qu’elle rejoint son « personnage sur sa culture tv en béton armé »32.
La télévision a plusieurs fonctions pour ses personnages, elle permet de rêver et d’avoir des modèles. Les séries télévisées permettent aussi de dégager des figures de la masculinité qu’admire les narratrices de ses romans, à l’image de Charles Ingalls (La Petite Maison dans la Prairie) dans Millénium Blues ou MacGyver dans Kiffe kiffe demain.
Dans Du rêve pour les oufs, ce sont les programmes de la télévision qui rythment la vie du « patron », le père de l’héroïne, cloué à la maison depuis son accident du travail au chantier. Chaque émission lui rappelle, lui qui a perdu la tête, la notion du temps (Télématin devient l’heure du café, l’Inspecteur Derrick, l’heure de faire la sieste, etc.).
La musique et les références aux chanteurs sont nombreux, de Idir, Barry White et Rihanna en passant par ABBA, dont la discographie sert de bande-son à la vie de la narratrice dans Millénium Blues.
Intégration et Assimilation
Le thème de l’intégration et de l’assimilation est développé dans Un homme, ça ne pleure pas où le personnage de Dounia, un avatar de Rachida Dati33, veut forcer le destin. Mourad, son frère cadet, décrit une sœur qui aurait aimé s’appeler Christine, et qui opère un processus de « christinisation » pour répondre au modèle français de l’assimilation. Dounia est à ses yeux ce que la République sait faire de mieux : « une réussite accidentelle ». En effet, elle a beau être transfuge, une femme politique, présidente d’une association féministe « fières et pas connes » (clin d’œil à Ni putes ni soumises), renier sa famille ainsi que sa culture arabo-musulmane au passage, elle est tout de même immédiatement renvoyée à ses origines par la presse qui la décrit comme « d’origine algérienne ».
Faïza Guène explore la question du destin des français issus de l’immigration, la manière dont ils composent avec leurs identités multiples pour être acceptés comme des enfants de la République. Son personnage de Dounia est affectée par ce qu’elle décrit comme le « Syndrome de Babar » : Babar est un petit éléphant dont la mère est tuée par un chasseur. Il est recueilli par une femme nommée Christelle qui lui apprend les bonnes manières. Il porte un costume trois-pièces, un nœud papillon, conduit une voiture mais est constamment renvoyé à sa condition d’éléphant34.
Ce thème est aussi présent dans Kiffe kiffe demain. Pour Brinda J. Mehta, Faïza Guène montre « l’hypocrisie » de l’intégration à la française où toute différence est rendue suspecte, et où les descendants d’immigrés sont relégués à une citoyenneté de second rang, par des représentations (notamment médiatiques) stéréotypées35.
Identité et transmission
L’écrivaine explique que chacun de ses romans est une lettre d’amour à son père36. En 2013, ce dernier décède après une longue maladie. C’est à cette période qu’elle a l’idée de son roman Un homme, ça ne pleure pas pour parler de transmission. « Quand j’ai perdu mon père, je me suis dit que lorsque cette génération de chibanis (« vieillards », en arabe maghrébin) sera partie, tout aura disparu avec eux. J’ai eu le sentiment qu’ils n’avaient jamais été reconnus à leur juste valeur, et qu’ils ne nous ont pas tout raconté »37.
La figure du père est omniprésente dans l’ensemble des romans de Faïza Guène38. Il est d’autant plus présent qu’il est absent physiquement (Kiffe kiffe demain) ou mentalement (Du rêve pour les oufs). Cette figure peut être tout aussi omniprésente par son silence (Un homme, ça ne pleure pas).
Pour l’universitaire Nour Seblini, Faïza Guène traite de l’identité des français d’origine maghrébine, tiraillés entre l’injonction à l’assimilation et la préservation de leur héritage39. Dans Millénium Blues, l’héroïne est initiée à cet héritage culturel par son père, immigré algérien. Il lui fait écouter A Vava Inouva d’Idir, une chanson kabyle inspirée de contes transmis oralement40.
Bien que la figure du père soit centrale, la figure de la mère l’est tout autant. D’ailleurs, elle lui consacre son dernier roman, La Discrétion (2020). Elle déclare dans une interview41 donnée à Tecknikart que l’idée du roman lui est venue en écrivant un texte pour l’émission Boomerang d’Augustin Trapenard sur France Inter en janvier 2018. Dans ce texte titré La lourdeur des nuages42, Guène résume la philosophie de cette génération d’immigrés qui ne voulait pas se faire remarquer : « Ici [en France], il faut rester discret ».
La question de l’identité est également abordée dans le recueil de nouvelles publié dans Chronique d’une société annoncée (2007) du collectif Qui fait la France ?. Dans un texte intitulé Je suis qui je suis, un clin d’œil à la chanson de Gloria Gaynor, I am what I am, elle raconte l’histoire d’un tueur mythomane qui s’invente de multiples identités, entre le réel et la fiction. Pour Isabelle Galichon, docteure en littératures, « Guène souligne les affres de la construction identitaire qui oscille entre transparence sociale et fiction : le travail de l’écrivain vise alors à rendre visible ceux qui disparaissent dans la société et à reconstruire ce qui semble disparate et éclaté »43.
Style
Faïza Guène revendique une écriture populaire, qui n’est pas destinée aux élites44. Elle déclare que L’Attrape-cœurs de J. D. Salinger a « beaucoup compté » pour elle comme source d’inspiration mais qu’elle écrit avant tout de manière « intuitive »9. Elle dit avoir écrit avant d’avoir lu, et que les mots lui venaient en écoutant les autres parler45. Son rapport à langue, elle le décrit ainsi : « je remixe la langue française en lui donnant des couleurs différentes de celles dont on la pare à Saint-Germain-des-Prés. Ce n’est pas un langage par défaut, je n’écris pas comme je parle mais je me sers de ce langage car je l’aime »32.
Oralité et traits argotiques
Les romans de Faïza Guène font la part belle à l’oralité et à l’argot. Ses écrits sont imprégnés de la culture des classes populaires. Dans un portrait réalisé en 2008 par Al Jazeera English, elle témoigne avoir grandi dans un foyer où il n’y avait pas d’étagères avec des livres, mais où régnait une culture de l’oralité46.
Lors de la sortie de Kiffe kiffe demain, l’usage de la langue est perçu comme un « hybride » alliant le verlan et le français standard47. Faïza Guène use de phrases courtes pour mettre en avant l’oralité et un rythme vif19.
Focus Vif, note que dans Les gens du Balto, Faïza Guène a « conservé l’oralité » et sa capacité à « reproduire les parlers les plus improbables »48. Dans ce roman chorale, l’oralité est adapté à chaque personnage49.
Pour la professeure Zineb Ali-Benali, le titre Un homme, ça ne pleure pas, « semble mimer l’oralité »50. Pour l’universitaire Silvia Domenica Zollo, le roman apporte de nouveaux éléments linguistiques et stylistiques qui permettent à ses personnages une « déculturation » et une « reconstruction identitaire ». La « mise en scène de l’oralité » permet au narrateur, professeur niçois d’origine maghrébine affecté en Seine-Saint-Denis, de reconstruire une identité culturelle et linguistique au contact de ses élèves et de son cousin venu d’Algérie51.
Usage du verlan
Faïza Guène utilise des mots en verlan, dont l’usage est devenu populaire dans la langue française. Son usage de la langue a souvent interpelé et elle s’en est justifié en ces termes :
« Je crois que certaines cultures admettent bien plus facilement l’évolution du langage et, en règle générale, les apports qu’on peut faire à la littérature aujourd’hui. J’ai trouvé cela moins figé en Scandinavie ou en Angleterre, par exemple. Cela me conforte dans l’idée qu’on construit de nouvelles choses, qu’en choisissant de m’intéresser à ces anti-héros du quotidien, je n’insulte en rien la noblesse de notre littérature qui doit s’ouvrir davantage »26.
Dans un article19 portant sur Kiffe kiffe demain, le professeur de linguistique Marc Sourdot estime que seules les « unités les plus courantes » du verlan sont utilisées, notamment celles référencées dans le Petit Robert. Cette « langue urbaine inventive est souvent subversive »52.
Aussi, l’universitaire et traductrice italienne Ilaria Vitali parle du « verlan et de cyberl@ngage » de Kiffe kiffe demain en indiquant que ce langage est un « sociolecte d’inclusion/exclusion sociale ». En effet, l’héroïne opère ce qu’elle qualifie de « code-switching » pour être comprise. Elle illustre son propos avec une scène du roman dans laquelle l’héroïne est frustrée de ne pas pouvoir utiliser des mots en verlan de peur de ne pas être comprise par sa psychologue53. Brinda J. Mehta souligne quant à elle un usage du verlan comme un marqueur de l’identité d’une jeunesse marginalisée54.
Dans son second roman Du rêve pour les oufs, l’esthétique de son texte interpelle L’Express : « Sa langue créative, mélange de verlan, de phrases châtiées et de proverbes africains de Tantie Mariatou, fait d’elle une porte-parole efficace, mais aussi un auteur à part entière »55.
Usage de l’arabe
Dans l’ouvrage collectif dirigé par Ilaria Vitali, Intrangers (II). Littérature beur, de l’écriture à la traduction (2011), les deux linguistes Alena Podhorná-Polická et Anne-Caroline Fiévet concluent que la reformulation des arabismes utilisés par Faïza Guène participent à la création de « ponts stylistiques » entre la France et le Maghreb. Ilaria Vitali qui a traduit du français à l’italien de nombreux romans « beurs » avance que les écrivains d’origine maghrébine sont à la fois écrivains et traducteurs dans la mesure où ils participent à l’initiation de leurs lecteurs à leur double culture56.
Marc Sourdot souligne l’usage des mots arabes « bled, hchouma, haâlouf, chétane, kiffer ou flouse » dans Kiffe kiffe demain que l’écrivaine utilise dans la bouche de personnages arabophones. Il explique que le roman a connu un succès au-delà d’un public adolescent car l’auteur a su « surprendre sans dérouter ». Il utilise le concept de « l’écriture décentrée » développé par Michel Laronde, qui dans son ouvrage L’écriture décentrée, la lague de l’Autre dans le roman contemporain (1997), énonce que cette écriture « rendrait compte de développements à l’intérieur de l’Hexagone d’une littérature marquée par des différences linguistiques et culturelles ancrées en partie dans l’origine étrangère des écrivains ». Dans les romans de Guène, les effets de styles ne se font pas au détriment de la compréhension, notamment avec l’usage systématique de la reformulation, d’intégration de termes équivalents ou de marqueurs métalinguitiques19.
Humour
Pour écrire sans misérabilisme sur les classes populaires, Faïza Guène utilise l’humour : « Je ne sais pas écrire des choses dures d’une manière dure. J’ai toujours besoin qu’il y ait de l’humour, de la légèreté pour venir adoucir tout ça »57. Pour L’Obs ses « textes débordent de vie, d’humour »58.
Dans Kiffe kiffe demain cela permet à l’écrivaine de décrire une réalité nuancée et loin des clichés sur la banlieue59. L’humour est omniprésent dans Du rêve pour les oufs60 où Faïza Guène « s’avère être une excellente caricaturiste »61. Pour L’Express, sa « langue [est] pleine de vannes et de lucidité […] »62.
Dans Du rêve pour les oufs, « Le discours que prête Guène à sa narratrice n’est ni celui de la défaite ni de l’abandon […] Il règne toujours un souffle d’espoir. Et puis, il y a l’humour qui caractérise le style de la romancière. […] »63.
Le Nouvel Observateur souligne les qualités de ses deux premiers romans (« des saynètes très drôles, une narratrice attachante, un vrai sens de l’observation ») mais déplore une écriture populaire « avec les mots du quotidien »64. Pourtant cette écriture populaire est revendiquée par l’écrivaine dès ses débuts. En 2008, elle avance que ses écrits ne sont pas assez « nobles » pour les « élites parisiennes » pour être considérés comme de la littérature (« I like telling stories about ordinary people, anti-heroes of modest means […] not noble or interesting enough to belong to litterature or fiction »)65.
Pour sa critique portant sur Les gens du Balto, Le Figaro note une « plume drôle et relevée »66. Pour Le Point, le roman est « dôle et tendre »67. La Croix note que « L’écriture « nature » et décomplexée de Faïza Guène se dévore sans effort et avec le sourire aux lèvres »68.
Pour sa critique d’Un homme, ça ne pleure pas, L’Express note « un sens de la formule qui claque » et « un humour tendrement décapant »37.
À la sortie du roman La discrétion, la journaliste de France Info Laurence Houot note qu’elle « restitue avec pudeur et humour une histoire complexe »69.
Réception
Réception française
Pour Faïza Guène, la banlieue est son « environnement » mais n’est pas le sujet de ses romans. Elle rappelle que Kiffe kiffe demain ne parlait pas de banlieue, « il parlait de l’adolescence »9. Elle déplore la confusion qui règne chez certains journalistes entre « le livre et l’auteur »26.
L’universitaire Mame-Fatou Niang explique la réception positive des romans de Faïza Guène dès lors que l’histoire a pour décor la banlieue de barres HLM. Pour elle, les romans de Faïza Guène sont encensés par le milieu élitiste de la littérature parisienne, non pas pour leurs qualités esthétiques, mais pour leurs qualités « ethnographiques » dans la mesure où ils sont reçus comme des documentaires sur la banlieue. C’est à la lumière de ce constat qu’elle explique la relégation de Guène dans les pages « Société » de la presse écrite. Elle en veut pour preuve le roman Les gens du Balto, qui sort des sentiers battues de la banlieue verticale des barres HLM pour camper dans la banlieue horizontale des pavillons. Ce roman fut un échec commercial comparé aux deux premiers mais marque « un réveil douloureux » pour l’écrivaine. Elle prend conscience de « l’affirmation du rôle qu’elle jouait (malgré elle ?) dans le milieu littéraire »70.
En 2018, Faïza Guène reviendra sur le tourbillon médiatique après le sortie de Kiffe kiffe demain, déclarant avoir le sentiment d’avoir été considérée comme « un singe savant » 9. En effet, le succès de son premier roman coïncide avec les émeutes urbaines de 2005. À L’Obs, elle déclare que les journalistes voulaient connaître son avis sur « le port du voile, l’immigration, les émeutes en banlieue… On me parlait de tout sauf de mon livre. J’étais considérée comme un écrivain de banlieue et pas comme un écrivain tout court »71. Profitant du contexte social de 2005, certaines élites politiques françaises, veulent en faire une porte-parole des banlieues. Elle déclinera les tentatives d’approches faites par différents ministères durant les présidences de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy17.
Dans son autobiographie, Mélanie Georgiades, plus connue sous son nom de scène Diam’s, décrit son amitié avec Faïza Guène qu’elle a rencontrée lors d’invitations faites par les médias à débattre sur des faits d’actualité car elles étaient considérées comme les deux « perles » de la banlieue. Les deux femmes étant réduites à représenter leur territoire d’origine et non leurs productions artistiques72.
Pour Zineb Ali-Benali50, Faïza Guène a été, consciemment ou non, une « anthropologue des siens » pour le milieu de la littérature parisienne. Elle évolue de la case de « beur », puis « intrangère »73 pour finir au « centre » de la littérature avec Un homme, ça ne pleure pas. C’est ainsi qu’elle place la critique enthousiaste de ce roman par François Busnel dans L’Express :
« Elle a fait du chemin depuis Kiffe kiffe demain ! On a découvert Faïza Guène en 2004 avec un premier roman qui, pour n’être pas très réussi, n’en fut pas moins un grand succès de librairie. Dix ans plus tard, la jeune femme s’est métamorphosée : elle s’est dotée d’un style, d’un ton, et a appris à raconter des histoires sans jamais verser dans le manichéisme, les généralités ou les raccourcis 74 ».
Pourtant, dans un article consacré à l’évolution de l’écriture chez Faïza Guène, l’universitaire Ioana Marcu, note qu’Un homme, ça ne pleure pas garde le style originel de Guène comme l’usage de l’oralité. Après son deuxième roman de la « confirmation », ce roman est celui « l’âge adulte » avec un style arrivé à « maturité »75.
Réception internationale
La réception des écrits de Faïza Guène en France et à l’étranger est différente76. Si en dehors de l’Hexagone elle est comparée à « Zadie Smith ou à Monica Ali », en France, elle incarne selon l’universitaire Laura Reeck « la révolte, une révolte totale qui peut mener à tout, même au silence et surtout au silence lorsque l’on est sommé de parler ».
Dans l’ouvrage collectif Banlieue vues d’ailleurs (2016) dirigé par l’historien Bernard Wallon77, il est rappelé que les universitaires spécialisés dans l’étude de la production des écrivains issus des banlieues sont principalement basés en dehors de l’Hexagone, notamment aux États-Unis, en Angleterre et en Italie. En effet, en France, cette littérature est « absente dans la plupart des anthologies et tentatives de classement dédiées à la littérature française contemporaine […] la critique universitaire française continue à ignorer ce corpus vaste qui compte pourtant des œuvres de qualité littéraire remarquable ». Pour lui, l’une des explications à cet état de fait serait structurel, les universités anglosaxonnes par exemple ayant des départements de French Studies, influencés par les études postcoloniales et les cultural studies qui analysent les œuvres considérées comme mineures et/ou issues des minorités.
Dans ce même ouvrage, l’universitaire britannique Christina Horvath78, spécialisée dans la littérature des auteurs issus de banlieue signe un article intitulé Écrire la banlieue dans les années 2000-2015 dans lequel elle énumère les raisons qui pourraient expliquer le déni des écrivains issus des banlieues dans le champs littéraire français : mépris pour le genre populaire et les genres mineurs, méfiance des universitaires hexagonaux à l’égard d’une littérature dont l’esthétique s’éloigne du « prestige du français standard normé, approuvé et certifié par l’Académie française ». Elle suppose également que les auteurs portant des noms étrangers ne seraient « pas suffisamment français » pour avoir une place dans les rayons « littérature française » ou intégrés dans les programmes scolaires. Pour finir, elle avance que les stéréotypes sur les banlieues, véhiculés par les médias, influencent les universitaires à ne pas croire en la capacité des auteurs résidants en banlieue d’être « dignes de leur attention ».
Cette analyse est partagée par la professeure de français Anouk Alquier dans un article publié en 2011 et intitulé La Banlieue Parisienne du Dehors au Dedans : Annie Ernaux et Faïza Guène. Elle y explique que les relents néocoloniaux au sein de la société française ne permettent pas de reconnaitre les textes qui se passent en banlieue comme textes littéraires. Ils sont reconnus comme « textes exotiques, étranges, voire tabous »79.
Dans une interview de Faïza Guène publiée en 2007 par le Contemporary French and Francophone Studies32 à la suite d’une tournée des universités américaines, elle déclarait avoir été confortée sur son travail, sur l’universalité de ses thèmes, ajoutant qu’en France , elle « en doute quelquefois car on a souvent besoin de me cantonner à la Banlieue ».
En 1995 déjà, Alec G. Hargreaves traduisait en ces termes la place inconfortable des écrivains français issus de l’immigration maghrébine : « La littérature issue de l’immigration maghrébine en France est une littérature qui gêne. Les documentalistes ne savent pas où la classer, les enseignants hésitent à l’incorporer dans leurs cours et les critiques sont généralement sceptiques quant à ses mérites esthétiques »80.
Le statut d’écrivaine
Faïza Guène et Françoise Sagan
En 2004, la journaliste de L’Obs Anne Fohr encense Kiffe kiffe demain mais s’interroge : « Le premier roman d’une beurette de banlieue ne passe pas inaperçu. Quand c’est une petite merveille, c’est la ruée sur l’auteur, sa vie, son œuvre. On en fera peut-être un phénomène. Nouvelle Sagan des cités ou petite sœur de Jamel Debbouze? »81. La « Sagan des cités »82 ou la « Sagan des banlieues »62,83 seront réutilisés dans la presse française mais également étrangère. Le seul point commun entre Françoise Saganet Faïza Guène étant une entrée précoce dans le monde de la littérature (Françoise Sagan a publié Bonjour Tristesse en 1954 à l’âge de 18 ans).
En août 2006, pour la sortie de son deuxième roman Du rêve pour les oufs, Le Nouvel Observateur critiqua ce surnom où l’écrivaine « se retrouve homologuée « Sagan des cités » par quelques plumitifs en mal de formules passe-partout »84. En octobre de la même année, Anne Fohr publie dans le même magazine une critique élogieuse du second roman de l’écrivaine, qualifiée cette fois-ci de « beurette phénomène » ou encore une « une fille des cités surdouée»85.
Les surnoms l’assignant à la banlieue seront encore nombreux.« Plume du bitume »86, « Bridget Jones des banlieues »87 dont la « plume rafraîchissante de 21 ans [est] trempée dans le bitume de Seine-Saint-Denis »55, « titi de banlieue »88, « la plume de Pantin (Seine-Saint-Denis) »89. Ou encore « une romancière qui a su incarner, plus que toute autre, une certaine littérature française du bitume »37.
Dès sa première émission télévisée, l’universitaire Kathryn A. Kleppinger90 fait remarquer que Faïza Guène tente de recadrer la réception de son travail. Elle retranscrit un passage de l’émission On a tout essayé, diffusée le 11 octobre 2004 sur France 2 :
Faïza Guène continuera à rejeter ces surnoms, y compris auprès de la presse étrangère, notamment dans une interview donnée au New York Times87 en 2004 (« I don’t want to be the Sagan of the housing projects »). Pourtant, elle est présentée ainsi à chaque sortie d’un roman. En 2008, elle déclarait à ce sujet : « Des cités, des banlieues, c’est devenu un nom de famille, une particule. Si je vais sur la Lune, je serai l’Armstrong des quartiers, non ? »89.
Ce phénomène d’association des écrivains issus de la banlieue parisienne et de l’immigration maghrébine à des figures connues dans le milieu littéraire français est une pratique courante dans les médias hexagonaux. En organisant des dictées géantes par exemple, l’écrivain Rachid Santaki a été affublé du surnom de « Bernard Pivot des banlieues »91.
Légitimité
En 2016, Faïza Guène apparait dans le documentaire Nos Plumes92 réalisé par Keira Maameri. Cette dernière tente de montrer les stéréotypes dont souffrent les artistes et écrivains issus de la banlieue parisienne dont Faïza Guène, Berthet, Rachid Djaïdani, ElDiablo et Rachid Santaki. Le documentaire traite de la question de la légitimité de ces auteurs dans le champs artistique et littéraire français.
L’usage d’une langue populaire et argotique est l’un des éléments qui participe à une forme d’exclusion de Faïza Guène du champs littéraire par la presse française. Les articles la concernant sont souvent classés dans la rubrique « Société » et non dans la rubrique « Littérature » ou « Culture », faisant de l’auteur un phénomène de société, plus qu’un phénomène littéraire.
En 2004, Le Nouvel Observateur fera sa critique de Kiffe kiffe demain dans sa rubrique « Société ». En 2006, Le Parisien titrera son article Faïza Guène, plume du bitume86 dans sa rubrique « Société ». En 2008, le même journal titrera Parlez-vous le Faïza Guène ?89 dans la même rubrique.
En 2006, elle déclare qu’en « France, c’est encore comme si je n’avais pas de légitimité, quand je regarde les émissions littéraires, je suis traumatisée ; on croirait qu’ils cherchent à tout prix à fermer le cercle… Et ce sont les mêmes qui ne comprennent pas pourquoi les gens ne lisent pas ! »2. D’ailleurs, elle dit dans plusieurs interviews se sentir exclue du champs littéraire français45.
À la question du Guardian sur l’éventualité qu’elle puisse recevoir un Prix Littéraire, elle déclare : « Les grands prix littéraires ? Vous plaisantez ? Jamais, de toute ma vie, jamais, je ne gagnerai un prix littéraire. Cela voudrait dire que j’écris de la littérature et qu’il y a des intellectuels dans les banlieues. C’est justement là-dessus que rien ne change et que cette vision néocolonialiste s’exprime… Les indigènes savent faire du sport, chanter et danser, mais ils ne peuvent pas penser »17.
Pour l’éditeur Guillaume Allary, le premier roman de Faïza Guène est arrivé dans une séquence historique où il n’y avait pas de voix des banlieues parisiennes dans la littérature française, où le « milieu littéraire parisien » était « ignorant sur une large partie de la population française ». (« The book arrived in that heavy silence in a very white, very inward-looking, Parisian literary milieu that was ignorant about a large part of the French population »)93.
Traductions
Faïza Guène est la première écrivaine française issue de l’immigration maghrébine à avoir un succès mondial. La traduction de son premier roman en vingt-six langues crée dès lors de nombreuses analyses universitaires, notamment au sein des départements de French Studies, sur les stratégies adoptées par les traducteurs. En effet, la plupart des traducteurs normalisent (simplifient) Kiffe kiffe demain, lui faisant perdre ses caractéristiques originales, notamment ses mots en verlan et ses arabismes. Or, l’oralité, le verlan et les arabismes caractérisent le style de l’écrivaine94.
Si l’œuvre de Guène traduit la culture des classes populaires issues de l’immigration maghrébine, avec un usage fréquent des arabismes, la traduction arabe de Kiffe kiffe demain a été la plus tardive. En effet, les universitaires Katrien Lievois, Nahed Nadia Noureddine et Hanne Kloots95 soulignent qu’en dépit de son succès, et des premières traductions publiées dès 2005 (en finnois, italien, néerlandais et serbe), la traduction arabe ne paraît qu’en 2010. Ils jugent la traduction arabe « déconcertante » avec un effacement total des spécificités esthétiques du roman transformé en arabe standard, dans un « registre formel ». La traduction de certains mots portent d’ailleurs à confusion. L’usage du mot « bled » est traduit par « balad », qui signifie « pays » en arabe standard, et est dépourvu de sa connotation « péjorative ». Ils soulignent que le titre arabe porte aussi à confusion, « kiffe kiffe » (aimer) sans voyelle étant lu « kaif kaif » (comment) par les arabophones.
Ils se sont également intéressés à la traduction espagnole et néerlandaise pour appréhender les stratégies retenues par les traducteurs. La version espagnole efface les références sociolinguistiques, notamment celle du titre, pour le traduire en Mañana será otro día. La traduction néerlandaise, Morgen kifkif, bien qu’elle garde certains mots arabe tels quels, utilise une langue neutre.
Pour l’universitaire Mattias Aronsson, qui s’est penché sur les deux premiers romans de Guène traduits en suédois, les mots argotiques, en verlan ou issus de la culture maghrébine sont souvent traduits dans une langue standard. « Ce procédé de normalisation rend le texte cible plus neutre et, peut-être, un peu moins singulier que l’original »96. La traduction suédoise fait perdre à Kiffe kiffe demain sa culture maghrébine en usant de l’argotique espagnol plus présent dans la langue suédoise. Entre autres exemples, Mattias Aronsson évoque le passage du mot arabe « walou » à un équivalent espagnol « nada ». Il explique ce « transfert » car l’argot utilisé en Suède est largement influencé par les immigrés sudaméricains.
La traduction américaine (Kiffe kiffe tomorrow) et italienne (Kif kif domani) restent fidèle au titre original. Pour l’universitaire Chiara Denti97 cela permet de rendre compte que le titre original est un « manifeste pour un demain hybride et hétérolingue »98.
La presse anglaise a d’ailleurs salué la traduction de Kiffe kiffe demain (Just like tomorrow) qui retranscrit le style de Guène. L’argot utilisé est principalement celui de l’immigration jamaïcaine. Sarah Ardizzone, qui a traduit l’ensemble des romans de Guène a « travaillé sur le langage avec des jeunes de Brixton »26, un quartier populaire de Londres. En 2006, The Daily Telegraphsaluait le travail de Ardizzone, qui a été capable de traduire avec « créativité » les traits argotiques du roman99 même si The Independent déplorait la perte au passage de certains traits d’humour100.
En 2020, dans le cadre d’une conférence organisée par l’Institut Français de Londres, au Royaume-Uni, à l’occasion de la Journée Internationale du droit des Femmes, Faïza Guène et sa traductrice Sarah Ardizzone ont, entre autres, échangés sur leur relation traducteur-auteur de plus de 15 années, une relation amicale, qui donne à Guène une « perspective anglaise » de son travail101.
Engagements
En 2007, Faïza Guène participe au collectif Qui fait la France ? (jeu de mot avec « kiffer »102), qui déplore que la littérature ne soit qu’un « exutoire des humeurs bourgeoises ». Ce collectif d’écrivains aux « identités mêlées » réclame son droit à faire partie du paysage de la littérature française, dans sa diversité. Ils publient un recueil de nouvelles sous le titre de Chroniques d’une société annoncée.
Faïza Guène est impliquée auprès d’associations, y compris celle qui l’a aidé à devenir écrivaine, Les Engraineurs. Elle déclare vouloir casser les stéréotypes et montrer que la littérature n’est pas « comme le golfe : une activité réservée aux riches »103.
L’écrivaine prend position pour que cessent les stéréotypes dont souffre son département de naissance, la Seine-Saint-Denis. Elle signe l’Appel des 93, un collectif lancé en avril 2005 par 93 personnalités dont l’objectif est de modifier le regard négatif du département. En 2006, elle devient la marraine104 du bateau Esprit93 pour le Transat Ag2r.
Faïza Guène collabore avec l’enseigne de Ramdane Touhami, la maison de parfum et cosmétiques Officine Universelle Buly 1803, à l’écriture de textes où elle explore avec humour la beauté féminine105,106. D’ailleurs elle interviendra dans le Podcast Kiffe Ta Race pour déconstruire les stéréotypes qui touchent les femmes racisées dans un épisode intitulé « La geisha, la panthère et la gazelle »107. En 2020, elle participe à l’ouvrage collectif féministe Ceci est mon corps.
Faïza Guène est marraine108 et participe régulièrement aux initiatives de La dictée pour tous109, une association qui organise des dictées géantes dans les quartiers populaires.
En 2018, elle inaugure une bibliothèque qui porte son nom dans le 13e arrondissement de Paris. Le nom de cette bibliothèque rattachée au centre social « 13 pour tous », est choisi par les femmes qui le fréquentent et qui avaient lancées, dix ans auparavant, leur premier diner littéraire avec Kiffe kiffe demain. Faïza Guène déclare à cette occasion son soutien au travail de terrain de ce centre social qui met en avant l’importance de la lecture110.
En 2019, elle se rend en Haïti pour le tournage de De vos propres yeux, une websérie produite par l’ONG Solidarités Internationalqui intervient depuis 9 ans dans ce pays afin d’éradiquer le choléra111.
Hommages
Dans son quatrième et dernier album SOS, sorti en 2009, Diam’s rend hommage à Faïza Guène dans sa chanson L’Honneur d’un peuple où elle chante « En attendant j’aime les lettres et je lis Faïza Guène »112.
En 2019, le producteur Chakib Lahssaini lance la websérie Kiffe aujourd’hui, diffusée sur France.tv Slash et sur YouTube, dont le titre est un « clin d’œil » à Kiffe kiffe demain, un « livre générationnel qui racontait le quotidien d’une jeune fille des quartiers dont les soucis étaient les séries qu’elle regardait l’après-midi, les histoires d’amour… Elle était parfaitement ordinaire et aurait pu s’appeler Monique, Germaine ou Fatoumata : elles ont toutes les mêmes problèmes à cet âge-là »113.
Œuvres
Romans
Collectifs
Livres d’art
En 2020, la Folio Society publie une série limitée de 750 coffrets114 contenant une reproduction de la version originale de The Story of Babar de Jean de Brunhoff, ses croquis ainsi qu’un recueil de textes de Faïza Guène, Adam Gopnik et Christine Nelson115.
Direction littéraire
Faïza Guène a été la directrice littéraire116,117 du premier roman de Grace Ly, Jeune Fille Modèle. Le roman retrace le parcours de Chi Chi, adolescente française issue de l’immigration sino-cambodgienne, qui raconte sa quête d’identité.
Créations cinématographiques
Courts-métrages
Pour le directeur du Département des études françaises et francophones de l’Université de Californie, Dominic Thomas, les courts-métrages de Faïza Guène permettent un dialogue entre le centre et la périphérie118. En 2010, il analyse la production de Faïza Guène et les inscrits dans une dynamique portée par les descendants d’immigrés pour casser les stéréotypes véhiculés à leur égard. L’action de filmer et d’écrire a, selon lui, une « dimension thérapeutique » et permet à ces artistes de se réapproprier une image malmenée par les médias. Utiliser la caméra et la plume permet de rendre visible les problèmes sociaux « et placent sous pression les idéaux et les valeurs républicaines ». Pour Dominic Thomas, les courts-métrages de Faïza Guène sont pertinents car engagés à contrer le discours médiatique, politique visant à « essentialiser et stigmatiser » les plus défavorisés au sein de la société.
Entre 2001 et 2002, Faïza Guène réalise deux court-métrages avec Les Engraineurs, association basée à Pantin qui organise des ateliers d’écriture et des réalisations audiovisuelles. Elle réalise le premier en 2001 avec le producteur Julien Sicard, La zonzonnière119, qui met en scène une adolescente déterminée à fuir sa famille avec son amie.
En 2002, elle n’a que 15 ans quand elle réalise seule le court-métrage RTT. Elle met en scène une mère célibataire qui se démène entre son travail de femme de ménage et l’éducation de ses enfants. Profitant d’une journée de repos en RTT, elle découvre que ses enfants basculent dans la délinquance. À travers ce court-métrage, Guène explore le rôle de la dislocation de la cellule familiale comme facteur de la délinquance juvénile. Elle racontera à la sortie de Kiffe kiffe demain que le projet avait manqué de tomber à l’eau, l’actrice principale ayant annulé sa participation la veille du tournage120. C’est alors sa mère, Khadra Guène121, qui interprétera le rôle principal.
En 2002, elle réalise ce court documentaire qui relate le massacre du 17 octobre 1961 des manifestants algériens à Paris. Cinq mois avant la fin de la guerre d’Algérie, ils protestaient contre le couvre-feu appliqués aux seuls maghrébins. La manifestation sera réprimée et fera entre 30 et 300 morts.
Cette répression sur le sol français de travailleurs algériens sera pendant longtemps un tabou. Faïza Guène déclarera à ce propos « Mes parents, ils ont connus la guerre d’Algérie, Octobre 1961 à Paris. Ils ne veulent pas faire de bruit. Mais nous, on est né ici, on ne se tait pas »122.
L’universitaire Alison Rice rappelle que cet évènement sera intégré et reconnu de manière symbolique dans Kiffe kiffe demain, dans un passage où l’héroïne relate l’amour que porte sa mère pour le maire de Paris, Bertrand Delanoë depuis qu’il a posé une plaque commémorative en souvenir des victimes123.
Ce documentaire fut réalisé avec Bernard Richard et financé par l’association Les Engraineurs124.
En 2005, elle obtient une bourse du CNC afin de réaliser le moyen-métrage Rien que des mots125 où elle fait jouer sa mère pour la seconde fois.
Scénarios
En 2010, elle retrouve Julien Sicard pour collaborer à un épisode de la série télévisée Histoires de vies diffusé sur France 2 qu’il dirige. Elle écrira le scénario de l’épisode 6 appelé Des intégrations ordinaires126.
Elle participe à l’écriture du scénario et des dialogues du film Sol, sorti au cinéma en 2020127.
Actrice
Faïza Guène tient son premier rôle au cinéma dans le film Sœurs128 de Yamina Benguigui (Sortie en 2020)129.
Notes et références
2- Marie-Pierre Subtil, « Faïza Guène, la sale môme qui écrit des best-sellers », Le Monde, 12 septembre 2006 (lire en ligne [archive])
3 Lauren Bastide, « La Poudre – Épisode 32 – Faïza Guène » [archive], sur https://www.nouvellesecoutes.fr/la-poudre/ [archive], 14 juin 2018
4 (en) Fatimah Kelleher, « An Interview with Faïza Guène », Wasafiri, vol. 28, no 4, 1er décembre 2013, p. 3–6 (ISSN 0269-0055, DOI 10.1080/02690055.2013.826783, lire en ligne [archive], consulté le 17 août 2020)
5 « Keira Maameri: «Nos plumes, ce sont les plumes de la France» » [archive], sur RFI, 16 septembre 2016 (consulté le 17 août 2020)
6 (en) Marion E. Hines, « Onomastic resemblances and the use of names in Faïza Guène’s « Kiffe kiffe Demain » », CLA Journal, vol. 54, no 1, 2010, p. 77–106 (ISSN 0007-8549, lire en ligne [archive], consulté le 17 août 2020)
7 Les Engraineurs, Olivier Apprill, Christelle Petit et Boris Seguin, « La zonzonnière et le bon à rien », Chimères. Revue des schizoanalyses, vol. 46, no 1, 2002, p. 39–48 (DOI 10.3406/chime.2002.2419, lire en ligne [archive], consulté le 17 août 2020)
8 « Association « Les Engraineurs » » [archive], sur https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/ [archive]
9 Aurélie Sipos, « Pantin : « J’ai toujours aimé les histoires » » [archive], sur https://www.leparisien.fr/ [archive], 12 janvier 2018
10 Luc Le Vaillant, « Boris Seguin, 48 ans, enseigne le français dans un collège de Pantin. Doutes et convictions d’un prof en grève aujourd’hui. Un hussard en banlieue. » [archive], sur Libération.fr, 30 septembre 1996 (consulté le 17 août 2020)
11 Pierre Georges, « L’Académie Céfran », Le Monde, 13 février 1996 (lire en ligne [archive])
12 Dominique Simonnet, « express société – Le dico des cités » [archive], sur L’Express, 15 février 1996
13 « Faïza Guène, écrivain à part et entière – Jeune Afrique » [archive], sur JeuneAfrique.com, 16 avril 2014 (consulté le 17 août 2020)
14 Par Marie-Pierre BolognaLe 18 avril 2007 à 00h00, « La cité des écrivains » [archive], sur leparisien.fr, 17 avril 2007 (consulté le 17 août 2020)
15 « Faïza Guène rejoint Plon » [archive], sur Livres Hebdo, 20 mai 2020
16 Virginia Bart, « Livres en bref », Le Monde, 25 janvier 2018 (lire en ligne [archive])
17 Angelique Chrisafis, « “Jamais ils ne me donneront de prix littéraire” » [archive], sur https://www.courrierinternational.com/ [archive], 18 juin 2008
18 Monica Hărşan, « La (Re)Construction Textuelle de L’identité Chez Faïza Guène et Abdellah Taïa », Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series IV: Philology & Cultural Studies, no 1, 2012, p. 35–50 (ISSN 2066-768X et 2066-7698, lire en ligne [archive], consulté le 17 août 2020)
19 Marc Sourdot, « Mots d’ados et mise en style : Kiffe Kiffe demain de Faïza Guène », Adolescence, avril 2008, p. 895-905 (lire en ligne [archive])
20 Mustapha Harzoune, « Les Gens du Balto | Musée national de l’histoire de l’immigration » [archive], sur https://www.histoire-immigration.fr/ [archive], 2009
21 Mustapha Harzoune, « Un homme, ça ne pleure pas », Hommes & migrations. Revue française de référence sur les dynamiques migratoires, no 1306, 1er avril 2014, p. 118–120 (ISSN 1142-852X, lire en ligne [archive])
22 Mustapha Harzoune, « Faïza Guène, Millénium Blues. Paris, Fayard, 2018, 234 pages, 19 € », Hommes & migrations. Revue française de référence sur les dynamiques migratoires, no 1325, 1er avril 2019, p. 207–208 (ISSN 1142-852X, lire en ligne [archive], consulté le 17 août 2020)
23 « Confessions d’un enfant du siècle ; À la vie, à la mort », La Libre Belgique, 5 février 2018
24 Nadir Dendoune, « On a aimé le sixième roman de Faïza Guène » [archive], sur lecourrierdelatlas.com, 26 août 2020
25 Serge Bressan, « « La discrétion » de Faïza Guène : la mère, cette héroïne… » [archive], sur lagrandeparade.com, 29 août 2020
26 Hubert Artus, « Faïza Guène : « Je n’insulte en rien la noblesse de la littérature » » [archive], sur https://www.nouvelobs.com/ [archive], 24 janvier 2017
27 Mirna Sindicic Sabljo, « Paris et ses banlieues dans les romans de Faïza Guène et Rachid Djaïdani », Etudes romanes de Brno, no 1, 2018, p. 7–20 (ISSN 1803-7399, lire en ligne [archive])
28 (en) Mirka Ahonen, « Redefining stereotypes: The banlieue and female experience in Faïza Guène’s Kiffe kiffe demain », French Cultural Studies, vol. 27, no 2, 1er mai 2016, p. 168–177 (ISSN 0957-1558, DOI 10.1177/0957155815616587, lire en ligne [archive], consulté le 18 août 2020)
29 (en) « Faïza Guène and Sarah Ardizzone » [archive], sur London Review Bookshop, 20 juin 2009
30 (en) Mireille Le Breton, « Reinventing the « banlieue » in contemporary urban Francophone literature », Beyond hate: representations of the Parisian Banlieue in literature and film, 2011, pp 131-139 (ISSN 1557-2277, lire en ligne [archive])
31 (en) Véronique Anover, « Review of Kiffe kiffe demain », The French Review, vol. 80, no 2, 2006, p. 488–489 (ISSN 0016-111X, lire en ligne [archive], consulté le 18 août 2020)
32 Laura Ceia-Minjares, « DJ Zaïfe : Remix de la cité du Paradis : Interview avec Faïza Guène, écrivaine », Contemporary French and Francophone Studies, vol. 11, no 1, 1er janvier 2007, p. 93–97 (ISSN 1740-9292, DOI 10.1080/17409290601136003, lire en ligne [archive], consulté le 18 août 2020)
33 « « Un homme ça ne pleure pas » : le retour drôle et tendre de Faïza Guène » [archive], sur https://www.rtl.fr/ [archive], 27 janvier 2014
34 Mustapha Harzoune, « Un homme, ça ne pleure pas | Musée national de l’histoire de l’immigration » [archive], sur https://www.histoire-immigration.fr/ [archive]
35 (en) Brinda J. Mehta, « Negotiating Arab-Muslim Identity, Contested Citizenship, and Gender Ideologies in the Parisian Housing Projects: Faïza Guène’s Kiffe kiffe demain », Research in African Literatures, vol. 41, no 2, 18 avril 2010, p. 173–202 (ISSN 1527-2044, lire en ligne [archive])
36 Yslande Bossé, « Faïza Guène : « Ma légitimité d’écrivain, je l’ai gagnée » » [archive], sur https://deliee.org/ [archive], 14 février 2018
37 Hubert Artus, « Un homme ça ne pleure pas: attention, humour (tendrement) décapant! » [archive], sur https://www.lexpress.fr/ [archive], 28 février 2014
38 (en) Ronja Schicke, « Father Figures in Beur Literature – a Comparison of Kiffe kiffe demain by Faïza Guène, Pieds-blancs by Houda Rouane and Les Chiens aussi by Azouz Begag », Masculinités maghrébines, 1er janvier 2017, p. 242–258 (DOI 10.1163/9789004342828_016, lire en ligne [archive], consulté le 18 août 2020)
39 (en-US) Nour Seblini, « Game of hypocrites: Beurs break silence in Faïza Guène’s Kiffe kiffe demain », French Cultural Studies, vol. 30, no 4, 12 octobre 2019, p. 335–346 (ISSN 0957-1558 et 1740-2352, DOI 10.1177/0957155819861039, lire en ligne [archive], consulté le 18 août 2020)
40 « Faïza Guène : la playlist de « Millénium blues » » [archive], sur https://www.hachette.fr/ [archive], 27 décembre 2017
41 « Faïza Guène | Mère courage », Technikart, été 2020, p.70
42 France Inter, « Découvrez un texte inédit de Faïza Guène : « La lourdeur des nuages » » [archive], sur www.franceinter.fr, 11 janvier 2018 (consulté le 18 août 2020)
43 Isabelle Galichon, « Pour une approche « décoloniale » des récits de banlieue », Romance Studies, vol. 36, nos 1-2, 3 avril 2018, p. 5–17 (ISSN 0263-9904, DOI 10.1080/02639904.2018.1457822, lire en ligne [archive])
44 Mathias Deguelle, « Faïza Guène accompagnée de Faïza Zerouala » [archive], sur https://www.franceinter.fr/ [archive], 8 juin 2014
45 Pascale Clark, « Comme on nous parle | Faïza Guène » [archive], sur https://www.franceinter.fr/ [archive], 6 janvier 2014
46 (en) Al Jazeera English, « France’s Rising Literary Star » [archive], sur https://www.youtube.com/ [archive], 19 septembre 2008
47 Anne Fohr, « Le monde selon Faïza », Le Nouvel Observateur, 19 août 2004
48 Laurent Raphaël, « Les gens du Balto », Focus Vif, 12 septembre 2008
49 « Faïza Guène au bistro » [archive], sur https://bibliobs.nouvelobs.com/ [archive], 4 septembre 2008
50 Zineb Ali-Benali, « Une fabrique d’écrivain. Le fruit ne tombe jamais loin de l’arbre de Faïza Guène » [archive], sur https://cahiers.crasc.dz/ [archive]
51 Silvia Domenica Zollo, « Pratiques langagières des cités dans Un homme, ça ne pleure pas de Faïza Guène », Argotica, 2014, p. 223-236 (ISSN 2286-3893, lire en ligne [archive])
52 Anouk Alquier, « La Banlieue Parisienne du Dehors au Dedans : Annie Ernaux et Faïza Guène », Contemporary French and Francophone Studies, vol. 15, no 4, 1er septembre 2011, p. 451–458 (ISSN 1740-9292, DOI 10.1080/17409292.2011.594278, lire en ligne [archive], consulté le 18 août 2020)
53 Ilaria Vitali, « De la littérature beure à la littérature urbaine : Le Regard des « Intrangers » », Nouvelles Études Francophones, 2009, pp. 172-183 (lire en ligne [archive])
54 (en) Brinda J. Mehta, « Negotiating Arab-Muslim Identity, Contested Citizenship, and Gender Ideologies in the Parisian Housing Projects: Faïza Guène’s Kiffe kiffe demain », Research in African Literatures, vol. 41, no 2, 18 avril 2010, p. 173–202 (ISSN 1527-2044, lire en ligne [archive], consulté le 18 août 2020)
55 Anne Berthod, « Pas si ouf, Faïza! » [archive], sur https://www.lexpress.fr/ [archive], 14 septembre 2006
56 Rossana Curreri, « Ilaria Vitali, Intrangers (II). Littérature beur, de l’écriture à la traduction », Lectures, 22 octobre 2012 (ISSN 2116-5289, lire en ligne [archive], consulté le 18 août 2020)
57 Christophe Lehousse, « Faïza Guène, black, blanc, blues », Le Magazine de Seine-Saint-Denis, 3 janvier 2018 (lire en ligne [archive])
58 « Faïza Guène au bistro » [archive], sur Bibliobs (consulté le 18 août 2020)
59 (en) Mirka Ahonen, « Redefining stereotypes: The banlieue and female experience in Faïza Guène’s Kiffe kiffe demain », French Cultural Studies, vol. 27, no 2, 1er mai 2016, p. 168–177 (ISSN 0957-1558, DOI 10.1177/0957155815616587, lire en ligne [archive], consulté le 18 août 2020)
60 Pierre Vavasseur, « « Du rêve pour les oufs » : plein d’humour » [archive], sur https://www.leparisien.fr/ [archive], 23 août 2006
61 Sabrina Fatmi Sakri, « Du rêve pour les oufs de Faiza Guène ou l’ironie comme stratégie de l’écriture féminine », Littérature maghrébine de langue française, 2011, p. 141-150 (lire en ligne [archive])
62 Gilles Médioni, « Faïza, on la kiffe » [archive], sur https://www.lexpress.fr/ [archive], 15 novembre 2004
63 (en) Véronique Anover, « Review of Du rêve pour les oufs », The French Review, vol. 82, no 2, 2008, p. 429–429 (ISSN 0016-111X, lire en ligne [archive], consulté le 18 août 2020)
64 « Pantin »Du rêve pour les oufs », de Faïza Guène », Le Nouvel Observateur, 23 août 2006
65 (en-GB) Angelique Chrisafis, « Meet Faiza Guene … the Bridget Jones o the Paris banlieues », The Guardian, 5 juin 2008 (ISSN 0261-3077, lire en ligne [archive], consulté le 18 août 2020)
66 Mohammed Aissaoui, « Les Gens du Balto de Faïza Guène », Le Figaro, 21 août 2008
67 Marine de Tilly, « Les Gens du Balto », Le Point, 1er mars 2010
68 « Faïza Guène confirme ses qualités littéraires; », La Croix, 12 octobre 2006 (ISSN 0242-6056, lire en ligne [archive], consulté le 18 août 2020)
69 Laurence Houot, « « La discrétion » : le nouveau roman de Faïza Guène mérite tous les prix » [archive], sur francetvinfo.fr, 27 août 2020
70 Mame-Fatou Niang, Identités françaises, Boston, États-Unis, Brill, 2019 (lire en ligne [archive]), p.132
71 « Les auteurs des quartiers cassent les codes de la littérature » [archive], sur https://www.lepoint.fr/ [archive], 30 août 2012
72 Mélanie Georgiades, Diam’s, autobiographie, Don Quichotte, 2012
73 Ilaria Vitali, Intrangers (I). Post-migration et nouvelles frontières de la littérature beur, Academia (Editions) (ISBN 978-2-8061-0020-7, lire en ligne [archive])
74 François Busnel, « Un homme, ça ne pleure pas, prétend Faïza Guène » [archive], sur https://www.lexpress.fr/ [archive], 13 mars 2014
75 Ioana Marcu, « Évolution de l’écriture chez Faïza Guène. Du «roman d’une adolescente pour des adolescents» au «roman de l’âge adulte» », Qvaestiones Romanicae, V, Section Langue et littérature françaises, 2017, p. 462-480 (ISSN 2457-8436, lire en ligne [archive])
76 Laura Reeck, « La littérature beur et ses suites. Une littérature qui a pris des ailes », Hommes & migrations. Revue française de référence sur les dynamiques migratoires, no 1295, 1er janvier 2012, p. 120–129 (ISSN 1142-852X, DOI 10.4000/hommesmigrations.1077, lire en ligne [archive], consulté le 18 août 2020)
77 Bernard Wallon, Banlieues vues d’ailleurs, CNRS Editions, 25 février 2016, 224 p. (lire en ligne [archive])
78 (en) « Christina Horvath » [archive], sur the University of Bath’s research portal (consulté le 18 août 2020)
79 Anouk Alquier, « La Banlieue Parisienne du Dehors au Dedans : Annie Ernaux et Faïza Guène », Contemporary French and Francophone Studies, vol. 15, no 4, 1er septembre 2011, p. 451–458 (ISSN 1740-9292, DOI 10.1080/17409292.2011.594278, lire en ligne [archive], consulté le 18 août 2020)
80 Alec G. HARGREAVES, « La littérature issue de l’immigration maghrébine en France : une littérature mineure ? », Études littéraires maghrébines, 1995, p. 17-28
81 Anne Fohr, « Le monde selon Faïza », Le Nouvel Observateur, 19 août 2004
82 « Ces personnalités qui montrent l’exemple », Le Parisien, 3 novembre 2005
83 Mohammed Aïssaoui, Bruno Corty, Dominique Guiou, « Détours d’horizons », Le Figaro, 23 décembre 2004
84 « Pantin »Du rêve pour les oufs », de Faïza Guène », Le Nouvel Observateur, 23 août 2006
85 Anne Fohr, « Les raisons du succès – La voix des banlieues », Le Nouvel Observateur, 12 octobre 2006
86 Vincent Mongaillard, « Faïza Guène, plume du bitume » [archive], sur https://www.leparisien.fr/ [archive], 23 août 2006
87 (en-US) Elaine Sciolino, « From Paris Suburbs, a Different Voice », The New York Times, 26 octobre 2004 (ISSN 0362-4331, lire en ligne [archive], consulté le 18 août 2020)
88 Mohammed Aïssaoui, « Le rêve américain de Faïza, titi de banlieue » [archive], sur https://www.lefigaro.fr/ [archive], 14 septembre 2006
89 « Parlez-vous le Faïza Guène ? » [archive], sur https://www.leparisien.fr/ [archive], 20 août 2008
90 (en) Kathryn A. Kleppinger, « Revising the Beurette Label: Faïza Guène’s Ongoing Quest to Reframe the Reception of Her Work » [archive], sur Branding the ‘Beur’ Author: Minority Writing and the Media in France, décembre 2015 (consulté le 18 août 2020)
91 Jean-Pierre Montanay, « Rachid Santaki, le « Bernard Pivot » des banlieues » [archive], sur https://www.lexpress.fr/ [archive], 10 novembre 2018
92 « film-documentaire.fr – Portail du film documentaire » [archive], sur www.film-documentaire.fr (consulté le 18 août 2020)
93 (en) Olivia Snaije, « The fire this time: French novelist Faiza Guene on writing, anger and dreams of ’98 » [archive], sur http://www.middleeasteye.net/ [archive], 16 juin 2020
94 (en) Stella Linn, « C’est trop auch! The Translation of Contemporary French Literature Featuring Urban Youth Slang », International Journal of Literary Linguistics, vol. 5, no 3, 29 août 2016 (ISSN 2194-5594, DOI 10.15462/ijll.v5i3.69, lire en ligne [archive], consulté le 18 août 2020)
95 Katrien Lievois, Nahed Noureddine et Hanne Kloots, « Le lexique des jeunes des cités dans Kiffe kiffe demain : choix traductifs en arabe, espagnol et néerlandais », TTR : traduction, terminologie, rédaction, vol. 31, no 1, 2018, p. 69–96 (ISSN 0835-8443 et 1708-2188, DOI https://doi.org/10.7202/1062547ar, lire en ligne [archive], consulté le 18 août 2020)
96 Mattias Aronsson, « Faïza Guène chez les Vikings : quelques réflexions à propos de la traduction suédoise d’un discours argotique et « beur » », Moderna Språk, vol. 109, no 1, 2015, p. 30–49 (lire en ligne [archive], consulté le 18 août 2020)
97 Chiara Denti, « L’hétérolinguisme ou penser autrement la traduction », Meta : journal des traducteurs / Meta: Translators’ Journal, vol. 62, no 3, 2017, p. 521–537 (ISSN 0026-0452 et 1492-1421, DOI https://doi.org/10.7202/1043946ar, lire en ligne [archive], consulté le 18 août 2020)
98 Chiara Denti, « Traduire un titre hétérolingue : Kiffe kiffe demain de Faïza Guène et ses traductions », Voci della traduzione/Voix de la traduction, 2016 (ISSN 1974-4382, lire en ligne [archive])
99 (en) Jasper Rees, « Unrecognised and unseen », The Telegraph, 30 avril 2006 (lire en ligne [archive])
100 (en) Nicholas Tucker, « Just Like Tomorrow By Faïza Guène, trans Sarah Adams » [archive], sur The Independent, 5 mai 2006
101 (en) Institut Français de Londres, « Faïza Guène at the Institut Français » [archive], sur YouTube, 12 mars 2020
102 (en) « Kathryn Kleppinger, “Branding the Beur Author: Minority Writing and Media in France, 1983-2013” (Liverpool UP, 2015) » [archive], sur Google Podcasts, 12 novembre 2016
103 Jérôme Citron, « Faïza Guène : “ Mes héros sont des gens ordinaires ” » [archive], sur https://www.cfdt.fr/ [archive], 27 février 2015
104 Marjorie Corcier, « Le bateau du 93 va bientôt mettre les voiles » [archive], sur https://www.leparisien.fr/ [archive], 7 avril 2006 (consulté le 18 août 2020)
105 Faïza Guène, « S’il vous plait, cessez de nous Kardashianiser » [archive], sur https://www.buly1803.com/ [archive]
106 Faïza Guène, « Journal de bord d’une femme à deux doigts d’être belle » [archive], sur https://www.buly1803.com/ [archive]
107 Rokhaya Diallo et Grace Ly, « #03 – La geisha, la panthère et la gazelle » [archive], sur YouTube, 9 octobre 2018 (consulté le 18 août 2020)
108 « Lectrices & Lecteurs » [archive], sur Dictée géante (consulté le 18 août 2020)
109 « « La Dictée pour Tous », racontée par son fondateur Abdellah Boudour » [archive], sur Clique.tv, 9 août 2018
110 « A Paris, une bibliothèque prend le nom de Faiza Guene » [archive], sur lecourrierdelatlas, 8 novembre 2018 (consulté le 18 août 2020)
111 Solidarités International, « Le jour où tout a basculé – De Vos Propres Yeux » [archive], sur De vos propres yeux, 2019
112 Diam’s, « L’Honneur d’un peuple » [archive], sur YouTube, 16 novembre 2009
113 « Kiffe aujourd’hui, portrait réaliste et drôle d’un étudiant de banlieue » [archive], sur cnc.fr, 12 septembre 2019
114 (en) « The Story of Babar » [archive], sur The Folio Society (consulté le 17 août 2020)
115 (en-US) « The Folio Society produces a limited edition of Jean de Brunhoff’s The Story of Babar » [archive], sur Entertainment Focus, 19 février 2020 (consulté le 17 août 2020)
116 « Interview. Grace Ly: «J’avais cette histoire en moi depuis des années, j’étais prête» » [archive], sur Paris-Bucarest et retour, 15 décembre 2018 (consulté le 17 août 2020)
117 Amanda Jacquel, « Grace Ly en lutte contre l’invisibilité des Asiatiques de France » [archive], sur Bondy Blog, 6 juin 2018
118 (en) Dominic Thomas, « Documenting the Periphery: The Short Films of Faïza Guène », French Forum, 2010, p. 18 (lire en ligne [archive])
119 Faïza Guène, « La Zonzonnière | Les engraineurs » [archive], sur les-engraineurs.org
120 Anne Fohr, « Le monde selon Faïza », Le Nouvel Observateur, 19 août 2004
121 « RTT | Les engraineurs » [archive], sur les-engraineurs.org (consulté le 18 août 2020)
122 (en) Kathryn Lachman, Edward Said and Assia Djebar: Counterpoint and the Practice of Comparative Literature. In Borrowed Forms: The Music and Ethics of Transnational Fiction, Liverpool, Liverpool University Press, 2014 (ISBN 978-1-78138-596-8, lire en ligne [archive]), pp. 59-88
123 (en) Alison Rice, « Rehearsing October 17, 1961: The Role of Fiction in Remembering the Battle of Paris », L’Esprit Créateur, vol. 54, no 4, 2014, p. 90–102 (ISSN 1931-0234, DOI 10.1353/esp.2014.0051, lire en ligne [archive])
124 « Mémoire du 17 octobre 1961 | Les engraineurs » [archive], sur les-engraineurs.org (consulté le 18 août 2020)
125 (en) « Rien que des mots » [archive], sur Imdb
126 (en) « Des intégrations ordinaires » [archive], sur Imdb
127 (en) « Sol » [archive], sur Imdb
128 Festival du Film Francophone d’Angoulême, « Soeurs | Les avant-premières | Festival du Film Francophone d’Angoulême » [archive], sur Festival du Film Francophone d’Angoulême – 28 août – 02 septembre 2020, 13 juin 2018 (consulté le 17 août 2020)
129 Soeurs (2020) – IMDb (lire en ligne [archive])
***************

« INCIPIT EN W », la maison d’édition que j’ai créée en 2014 a vécu. Voilà. Une belle aventure s’est achevée il y a quelques mois. Fierté d’avoir publié une vingtaine d’auteurs, d’autrices. D’avoir passé des journées entières plongé sur chaque manuscrit, chaque page, chaque ligne, à lire, relire, corriger, échanger avec l’auteur, l’autrice. Des heures entières à corriger, cadrer, rectifier (pour l’imprimeur). Des journées de bureaucratie aussi (Bibliothèque nationale, Urssaf, Impôts…) Les difficultés n’ont pas été en reste. Elles furent nombreuses. Parmi les plus importantes figure la diffusion. La plupart des libraires contactés, suppliés, bousculés, harcelés, etc, n’ont pas vraiment joué le jeu… Pas tous heureusement.
Que chacun des auteurs, autrices, qui nous ont fait confiance soit ici remercié. Je les ai tous en amitié, et en mémoire. Cinq ans c’est une expérience, un parcours, une histoire, une grande satisfaction !… et une exigence d’énergie insoupçonnable. Mais avec à la clé une réelle et belle aventure.
Par: Denis Faïck
Philosophe, maître de conférences, écrivain et critique littéraire, auteur du site philotude.fr
in: www.huffingtonpost.fr/ – 02 octobre 2020
Le livre d’Emmanuel Carrère est l’un des livres dont on parle le plus en cette rentrée littéraire. Le sujet est attirant, et c’est cela qui peut être problématique pour un critique, dans la mesure où il convient de s’extraire de ce qui est attirant dans le sujet pour ne juger que la qualité littéraire.
Un écrivain qui parle de la méditation, du yoga, de sa bipolarité, de sa dépression, de son internement, voilà qui peut en effet être l’objet de l’attention. Je tente de m’extraire de ce sujet pour aller à l’essentiel, à savoir à l’art de l’écrivain.

Pourquoi je n’ai absolument pas aimé ce livre?
L’art, et ici la littérature, a pour sens de se confronter au réel pour nous en dire quelque chose. Il tente de montrer, selon les mots de Paul Valéry, que nous n’avions pas vu ce que nous voyons. D’abord parce que nous n’avons pas vu ce qui est présenté, montré, alors l’art le souligne, le met en exergue, “l’exagère” et ainsi l’accentue pour le montrer.
Mais l’art, aussi, nous fait voir ce que nous n’avons pas vu, parce qu’il va au-delà de ce qui est montré, pour présenter une face du réel non perçue de notre point de vue. L’art, en ce sens, creuse, décortique, ou “tourne” la face visible pour exposer les faces dissimulées au regard.
« On ne fait pas de la littérature avec des phrases qui ne sont que des exposés de sensations immédiates. »
C’est en ce sens que l’art n’est pas factuel; il ne peut se contenter de simplement dire les choses, ce que j’avais déjà écrit dans ma critique du livre Ça raconte Sarah de Pauline Delabroy-Allard. Notre vie courante, à toutes et à tous, dit le fait: j’ai faim, je vais au cinéma, je souffre, je l’aime, etc…; un journaliste dit le fait, un témoignage dit le fait. Mais pas l’artiste. L’artiste l’exprime, le transfigure, le forme et le déforme, et ce n’est pas du tout la même chose.
Il peut dire des choses simples, mais pas simplement, comme, par exemple, montrer un aspect inconnu de la réalité, simple, mais inattendu, ignoré. Là on n’est plus dans le simplisme qui, quant à lui, énonce le fait brut connu de tous, et d’une manière qui appartient à tous.
Le style, selon Proust, c’est donner l’impression au lecteur qu’on lit une langue étrangère dans sa propre langue. On pourrait dire aussi que le style, c’est donner à voir une face du monde qui est énigmatique car jamais perçue, ce qui donne l’aspect de l’étrangeté.
C’est ce que ne fait pas le livre d’Emmanuel Carrère. Tout, ou presque, est factuel dans ce livre. Tout ce qu’il écrit a un sens comme témoignage, journal intime, article dans Psychologie magazine, car ici on expose au premier degré, si j’ose dire, ce qui est immédiatement vécu. Et c’est très bien comme cela, car il n’y a pas de prétention littéraire.
Tirer des citations d’un livre peut le dénaturer, sauf quand tout s’y ressemble.
“On n’en pouvait plus, on a mal partout, on n’a qu’une envie c’est de décroiser les jambes, de s’étirer, d’aller marcher dehors.”
Quand on lit une série de phrases comme celle-ci, censées exprimer le fond des choses dans l’expérience méditative, phrases qui parsèment les 400 pages du livre, on se demande: et donc?
Écrire qu’on s’assoit sur un zafu, qu’on a mal au dos et qu’on a plein de pensées, textuellement, en quoi cela apporte quelque chose au réel? Presque tout est factuel, et la question récurrente qui me vient sans cesse après avoir lu des phrases qui ne font que rapporter des faits qui devraient en rester aux magazines de psychologie: et?
Et après?
Je prends la liberté de citer ma critique de Ça Raconte Sarah, qui est du même ordre que le livre d’Emmanuel Carrère: “Au sens étymologique, exprimer signifie ‘extraire en pressant’. Autrement dit, faire sortir par un acte. La donnée immédiate n’est pas suffisante, alors on agit sur elle, on la malaxe, on la tord, on la saisit pour éclairer ce qui est dedans. Tout art, me semble-t-il, part de ce principe: les données immédiates du vécu, du vu, du senti ne sont pas suffisantes.” Voilà ce que “Yoga” ne fait pas. Il n’exprime pas, il énonce.
Emmanuel Carrère pose un projet: dire que le yoga n’est pas seulement bien, car d’autres l’ont dit. Il veut se placer dans un “autre rayon de librairie que celui du développement personnel.” Autrement dit celui de la littérature. Beau projet.
Il souhaite ainsi dire que le yoga et la méditation sont aussi “un rapport au monde”, une “voie de connaissance, un mode d’accès au réel dignes d’occuper une place centrale dans nos vies.” Certes, mais cela, pour qui connaît un peu le yoga et la méditation, est fort connu. L’écrivain doit alors dire autre chose, montrer autre chose d’une autre manière. Or le livre est à l’image de la citation suivante:
“Je regarde les dos, je regarde les nuques. Je me demande qui a mal comme moi, qui s’ennuie, qui plane, qui flippe (…) C’est un drôle de spectacle, émouvant.” Quel spectacle ! Toutes ces “personnes réunies pour dix jours dans un hangar pour plonger chacun en soi-même, savoir mieux qui il est, savoir mieux ce qui le meut.”
Bien sûr, on pourra dire que je sors cela du contexte. Oui, mais tout est globalement sur le même mode. Ce mode on le trouve dans n’importe quel journal de témoignages de développement personnel.
La science, d’ailleurs, la physique, l’histoire, la biologie, la philosophie, font la même chose que l’art. Elles dépassent les faits pour aller au-delà. On ne fait pas de science avec les sens. De même on ne fait pas de la littérature avec des phrases qui ne sont que des exposés de sensations immédiates, de pensées immédiates qui sont écrites telles qu’elles le sont dans n’importe quel journal individuel qui énonce des faits. Sinon, quelle serait la différence entre la littérature et le reste?
La révélation de sa faiblesse, de ses défauts, de sa maladie, de ses tourments n’est pas suffisante non plus pour faire un bon livre, et a fortiori un grand livre. Rousseau l’a fait avec Les Confessions en fondant l’autobiographie moderne, et sans doute d’autres après lui. Alors, pour écrire un grand livre, il faut le faire mais comme d’autres ne l’ont pas fait. Or l’auteur, ici, par le simplisme de son langage, en reste au premier degré d’un journal intime que tout un chacun peut écrire, à condition de savoir un peu écrire.
Sur son trouble bipolaire et sa thérapie, on apprend ce qu’on peut apprendre sur n’importe quel site spécialisé ou dans n’importe quel livre sur la question, mais cela n’est pas l’essentiel. L’essentiel c’est qu’on l’apprend de la même manière : “La tachypsychie, c’est comme la tachycardie, mais pour l’activité mentale.” Ou encore : “J’ai traversé en plus de ce qu’on peut appeler des passages à vide deux phases de vraie dépression, de dépression sévère, celle qui fait que pendant plusieurs mois on ne se lève presque plus, ne parvient plus à accomplir les tâches élémentaires de la vie et surtout ne peut plus imaginer qu’autre chose adviendra.”
Oui, et donc? Cette description peut être celle d’un dictionnaire de psychologie.
Ou encore à propos de la bipolarité :“Quand on est dans la phase dépressive, on se rend forcément compte qu’on y est c’est horrible, c’est l’enfer, mais au moins on ne peut pas s’y tromper. Alors que la phase maniaque a ceci d’insidieux qu’on ne se rend pas compte que c’est une phase maniaque.”
Cela on peut le lire dans un compte-rendu sur la bipolarité, de la même manière. Et tout le reste est du même ordre. Donc toujours la même question : et donc ?
Le fond et la forme, ici, ne disent rien de plus qu’un exposé. Et tout le livre, ou presque, est comme cela. Sur le fond et la forme: “Il est vital, dans les ténèbres, de se rappeler qu’on a aussi vécu dans la lumière et que la lumière n’est pas moins vraie que les ténèbres.”
Certes, mais opposer lumière et ténèbres est une opposition tellement connue que l’écrivain doit au moins la revisiter. Ici, rien de nouveau sous le soleil.
Mélanger les genres, un peu essai, un peu exposé, un peu autofiction, un peu biographie, un peu journalisme, est très intéressant, mais cela ne suffit pas à faire un livre remarquable. Il ne suffit pas, non plus, de parler des réfugiés, des Syriens et autres pour faire un livre saisissant.
« Pour écrire un grand livre, il faut le faire comme d’autres ne l’ont pas fait. »
Cette idée de Paul Klee: l’art ne reproduit pas le visible, il rend visible. Voilà, l’écrivain doit extraire du monde et on extrait par ce que l’artiste ajoute au monde dans sa forme.
Enfin, même si l’écrivain peut énoncer un universel, et donc partagé par tous, il doit je pense exprimer son expérience singulière, ce à quoi je ne peux pas accéder, ce qui lui est propre et qui en fait une origine. Or ici il dit ce que tout pratiquant de la méditation sait. Il dit ce que les personnes qui connaissent un peu la bipolarité savent. En bref, comme on enfonce des portes ouvertes, il expose tel quel un vécu commun et qui me fait encore poser la même question: et donc? Et après?
Et l’amour. Peut-être y aura-t-il ici quelque chose.
Il craint que s’achève ce qu’il vit avec une femme: “Fini de descendre acheter la baguette fraîche et de presser des oranges avant qu’elle se réveille. Fini de la suivre des yeux quand elle traverse l’appartement vêtue de votre seul tee-shirt. Fini de s’envoyer trente textos par jour (…) Finie l’expression de son visage au moment où vous entrez en elle, et fini de soupirer ‘Oh là là’, en même temps, parce que c’est tellement bon.”
Oui certes, mais c’est gentil, c’est sympathique et c’est bien. Mais on attend je crois autre chose d’un livre de littérature.
Une belle phrase: “Je continue à ne pas mourir.” Magnifique phrase. Sans doute la plus belle du livre. Seulement elle n’est pas de l’auteur. Elle ouvre un monde qui engloutit le reste du livre.
Je précise. Il y a une manière d’être factuel. Mais là, après une phrase, deux, trois peut-être, survient la révélation, le mot qui renverse, ou même le silence qui fait du texte une chose nouvelle, surprenante, ou tellement habituelle qu’on l’avait oubliée. C’est le surgissement qui est l’ajout que l’art amène aux choses.
Alors comment expliquer cet engouement pour ce livre qui est en plus sur la liste du prix Goncourt? Nous savons qu’avant de lire un livre, nous sommes d’abord influencés par le nom de l’auteur, puis par le sujet. Or ce n’est en rien ce qui fait l’essence d’un livre.
Alors c’est peut-être parce qu’il construit bien ses phrases dans le respect de la syntaxe et de la grammaire. Oui, comme le font tous les agrégés de lettres.
Un mot sur le fond du livre: je souffre, des gens souffrent, nos proches, des étrangers souffrent.
Oui, certes, bien sûr. Et Emmanuel Carrère nous l’apprend-il ?
Peut-être ai-je raté quelque chose...
———
J’apprends que l’émission hebdomadaire sur Canal Algérie « Culture club » est définitivement arrêtée. La censure est exécrable. Je comprends bien ce tollé naissant à la suite de la suppression de l’émission « Culture Club », je l’entends bien. Au pays de l’aveugle le borgne est roi. Je veux dire que les émissions culturelles sont rares dans la sphère médiatique algérienne, si l’on met de côté la chanson et le bendir. Et dans ce désert culturel, Culture club apparaissait comme une lumière, ce qu’elle n’était pas du tout. Disons qu’elle barbotait dans une marre. Il reste néanmoins que sa « liquidation » est à dénoncer. Je ne connais pas les dessous de cette suppression et ce qui est prévu pour remplacer l’émission, si tant est qu’on ait prévu quoi que ce soit. Mais je peux néanmoins écrire qu’à part quelques rares moments d’exception, ça ronronnait en rond dans « Culture Club arobase point com ». On n’a jamais entendu quelque réflexion que ce soit d’un téléspectateur, très sollicité par ailleurs, via le ridicule « vos questions, vos réactions ». Je n’ai jamais entendu un point de vue, ou une question d’un téléspectateur alors qu’il est sans cesse sollicité « n’oubliez-pas ‘culture club arobase point com’ » disais-je. Ça ronronnait et ça se léchait en famille. Je t’embrasse, tu m’embrasses, on connaît la chanson. Ça sentait souvent le détestable copinage.Toujours les mêmes poncifs, les mêmes phrases stéréotypées, les mêmes arguties. Toujours rester lisse, caresser ou pourfendre dans le sens du poil, aucun débordement non autorisé. La peur donc. Toujours les mêmes salamalecs, peu de profondeur, peu de recherche, peu de réflexion sur l’art, la littérature…. Les mots galvaudés, dénués de sens sont repris, étalés pour épater comme on étale le peu de confiture qu’on possède pour montrer aux voisins qu’on en possède de la confiture (culture). «Nos agitateurs », agitateurs dans un bocal ou un verre de thé peut-être. La parole donnée à l’invité, lui était vite reprise par le présentateur qui adorait s’entendre parler en remuant ses yeux et sa grosse gourmette en or (ou argent) « n’oubliez pas arobase entv point dz » qu’il répétait ainsi que d’autres termes-tics à en devenir malade. Toujours (ou presque) les mêmes troncs qui circulent en rond depuis des années. Où Kateb Yacine, Mimouni, Djaout, Martinez et d’autres monopolisaient, à leur corps défendant, l’essentiel du temps alors que les jeunes espoirs, parfois brillants, sont abandonnés à eux-mêmes. Et il y en a pourtant à la pelle dans les trois langues, j’en ai rencontré. Alors que des sommités (algériennes bien sûr) de la littérature francophone, saluées dans le monde entier, étaient reniées. Ordre politique: Boualem Sansal, Kamel Daoud, Salim Bachi, Maïssa Bey… Ah, Culture club, la facilité et le copinage très souvent. Je t’invite, tu m’invites…. Mais, hélas, hada ma halbet. Je préférais de loin, de très loin, l’émission de Youcef Saïeh « Expression Livres » qui, sans se la péter (désolé), nous persuadait qu’il en savait quelque chose du titre en question dans l’émission, qu’il avait lu de fond en comble le livre de l’invité. C’est vrai qu’il parlait beaucoup aussi, mais pas dans le vide, il ne soufflait pas du vent pour le vent. Et il posait de nombreuses questions à l’invité, le poussait pour en dire toujours plus sur ses écrits. Tel est mon point de vue.
*************
_______________________________
SUR FACEBOOK :


____________________________
LE SOIR D’ALGERIE:

La scène artistique indignée
Suppression de l’émission «Culture club»
Publié par Sarah Haidar – le 03.10.2020 , 11h00
C’était l’un des rares programmes culturels de Canal Algérie et rien que par son existence, l’émission « Culture Club » faisait beaucoup d’heureux parmi l’audimat d’une télévision publique exsangue.
Présentée par Karim Amiti, l’émission culturelle hebdomadaire « Culture Club » n’est plus. Les raisons de la suppression des programmes de la grille de Canal Algérie ne sont pas explicitées, mais il s’agirait, selon nombre d’acteurs du domaine, de censure.
Écrivains, musiciens, plasticiens, femmes et hommes de théâtre, ou encore cinéastes et comédiens, « Culture Club » invitait chaque semaine un groupe d’artistes et auteurs pour discuter de leurs œuvres. En effet, tout dans le contexte actuel marqué par la lutte contre la diversité d’idées et le débat contradictoire laisse penser que l’émission où des invités de tous horizons et de tous bords idéologiques venaient s’exprimer a été censurée. La suppression « définitive » de cette émission a suscité une vague d’indignation au sein du milieu artistique et littéraire où de nombreux acteurs ont dénoncé ce qu’ils considèrent comme de la censure. L’écrivaine Amina Mekahli rend hommage au « professionnalisme, l’humanisme et l’humilité » avec lesquels Karim Amiti « a œuvré au rayonnement de la littérature et de la culture algériennes ». Et de conclure : « Ils peuvent arrêter une émission mais jamais ils ne pourront arrêter la passion qui l’anime .» Le professeur d’arts dramatiques Habib Boukhelifa dénonce « le retour de la pensée unique et de la chape de plomb » et regrette « une émission phare que les Algériens adorent ». La metteure en scène Hamida Aït el Hadj, pour sa part, crie « au secours, la guillotine est sortie du musée » et déplore la mort d’une émission que «tous attendaient : les artistes, les écrivains, les plasticiens » et tous ceux qui « croyaient en une renaissance de la culture algérienne ». Tout aussi affligé, le pédagogue et ancien conseiller au ministère de l’Education nationale Ahmed Tessa parle d’une « mort en direct » et regrette « la rare, pour ne pas dire la seule bouffée d’oxygène dans le champ télévisuel algérien. Toutes mes condoléances aux amis de la culture, aux écrivains, artistes, universitaires et auteurs suite à ce décès programmé de la culture ». Raja Alloula, la présidente de la Fondation Alloula et veuve du défunt metteur en scène, se dit, quant à elle, « ahurie et stupéfaite par l’arrêt de l’émission qui, depuis des années, nous réconcilie avec la télévision algérienne. Une émission où la création est mise à nu, où la riche discussion va dans les profondeurs de la création, où un animateur pose les questions qu’il faut pour la connaissance d’une œuvre artistique. En retour, le riche débat qui s’ensuit nous pousse à lire, à acheter des ouvrages pour enrichir notre bibliothèque (pour ceux qui en ont une). L’animateur de cette émission est, progressivement, devenu notre ami, celui qui nous révèle depuis des années les méandres de l’univers des artistes. C’est ainsi que nous faisons souvent connaissance avec des noms de notre culture qu’aucun autre espace télévisé ne présente ».
Un autre son de cloche, beaucoup moins consensuel et néanmoins intéressant, vient de l’auteur et universitaire Ahmed Hanifi qui publie sur son blog un texte où il commence par dénoncer la « liquidation » de « Culture Club » mais exprime un avis tranché sur cette émission où « à part quelques rares moments d’exception, ça ronronnait en rond. (…) Ça sentait souvent le détestable copinage. Toujours les mêmes poncifs, les mêmes phrases stéréotypées, les mêmes arguties. Toujours rester lisse, caresser ou pourfendre dans le sens du poil, aucun débordement non autorisé. La peur donc. Toujours les mêmes salamalecs, peu de profondeur, peu de recherche, peu de réflexion sur l’art, la littérature…. Les mots galvaudés, dénués de sens sont repris, étalés (…) »
S. H.
—————–
Nous sommes arrivés à Manosque samedi matin pour le week-end. Un froid de canard et un vent léger, mais quand même, pas très agréable.

Soleil de circonstance, pâlot. Ces 22° Correspondances (du 23 au 27 septembre) se présentent avec timidité dirais-je. Covid-19 exige. Une cinquantaine d’auteurs cette année se sont présentés contre le double habituellement. Le public est nombreux pour chaque auteur dans les différents lieux d’intervention au cœur de la ville de Giono.
Nous avons assisté à l’intervention d’Adèle Van Reeth qui a présenté son livre « La vie ordinaire » (Gallimard). Elle pose la question de l’intranquillité qui nous saisit de temps en temps. Elle nous propose son regard à partir de sa propre expérience de l’apprentissage de la vie intellectuelle et de la maternité. Ecoutez-la sur la vidéo.

Un peu plus tard c’est Rebecca Lighieri qui propose « Il est des hommes qui se perdront toujours » (POL). L’histoire d’un Marseillais des quartiers nord, Karel, avec sa petite famille il survit comme il peut comme c’est généralement le cas dans les quartiers populaires, entre drogue et pauvreté.
Sur la place de l’Hôtel de ville nous avons assisté à la belle intervention d’Eric Reinhard qui a présenté « Comédies françaises » (Gallimard)

Le froid ne nous a pas permis de rester jusqu’à la fin. Je me dois de dire qu’à la vérité il ne faisait pas très froid, mais j’avais (étourdi) oublié que Manosque est à quelques tires d’ailes des Alpes et qu’il y fait froid. Son climat n’est pas du tout celui de mon environnement au bord de la Méditerranée.



Apreès Reinhard nous avons fait un petit saut sur la place Marcel Pagnol. Deux autrices, Dima Abdallah et Sarah Chiche parlaient de leurs romans, respectivement « Mauvaises herbes » (Sabine Wespieser) et « Saturne » (Seuil)


Le Centre Jean Giono


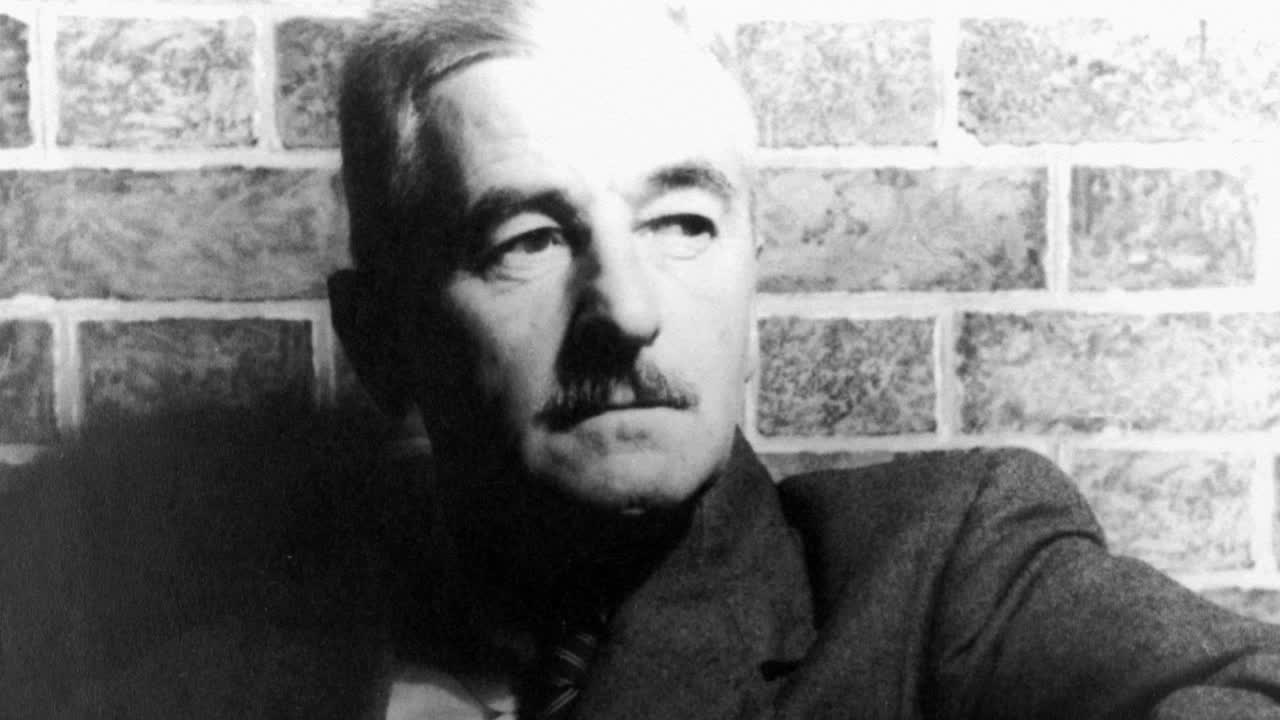
Nous sommes le 25 septembre, jour anniversaire de la naissance d’un génie de la littérature universelle, William Faulkner.
A cette occasion je vous donne à lire une de ses plus célèbres nouvelles, « Une rose pour Emily », écrite alors qu’il avait 32 ans. On la trouve dans le recueil Treize histoires (These Thirteen).
Puis je vous fais suivre un article complet que j’avais écrit en septembre 1997, article paru dans le quotidien algérien, disparu depuis, LA TRIBUNE, (de feu Kh. Ameyar)
Et, à la suite, de nombreux liens très utiles… Avec vidéos etc…
*************

William Faulkner dans sa ferme
UNE ROSE POUR EMILY
.
UNE ROSE POUR EMILY
(Traduit par M.-E. Coindreau)
1
Quand Miss Emily Grierson mourut, toute notre ville alla à l’enterrement : les hommes, par une sorte d’affection respectueuse pour un monument disparu, les femmes, poussées surtout par la curiosité de voir l’intérieur de sa maison que personne n’avait vu depuis dix ans, à l’exception d’un vieux domestique, à la fois jardinier et cuisinier.
C’était une grande maison de bois carrée, qui, dans le temps, avait été blanche. Elle était décorée de coupoles, de flèches, de balcons ouvragés, dans le style lourdement frivole des années 70, et s’élevait dans ce qui avait été autrefois notre rue la plus distinguée. Mais les garages et les égreneuses à coton, empiétant peu à peu, avaient fait disparaître jusqu’aux noms augustes de ce quartier ; seule, la maison de Miss Emily était restée, élevant sa décrépitude entêtée et coquette au-dessus des chars à coton et des réservoirs à essence. Elle n’était plus la seule à outrager la vue. Et voilà que Miss Emily était allée rejoindre les représentants de ces augustes noms dans le cimetière assoupi sous les ifs, où ils gisaient parmi les tombes alignées et anonymes des soldats de l’Union et des Confédérés morts sur le champ de bataille de Jefferson.
De son vivant, Miss Emily avait été une tradition, un devoir et un souci ; une sorte de charge héréditaire qui pesait sur la ville depuis ce jour où, en 1894, le Colonel Sartoris, le maire – celui qui lança l’édit interdisant aux négresses de paraître dans les rues sans tablier – l’avait dispensée de payer les impôts, dispense qui datait de la mort de son père et s’étendait jusqu’à perpétuité. Non que Miss Emily eût jamais accepté qu’on lui fît la charité. Le Colonel Sartoris avait inventé l’histoire compliquée d’un prêt d’argent que le père de Miss Emily aurait fait à la ville et que la ville, pour raison d’affaires, préférait rembourser de cette façon-là. Il n’y avait qu’un homme de la génération avec le cerveau du Colonel Sartoris pour avoir pu imaginer une chose pareille, et il n’y avait qu’une femme pour l’avoir pu croire.
Quand la génération suivante, avec ses idées modernes, donna à son tour des maires et des conseillers municipaux, cet arrangement souleva quelques mécontentements. Le premier janvier ils lui envoyèrent une feuille d’imposition. Février arriva sans apporter de réponse. Ils lui envoyèrent une lettre officielle, la priant de passer, quand elle le jugerait bon, au bureau du shériff. La semaine suivante, le maire lui écrivit lui-même, lui offrant d’aller chez elle ou de l’envoyer chercher en voiture. En réponse il reçut un billet où, sur un papier d’une forme archaïque, d’une écriture courante et menue à l’encre passée, elle lui disait qu’elle ne sortait plus du tout. La feuille d’impôts était incluse, sans commentaires.
Le conseil municipal siégea en séance extraordinaire. Une députation se rendit chez elle et frappa à cette porte qu’aucun visiteur n’avait franchie depuis que, huit ou dix ans auparavant, elle avait cessé de donner des leçons de peinture sur porcelaine. Le vieux nègre la fit entrer dans un hall obscur d’où un escalier montait se perdre dans une ombre encore plus profonde. Il y régnait une hauteur de poussière, de chose qui ne sert pas ; une odeur de renfermé et d’humidité. Le nègre les conduisit dans le salon. L’ameublement en était lourd, les sièges couverts en cuir. Quand le nègre ouvrit les rideaux d’une des fenêtres, ils virent que le cuir était craquelé ; et, quand ils s’assirent, un léger nuage de poussière monta paresseusement autour de leurs cuisses et, en lentes volutes, les atomes s’élevèrent dans l’unique rais de soleil. Près de la cheminée, sur un chevalet à la dorure ternie, se trouvait un portrait au crayon du père de Miss Emily.
Ils se levèrent quand elle entra. Elle était petite, grosse, vêtue de noir, avec une mince chaîne d’or qui lui descendait jusqu’à la taille et disparaissait dans sa ceinture, et elle s’appuyait sur une canne d’ébène à pomme d’or ternie. Son ossature était mince et frêle. C’est peut-être pour cela que ce qui chez une autre n’aurait été que de l’embonpoint, était chez elle de l’obésité. Elle avait l’air enflée, comme un cadavre qui serait resté trop longtemps dans une eau stagnante, elle en avait même la teinte blafarde. Ses yeux, perdus dans les bourrelets de sa face, ressemblaient à deux petits morceaux de charbon enfouis dans une boule de pâte, tandis qu’elle les promenait d’un visage à l’autre, en écoutant les visiteurs présenter leur requête.
Elle ne les invita pas à s’asseoir. Elle se contenta de rester debout sur le seuil, attendant tranquillement que le porte-parole se soit arrêté, balbutiant. Ils purent entendre alors le tic-tac de la montre invisible attachée à la chaîne d’or.
Sa voix était sèche et froide : « Je n’ai pas d’impôts à payer à Jefferson. Le Colonel Sartoris me l’a expliqué. Peut-être un d’entre vous pourra-t-il consulter les archives de la ville, et vous donner à tous satisfaction. »
2
Ainsi, ils furent vaincus, bel et bien, comme l’avaient été leurs pères, trente ans auparavant, au sujet de l’odeur. Cela se passait deux ans après la mort de son père et peu de temps après que son amoureux – celui qui, pensions-nous, allait l’épouser – l’eut abandonnée. Après la mort de son père, elle sortit très peu ; après que son amoureux fut parti, on ne la vit pour ainsi dire plus. Quelques dames eurent la témérité d’aller lui rendre visite, mais elles ne furent point reçues et, autour de la maison, il n’y eut d’autre signe de vie que le nègre, jeune à cette époque, qui entrait et sortait avec un panier de marché.
Une voisine alla se plaindre au maire, le juge Stevens, âgé alors de quatre-vingt ans.
Le lendemain il reçut deux autres plaintes. L’une émanait d’un homme qui se présenta, timide et suppliant : « Il faut absolument faire quelque chose, Monsieur le juge. Pour rien au monde je ne voudrais ennuyer Miss Emily, mais il faut que nous fassions quelque chose ».
Ce soir-là le conseil municipal se réunit : trois barbes grises et un jeune homme, un membre de la nouvelle génération.
Alors, la nuit suivante, un peu après minuit, quatre hommes traversèrent la pelouse de Miss Emily et, comme des cambrioleurs, rodèrent autour de la maison, reniflant le soubassement de brique et les soupiraux de la cave, tandis que l’un d’eux, un sac sur l’épaule, faisait régulièrement le geste du semeur. Ils enfoncèrent la porte de la cave qu’ils saupoudrèrent de chaux, ainsi que toutes les dépendances. Comme ils retraversaient la pelouse, ils virent qu’une fenêtre, sombre jusqu’alors, se trouvait éclairée. Miss Emily s’y tenait assise, à contre-jour, droite, immobile comme une idole. Silencieusement ils traversèrent la pelouse et se glissèrent dans l’ombre des acacias qui bordaient la rue. Au bout d’une quinzaine l’odeur disparut.
C’est alors que les gens commencèrent à avoir vraiment pitié d’elle. Les gens de la ville qui se rappelaient comment la vieille Mme Wyatt, sa grand-tante, avait fini par devenir complètement folle, trouvaient que les Grierson se croyaient peut-être un peu trop supérieurs, étant donné ce qu’ils étaient. Il n’y avait jamais de jeune homme assez bon pour Miss Emily. Nous nous les étions souvent imaginés comme des personnages de tableau : dans e fond, Miss Emily, élancée, vêtue de blanc ; au premier plan son père, lui tournant le dos, jambes écartées, un fouet à la main, tous les deux encadrés par le chambranle de la porte d’entrée grande ouverte. Aussi, quand elle atteignit la trentaine sans s’être mariée, je ne dis pas que cela nous fît vraiment plaisir, mais nous nous sentîmes vengés. Même avec des cas de folie dans la famille, elle n’aurait pas refusé tous les partis s’ils s’étaient réellement présentés.
A la mort de son père le bruit courut que la maison était tout ce qui lui restait, et, d’un côté, les gens n’en furent pas fâchés. Ils pouvaient enfin avoir pitié de Miss Emily. Seule et dans la misère, elle s’était humanisée. Maintenant, elle aussi allait connaître cette vieille joie et ce vieux désespoir d’un sou de plus ou de moins.
Le lendemain de la mort de son père, toutes les dames s’apprêtèrent à aller la voir pour lui offrir aide et condoléances, ainsi qu’il est d’usage. Miss Emily les reçut à la porte, habillée comme de coutume, et sans la moindre trace de chagrin sur le visage. Elle leur dit que son père n’était pas mort. Elle répéta cela pendant trois jours, tandis que les pasteurs venaient la voir, ainsi que les docteurs, dans l’espoir qu’ils la défiguraient à les laisser disposer du corps. Juste au moment où ils allaient recourir à la loi et à la force, elle céda, et ils enterrèrent son père au plus vite.
Personne ne dit alors qu’elle était folle. Nous croyions qu’elle ne pouvait faire autrement. Nous nous rappelions tous les jeunes gens que son père avait écartés, et nous savions que, se trouvant sans rien, elle devait se cramponner à ce qui l’avait dépossédée, comme on fait d’ordinaire.
3
Elle fur longtemps malade. Quand nous la revîmes elle avait les cheveux courts, ce qui lui donnait l’apparence d’une jeune fille et une vague ressemblance avec les anges des vitraux d’église, quelque chose de tragique et de serein.
La ville venait juste de passer les contrats pour le pavage des trottoirs et, pendant l’été qui suivit la mort de son père, on commença les travaux. La Société de construction arriva avec des nègres, des mulets, des machines et un contre-maître nommé Homère Barron, un Yankee grand gaillard brun et décidé, avec une grosse voix et des yeux plus clairs que son teint. Les petits enfants le suivaient en groupe pour l’entendre jurer contre les nègres, les nègres qui chantaient en mesure tout en levant et abaissant leurs pioches. Il ne tarda pas à connaître tout le monde dans la ville. Chaque fois qu’on entendait de grands éclats de rire sur la place, on était sûr qu’Homère Barron était au centre du groupe. On ne tarda pas à le voir, le dimanche après-midi, se promener avec Miss Emily, dans le cabriolet du loueur de voitures avec ses roues jaunes et sa paire de chevaux bais.
Tout d’abord nous nous réjouîmes de voir que Miss Emily avait maintenant un intérêt dans la vie, parce que toutes les dames disaient :
Mais il y en avait d’autres, des gens plus âgés, qui disaient que même le chagrin ne devait pas faire oublier à une grande dame que NOBLESSE OBLIGE, sans appeler ça, NOBLESSE OBLIGE (en français dans le texte). Ils se contentaient de dire :
Elle avait des parents en Alabama, mais, dans le temps, son père s’était brouillé avec eux au sujet de la succession de la vieille Mme Wyatt, la folle, et les deux familles avaient cessé de se voir. Personne n’était même venu à l’enterrement.
Et aussitôt que les vieilles gens eurent dit : « Pauvre Emily », on commença à chuchoter : « Comment, vous pensez vraiment… ? disait-on. – Mais bien sûr, pour qu’elle autre raison voudriez-vous… ? » Cela derrière les mains ; crissement de soie et de satin qui se tendaient pour apercevoir, de derrière les jalousies, fermées sur le soleil des dimanches après-midi, la paire de chevaux bais passant dans un léger et rapide clop-clop-clop. – « Pauvre Emily ! »
Elle portait la tête assez haute, même alors que nous pensions qu’elle était déchue. On eût dit qu’elle exigeait plus que jamais que l’on reconnût la dignité attachée à la dernière des Grierson. Il semblait que ce rien de vulgarité terrestre ne faisait qu’animer d’avantage son impénétrabilité. C’est comme le jour où elle acheta la mort aux rats, l’arsenic. C’était plus d’un an après qu’on avait commencé à dire : « Pauvre Emily », et pendant que ses deux cousines habitaient avec elle.
Le droguiste en énuméra quelques-uns. « Ils tueraient un éléphant. Mais ce que vous voulez, c’est…
Le droguiste la regarda. Elle le dévisagea, droite, le visage comme un drapeau déployé. – Mais, naturellement, dit le grossiste, si c’est ce que vous voulez. Seulement, voilà, la loi exige que vous disiez à quoi vous voulez l’employer.
Miss Emily se contenta de le fixer, la tête renversée afin de pouvoir le regarder, les yeux dans les yeux, si bien qu’il détourna ses regards et alla chercher l’arsenic qu’il enveloppa. Le petit livreur nègre lui apporta le paquet ; le droguiste ne reparut pas. Quand, arrivée chez elle, elle ouvrit le paquet, il y avait écrit sur la boîte, sous le crâne et les os en croix : « Pour les rats ».
4
Aussi, le lendemain, tout le monde disait : Elle va se tuer ; et nous trouvions que c’était ce qu’elle avait de mieux à faire. Au début de ses relations avec Homère Barron, nous avions dit : « Elle va l’épouser. » Plus tard nous dîmes : « Elle finira bien par le décider » ; parcequ’Homère lui-même avait remarqué – Il aimait la compagnie des hommes et on savait qu’il buvait avec les plus jeunes membres Elk’s Club – qu’il n’était pas un type à se marier. Plus tard nous dîmes « Pauvre Emily » derrière les jalousies, quand il passait, le dimanche après-midi, dans le cabriolet étincelant, Miss Emily, la tête haute, et Homère Barron, le chapeau sur l’oreille, le cigare aux dents, les rennes et le fouet dans un gant jaune.
Alors quelques dames commencèrent à dire que c’était là une honte pour la ville et un mauvais exemple pour la jeunesse. Les hommes n’osèrent point intervenir, mais à la fin les dames obligèrent le pasteur baptiste – la famille d’Emily était épiscopale – à aller la voir. Il ne voulut jamais révéler ce qui c’était passé au cours de cette entrevue, mais il refusa d’y retourner. Le dimanche suivant, ils sortirent encore en voiture et, le lendemain, la femme du pasteur écrivit ux parents d’Emily, en Alabama.
Elle eut donc à nouveau de la famille sous son toit, et tout le monde s’apprêta à suivre les événements. Tout d’abord il ne se passa rien. Ensuite, nous fûmes convaincus qu’ils allaient se marier. Nous apprîmes que Miss Emily était allée chez le bijoutier et avait commandé un nécessaire de toilette pour homme avec les initiales H.B. sur chaque pièce. Deux jours après, nous apprîmes qu’elle avait acheté un trousseau d’homme complet y compris une chemise de nuit, et nous dîmes : « Ils sont mariés. » Nous étions vraiment contents. Nous étions contents parce que les deux cousines étaient encore plus Grierson que Miss Emily ne l’avait jamais été.
Nous ne fûmes donc pas surpris lorsque, quelque temps après que les rues furent terminées, Homère Barron s’en alla. On fut un peu déçu qu’il n’y ait pas eu de réjouissances publiques mais on crut qu’il était parti pour préparer l’arrivée de Miss Emily ou pour lui permettre de se débarrasser des cousines. (Nous formions alors une véritable cabale et nous étions tous les alliés de Miss Emily pour l’aider à circonvenir les cousines.) Ce qu’il y a de certain, c’est qu’au bout d’une semaine, elles partirent. Et, comme nous nous y attendions, trois jours ne s’étaient pas écoulés que Homère Barron était de retour dans notre ville. Un voisin vit le nègre le faire entrer par la porte de la cuisine, un soir, au crépuscule.
Nous ne revîmes plus jamais Homère Barron et pendant quelque temps, nous ne vîmes pas Emily non plus. Le nègre entrait et sortait avec son panier de marché, mais la porte d’entrée restait close. De temps à autre, nous la voyions un moment à sa fenêtre, comme le soir où les hommes allèrent répandre de la chaux chez elle, mais pendant plus de six mois, elle ne parut dans les rues. Nous comprîmes qu’il fallait aussi s’attendre à cela ; comme si cet aspect du caractère de son père qui avait si souvent contrarié sa vie de femme avait été trop virulent trop furieux pour mourir.
Quand nous revîmes Miss Emily, était devenue obèse et ses cheveux grisonnaient. Dans les années suivantes, elle devint de plus en plus grise jusqu’au moment où, ayant pris une couleur gris-fer poivre et sel, sa chevelure ne changea plus. Le jour de sa mort, à soixante-quatorze ans, ses cheveux étaient encore de ce gris fer vigoureux, comme ceux d’un homme actif.
A dater de cette époque, sa porte resta fermée sauf pendant une période de six ou sept ans, alors que, âgée d’environ quarante ans, elle donnait des leçons de peinture sur porcelaine. Elle installa, dans une des pièces du rez-de-chaussée, un atelier où les filles et les petites-filles des contemporains du Colonel Sartoris lui furent envoyées avec la même régularité et dans le même esprit qu’elles étaient envoyées, à l’église, le dimanche, avec une pièce de vingt-cinq sous pour la quête. Cependant elle avait été déchargée d’impôts.
La nouvelle génération devint alors le pilier, l’âme de a ville, et les élèves du cours de peinture grandirent et se dispersèrent et ne lui envoyèrent pas leurs filles avec des boîtes de couleur, des pinceaux ennuyeux, et des images découpées dans les journaux de dames. La porte se referma sur la dernière élève et resta fermée pour de bon. Quand la ville obtint la distribution gratuite du courrier, Miss Emily fut la seule à refuser de laisser mettre un numéro au-dessus de sa porte et d’y laisser fixer une boîte à lettre. Elle ne voulut rien entendre.
Tous les jours, tous les mois, tous les ans, nous regardions le nègre devenir de plus en plus gris, de plus en plus voûté, entrer et sortir avec son panier de marché. A chaque mois de décembre on lui envoyait une feuille d’impositions que la poste nous retournait la semaine suivante avec la mention « non réclamée ». De temps à autre nous l’apercevions à une des fenêtres du rez-de-chaussée – elle avait évidemment fermé le premier – semblable au torse sculpté d’une idole dans sa niche et nous ne savions jamais si elle nous regardait ou si elle ne nous regardait pas. Et elle passa ainsi de génération en génération chère inévitable, impénétrable, tranquille et perverse.
Et puis elle mourut. Elle tomba malade dans la maison remplie d’ombres et de poussières avec, pour toute aide, son nègre gâteux. Nous ne sûmes même pas qu’elle était malade ; il y avait longtemps que nous avions renoncé à obtenir des renseignements du nègre. Il ne parlait à personne, même pas à elle probablement, car sa voix était devenue rauque et rouillée à force de ne pas servir.
Elle mourut dans une des pièces du rez-de-chaussée, dans un lit en noyer massif garni d’un rideau, sa tête grise soulevée par un oreiller jaune et moisi par l’âge et le manque de soleil.
5
Le nègre vint à la porte recevoir la première des dames. Il les fit entrer avec leurs voix assourdies et chuchotantes, leurs coups d’œil rapides et furtifs, puis il disparut. Il traversa toute la maison, sortit par derrière et on ne le revit plus jamais.
Les deux cousines arrivèrent tout de suite. Elles firent faire l’enterrement le second jour. Toute la ville vint regarder Miss Emily sous une masse de fleurs achetées. Le portrait au crayon de son père rêvait d’un air profond au-dessus de la bière, les dames chuchotaient, macabres, et, sur la galerie et sur la pelouse, les très vieux messieurs – quelques-uns dans leurs uniformes bien brossés de Confédérés – parlaient de Miss Emily comme si elle avait été leur contemporaine, se figurant qu’ils avaient dansé avec elle, qu’ils l’avaient courtisée peut-être, confondant le temps et sa progression mathématique, comme font les vieillards pour qui le passé n’est pas une route qui diminue mais, bien plutôt, une vaste prairie que l’hiver n’atteint jamais, divisée pour eux par l’étroit goulot de bouteille des dix dernières années.
Nous savions déjà qu’au premier étage i y avait une chambre qui n’avait pas été ouverte depuis quarante ans et dont il nous faudrait enfoncer la porte. On attendit pour l’ouvrir que Miss Emily fût décemment ensevelie.
Sous la violence du choc, quand on défonça la porte, la chambre parut s’emplir d’une poussière pénétrante. On aurait dit qu’un poêle mortuaire ténu et âcre, était déployé sur tout ce qui se trouvait dans cette chambre parée et meublée comme des épousailles, sur les rideaux de damas d’un rose passé, sur les abat-jour roses des lampes, sur la coiffeuse, sur les délicats objets de cristal, sur les pièces du nécessaire de toilette avec leurs dos d’argent terni, si terni que le monogramme en était obscurci. Parmi ces pièces se trouvaient un col et une cravate, comme si on venait juste de les enlever. Quand on les souleva ils laissèrent sur la surface un pâle croissant dans la poussière. Le vêtement était soigneusement plié sur une chaise sous laquelle gisaient les chaussettes, et les souliers muets.
L’homme lui-même était couché sur le lit.
Pendant longtemps, nous restâmes là, immobiles, regardant son rictus profond et décharné. On voyait, que, pendant un temps, le corps avait dû reposer dans l’attitude de l’étreinte, mais le grand sommeil qui survit à l’amour, le grand sommeil qui réussit à conquérir même la grimace de l’amour l’avait trompé ce qui restait de lui, décomposé sous ce qui restait de la chemise de nuit était devenu inséparable du lit sur lequel il était couché ; et sur lui comme sur l’oreiller à côté de lui reposait cette couche unie de poussière tenace et patiente.
Nous remarquâmes alors que l’empreinte d’une tête creusait l’autre oreiller. L’un d’entre nous y saisit quelque chose et, en nous penchant, tandis que le fine, l’impalpable poussière nous emplissait le nez de son âcre sècheresse, nous vîmes que c’était un cheveu, un long cheveu, un cheveu couleur gris-fer.
.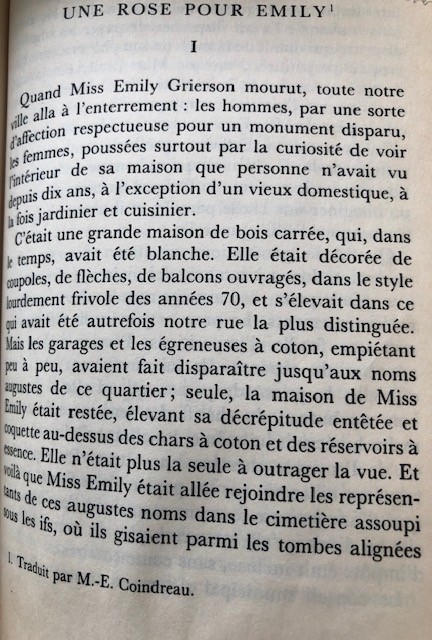
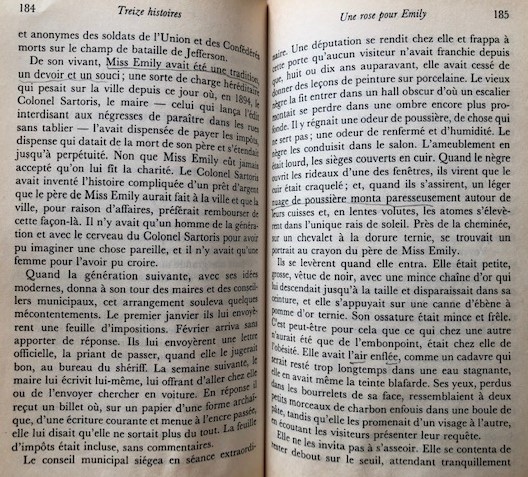 C
C
**************
http://ahmedhanifi.com/wp-content/uploads/2020/09/Une-rose-pour-Emily.mp4
http://ahmedhanifi.com/wp-content/uploads/2020/09/William-Faulkner-au-Japon-en-1956.mp4
*********************
JE VOUS CONSEILLE VIVEMENT DE LIRE LES TEXTES CI-DESSOUS
********************
http://ahmedhanifi.com/paris-rend-hommage-a-william-faulkner/ (article sur la Tribune)
http://leblogdeahmedhanifi.blogspot.com/search?q=faulkner (COMPLET * sur mon blog)
VOIR/LIRE EGALEMENT ICI:
http://www.lecture-ecriture.com/6959-Lumi%C3%A8re-d%E2%80%99Ao%C3%BBt-William-Faulkner
https://www.youtube.com/watch?v=zYRj4dj2SHU
https://www.youtube.com/watch?v=WOM1tYS6r9Q
http://maisonsecrivains.canalblog.com/archives/2008/02/p10-0.html

Ma bibliothèque… côté Oxford ou Yoknapatawpha
Blasphémer est un droit. Blesser, offenser, humilier, caricaturer aussi…
À tous ceux qui blessent, qui offensent, qui humilient, à tous ceux qui barbarisent l’Autre, ceci, de Montaigne :
« Mais ces autres, qui nous viennent pipant des assurances d’une faculté extraordinaire qui est hors de notre connaissance, faut-il pas les punir de ce qu’ils ne maintiennent l’effet de leur promesse, et de la témérité de leur imposture ? Ils ont leurs guerres contre les nations qui sont au-delà de leurs montagnes, plus avant en la terre ferme, auxquelles ils vont tout nus, n’ayant autres armes que des arcs ou des épées de bois, apointées par un bout, à la mode des langues de nos épieux. C’est chose émerveillable que de la fermeté de leurs combats, qui ne finissent jamais que par meurtre et effusion de sang ; car, de déroutes et d’effroi, ils ne savent que c’est. Chacun rapporte pour son trophée la tête de l’ennemi qu’il a tué, et l’attache à l’entrée de son logis. Après avoir longtemps bien traité leurs prisonniers, et de toutes les commodités dont ils se peuvent aviser, celui qui en est le maître, fait une grande assemblée de ses connaissants ; il attache une corde à l’un des bras du prisonnier, par le bout de laquelle il le tient éloigné de quelques pas, de peur d’en être offensé, et donne au plus cher de ses amis l’autre bras à tenir de même ; et eux deux, en présence de toute l’assemblée, l’assomment à coups d’épée.
Cela fait, ils le rôtissent et en mangent en commun et en envoient des lopins à ceux de leurs amis qui sont absents. Ce n’est pas, comme on pense, pour s’en nourrir, ainsi que faisaient anciennement les Scythes ; c’est pour représenter une extrême vengeance. Et qu’il soit ainsi, ayant aperçu que les Portugais, qui s’étaient ralliés à leurs adversaires, usaient d’une autre sorte de mort contre eux, quand ils les prenaient, qui était de les enterrer jusques à la ceinture, et tirer au demeurant du corps force coups de trait, et les pendre après, ils pensèrent que ces gens ici de l’autre monde, comme ceux qui avaient sexué la connaissance de beaucoup de vices parmi leur voisinage, et qui étaient beaucoup plus grands maîtres qu’eux en toute sorte de malice, ne prenaient pas sans occasion cette sorte de vengeance, et qu’elle devait être plus aigre que la leur, commencèrent de quitter leur façon ancienne pour suivre celle-ci.
Je ne suis pas marri que nous remarquons l’horreur barbaresque qu’il y a en une telle action, mais oui bien de quoi, jugeant bien de leurs fautes, nous soyons si aveugles aux nôtres. Je pense qu’il y a plus de barbarie à manger un homme vivant qu’à le manger mort, à déchirer par tourments et par gênes un corps encore plein de sentiment, le faire rôtir par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux (comme nous l’avons non seulement lu, mais vu de fraîche mémoire, non entre des ennemis anciens, mais entré des voisins et concitoyens, et, qui pis est, sous prétexte de piété et de religion), que de le rôtir et manger après qu’il est trépassé.
Chrysippe et Zénon, chefs de la secte stoïque ; ont bien pensé qu’il n’y avait aucun mal de se servir de notre charogne à quoi que ce fut pour notre besoin, et d’en tirer de la nourriture ; comme nos ancêtres, étant assiégés par César en la ville de Alésia, se résolurent de soutenir la faim de ce siège par les corps des vieillards, des femmes et d’autres personnes inutiles au combat. “ Les Gascons, dit-on, s’étant servis de tels aliments, prolongèrent leur vie. ”
Et les médecins ne craignent pas de s’en servir à toute sorte d’usage pour notre santé ; soit pour l’appliquer au-dedans ou au-dehors ; mais il ne se trouva jamais aucune opinion si déréglée qui excusât la trahison, la déloyauté, la tyrannie, la cruauté, qui sont nos fautes ordinaires.
Nous les pouvons donc bien appeler barbares, eu égard aux règles de la raison, mais non pas eu égard à nous, qui les surpassons en toute sorte de barbarie… »
Montaigne, Les Essais, livre 2, « Des cannibales »
Un article de SALAH GUEMRICHE (*)
Article parut ce jour 1° juillet 2020 in « Le Soir d’Algérie »
.
D’Algérie, je reçois maintes demandes d’information ou de conseils de jeunes auteurs francophones qui cherchent à publier leurs écrits en France. Soit parce qu’ils ont été déçus par les éditeurs du pays, soit parce qu’ils estiment que leurs textes seraient mieux accueillis au pays de Voltaire.
Un manuscrit est toujours une bouteille à la mer
Ici, et d’une manière générale, le parcours d’un manuscrit est ce qu’il y a de plus aléatoire. Un texte peut trouver son « lecteur-maison » dans les trois à quatre mois qui suivent sa réception, comme il peut se perdre entre les mille autres manuscrits dont 98% des auteurs recevront une lettre de refus, une lettre standard, la même que celle reçue par un autre «recalé» et pas forcément pour les mêmes motifs.
Personnellement, quand il m’arrive (et cela m’est arrivé plusieurs fois) de recevoir une telle lettre, je fais tout pour obtenir la fiche de lecture. Je considère même cela comme un dû. J’y réussis parfois, mais en contournant le comité de lecture… Sinon, vous aurez droit au sempiternel argument : «Vu la masse de manuscrits qui arrivent par la poste, il est impossible de répondre par lettre personnalisée à chaque auteur.» Argument fallacieux, et irrecevable, pour la simple raison qu’il suffirait qu’un(e) stagiaire (Ah ! le-la stagiaire, comme on le verra, quelle aubaine !) soit chargé(e) d’envoyer à l’auteur du manuscrit refusé une copie de la fiche de lecture établie par le comité… Ce qui, j’insiste, devrait être une obligation, pour l’éditeur, et même le premier des droits… d’auteur. Sic.
Pourquoi, donc, ce droit est-il dédaigné ? La vraie raison, au demeurant compréhensible, reste inavouable : en réalité, l’éditeur, édifié par l’histoire de son métier, redoute que le même manuscrit jugé sans valeur chez lui ne trouve chez la concurrence un succès de librairie inattendu, ce qui serait ressenti comme un désaveu du jugement émis par son propre comité de lecture, lequel compte souvent, qui plus est, des personnalités littéraires. Cela est arrivé dans le passé, et cela arrive encore, et le mea culpa passe rarement les murs de la maison d’édition.
Comités de lecture
Entre abnégation et inconséquence
Les historiens de la littérature vous fourniraient moult exemples, dont le plus célèbre, traumatisant pour l’éditeur qui avait raté le coup, celui du manuscrit Du côté de chez Swann de Marcel Proust. La note de lecture, rédigée par un lecteur de la NRF (Gallimard), un certain André Gide, disait : «Trop de duchesses et de comtesses, ce n’est pas pour nous.»
L’auteur de L’Immoraliste finira par s’excuser. «L’un des regrets, des remords les plus cuisants de ma vie», écrira-t-il dans une lettre alors que Proust venait de publier son texte chez Grasset, mais, tenez-vous bien, à compte d’auteur ! Chez Grasset, mais à compte d’auteur, oui. On connaît la suite…
Plus près de nous, les éditions de L’Olivier ont raté Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part d’Anna Cavalda qui se vendra à 2 000 000 d’exemplaires, toutes éditions confondues, chez un petit éditeur : Le Dilettante ! Le patron de L’Olivier s’en était expliqué, nous apprennent Mohammed Aïssaoui et François Aubel dans Le Figaro : «En fait, le manuscrit avait été refusé par un stagiaire de l’époque !» Ce qui fait conclure aux deux critiques : « Ah ! le petit stagiaire, il a bon dos aujourd’hui »… (1)
Et Love Story, ça vous dit quelque chose ? De l’Américain Erich Segal. Raphaël Sorin en a gardé un souvenir cuisant, pour avoir raté ce qui allait devenir un best-seller et un succès mondial à l’écran ! D’où son confiteor : «J’étais au Seuil à l’époque et mon rapport de lecture avait été accablant pour ce livre que j’avais trouvé vraiment bébête. Je me souviens avoir dit que c’était nul (…). Mais Flammarion l’a pris et ça a marché…»
Il est d’autres exemples, plus proches de nous, qu’il m’arrive de donner aux jeunes auteurs, afin qu’ils gardent à l’esprit qu’une lettre de refus n’est pas toujours à prendre à la… lettre. Mais voilà… Pour peu que leurs manuscrits traitent de l’Algérie (ou, sujet plus aventureux, de l’Islam), cela devient une autre paire de manches. Du moins ici, en France…
«Écrire utile»
De la littérature de l’urgence
Souvenir, souvenir… C’était en 1997, devant la salle de la Mutualité (Paris), au sortir d’un meeting de soutien aux «démocrates» algériens qui avaient fui la terreur islamiste. Le témoignage d’un réfugié, approché par une célèbre journaliste de télévision, devenue éditrice.
Le jeune homme, qui se disait poète comme on se dit fonctionnaire, venait d’évoquer des atrocités dont le récit lui fut rapporté par un proche, journaliste. La dame : «Justement ! C’est ce qu’il faut nous écrire ! La poésie attendra, jeune homme ! Un écrivain doit savoir écrire utile, surtout quand son peuple vit le martyre, alors que la l’Indépendance lui a coûté tant de martyrs, comme vous dites là-bas ! Écrivez ça, oui ! Et n’hésitez pas à aller au-delà du témoignage ! Transcendez, jeune homme, transcendez, et vous ferez œuvre utile !»
C’est ainsi que l’on commencera à parler de «littérature de l’urgence»,(2) et que des éditeurs se bousculeront très tôt pour avoir qui son témoin et qui son théoricien du «Qui- tue-qui ?». «Écrire utile» ? Étrange formule qui résonne comme un impératif catégorique, et qui revient à dire : «ÉCRIVEZ DONC CE QUE L’ON ATTEND DE VOUS, ICI, À PARIS !»
Évidemment, posez ce constat et aussitôt des esprits éclairés vous rétorqueront : «Ça va, la parano algérienne, on connaît !» Certes, et je dirai même mieux : tout Algérien est, par définition, schizo-parano ! En cela, je suis un Algérien pur jus, et heureusement que je me soigne, par le seul remède efficace, celui qui reste à ma portée : l’écriture, et, particulièrement, la fiction.
Plus sérieusement, est-ce vraiment notre paranoïa qui fait que l’édition française soit devenue sélective avec les écrits d’auteurs algériens, et sélective pas pour des motifs purement littéraires ? Demandez-vous pourquoi les manuscrits de Rachid Boudjedra, qui, malgré son éclipse, reste ce grand écrivain, un des rares à résister au formatage en vigueur dans l’édition francophone, ne «parviennent» plus aux éditeurs germanopratins… Sélective, oui, mais pas en matière de qualités littéraires : à Paris, des critiques sincères s’étonnent (mais, hélas, en privé !) de certains succès médiatiques (d’auteurs algériens) qui, à l’aune du style, voire de la syntaxe même, n’auraient même pas dû atteindre le stade d’un débat au sein d’un comité de lecture ! Et sélective, l’édition, l’est curieusement depuis la «Décennie noire», cette «guerre civile» qui autorisa l’élite parisienne à décréter que «Camus a eu raison avant tout le monde», pour avoir écrit que l’indépendance était pure «utopie». Mais qui connaît cet aveu de l’auteur de L’Étranger lui-même : «J’ai avec l’Algérie une longue liaison qui m’empêche d’être tout à fait clairvoyant à son égard» ?
Alors, paranoïa, vraiment ? Voyons voir…
Critique littéraire
«Cuisine et dépendances»
Comme je le signale en préambule dans la version brochée (éd. Frantz-Fanon, 2017) de mon «roman-essai» Aujourd’hui, Meursault est mort(3), le manuscrit avait été refusé par plusieurs éditeurs de France, ce qui m’avait poussé à le publier en ebook, le 27 juin 2013, soit plus de quatre mois avant Meursault, contre-enquête de Kamel Daoud. Le tout premier article, quelques lignes plutôt positives, parut sur un blog d’un critique littéraire hébergé sur le site de Pierre Assouline, membre de l’Académie Goncourt. L’article disparaîtra bizarrement du site à l’approche des sélections des prix de l’année 2014… Ce que je ne dis pas dans le préambule, par respect de la confidence, c’est que, trois jours avant les délibérations des Goncourt, je reçus, à quelques heures d’intervalle, deux courriels, et sans que les deux expéditeurs, membres dudit jury, se fussent concertés (j’en aurai plus tard la preuve) : chacun me demandait de lui faire parvenir d’urgence mon manuscrit. Provincial, je ne pus qu’envoyer par courriel une version PDF… Trois jours avant le jour J ! Oui, vous pouvez le dire : bizarre ! Sauf que, plus bizarre (et sans tirer de conclusion, s’il vous plaît !), il manquera deux voix au lauréat pressenti (euphémisme).
En désespoir de cause, Regis Debray (sic) finira tout de même par obtenir compensation : le Goncourt du Premier roman…
J’ai déjà évoqué sur mon blog le procès en plagiat (de mon Dictionnaire des mots français d’origine arabe, Seuil 2007 ; Points 2012 et 2015), un délit dont la découverte me valut un accident vasculaire, rien que ça ! Procès que j’avais intenté à Alain Rey : 2014-2019, cinq années de bataille, pot de terre contre pot de fer.
En décembre dernier, le Tribunal de grande instance de Paris m’a donné raison, mais a minima : la partie adverse, en la personne de Monsieur Alain Rey, fut reconnue coupable non pas de plagiat mais de «parasitisme» (après tout, on ne dit plus «femme de ménage» mais «technicienne de surface» !).
Cela dit, qui donc, en France, a entendu parler de ce verdict ? Et quel grand média l’a évoqué ? Juste un flash sur FranceTv-Info ; quelques lignes sur… Sputnik. News et Inforussie ; curieusement, Le Monde comme Livres-Hebdo titrent non pas sur Alain Rey mais sur son éditeur.
Seul un quotidien régional, Le Courrier de l’Ouest, avait traité le fond de l’affaire, sans épargner le lexicographe, et même à la une ! Quant aux émissions consacrées aux livres, sur les chaînes de télévision françaises, motus et bouche cousue. Pire : François Busnel, recevant Alain Rey dans son émission «La Grande Librairie», sur France 5, ne dira mot du procès intenté à son invité, encore moins de la conclusion du TGI de Paris !… Circulez, y’a rien à voir !… Comme l’écrira Daniel Junqua, ancien du Monde et ancien directeur du Centre de formation et de perfectionnement des journalistes (CFPJ) : «Le Courrier de l’Ouest a suivi cette affaire de bout en bout avec un grand professionnalisme. On ne peut en dire autant de la plupart des grands médias nationaux qui ont préféré ignorer une décision de justice qui met à mal la réputation du pape français du dictionnaire, chouchou des plateaux télé… Les juges, quant à eux, ne se sont pas laissés impressionner et sont allés au fond des choses. Allons, tout n’est pas si mal en France !»
Je passe sur le parcours de mon essai : Israël et son prochain, d’après la Bible, un manuscrit qui, en dépit de trois fiches de lecture élogieuses (que j’ai fini par obtenir, de La Découverte, de Desclée de Brouwer et du Suisse Labor et Fides), a mis dix ans avant de trouver son éditeur (L’Aube, 2018). Certes, avec un sujet tabou, Israël, le tabou des tabous en France, il fallait s’y attendre.
Quand l’éditeur se fait ordonnateur
Mais c’est sur le parcours sidérant d’un autre manuscrit que ma «paranoïa» d’Algérien allait trouver son compte, pour ainsi dire…
Il s’agit d’un essai-enquête sur l’évangélisation et les conversions de musulmans au christianisme : Le Christ s’est arrêté à Tizi-Ouzou. Une enquête qui m’avait mené du sud de la France (pour interviewer une pasteure d’origine kabyle) jusqu’en Tunisie, en passant par l’Espagne (où vivait, près de Grenade, une communauté de convertis d’origine marocaine), le Maroc et l’Algérie (Kabylie).
Un mois après avoir posté le manuscrit à l’éditeur (un grand parmi les plus grands), je reçus un compte rendu de lecture dans lequel on me demandait de revoir ma copie afin de donner de «l’épaisseur» à mon sujet. Ce à quoi je me pliai, sans état d’âme. Je dus donc retravailler mon texte… Après la seconde lecture de l’éditeur, je reçus un courriel dans lequel on me demandait carrément (je cite) : «d’ajouter des éléments, même s’il faut en inventer» !… Tel quel, noir sur blanc ! Et pour une enquête de terrain ! Ne comprenant pas (ou plutôt craignant d’avoir bien compris) ce que l’on attendait vraiment de moi, je contactai ledit éditeur par téléphone.
Qui précisa sa pensée, sans façon : «Il nous faut des convertis plus critiques envers l’islam !» Comme je restai sans voix, l’homme ajouta : «Il manque du sang et des larmes, pour tout dire !»
Quitte à inventer ? Oui ! Sidéré, je restai deux semaines à me demander ce que je devais faire… Surtout que la deuxième moitié de l’à-valoir (la moitié de 15 000 €, s’il vous plaît, frais d’enquête compris !) ne devait m’être versée qu’après acceptation du manuscrit final, ce qui est la règle.
Alors… Répondre aux désirs de l’éditeur et signer d’un pseudonyme, peut-être ? Il faut dire que j’étais dans une situation matérielle des plus critiques, et que la première moitié de l’à-valoir (7 500 €, donc) avait servi à mes voyages pour les besoins de l’enquête (France, Espagne, Maroc, Algérie, Tunisie). Et ma banquière, qui suivait avec sympathie et confiance mon travail, me voyant enfoncé-dans-le-rouge-foncé, ne pouvait admettre que je perdisse une telle somme…
Ajouter du sang et des larmes, quitte à inventer : à quel prix !
De la «littérature de l’urgence» à la littérature d’allégeance
Un matin, devant mon café, je m’entendis penser : «Qu’est-ce qui est indélébile, le rouge au front ou le rouge au compte ?» Pour toute réponse, décision fut prise : renoncer à la deuxième moitié de l’à-valoir. Puis, désabusé, meurtri par une telle perversion du milieu éditorial, je me mis en quête d’une autre maison… Que je trouvai en l’espace d’une semaine ! Mais avec un à-valoir équivalant au sixième du premier, et sans compter que le nouvel éditeur n’avait pas eu à payer les frais d’enquête !…
À la parution du livre (Le Christ s’est arrêté à Tizi-Ouzou, Denoël 2010), l’éminente maison d’édition m’informa qu’elle lançait une action en justice pour cause de rupture de contrat. Serein, je répondis de trois mots : «Clause de conscience», en joignant juste une copie du courriel où l’on me demandait tout bonnement «d’ajouter des éléments, même s’il faut inventer».
Dès lors, silence radio.
Voilà, donc, quelques vérités sur les mœurs de l’édition en France auxquelles on peut être confronté, si l’on ne cède pas à l’injonction de «l’Écrire utile». Mais au fait, utile à qui, et utile à quoi ? Bonnes questions !… Et voilà pourquoi (comme mon personnage dans L’Homme de la première phrase, Rivages/Noir, 2000), je continue à flétrir ce «néo-algérianisme» qui, dans la droite ligne des nostalgiques du «temps béni des colonies», nous a enfanté une «littérature d’allégeance».
Cela dit, vous qui avez demandé mon avis, ne baissez jamais les bras : il y aura toujours une opportunité, un éditeur libre, sans arrière-pensée ni perversion idéologique, pour qui la veine littéraire vaut mieux que le filon, et «l’Écrire vrai» mieux que «l’Écrire utile».
S. G.
(*) Essayiste, romancier, ancien journaliste, Salah Guemriche est l’auteur de quatorze ouvrages, parmi lesquels le désormais classique Dictionnaire des mots français d’origine arabe (Seuil 2007, en poche : Points 2012 et 2015) ; Chroniques d’une immigration choisie (L’Aube, 2019) ; Alger-la-Blanche, biographies d’une ville (Perrin, 2012) ; Abd er-Rahman contre Charles Martel – la véritable histoire de la bataille de Poitiers (Perrin, 2010) ; Un été sans juillet – Algérie 1962 (Le Cherche-Midi, 2004) ; L’Homme de la première phrase (Rivages/Noir, 2000).
1) 1 https:// www.lefigaro.fr/ livres/2013/11/21/03005-20131121ARTFIG00513-les-mauvais- coups-des-editeurs.php
2) «La littérature de l’urgence a pour visée de réconforter le lecteur (et l’éditeur), de le rassurer sur son présent, de l’anesthésier. Ce sont en définitive des écrits de la stagnation. Elle est une écriture qui témoigne, un ‘’document humain’’ selon les termes de Pierre Jourde, mais sans envergure» (Ahmed Hanifi, La littérature de l’urgence, entre réalité et exigences littéraires, http://www.latribune-online.com/1512/contact.htm
(AH: pour lire cet article cf en bas de cette page)
3) Sous-titré Dialogue avec Albert Camus, il parut en version brochée aux éditions Frantz-Fanon (Algérie, 2017). Toujours téléchargeable, version numérique sur Amazon : https://www.amazon.fr/dp/B07VMYXFMZ
__________________________
CLIQUER ICI POUR LIRE « LA LITTÉRATURE DE L’URGENCE »
Titre complet: «La littérature de l’urgence» entre réalité et exigences littéraires
in La tribune lundi 15 décembre 2003
.
_________________________
.
LE SOIR D’ALGÉRIE MERCREDI 1° JUILLET 2020
.


__________________________________
.
DR
___________________________________
.À JÉRUSALEM _ UN POÈME DE MAHMOUD DARWICH_ CLIQUER ICI
__________________________________
Fi el Qodsi (A Jérusalem)
À Jérusalem, je veux dire à l’intérieur des vieux remparts,
je marche d’un temps vers un autre
sans un souvenir qui m’oriente.
Les prophètes là-bas se partagent l’histoire du sacré …
Ils montent aux cieux et reviennent moins abattus et moins tristes,
car l’amour et la paix sont saints et ils viendront à la ville.
Je descends une pente, marmonnant :
Comment les conteurs ne s’accordent-ils pas
sur les paroles de la lumière dans une pierre ?
Les guerres partent-elles d’une pierre enfouie ?
Je marche dans mon sommeil.
Yeux grands ouverts dans mon songe,
je ne vois personne derrière moi. Personne devant.
Toute cette lumière m’appartient. Je marche.
Je m’allège, vole
et me transfigure.
Les mots poussent comme l’herbe
dans la bouche prophétique d’Isaïe : « Croyez pour être sauvés. »
Je marche comme si j’étais un autre que moi.
Ma plaie est une rose blanche, évangélique.
Mes mains sont pareilles à deux colombes
sur la croix qui tournoient dans le ciel
et portent la terre.
Je ne marche pas.
Je vole et me transfigure.
Pas de lieu, pas de temps.
Qui suis-je donc ?
Je ne suis pas moi en ce lieu de l’Ascension.
Mais je me dis :
Seul le prophète Muhammad
parlait l’arabe littéraire. « Et après ? »
Après ?
Une soldate me crie soudain :
Encore toi ? Ne t’ai-je pas tué ?
Je dis : Tu m’as tué … mais, comme toi,
j’ai oublié de mourir.
___________________________________
.
___________________________________
CLIQUER ICI POUR VOIR UNE AUTRE VIDÉO
__________________________________
AUTRES ARTICLES ET VIDÉOS = SUR MON BLOG_ CLIQUER ICI
__________________________________
.

Virginie DESPENTES – DR
« Lettre adressée à mes amis blancs qui ne voient pas où est le problème… » – Virginie Despentes-
_______________________________
______________________________
Lettre lue par Augustin Trapenard sur France Inter, le jeudi 4 juin 2020, 8h57
Virginie Despentes est écrivaine. Dans cette lettre, rédigée après la manifestation en soutien à Adama Traoré et adressée à « ses amis blancs qui ne voient pas où est le problème », elle dénonce le déni du racisme et explique en quoi « être blanc » constitue un privilège.
Paris, le 3 juin 2020
Lettre adressée à mes amis blancs qui ne voient pas où est le problème.
En France nous ne sommes pas racistes mais je ne me souviens pas avoir jamais vu un homme noir ministre. Pourtant j’ai cinquante ans, j’en ai vu, des gouvernements. En France nous ne sommes pas racistes mais dans la population carcérale les noirs et les arabes sont surreprésentés. En France nous ne sommes pas racistes mais depuis vingt-cinq ans que je publie des livres j’ai répondu une seule fois aux questions d’un journaliste noir. J’ai été photographiée une seule fois par une femme d’origine algérienne. En France nous ne sommes pas racistes mais la dernière fois qu’on a refusé de me servir en terrasse, j’étais avec un arabe. La dernière fois qu’on m’a demandé mes papiers, j’étais avec un arabe. La dernière fois que la personne que j’attendais a failli rater le train parce qu’elle se faisait contrôler par la police dans la gare, elle était noire. En France on n’est pas raciste mais pendant le confinement les mères de famille qu’on a vues se faire taser au motif qu’elles n’avaient pas le petit papier par lequel on s’auto-autorisait à sortir étaient des femmes racisées, dans des quartiers populaires. Les blanches, pendant ce temps, on nous a vues faire du jogging et le marché dans le septième arrondissement. En France on n’est pas raciste mais quand on a annoncé que le taux de mortalité en Seine Saint Denis était de 60 fois supérieur à la moyenne nationale, non seulement on n’en a eu un peu rien à foutre mais on s’est permis de dire entre nous « c’est parce qu’ils se confinent mal ».
J’entends déjà la clameur des twitteurs de service, s’offusquant hargneusement comme ils le font chaque fois qu’on prend la parole pour dire quelque chose qui ne corresponde pas à la propagande officielle : « quelle horreur, mais pourquoi tant de violence ? »
Comme si la violence ce n’était pas ce qui s’est passé le 19 juillet 2016. Comme si la violence ce n’était pas les frères de Assa Traoré emprisonnés. Ce mardi, je me rends pour la première fois de ma vie à un rassemblement politique de plus de 80 000 personnes organisé par un collectif non blanc. Cette foule n’est pas violente. Ce 2 juin 2020, pour moi, Assa Traoré est Antigone. Mais cette Antigone-là ne se laisse pas enterrer vive après avoir osé dire non. Antigone n’est plus seule. Elle a levé une armée. La foule scande : Justice pour Adama. Ces jeunes savent ce qu’ils disent quand ils disent si tu es noir ou arabe la police te fait peur : ils disent la vérité. Ils disent la vérité et ils demandent la justice. Assa Traore prend le micro et dit à ceux qui sont venus « votre nom est entré dans l’histoire ». Et la foule ne l’acclame pas parce qu’elle est charismatique ou qu’elle est photogénique. La foule l’acclame parce que la cause est juste. Justice pour Adama. Justice pareille pour ceux qui ne sont pas blancs. Et les blancs nous crions ce même mot d’ordre et nous savons que ne pas avoir honte de devoir le crier encore, en 2020, serait une ignominie. La honte, c’est juste le minimum.
Je suis blanche. Je sors tous les jours de chez moi sans prendre mes papiers. Les gens comme moi c’est la carte bleue qu’on remonte chercher quand on l’a oubliée. La ville me dit tu es ici chez toi. Une blanche comme moi hors pandémie circule dans cette ville sans même remarquer où sont les policiers. Et je sais que s’ils sont trois à s’assoir sur mon dos jusqu’à m’asphyxier – au seul motif que j’ai essayé d’esquiver un contrôle de routine – on en fera toute une affaire. Je suis née blanche comme d’autres sont nés hommes. Le problème n’est pas de se signaler « mais moi je n’ai jamais tué personne » comme ils disent « mais moi je ne suis pas un violeur ». Car le privilège, c’est avoir le choix d’y penser, ou pas. Je ne peux pas oublier que je suis une femme. Mais je peux oublier que je suis blanche. Ça, c’est être blanche. Y penser, ou ne pas y penser, selon l’humeur. En France, nous ne sommes pas racistes mais je ne connais pas une seule personne noire ou arabe qui ait ce choix.
Virginie Despentes
___________