Le temps d’un aller simple – Marsa édition – Paris 2001
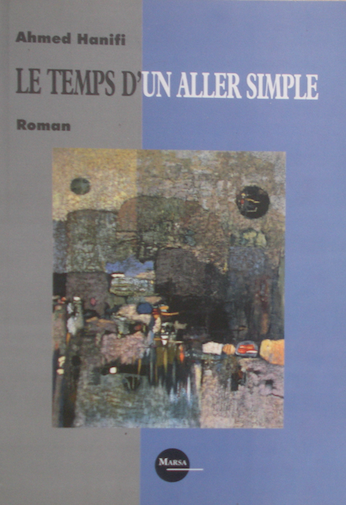 C
C

» Personne ne sait quand tombera le crépuscule
et la vie n’est pas un problème qui puisse être résolu
en divisant la lumière par l’obscurité et les jours par les nuits,
c’est un voyage imprévisible entre des lieux qui n’existent pas.
Je peux, par exemple, marcher sur le rivage
et ressentir tout à coup le défi effroyable
que l’éternité lance à mon existence
dans le mouvement perpétuel de la mer
et dans la fuite perpétuelle du vent. »
Stig Dagerman : Notre besoin de consolation est impossible à rassasier
Le temps d’un aller simple s’ouvre ainsi: Machinalement elle l’accompagne jusqu’à la dernière marche. Des larmes coulent lentement sur les joues. Elle fait un dernier geste auquel il ne répond pas. Sinon de l’abîme de son être. Dans un effort ultime, pantelant, il dresse gauchement son index et murmure résigné quelques signes qui siéent à sa condition présente mais qu’il ne choisit peut-être pas. Elle entend : J’ai appris que les mots ne servent à rien, que les mots ne correspondent jamais à ce qu’ils s’efforcent d’exprimer. D’autres mots s’échappent : Tant de temps passant est-il venu sur l’homme… Toutes les portes se referment. Des lumières s’éteignent, d’autres tournoient. Elle lui tend ses bras son cœur son corps. Tout son être. Elle court trébuche et tombe sur la chaussée enneigée. Instinctivement elle se tient le ventre épanoui. Le convoi s’ébranle enfin vers la nuit cristalline d’où l’homme émergea. Alors que sa mémoire déséquilibrée laboure convoque et ravive des expériences ; de toutes parts des myriades d’éclairs fugaces irradient la surface de son éphémère présent. Il vit :
GAMLA-STAN
« Obligé. C’est obligé d’avoir froid. Moins douze degrés ! Nous sortons du Moulin rouge. Il est bientôt seize heures. La nuit semble définitivement installée dans la tristesse et l’obscurité. J’ai aussi froid que lorsque nous y sommes entrés. Moins douze ! Housia tremble. Je ne lui demande pas si elle tremble de froid ou bien d’autre chose. D’autres salles déversent leurs spectateurs qui s’écoulent dans les rues illuminées. Un autre flot continu d’humanité se meut dans le sens opposé en direction des cinémas devant lesquels il se transforme en de grosses grappes prêtes à faire le pied de grue en attendant les séances suivantes. L’ensemble forme un drôle de gigantesque sablier instable. Les trottoirs sans cesse sablés sont tapissés d’une poudre blanche par endroits luminescente et dense, toujours renouvelée qui refroidit les bruits de la ville. Entre guirlandes et jouets enseignes et ornements, les boutiques de la Mäster Samuels gatan rivalisent de hardiesse. Nous traversons quelques ruelles et bifurquons sur la gauche. De nouveau, nous marchons sur la Drottnin gatan et pas un mot n’est prononcé. Les traces que dessinent nos pas sur les trottoirs, lents ou accélérés, sont immédiatement recouvertes de neige. J’ai froid et soif. Par fournées entières et compactes, dans un mouvement commun, modéré, freiné, les gens s’engouffrent dans le métro presque avec regret. Housia et moi marchons sans hâte. Au bout de plusieurs dizaines de mètres, essoufflée, Housia parle enfin. Moi aussi. Je m’arrêterai bien un moment, les douleurs me reprennent. Moi : Je prendrai bien une bbb boisson chaude.
– Entrons là si tu veux bien. Nous échangeons ces mots et des bouffées de vapeur chaude. Lorsque nos paroles fondent les bulles disparaissent avec. Lorsque d’autres mots surgissent d’autres bulles les marquent au pas. Nous pénétrons dans un bâtiment dont la prestance est fortement ternie et controversée par le poids des années. La foule est abondante dans le centre commercial dont l’entrée est large et absorbante. L’ascenseur nous conduit péniblement à l’étage. Nous sommes dans le Åhléns Café sur la Klarabergsgatan. Les clients y sont nombreux par ce temps à ne pas mettre une idée à l’air libre. Que prends-tu me demande Housia. Un café.
Puis vers le garçon avant de s’asseoir : Två kaffe tack. Je frissonne encore ajoute-t-elle en s’agrippant à mon bras droit comme un naufragé à une bouée. Je repense à l’état dans lequel je me trouvais tout à l’heure. Les mots manquent pour l’exprimer.
Elle ne tremble donc pas de froid. Je lui dis : Tu le dis si bien ; les mots manquent. J’ai froid. Elle précise ; je pense au film Alec.
– Je pense aussi au film. Il y a une scène qui me poursuit dont je n’arrive pas à me débarrasser. Celle de la balançoire. Tu vois? Au moment de la projection elle m’a renvoyé à une autre scène, identique et de même époque. Le même spectacle.
– Ah?
Une scène de « Monnaie de singe » qui figure deux femmes installées dans la balancelle tandis que la lumière de l’après-midi pénétrait les interstices des glycines mauves prêtes à fleurir. La même scène.
– Monnaie de singe…monnaie de singe…
– Le Sud, la guerre 14-18, docteur Gray, les fff femmes…
– Quelle mémoire !
– Et les cliquetis des pendules. Inexorables et incessants cliquetis semant tout le long de leur lamentable superposition mensonge et désolation. J’en ai sué. Clic-clac, clic-clac, clic-clac. Pour accompagner mon clappement et détendre l’atmosphère Housia agite le bras en l’air et mime un balancier peu crédible. Je souris discrètement. Un jeune couple triste est assis à nos côtés, indifférent. Mon Dieu. Je ne supporte pas les horloges. On leur prête des qualités que je trouve exagérées. Contrairement à ce que l’on dit, elles n’indiquent jamais la bonne heure, pas même le temps. Comment peut-on -par la grâce d’une formule alambiquée et tarabiscotée mêlant pendule et masse de pendule, pesanteur et période, gravité et que sais-je encore- comment peut-on oser annoncer le même temps pour l’humanité entière ; à la fois pour les Japonais les Inuits et les Massaïs, avec une assurance sans faille à peine nuancée? Voilà une gageure ! Un leurre plutôt. Je préfère le silence aux horloges artificielles. Plutôt le silence que le mensonge. C’est cela. Oui, c’est cela.
Exactement. Mensonges. Il s’agit bien de mensonges. Le poète dit que les cliquetis ou les mouvements d’une montre nous sont destinés. Soit. Horloge ! dieu sinistre, effrayant, impassible, / Dont le doigt nous menace et nous dit : « souviens toi ! / Les vibrantes Douleurs dans ton cœur plein d’effroi / Se planteront bientôt comme dans une cible,.. ». Soit. Les cliquetis nous parlent. Disent-ils pour autant les quatre vérités sur le temps? Sûrement pas. Par la répétition et le harcèlement, les aiguilles développent en nous des sentiments mêlés. Conflictuels. Elles ne nous laissent pas impassibles. Par habitude et par acharnement je le répète. Un tas de mensonges de fausses menaces et de perfidies répétés. Elles se veulent tyrannie, elles ne sont qu’imposture. Ainsi qu’une carte de Suède d’Algérie ou de France ne peut-être la Suède l’Algérie ou la France, la trotteuse ne peut être que leurre. C’est ma conviction. Pourtant combien de nos comportements de nos actions -mes comportements, mes actions- reposent sur ces mensonges, ces illusions. Lorsqu’un menteur veut être pris sur parole il procède de la même façon. Il répète toujours les mêmes mots ; dans un ordre toujours différent, mais toujours martelant les mêmes mots. On a raison de penser qu’il en reste hélas toujours quelque chose. Personnellement j’ai du respect pour quelqu’un qui pense et qui ; par crainte du choix des mots ou pour toute autre raison ne dit pas, mais je n’en ai pas pour celui qui parle parle parle pour sciemment tromper ou pour ne rien dire. Après tout, chacun possède ses propres histoires. Libre à lui de les enjoliver, les travestir, les dissimuler ou pas. Mensonge et diversion contre silence. C’est vrai que cela n’est pas donné de dire ce qu’on pense, ce qu’on estime devoir dire. On estime et on se tait. Mensonges donc. Tant pis pour les cabourgeais et le premier d’entre eux mais un vase plein d’iris toscans ou saturé d’arômes grassois c’est beaucoup plus qu’une quantité de ridicules coups sous verre, mesurés, assénés par d’absurdes et vulgaires aiguilles qui se prennent pour des baguettes de chef d’orchestre. Comment penser un instant que le temps peut… Non non, sous ces coups répétés le temps est pris à partie. Il est pris à partie par un autre temps, une illusion qui lui sont substitués. Parfois je me surprends à rêver d’un monde sans montres sans horloges sans aiguilles sans cadrans solaires -comme cela fut. Un monde où seule règnerait la lumière et j’en tremble… Je me surprends à penser cela et je frissonne à cette saine idée. Je suis pris dans un vertige indescriptible ou presque, comme lorsque l’on est ébranlé par le doute, lorsque tout se met à flotter autour de soi et cela m’arrive assez régulièrement. Je vois des êtres avancer dans un désordre généralisé apparent, fait de commentaires bruyants et d’échanges fraternels. Pas d’horloges. Pas de montres. On ne peut même pas y penser. Cela n’a jamais existé. L’idée même de lier ses actions à cette illusion que l’on nomme aujourd’hui temps, est inconcevable. Alors on avance chacun selon son rythme. Naturellement. -Dans une pièce, un chat fixe un poisson qui s’agite dans un aquarium. Tous deux semblent patients. Je les observe : quelle est leur expérience de la patience?- On ne peut arriver en avance ou en retard, ni même à l’heure ; nulle part. Quelle que soit l’action entreprise on est ni en avance ni en retard. On ne peut incriminer ni chef de gare ni voyageur ni passager ni quiconque. Personne n’est fautif. Il n’y a pas de faute. Ni remords à avoir. Il n’y a ni gare ni chef de gare. Je me surprends à rêver d’un temps que l’argent et l’empressement indiffèrent quel que soit le lieu. Au nord au sud à l’est à l’ouest nul besoin de montre. A propos pourquoi associe-t-on boussole et montre? C’est pourtant différent. Une boussole n’impose ni un rythme -artificiel- ni un lieu ni rien d’autre. Une boussole indique le nord ou les sept étoiles à qui veut, sans qu’il soit contraint de s’y rendre. Les aiguilles d’une montre, dont les prétentions sont pourtant bien amoindries par leurs capacités, trompent et asservissent les incrédules.
La seule relation que j’entrevois entre boussole et montre est une relation de soumission. Les aiguilles d’une montre ne peuvent se passer des points cardinaux alors que ceux-ci oui. Et cette course à la précision des physiciens du Maryland comme la course à la rigueur des Suisses sont vouées à l’échec car elles ne riment à rien. A si peu. La cible qu’ils visent n’est pas celle qu’ils pensent. Les uns et les autres sont convaincus de vaincre un jour le temps. Hélas pour eux ils ne posséderaient qu’une trotteuse d’espace ; l’espace d’un cadran parcouru en un temps enchaîné à la vitesse. Ne nous ressasse-t-on pas péremptoirement que d = v par t? Pauvre Zénon d’Elée. Comment peut-on honnêtement associer dans une même perspective boussole et montre? Absurdité. Je ne comprends pas.
Tu as compris le film? je parle du film pas du cliquettement des pendules dit Housia doucement comme pour s’excuser du dérangement qu’elle pense m’infliger. Elle se mordille la lèvre comme le ferait un gamin pour se justifier d’un geste ou d’une parole aussitôt regrettés. Or ce n’est pas le cas. Elle ajoute : Il me semblait que tu comprenais peu le suédois?
Nos voisins de table ne nous prêtent guère attention. Pourquoi le feraient-ils? Ils sont déjà démesurément blasés de vivre à les voir ainsi se regardant comme ne sauraient mieux faire des chiens de faïence espagnole et kitsch. On comprend que leur discussion est au mieux légère. Ces périodes noires et froides sont terribles ici. Pour tous les âges. Housia répète ce que j’ai bien entendu. Je tremblote et lui réponds que je n’ai pas compris tous les dialogues : non sinon quelques mots, quelques expressions. Mais tu sais, je l’ai vu trois froids, pardon trois fois ! Oh, il y a belle lurette. C’était à Oran. Je l’avais trouvé infiniment triste et désespérément long. Nous étions à l’époque rancuniers et nous buvions alors les mots venus d’ailleurs, particulièrement ceux qui nous étaient interdits de reproduire même pour le plaisir. Aujourd’hui mon attention a été saisie essentiellement par les images, je veux dire par les couleurs, par les formes. Par leur progression, par leur cheminement. Alors même que les images défilaient, je tentais d’anticiper sur les suivantes, de les deviner. Elles me contrariaient voilà tout. J’avais devant moi deux films qui se superposaient. Celui qui se déroulait devant nous et celui que convoquait ma mémoire.
Cette fois Housia s’arme d’une raquette de ping-pong et d’un lot de certitudes. Pourquoi pas? Je relève le défi.
Elle : la mémoire est prétentieuse, ça joue toujours des tours ça !
Moi : on dit que…
Elle : on dit que même Bergman ne pouvait exprimer avec infaillibilité ses propres intentions au moment du tournage, le sais-tu?
Moi : pour ce qui me concerne…
Elle : tu ne réponds pas.
Moi : je ne suis jamais sûr de ce que j’avance car je ne maîtrise pas toujours les mots que j’utilise. Ttt tu le sais…
Elle : Tu réponds à côté.
Moi : excuse moi, je veux dire…
Elle : moi, l’extrait qui m’a le plus remuée, j’en tremble encore, c’est celui où l’on voit les deux sœurs, délivrées de la troisième, Agnès… enfin pas tout à fait délivrées à vrai dire… ce sont ces moments qui m’ont le plus émue ; lorsque les deux sœurs, forgées dans une haine-amour réciproque se rencontrent. Maria se rapproche de Karin qui la rejette à plusieurs reprises pour ensuite venir la retrouver, lui demander pardon. Elles finissent par s’enlacer et se parler, se caresser, fraterniser comme elles ne l’ont jamais fait auparavant, sous les gémissements incessants et harmonieux d’un violoncelle-arc-en-ciel et sous le regard verré distant de la caméra qui s’incruste tour à tour dans l’un puis dans l’autre des deux visages, dans ces êtres noirs, encerclés de rouge et pénétrés par la culpabilité, noyés dans la souffrance. Une renaissance ! Ca m’a remuée. J’ai été saisie à la fois de nausée et d’admiration. Ca m’a glacée… J’ai pleuré. Je ne sais pourquoi j’ai pensé à toi. J’ai pensé à Katarina aussi. J’ai voulu fuir.
(Elle se collait contre moi).
Je la retiens par la main et dis :
– Nous devrions nous parler jour et nuit !
– Ja ! Viborde talas vide dag och natt ! Car il est vrai que notre besoin de consolation est stig…
– Pardon?
– Nous devrions nous parler jour et nuit !
– N’est-ce pas. Je disais que certains des mots que je prononce signifient parfois plus que la situation elle-même, plus que l’expérience que je souhaite partager ou seulement expliquer. J’ai l’intention de dire une chose et voilà que j’en dis une autre. Les mots sont sibyllins ou prétentieux comme tu dis, eux aussi. A la moindre inattention ils échappent au sens premier qu’ils portent et qu’ils trahissent par des contorsions ou bien souvent ouvertement directement, sans ambages. Il n’est pas aisé de les indexer à telle situation ou à telle expérience ! Beaucoup de gens savent y faire. Moi non. Et crois-moi il s’agit moins de choix que de guerre. Une guerre presque naturelle qui m’a été imposée.
– Une guerre imposée? comment?
Ah, ça… cela vient de loin. Une guerre. Oui, une guerre ! Larvée. Chez moi les mots et les émotions se mènent une guerre sans merci. Insidieuse mais permanente. J’ai un faible prononcé pour les émotions car elles ne me trahissent jamais. Les mots oui. Ils sont comme des joueurs sur le qui-vive, calculateurs et froids. Les mots ne me trahissent jamais.
– J’ai vu, j’ai vu.
– Non, non, non ! Les émotions nnn ne me trahissent pas. Les mots oui. C’est ce que je t’explique. Mais une fois couchés sur du papier ils sont cuits. Ils ont beau papillonner, ils sont faits comme des mouches prises dans le serpentin, dans le tue-mouches. Je les observe les triture les range les réduis les étale les trucide les remplace par d’autres moins désinvoltes.
Housia s’énerve et crie. « C’est pourquoi je dis j’ai vu, j’ai vu ! » Je lui suggère de ne pas crier. « Je ne crie pas ! »
-Tiens, une belle citation me vient à l’esprit. J’ai appris que les mots ne servent à rien, que les mots ne correspondent jamais à ce qu’ils s’efforcent d’exprimer. C’est beau n’est ce pas? A propos, toi par contre tu parles pour ainsi dire, parfaitement le français. Quels progrès ! Il y a longtemps que je voulais te le dire. Voilà qui est fait. Penses-tu que nous sommes en avance? Housia jette un regard vers le bâti dormant de la porte d’entrée au moment où l’on nous sert les cafés.
– Tack ! Nous avons le temps.
– A ton avis que penserait Katarina du film?
– Oh, alors là… C’est pas si simple tu sais.
– J’ai hâte de connaître ses réactions lorsque nous lui raconterons
– Je les connais ! Je l’entends et la vois nous répondre : « Vous auriez pu choisir un film plus léger. Ce film est difficile et toi tu n’aurais pas dû aller le voir dans l’état où tu es ».
(Il est vrai que son physique métamorphosé en impose. Elle voulait un enfant mais pas le père. Qui fuit de toute manière. Elle a gain de cause. La première manche est acquise. Reste l’enfant.
« Il aura deux prénoms » m’avait-t-elle averti dès les premiers jours. « Tu peux me proposer quelques prénoms arabes? » J’ai protesté en douceur pour la forme avec force gesticulations : « Pourquoi pas algérien? » Finalement de tous ceux que je lui ai proposés elle choisit après une mûre méditation un prénom à la fois arabe et algérien probablement pour ne pas me vexer, mais sans doute pour le suintement de sa sonorité Ya-Sin. Celui-ci
parmi tous.
– Que veut-il dire?
– Rien. Enfin, si. Ya et Sin sont deux lettres de l’alphabet. Arabe. Mais c’est surtout le titre d’une soura du Coran. La plus appréciée des musulmans. Elle est dit-on, le cœur du Livre . Je ne saurais te dire de quoi elle traître elle traite ». Elle a beaucoup rit de ce lapsus. Que dira-t-elle à Ya-Sin?.)
Brutalement profitant de mon égarement elle saute du coq à l’âne et dit :
– Pourquoi tu souris? tu ne verras pas Ya-Sin. Partir, quelle idée. Ca ne va pas?
– Mais toi, qu’as-tu à me poser cette question là, maintenant, tu crois que c’est mon choix?
– Explique-toi !
Je lui réponds stoïque que si je suis arrivé, c’est bien pour partir non? Je ne vais pas m’éterniser ! Et même si je le voulais je ne pourrais pas rester. Cela ne dépend pas de moi, c’est comme la richesse ou la célébrité, cela ne dépend pas de moi. Tout a une fin. Les choses ont une fin. Le bonheur les plantes – et même le gui ! – les hommes les voyages ont une fin ! Et je ne suis qu’un homme après tout, ma liberté de choix comme celle de tout homme ne s’épanouit que dans l’illusion.
J’ai depuis longtemps tout préparé. Mes réponses et même les questions. J’ai toutes les réponses qu’il faut au cas où… J’ai tout préparé mais elle ne me pose aucune autre question. Elle ne m’interrogera plus sur les évidences. (Je le regrette car je pense que les évidences doivent être exprimées tout comme les banalités. Formuler des évidences ou des banalités c’est autoriser le questionnement. Derrière les évidences il se cache souvent des réalités insoupçonnées. Enfin…). Je crois même qu’elle se fâche. Je ne la regarde pas. J’ai pourtant bien envie d’ajouter que ma conviction ici est faible, que j’aimerai la renforcer, que la fin ce n’est pas très important. Je voudrai ajouter que je crois à la fébrilité du vivant, aux cycles, aux mouvements. Eux sont éternels même si chaque individu dans sa consistance toute relative, a atteint ses propres limites, son propre horizon, sa propre réconciliation, sa propre vérité. L’humilité de l’homme devrait être incommensurable. J’ai un fort désir de lui dire tout cela pour aller jusqu’au fond du problème, car les évidences il faut leur faire face. Les clarifier, les dépouiller. Une force
incontrôlable m’invite au silence. Je me tais. Un long moment a passé. Je dus lui causer du dépit.
– Tu es parfois comme Katarina. Je te demande quelque chose et toi tu me réponds à côté. Souvent avec Katarina c’est pareil ou pire car elle se cherche dans l’adversité. Elle me cherche. Hier encore, tu as bien entendu : « et le resto, c’est le resto qui était prévu ! ». Elle a bien dit cela. Elle sera en retard alors qu’elle a promit d’y être avant nous. Excuses-moi mais je pense qu’elle exagère un peu depuis quelques temps. Depuis plusieurs mois. Depuis que je suis dans cet état. Je dirais même, depuis que tu es arrivé. Et toi tu procèdes pareillement.
Ces jours ci l’une et l’autre abusent et exploitent ma faiblesse ou ma patience. A tour de rôle. Je ne prendrai pas position, même si parfois elles sont au bord de la crise de nerf ; non que je n’aime pas prendre position mais cela ne me semble pas important. Encore moins aujourd’hui. Son état physique influe sur son mental. Que veut-elle? Quoi qu’elle puisse vouloir je ne suis plus disposé à jouer à l’arbitre au premier coup de sifflet. Je n’en ai ni la force ni la volonté. Je lui dis haut et fort :
– Ecoute, tu ne vas pas de nouveau te fâcher avec ta mère au prétexte que je réponds comme elle par des biais à tes interrogations. Si tu veux mon avis, ce qu’il faudrait c’est qu’une tierce personne mais ppp pas moi, intervienne pour vous réconcilier. Elle écarquille ses grands yeux, immenses et pleins de malice. Sans colère.
– Une tierce personne? Nous réconcilier? Mais… c’est de toi que…
– Vos scènes me font penser à une anecdote qui n’a plus d’âge mais que je trouve correspondre à ce type de situation.
– Aha…
Tu sais que Nyar est un ami d’enfance. Je le connais de bout en bout. Autant que je me connais. J’ai beaucoup d’affection et de respect pour lui. Vice versa. Jeunes nous étions déjà souvent ensemble. Nous aimions ensemble jouer au football, aller à la mer au cinéma -Nous avions tout notre temps depuis que nous fûmes la même année renvoyés du collège pour n’avoir pas su comme beaucoup d’autres trouver un faux père ou frère qui pût par une quelconque parade impressionner le principal ou les maîtres et nous extraire de l’impasse.- Nous n’avions pas toujours
le même regard sur les gens, la vie. Souvent nous avions des difficultés -à défaut d’arguments sensés- à mettre fin à des querelles nées de nos divergences. Nous finissions par partir chacun de son côté. Nous ne discutions pas vraiment, vois-tu. Le lendemain nous n’y pensions plus. Mais une brouille nouvelle guettait toujours au creux de nos rencontres. Un jour, une fois de plus nous nous sommes accrochés sur une futilité. Mais pour nous, à cette époque c’était tout, sauf une futilité. Nous en sommes presque venus aux mains. Un inconnu, un vieux monsieur, un étranger nous emporta dans un tourbillon pédagogique à propos de l’amitié, l’éphémère, le rire et la futilité justement, pendant un temps qui semblait ne plus vouloir s’arrêter. Par respect nous ne bronchions pas. Puis Nyar le soupçonna de défendre mon point de vue. Il le lui dit. Je rouspétai et à mon tour j’accusai l’étranger d’être contre moi. L’étranger finit par avoir le dessus puisqu’il nous réconcilia. Difficilement mais il y parvint. Ce monsieur -c’était un brave monsieur- est resté quelque temps à Oran. Il devint un grand-père en quelque sorte, un grand maître. Nous apprîmes beaucoup de lui. De nos jours encore, plusieurs fois il me semble l’avoir croisé. Drôle de situation, de sensation. Tiens, hier ; je t’ai dit qu’au National muséum j’ai vu un type qui lui ressemblait !
– Je m’en souviens.
– Je dois avoir la berlue.
(Le portrait l’empêchait de dormir. Quand il était loin de Londres, la terreur s’emparait de lui à l’idée que d’autres yeux que les siens pussent le voir).
Housia regarde l’heure comme elle aurait regardé le ciel ou un objet quelconque. Elle oublie ses interrogations. Elle dit poliment : « Ah oui ». Je sais maintenant qu’elle s’impatiente pour sortir. Le café n’en est pas un. Ni le bâtiment ni le liquide. Centre commercial pour l’un, jus de chaussette pour le second. Il provient peut-être d’un caféier local, un caféier du nord. Non, je ne suis pas irrévérencieux en pensant cela. Mais nous avons bien fait de quitter les lieux sitôt réchauffés. La salle était comble et bien chaude. L’essentiel.
Nous suivons le boulevard Vasabron puis empruntons Vasterlång gatan dans la moyenâgeuse Gamla-Stan, un îlot de vieilles demeures et de ruelles serrées les unes contre les autres flottant entre le populaire Södermalm et Norrmalm. Derrière la cathédrale nous pénétrons sur notre gauche dans Stortorget. En ces lieux la foule est épaisse. Il y a beaucoup d’hivernants étrangers. Ils sont reconnaissables aux tics qui secouent leur tête dans tous les sens comme s’ils voulaient conserver tous les détails de la vie et des choses, y compris dans la pénombre. Ils sont aussi bruyants que pressés. Encore une fois je demande l’heure à Housia qui, de nouveau ne répond pas Le jour a déjà froidement tiré sa révérence depuis au moins seize heures. Quelle heure est-il? Monumentale et donc dédaigneuse, la bourse demeure de marbre et de prestige. Je n’insiste pas mais cela m’agace. Stortorget est une belle place ceinturée de bas immeubles illuminés dans laquelle plongent deux rues piétonnes. Au centre un ensemble de fontaines sont plantées, chacune orientée vers un coin de la place. Le peuple de Stockholm fait son marché de Noël dans une allégresse feutrée, mise à mal par l’angoisse noire générale qui recouvre le pays chaque année à la même période plusieurs mois durant. L’eau ne coule pas. Dans la gueule de chaque dragon dont les têtes ornent les sources s’est formé un bouchon. Je prends mon bloc-notes et y couche quelques commentaires supplémentaires sur ces moments. Mon stylo et mon bloc-notes sont des objets qui forment une excroissance de mon être. Nous avons grandi ensemble. Ils sont ma seconde nature. Sans mon stylo sans mon agenda je deviens ver de terre. Nu. Ils sont mon issue de secours lorsque je suis bâillonné par le diktat des paroles. Il m’est difficile de vivre sans utiliser ce privilège, le privilège de pouvoir figer des appréciations montées au forceps, sur le monde et sur soi et de redécouvrir, intacte et sans nostalgie si possible ; des mois, des années plus tard, enfouie dans des mots forteresses allongés sur le papier jauni, l’atmosphère du moment. Evidemment. L’eau ne coule plus donc. Figée. Le froid a raison de sa fluidité comme l’eau a raison d’un château de sable monté sur une plage d’été bariolée. Depuis une semaine une masse d’air arctique précoce et exceptionnelle s’abat sur toute une partie du pays entre Älvkarleby, Stockholm, Arkiva et Kiruna du Lappland. Ici la température atteint douze degrés Celsius en dessous de zéro. Je ne tiens plus. Les gamins ne sont plus là. Les ouvriers, reviendront demain s’acharner sur des canalisations en piteux état. Depuis plusieurs jours des milliers de minuscules flocons étoilés, en apparence semblables, mais combien réellement variés parfois par groupes enchevêtrés les uns aux autres, parfois épars, glissent mollement vers le sol à l’instar des trapézistes qui se laissent choir le long de cordes arquées invisibles ; muets. C’est l’anarchie. Et cette eau visqueuse qui ne coule plus. Peut-on accepter un instant une fontaine sans eau? Voilà. C’est exactement pareil. Pourquoi l’eau ne coule plus? Cela n’est même pas de la faute de l’homme. Il n’y a pas d’eau. C’est comme les aiguilles de tout à l’heure. Je pourrais dire des choses à ce propos. Le sapin est couvert de mille et une guirlandes, de paquets, de boules de Noël et de feu. Il est beau et immense !
– Des oreilles aux orteils je suis gelé.
– C’est par-là.
Nous revenons vers Västerlång gatan. Nous la remontons puis la traversons pour prendre un passage voûté. Nous pénétrons dans une sorte de restaurant populaire qui se trouve à quelques pas sur la droite, le Kebab Café. Lorsque Housia pousse la lourde porte double-vitrée et embuée, tout un assortiment d’odeurs transportées dans une bulle d’air chaud nous attire jusqu’au fond de la salle près d’une belle terrasse. Elle fut naguère fleurie. Nous nous approchons d’une des quelques rares tables orphelines et nous y installons. A l’extérieur, sur la terrasse inaccessible, il ne reste que des corps de plantes rabougris, flétris. Le temps y est pour quelque chose. Au patron qui accourt vers notre table -ce n’est peut-être pas le patron mais il en a l’air ; l’air renfrogné- nous faisons signe de patienter. En fait, je lui fais « après » en simulant un grand cercle que je profile avec mon index gauche. Je renouvèle le même geste. Il tente avec son regard ombrageux d’insister. « Jag förstår inte » dit-il et repart pas très heureux. « Ja ja » dit Housia en dégageant le clapet de son téléphone qui se met à sonner. Des clients se retournent. Elle se lève, évite des regards et des chaises, s’excuse et tente en vain d’ouvrir la porte qui donne sur la terrasse. Elle se dirige vers la sortie, échange quelques paroles. Elle revient au terme d’un court moment et désactive son téléphone. Elle sourit.
– C’était Katarina. Elle nous rejoint dans une demi-heure.
– Mais, c’est ce qu’elle nous a déjà dit tantôt.
– Oui mais enfin… Tu n’as rien commandé?
– Tiens voilà le patron.
Auprès du patron -il en a l’air- Housia s’excuse pour la communication. Je comprends qu’elle lui explique la situation. Il sourit en me regardant. Je lui renvoie poliment sa politesse.
– One bier please. Två !
La soirée s’annonce des plus intéressantes. Les serveurs s’agitent avec dextérité. Ils étalent fièrement dans ces circonstances l’art d’esquiver les coups de leurs collègues, de tenir debout, de ne pas glisser quel que soit le poids ou le nombre d’objets qui garnissent leur plateau -haut sur leurs cinq doigts, voire trois- d’arriver à destination, de servir, sourire et revenir pour un nouveau tour en évitant méthodiquement le panneau de la porte-battante de la cuisine. Justement, l’un d’eux faillit me contrarier. Sur le côté un jeune homme s’esclaffe. Nous pouffons à notre tour. Les deux mains ouvertes, plaquées contre son ventre, Housia ne s’aventure pas plus. Elle tente difficilement de contrôler son rire. Le brouhaha s’accommode des lieux et s’amplifie dans un îlot de fraternité bientôt plus forte, tissée par les échanges et les éclats de rire, encouragée par toutes sortes de remontants.
– Ca va? restez assis. Ca a été le ciné? racontez un peu.
Nous apprécions la discrétion calculée de Katarina. Elle dépose mon sac de voyage.
– Merci.
Alors? dit-elle. Nous lui parlons de Viskningar och rop. Elle n’apprécie effectivement pas. Housia glousse et Katarina change aussitôt de sujet de conversation. Housia et sa mère prennent chacune un Janssons frestelse. Quant à moi, j’ai assez englouti de kåldomar et de Köttbullar och potatis, je préfère me laisser tenter par un bon plat du sud. Devrai-je dire de chez moi? Un bon vieux plat de felfla. Ail poivrons verts et huile d’olive. Sur ma droite nos voisins s’en donnent à cœur joie. Comme ils ont -de toute évidence- plusieurs tours d’avance ils entament une chanson à boire comme s’ils étaient devant l’arbre sacré de mai : He-lan går, sjung hopp falle rallan rallan lej !… et glou et glou. Plus tard, à leur invitation nous nous joignons à eux, d’autres clients font de même et puis tout le monde. On jurerait que l’hiver et la désillusion qu’il charrie sont loin tant la joie et la spontanéité sont immenses et réelles. Le patron -est-ce un turc?- offre plusieurs tournées. Une vraie fête d’adieux !… Alors avec Young nous reprenons et buvons en chœur. Then I ran into… L’air m’est tellement familier que les notes et paroles dansent dans ma mémoire avant de jaillir des amplificateurs de la chaîne hi-fi du restaurant. Les unes après les autres elles figurent un filet comme des gouttelettes d’une eau de jouvence, et viennent se jeter corps et âme contre nos tympans jouisseurs. La vie ! Then I ran into the hangman, he said « it’s time to die ». You gotta tell your story boy, you know the reason why… Je me croirais au Casanova. Il y a là pas moins de trois douzaines de personnes. Personnel compris. Cela fait beaucoup trop de monde pour un si petit espace débordant d’humanité et de générosité. Une plage de vie. Quelques écrans diffusent une lumière artificielle vive qui contribue à rehausser le moral général. Les huit vieilles tables sont assiégées. Les bougies vivantes qui les garnissent font danser les ombres des bouteilles vides et nos silhouettes sur le mur décrépit. Les flammes s’étirent vers les lampes électriques pendues, inertes et vaincues, peu soucieuses. Jusqu’au dernier souffle consumé, aussitôt renouvelé.
Katarina me glisse un objet entre les mains. Elle dit simplement : C’est ta fête non?. Ses mots sont les mêmes à mille lieues temporelles. Nous étions alors emportés l’un et l’autre. L’un contre l’autre, corps unique dans un tourbillon de mots de gazouillis de couleurs de paysages et de parfums ; de bonheur et de silence. D’émotions. Ce soir ses mots sont fraternels et ses yeux affectés.
– Ma fête, quelle fête, qu’est-ce?
– Ben qu’attends-tu, défais le paquet !
– Non, c’est pas vrai, c’est merveilleux, vraiment merveilleux ! Je vous embrasse ! Je n’aurai jamais suffisamment de mots pour vous demander pardon, heu… pardon ; je veux dire pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi depuis le début. Je vous embrasse ». D’autres sons restés en travers, muselés, rebroussent leur chemin dans ma gorge sèche.
« Happy birthday » dit une voix. « Är det en kompass? » demande une autre. « Javisst, heu… sure it’s a compass ». Et une magnifique montre électronique.
Ah d’accord ! (« Quelle heure as-tu? Depuis que j’ai égaré ma fichue montre je suis perdu. Pourquoi souris-tu? J’y tenais beaucoup tu sais… Comment ai-je pu? Elle a appartenu à ton grand-père. Je te l’ai dit non? ») Ah d’accord !
Le groupe frénétiquement tape dans les mains sur les tables sur les bouteilles ! Mais il fallait que ce moment arrive. Katarina se lève. Elle s’excuse de devoir nous quitter. Elle est tirée par la manche. Elle se relève une nouvelle fois et s’excuse de nouveau toujours souriante et triste. Je me lève aussi. Difficile. Une chaise tombe à la renverse. Je happe un clin d’œil azur mouillé qu’elle adresse à sa fille. De nouveau elle m’embrasse à quatre reprises et file. Je devine une larme à l’œil… You gotta tell your story boy, you know the reason why. Are you ready for the country, because it’s time to go…
– N’oublie pas ton sac de voyage me crie Katarina. Tu as tout le reste j’espère. Aussitôt la lourde porte poussée une bouffée d’air glacé nous enveloppe. Elle est déjà dehors. Je suis seul à tenter une réaction. La porte se referme. Je ne la verrais pas se retourner. Je l’imagine: tête baissée, elle fait quelques mètres ; la voilà qui ralentit. Elle tourne la tête, son regard brouillé fixe mal l’entrée du Kébab. Elle ne supporte pas les adieux. Qui les endure? Les uns dansent les autres applaudissent. Nous trinquons tous. C’est la contagion. Je me rassieds. Housia dit seulement, les deux mains en entonnoir collées à mon oreille : c’est rare ici de faire comme cela. Je l’imite et crie car il faut bien répondre : c’est pour moi, tu n’as pas compris? J’ajoute :
– J’espère que tu m’accompagneras n’est ce pas, jusqu’au bout hein? »
– Mais pourquoi maintenant?
– Je t’ai déjà répondu. Cela ne dépend pas de moi. » (Le moment lui seul peut éventuellement dépendre de moi. Je ne suis pas heureux. Ma conscience a fortement inoculé ma soirée de sa prestance abyssale ; plus que d’habitude.) Puis je me lève de nouveau.
– Excuse-moi.
Je me rends aux toilettes et m’enferme le temps d’absorber mes psychotropes. Ai-je avalé trois, quatre ou six comprimés? Peut-être plus. Je referme le vieil et encombrant robinet d’eau. Je finis par trouver mon carnet sur lequel je porte ces mots : « je suis trop conscient pour être heureux. Pardon » . Puis, je remonte. Nous avalons d’autres alcools. Are you ready for the… L’euphorie nous menace le temps glisse et le patron exténué s’impatiente. Nous tentons de nous défaire des autres noceurs. La troisième tentative est la bonne. Housia et moi quittons cette folie sous des hourras gênants que nous lancent les plus spongieux des fêtards. Nous allons sans presser le pas en direction de la station.
– Pas trop lourd le sac? »
Nous marchons une centaine de mètres. Peut-être plus. Je ne suis pas bien. Je propose de nous arrêter. Quelques couples pressés ralentissent, hésitent, passent se retournent par habitude et reprennent leur chemin. J’imagine un instant leurs pensées que je colore en noir. Je ne peux leur en vouloir. Ils nous ressemblent. Je prends sa tête dans mes mains brûlantes et l’attire contre la mienne. Les larmes ne sont pas amères. Un vide accablant s’embusque dans mes pensées. Il est le fruit du dégoût. Indéfinissable dégoût. Est-ce du désenchantement? et pourquoi? Non. Non… Le voyage est accompli et il n’y a nul plaisir à le contempler après. On devrait avoir plus de plaisir à accomplir un bienfait, une œuvre ou un voyage qu’à les admirer ou les regretter les yeux plongés dans le rétroviseur de sa propre vie. Les vivre oui, mais à quoi bon les contempler? Une fois satisfaits il faut les prendre tels qu’ils sont : Achevés, inconvenants, creux. Cuisants peut-être aussi. Cela fait 2000 ans qu’on le dit. Iam fructu artis suae fruitur… Les branches qui nous portent finissent toujours par pourrir. Alors… Ce n’est que trop facile à dire. Nous ne pouvons que.
Lorsque le moment se présente -redouté ou sereinement attendu, parfois même décidé et programmé- il faut dignement le saisir. Instinctivement Housia me suit ; écrasée, effondrée dans le silence. Quel mot, quels mots prétentieux suffisants, pourraient traduire nos émotions, nos troubles ou oseraient en ce moment refléter ce qui même les précède, les enfante ; ces rythmes intérieurs indicibles. De nouveau je demande à Housia un moment de répit. J’implore son pardon.
– N’oublie pas Ya-Sin, Ya-Sin.
Je sue un peu plus. Des picotements pianotent de plus en plus vite et fort, le long de mes bras et avant-bras. Les tiraillements y sont plus vifs. A hauteur de Elsegatan le sac à dos se dégage et glisse le long du bras gauche. Mes doigts engourdis ne peuvent plus rien retenir. Il plonge sur la chaussée blanchie.
– Alec !
Ma poitrine se comprime, se déchire. Je manque d’air et d’eau. Mes jambes me lâchent. Brusquement le ciel s’écroule. Jamais la terre ne fut si basse. Ciel et terre sont maintenant confondus. Je sombre dans le blanc, cerné par ma propre vérité.
– Alec !
Il a suffit d’un instant. J’entends : « Snälla, snälla, kala på en ambulans ! ». Est-ce elle? J’ai chaud. Des bruissements alentours flottent puis se font voix. Je devine des têtes casquées, des blouses blanches qui tournoient dans un jeu de lumières. Les yeux sont avides et blancs. Eux aussi tourbillonnent à la recherche d’autres yeux ou d’autres soutiens ou quelque encouragement. Quelques bouches se tordent, s’ouvrent, se contorsionnent. Je ne reconnais personne. Devrai-je reconnaître quelqu’un? C’est carnaval. Quel rôle m’est attribué? Et tous ces gens en bas qui s’affairent autour de moi ; est-ce une idée? Une vue de l’esprit? Pourquoi? Une sensation agréable désormais m’accompagne.
– Razi !
Je ne réponds pas. Le puis-je? A quoi bon. Je glisse sur les eaux accueillantes d’une rivière lactescente. Je leur souris. Je Lui souris et Lui tend mon gauche index. Des mots que toute leur vie ma mère sa mère et ses aïeules n’ont cessé de me répéter, de nous répéter, s’insurgent, se révoltent et s’échappent. M’entend-Il ? Est-Il seulement là? Ach’ hadou en’ la Ilah. J’ai appris que les mots ne servent à rien, que les mots ne correspondent jamais à ce qu’ils s’efforcent d’exprimer. Ma mémoire s’emballe au seuil de ma conscience.
– Far !
Ah ! Il lui est aisé maintenant de dérouler à sa guise des bribes de ma propre histoire ! Ma mémoire est souveraine. Elle n’en fait forcément qu’à sa tête. Pour combien de temps? Housia ! Eva ! Kata… Ce sont là les premières pages du roman Le temps d’un aller simple.
