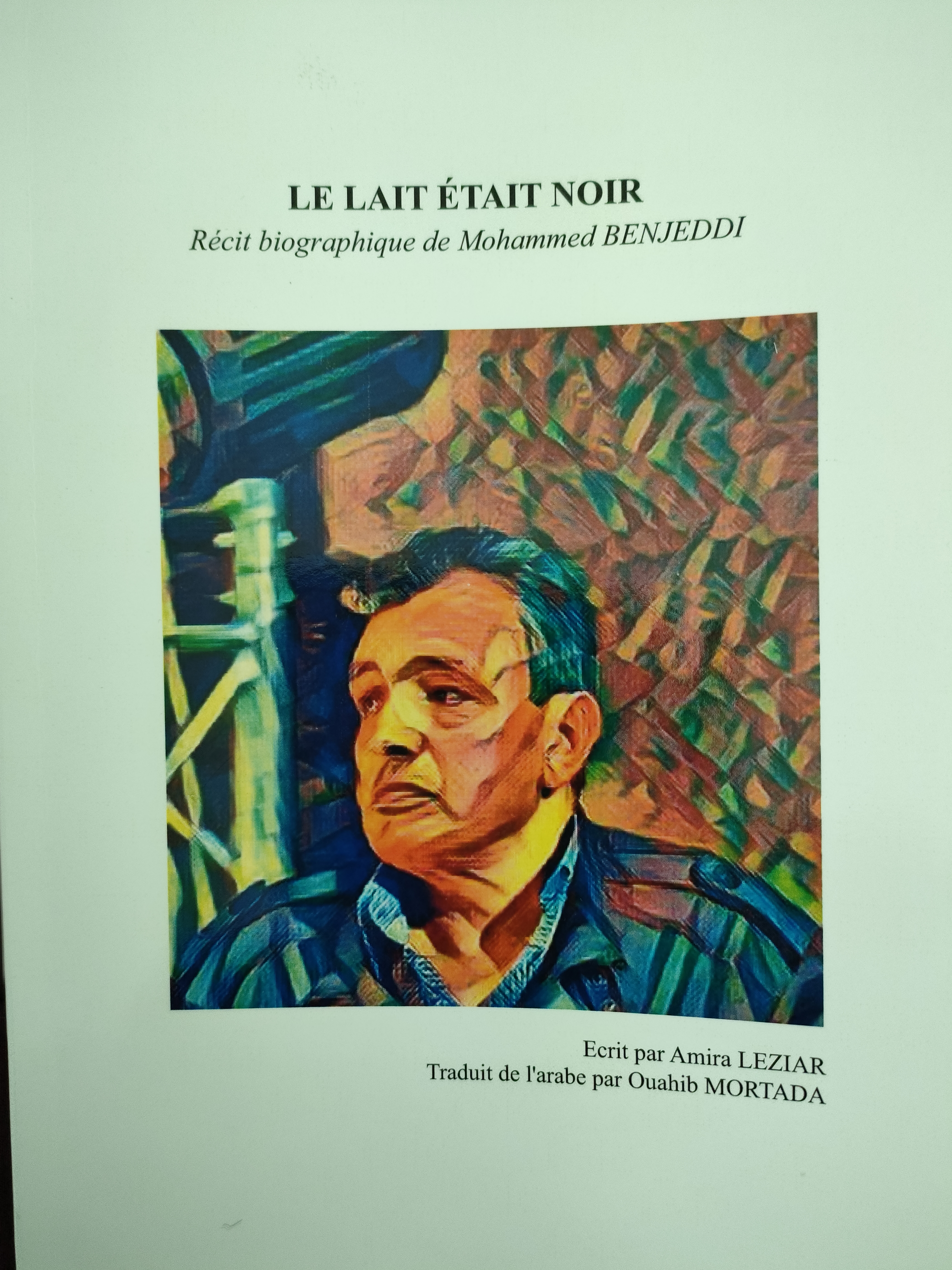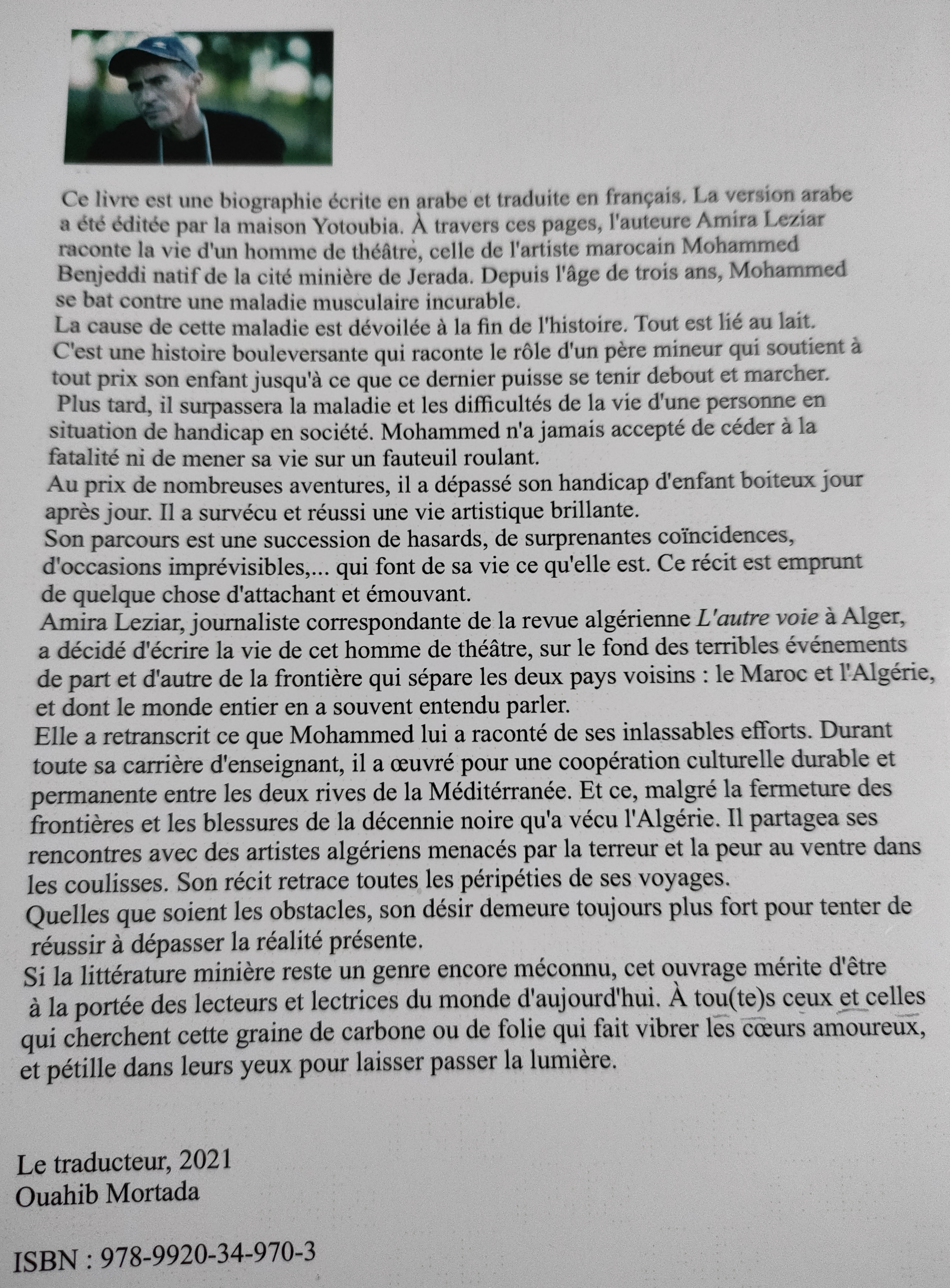Le livre «Algérie, les écrivains dans
la décennie noire» de Tristan Leperlier (CNRS Éditions, Paris septembre 2018,
344 pages), est « la version remaniée » d’une thèse de doctorat de l’auteur,
soutenue il y a trois ans à l’École des hautes études en sciences sociales
(Paris) et intitulée «Une guerre des langues ? Le champ littéraire algérien
pendant la décennie noire (1988 – 2003). Crise politique et consécrations
transnationales».
Le livre se positionne «entre études littéraires et sociologie des
intellectuels» et s’adresse aussi bien «aux lecteurs curieux de découvrir une
littérature (algérienne)
qu’aux lecteurs qu’intéressent les enjeux de l’engagement politique en période
de censure religieuse, de migrations intellectuelles et d’identités
postcoloniales». Il s’articule autour de quatre grandes interrogations
(chapitres). La première interroge le statut de l’écrivain, la deuxième ce que
fut la guerre civile, la troisième l’engagement de l’écrivain et la quatrième
les écrivains dans la relation France-Algérie. Comme l’indique l’intitulé de la
thèse, la recherche couvre la période allant de 1988, année de la révolte des
jeunes Algériens, à 2003, année de Djazaïr, une année de l’Algérie en France,
«couronnant une période où les relations littéraires entre la France et
l’Algérie ont été intenses, et marquant le retour de l’État algérien en
matières culturelles».
Les choix méthodologiques : l’analyse qui s’inscrit «à la croisée des études
littéraires et des sciences sociales» est à la fois qualitative et
quantitative, elle introduit des concepts empruntés notamment à Max Weber,
Émile Durkheim, Pierre Bourdieu, Erving Goffman. Tristan Leperlier procède à
des entretiens semi-directifs en français ou en arabe, avec 80 individus dont
65 écrivains, 15 éditeurs, 2 journalistes… La base de données des œuvres
littéraires algériennes en contient «plus de deux mille» (ou : «environ deux
mille») et 174 écrivains algériens en activité entre 1988 et 2003». Tout le
long du livre, argumentaires et justifications s’enchaînent sous différents
angles et contenus et se complètent pour aboutir à une construction cohérente
de la question centrale du rôle des écrivains algériens durant la décennie
noire et les conséquences que les bouleversements politiques et sociaux ont
eues sur eux. Autrement dit, comment les écrivains algériens ont été partie
prise et partie prenante ? Le contenu de la recherche est très dense et très
circonstancié. Aussi, nous proposons cinq rubriques ramassées qui, dans leur
ensemble, espérons-le, en reflètent l’essentiel : 1- la position de
l’intellectuel, 2- les différents groupes, 3- francophones, arabophones, 4-
engagement et témoignage, 5- une littérature spécifique et des logiques
économiques.
1- La position de l’intellectuel
Tristan Leperlier introduit la question de l’autonomie de l’écrivain et la
tradition française quant à l’engagement de ce dernier au nom des valeurs
universelles de tolérance, de vérité
Deux types d’écrivains sont opposés, l’ «intellectuel critique» et le
«conseiller du prince». L’auteur n’évoque pas la question de l’intellectuel
organique d’Antonio Gramsci, ni la critique de Pierre Bourdieu. En Algérie,
l’écrivain dispose d’un statut éminent, il est le «parangon de l’intellectuel»
jusqu’aux années 90, qui seront aussi les années qui mettront un terme à cette
position de prestige, au bénéfice des journalistes. Deux facteurs sont la cause
du déclin de l’écrivain phare : la crise politique et son internationalisation,
et la guerre civile qui suivit. Mais aussi son soutien «bon gré mal gré» à un
régime «semi-autoritaire». L’auteur nuance, «l’engagement des écrivains
algériens paraît bien plus complexe que le discours d’héroïsation à leur propos
ne donne à penser». Alors qu’ils étaient «à l’avant-garde de la contestation du
pouvoir politique», au début de la décennie Chadli Bendjedid, ils se mirent en
retrait pendant les émeutes d’octobre 88. Kateb Yacine allant jusqu’à appeler à
serrer les rangs autour du FLN (Front de libération nationale) post-octobre,
écrivant dans une tribune «Le FLN a été trahi» (Le Monde daté du 26 octobre
1988), alors que les journalistes «étaient en première ligne… Dès mai 88, un
mouvement des journalistes algériens s’était d’abord structuré autour de
revendications salariales». Les journalistes «en tant que journalistes»
remplacent les écrivains à l’avant-poste de la contestation». Le silence des
écrivains prendra fin au lendemain de «l’arrêt du processus électoral», lorsque
la montée en puissance des islamistes mettait en péril l’autonomie du champ
littéraire.
À la suite des émeutes d’octobre 88, l’Algérie se démocratise, s’ouvre au
multipartisme. Une nouvelle Constitution, garantissant les droits fondamentaux
des citoyens, liberté d’expression, d’opinion, d’association, liberté
religieuse, liberté de la presse, est adoptée. Le gouvernement de Mouloud
Hamrouche libéralise la presse (loi 90-07 du 3 avril 1990). Dans
l’effervescence que vit le pays, les journalistes occupent le devant de la
scène et le champ intellectuel. Ils sont «l’avant-garde intellectuelle de la
contestation politique», alors que les écrivains se mettent en retrait.
L’auteur liste les forces politiques en présence alors, citant le FLN et le PAGS
(Parti de l’avant-garde socialiste), puis les islamistes, les berbéristes et
les libéraux ou réformateurs, en accusant ces derniers d’être «stratégiquement
alliés aux fondamentalistes», faisant l’impasse sur les autres organisations
dont plusieurs sont trotskystes et le FFS (Front des forces socialistes), le
plus ancien parti d’opposition au régime depuis l’indépendance. L’auteur
évoquera plus loin ce parti sans le qualifier ou bien l’indexer comme
«participant à la Quatrième internationale».
«Formés généralement dans le marxisme, les écrivains, en tant qu’élite, ont
connu une forte promotion dans les années 70 et ne sont donc pas foncièrement
hostiles au régime FLN» face auquel ils adoptent «une attitude de
soutien-critique» jusqu’au changement intervenu à la tête du Pouvoir avec
l’arrivée de Chadli Bendjedid. Avec les émeutes d’octobre 88, «la
représentation de l’intellectuel, et de l’écrivain en particulier, est rompue».
Il y a entre ces intellectuels et les jeunes émeutiers «un décalage social». 25%
(de la base de données de l’auteur) «des écrivains actifs pendant les années 90
ont tenu un poste de responsabilité (haute administration, direction de
recherche…)».
Le « retour de la gauche» aux commandes du pays, à la fin des années 80 début
90, invite les intellectuels les plus indépendants par rapport au FLN à
«élaborer de nouvelles politiques culturelles publiques» favorisant
l’autonomie. On assiste à une forte libéralisation du secteur culturel. La SNED
(Société nationale d’édition et de diffusion) où Rachid Boudjedra officiait
depuis sa nomination en 1981 comme «censeur en chef assumé» (El Watan, 10
octobre 2017) ne dispose plus du monopole.
Le réengagement politique des écrivains ne s’effectuera qu’à la fin de la
décennie avec la «visibilisation publique croissante des islamistes» et leur
menace. De nombreux écrivains intégreront au début de l’année 89, le
«Rassemblement des artistes, intellectuels et scientifiques (RAIS)» qui publie
le 29 février une «Déclaration pour la tolérance». Le texte, signé par près de
8.000 personnes, sera déposé à l’Assemblé nationale le 8 mars de la même année.
À la fin des années 80, «comme dans les années 70 quand ils acceptaient de
répondre aux injonctions de la célébration nationaliste et socialiste, les
écrivains reprennent à leur compte les enjeux du champ politique». Leurs
sollicitations ont été entendues. «En 1992, ils se sont rangés majoritairement
du côté d’un «État» qui n’hésitait pas à mettre en cause le résultat des
élections législatives, puis à mettre en place des mesures répressives à
l’égard du mouvement islamiste». Les écrivains sont «plus engagés pour les
libertés individuelles que pour la démocratisation susceptible de mettre en
danger ces libertés». Une dizaine d’années plus tard, «lors du Printemps noir
en Kabylie en 2001 -répression massive provoquant des centaines de morts-, les
écrivains se sont, comme en 1988, peu mobilisés».
2- Les différents groupes
L’auteur distingue trois positions politiques chez les écrivains : il y a les
anti-islamistes radicaux (les éradicateurs), les anti-islamistes dialoguistes
et les pro-islamistes. À partir des entretiens et des bases de données, les
trois-quarts des anti-islamistes sont radicaux. «Les positions pro-islamistes
et dialoguistes paraissent marginales». Tristan Leperlier questionne dans un
premier temps la relation entre les prises de positions politiques des
écrivains et leur position dans le champ littéraire, et dans un second temps la
relation entre ces prises de positions politiques à l’aune de leur proximité ou
non avec le Pouvoir, l’auteur écrit souvent «État» sans éclaircissement des
deux notions.
Il se dégage de son analyse «trois nuages» : individus, modalités, modalités
politiques, à partir desquels sont dégagés trois idéaux-types : les Professionnels
(souvent héritiers d’un capital littéraire, ils vivent de leurs écrits), les
Professeurs (fonctionnaires, anciens étudiants en Lettres), Les reconvertis
(ceux-là, souvent journalistes, venus tard à la publication).
Dans la rubrique «Deux rapports àl’État’»,
l’auteur distingue deux groupes d’écrivains s’inscrivant contre les islamistes
: les dialoguistes et les radicaux. Les écrivains du premier ont dénoncé le
coup d’État et soutenu la Plateforme de Rome en 1995 signée «entre trois partis
frustrés de leur victoire en 1992». Dans les faits, la Plateforme de Rome n’a
pas été ratifiée par trois, mais sept partis politiques et la Ligue des droits
de l’homme de maître Ali Yahia Abdenour. Les écrivains dialoguistes sont à la
marge du champ littéraire, écrit l’auteur, il n’y en a que deux de grande
carrure, et ils sont «les moins dotés en toutes sortes de capitaux et ont peu
accès aux postes politiques ».
Les écrivains du second groupe ont soutenu l’arrêt du «processus électoral» et
«la politique anti-islamiste radicale de Rédha Malek, figure politique
importante de la gauche». D’ailleurs, «la tendance de leur participation au
pouvoir politique s’est renforcée». Les anti-islamistes radicaux, s’ils
reconnaissent qu’au sein du pouvoir il y a une «diversité», ils la «nient»
s’agissant du mouvement islamiste, «c’est un leurre», répète par exemple Rachid
Boudjedra «communiste très intégré aux cercles du Pouvoir». Ce «Voltaire
d’Alger» qui se veut «orientateur des consciences dans son pays et ambassadeur
de l’image de l’Algérie dans le monde». Il s’agit en définitive de deux
rapports au Pouvoir politique. Nombre d’écrivains de la génération de Novembre
«doivent à »l’État »
algérien leur très forte promotion sociale… Si la plupart des jeunes
écrivains de langue française ont été favorables à l’arrêt du processus
électoral de décembre 1991», contrairement à nombre de leurs aînés, ils
«semblent être les premiers à s’éloigner de l’approche anti-islamiste radicale
pour mettre en cause et »l’État » et les islamistes».
–
L’auteur met en avant la concurrence entre écrivains et journalistes dans le champ intellectuel. «Par les écrivains dialoguistes, le champ littéraire rentre en friction avec d’autres champs intellectuels». L’opposition entre intellectuels anti-islamistes radicaux (des écrivains) et dialoguistes (des journalistes et universitaires structurés autour de la maison française d’édition La Découverte comme Mohammed Harbi, Benjamin Stora, Tassadit Yacine José Garçon, Salima Ghezali, Ghania Mouffok…), on la retrouve entre intellectuels critiques «universalistes» et «spécifiques». Les premiers interviennent dans le débat «au nom des valeurs», les seconds «au nom d’une spécification».
3- Francophones, arabophones
L’auteur réfute cette image qu’ont certaines élites françaises reconduisant une
perception coloniale, selon laquelle face à l’Algérien «évolué et moderne» et
donc francisé et dont l’horizon est tourné vers la France, est posté
«l’archaïsme, voire la barbarie du reste de la population». Selon cette «doxa
française, la guerre civile algérienne aurait été avant tout une guerre
culturelle opposant arabophones et francophones» Mais il précise que les
écrivains algériens exilés en France ont contribué à la diffusion de cette
représentation. Boualem Sansal (qui n’est pas exilé à l’étranger) «parle de
guerre linguistique». Chez les arabophones, la langue arabe est mise en avant
contre le français «langue de la colonisation et de l’aliénation». Brahim Saci,
philosophe laïc, «mais» -conjonctionne l’auteur- opposé à l’arrêt du processus
électoral, se permet de généraliser : «C’était aussi une guerre des langues»,
affirme-t-il. Tristan Leperlier indique que dans le champ littéraire «fortement
bipolarisé, la guerre civile est devenue une guerre des langues», ce qu’elle
n’était pas avant.
Selon l’auteur, en partie, le conflit entre les pro et les anti-islamistes se
résume à l’opposition entre fondamentalistes et gauche marxiste qui avait
structuré la vie politique depuis l’indépendance. Ce raccourci (il n’y en a pas
beaucoup heureusement) ne nous semble pas à la hauteur des prétentions du
chercheur. Quelques pages plus loin, et pour illustrer son propos, Tristan
Leperlier rapporte les mots d’un auteur de la gauche marxiste qui, -près d’un
an après octobre 88-, dans le numéro du 7 juillet 1989 de Révolution Africaine
(FLN), faisait sur cinq pages le panégyrique de Nicolae Ceausescu. Cette
«opposition entre les pro et les anti-islamistes a été en partie absorbée par
le clivage linguistique francophone/arabophone».
4- Engagement et témoignage
La problématique de l’engagement a été «réactivée» par la guerre civile alors
qu’elle s’était effacée durant la décennie 80 après qu’elle fût «centrale dans
les années 70». L’auteur propose à partir de la sociologie d’Émile Durkheim
(explication causale du réel) et de Max Weber (compréhensive et subjectiviste
ou le point de vue de l’acteur) une typologie du geste d’engagement par le
biais de la littérature. L’engagement d’attestation, l’engagement d’évocation et
l’engagement d’interrogation.
L’engagement d’attestation est une «affirmation d’un propos politique».
L’objectif de cette stratégie est de contrer les discours pro-islamistes «et
surtout dialoguistes». L’engagement d’évocation «ne formule pas de propos politique
explicite, n’affirme pas de valeurs». Cet engagement-là «entre en discussion»
plus avec un imaginaire. L’engagement d’interrogation «est fondamentalement
politique tout en cherchant l’autonomie de la littérature». Il est
contradictoire avec l’ethos de témoin, il peut mettre en cause les valeurs »attestées »
par d’autres.
Mais ces engagements sont une chose et l’engagement esthétique en est une
autre.
Si l’exil des écrivains algériens est important (le quart d’entre eux),
l’accueil qui leur est fait n’en n’est pas moins très positif du fait de
l’attente du public français. Il y a une «délocalisation exceptionnelle de la
littérature algérienne en France». Les préoccupations nationales sont très
présentes dans les livres de ces écrivains. La plupart d’entre eux «ont assumé
un ethos de témoin» et nombreux sont leurs écrits qui sont présentés comme des
témoignages alors qu’ils se situent entre fiction et histoire vécue. Lors de
notre enquête, écrit Tristan Leperlier, «Malika Mokeddem est la plus souvent
citée comme l’exemple typique de la »littérature d’urgence » ou de »témoignage »,
elle est devenue une sorte de bouc émissaire ». L’auteur émet l’hypothèse que
c’est «son virulent engagement féministe anti-islamiste qui lui est reproché».
La reconnaissance de tous ces écrivains n’est pas acquise. «Cette notion de témoignage, écrit l’auteur, est souvent rattachée dans les années 90 à celle de l’urgence», une représentation très controversée. Pour étayer ses affirmations, l’auteur prend pour exemple le contenu d’ouvrages de Rachid Mimouni, Yasmina Khadra, Malika Boussouf… Il fallait constituer en France, où se développe un discours hostile aux anti-islamistes radicaux, un discours opposé politique et littéraire, même si, comme dans »La Malédiction » (Stock 1993) de Rachid Mimouni, «la qualité du texte n’a plus rien à voir avec celle des précédents du même auteur» (1). Ce roman «abandonne toute recherche littéraire au profit d’un roman à thèse politique».
Chez Yasmina Khadra, le chercheur note que «les cinq romans qu’il publie entre
1997 et 1999 proposent au lecteur une interprétation spécifique de la guerre
civile : elle sert non un peuple opprimé que les islamistes représenteraient,
mais les intérêts économiques de la classe dirigeante, appelée «mafia
politico-financière». La crédibilité de ce «discours» est liée à l’auteur
lui-même, à son identité «à la fois algérienne et musulmane et féminine» et qui
est sans cesse rappelée dans le paratexte de ses romans de cette période.
Yasmina Khadra révèlera sa véritable identité en 2001 dans son livre L’Écrivain
(Julliard).
Avec le roman de Malika Boussouf »Vivre traquée » (Calmann Lévy, 1995) dédié à André Glucksman et à ses proches, «s’affirme le modèle du témoignage de journaliste». Il y a concurrence entre journalistes et écrivains, conséquence de leur «très grande proximité». L’auteur précise que la moitié des écrivains algériens de la période analysée ont exercé comme journalistes.
Ces écrits sont qualifiés d’intimes, de «témoignages». Dans »Peurs et mensonges » de Aïssa Khelladi (Amine Touati) qui «travaille à la Sécurité militaire avant de devenir journaliste politique… dans la presse de gauche francophone» (2) peut être qualifié d’autofiction, balançant entre journalisme et témoignage. «C’est un texte sobre et réfléchi : une écriture de l’urgence d’abord», écrit sa collègue Marie Virolle de la revue Algérie Littérature/Action. Une littérature de l’urgence, une «expression quasi oxymorique». Cette notion est critiquée, «une littérature à une dimension uniquement politique et conjoncturelle, et écrite dans la précipitation, c’est-à-dire insuffisamment élaborée (3). C’est en creux, le spectre d’une littérature de journalisme qui se dessine». Ce qu’approuve Leïla Sebbar. Quant à Maïssa Bey (l’auteur écrit Samia Benanteur), même si elle utilise l’éthique du modèle de témoignage (engagement féministe et anti-islamiste), elle prend ses distances avec cette littérature grâce à «son esthétique transparente». À son propos, l’auteur écrit : »Maïssa Bey met en avant les raisons commerciales qui auraient conduit Le Seuil à refuser son manuscrit »Au commencement était la mer », puisqu’on lui signifiait que son texte était »trop poétique pour dire la réalité sanglante de l’Algérie d’aujourd’hui ». C’était le plus beau compliment qu’on pouvait me faire. Ce qui voulait dire que je n’avais pas écrit un »témoignage », s’est réjouie l’écrivaine.
De nombreux autres exemples sont donnés sur ces questions : S. Ammar-Khodja, S.
Bachi, A. Camus, M. Dib, A. Djebar, A. Djemaï, A. Mosteghanemi… que nous ne
reprenons pas ici car leur développement alourdirait notre texte.
5- Une littérature spécifique et des logiques économiques
Durant les années 90, La France, en même temps qu’elle accueillait les
écrivains algériens, «elles les ghettoïsait dans une étiquette nationale et les
soumettait à des logiques économiques».
En France, comme les écrivains algériens francophones, leur littérature est
aussi marquée. «Marquée comme toutes les littératures périphériques» et en même
temps, elle est étiquetée, ce qui lui donne une visibilité marchande
(«francophone», «algérien»). Les écrivains sont «conscients des effets de ces
étiquetages et en jouent». D’un côté, ils apprécient de pénétrer le marché,
mais de l’autre, ils appréhendent «l’assignation à un ghetto».
«La guerre civile provoque une forte auto-identification des écrivains
algériens». Ils s’alarment de la situation politique du pays et de son image
qui se dégrade, et sont pénétrés par un «sentiment de honte», un sentiment
exprimé dans les romans comme dans »La
troisième fête d’Ismaël », »Chronique algérienne », août 1993-août 1994 de
Nayla Imaksen ou Soumya Ammar-Khodja (Le Fennec, Casablanca). Une
auto-identification que ne partagent pas tous les écrivains, ainsi Anouar Benmalek
cité par Tristan Leperlier : «Je revendique et mon enracinement en Algérie
ainsi que mon droit à l’universalité. Le terme écrivain algérien a une espèce
de connotation ethnique». Mais c’est justement sur ces points, sur «cette
auto-identification», sur cette «nouvelle littérature algérienne» que
s’édifiera à Paris la revue Algérie Littérature/Action. Il y a un fort intérêt
en France quant à cette littérature algérienne pendant les années de guerre
civile (et même avant, un «intérêt renouvelé» depuis octobre 88). «Une niche de
marché» lui est ouverte avec un risque qu’elle perde son autonomie. Il y a «un
double soupçon mercantile» porté à la fois sur les écrivains algériens et les
éditeurs français. Certains écrivains algériens qualifiés en Algérie d’«opportunistes»
sont accusés de rechercher «les suffrages étrangers», ce qui implique «de se
soumettre à la demande d’exotisme du public étranger», quant aux éditeurs
français, ils sont qualifiés d’ «ethnocentriques» parce qu’intéressés par la
seule violence. Ce soupçon est pour l’auteur «en passe de devenir un lieu
commun, tant il circule entre les cercles intellectuels des deux rives». Il
ajoute que ce «point de vue est polémique, il exprime le rejet (par les agents
du pôle national du champ littéraire) de la domination du pôle international.
Le refus de la littérature de témoignage, de l’urgence par les éditions Barzakh
relève de cette logique».
Pour le pôle national du champ littéraire algérien, «c’est l’authenticité de la littérature algérienne produite à l’étranger qui est mise en doute. L’auteur cite Kamel Daoud (journaliste) et Sadek Aïssat, auteur. Kamel Daoud qui écrivait alors (à cette époque, il n’avait pas encore publié de livre) : «La littérature algérienne publiée en France est une véritable mise en scène perpétuelle de soi-même et de son propre drame, simplifiée et vulgarisée pour la consommation de l’autre (…). Il ne peut y avoir de culture algérienne en exil en vérité». De son côté, Sadek Aïssat qui avait publié »L’année des chiens » (Anne Carrière, 1996) déclare : «J’avais peur qu’on m’emmène là où je ne voulais pas aller, j’avais peur que l’édition, les circuits autorisés, me demandent des choses…, me fabriquent, en fait me fabriquent et fassent de moi ce que je ne voulais pas être». Il y a dans l’appréhension de cet auteur et en filigrane la récupération et la transformation de ses écrits par les maisons d’édition françaises. Ce qu’a montré avec pertinence et force détails Kaoutar Harchi (4).
Tristan Leperlier relativise la question du «constat d’ethnocentrisme… (qui) n’est pas particulier aux relations franco-algériennes… les conclusions tirées sont parfois excessives… On a même parlé de machine éditoriale à mouliner les auteurs »». L’auteur considère que «les écrivains francophones entrent dans le marché français sans passer par l’intermédiaire d’un traducteur (comme d’autres auteurs), ce qui leur permet une plus grande marge de manœuvre dans la négociation avec leur éditeur». Il distingue différentes postures éditoriales selon que l’on est «petit éditeur», «éditeur moyen» ou «grand éditeur» avec des capitaux faibles ou importants. Il ajoute toutefois que le champ littéraire algérien est aussi soumis aux contraintes du marché «qui sont partiellement des pressions politiques privilégiant l’approche anti-islamiste radicale». En France, les écrivains algériens sont fortement valorisés, «moins du fait de leur autorité propre que des valeurs qu’ils promeuvent comme »intellectuels musulmans alibis »». Et nous pouvons ajouter et préciser qu’ils sont d’autant valorisés que leurs discours politiques s’emboîtent dans ceux des intellectuels français et autres faiseurs d’opinions. Plusieurs pages de la recherche sont consacrées à la revue Algérie Littérature/Action qui, en France, «avec des capitaux symboliques et économiques français», a participé à la reconstruction d’«un pôle autonome au champ littéraire algérien» qui subissait tant en Algérie qu’en France «des pressions économiques et idéologiques».
En conclusion, Tristan Leperlier affirme notamment que le champ littéraire algérien a été surpolitisé durant la période observée, poussant les écrivains à s’engager politiquement. Le fait que les écrivains «aient été en retrait de la politisation des émeutes d’octobre 88 et qu’ils se soient rangés (majoritairement) du côté de »l’État » dans la lutte radicale contre le mouvement islamiste, à rebours de l’image héroïque habituelle de l’écrivain luttant contre un État liberticide», s’explique en partie par l’idée que l’écrivain «est censé participer à la construction de la nation et qu’il est ambassadeur du pays à l’étranger, en particulier en direction de l’ancienne métropole coloniale».
Avec la fin de la guerre civile, il y a eu «une dépolitisation inédite du champ littéraire». La hiérarchie qu’on y observe entre francophones et arabophones «s’appuie en bonne partie sur le fait que la langue française est en lien avec la France». Le chercheur conclut que ce livre a permis de battre en brèche trois lieux communs de la critique que nous citons ici sans en reprendre les développements : «Rejeter l’opposition entre littérature et société, rejeter le culturalisme, reconsidérer les relations postcoloniales.
Au terme de notre lecture de cette volumineuse et importante recherche
doctorale, nous avons, d’une part, regretté que l’auteur n’ait pas tenu à
distinguer clairement «l’État» entendu comme personne juridique et morale de
gouvernance et «Pouvoir» en tant que puissance détenue par un groupe de
personnes sur les citoyens et, d’autre part, déploré l’absence d’œuvres et de
romanciers algériens qui auraient pu apporter un point de vue autre ou nuancé
aux côtés de tous ceux qui ont été pris en référence, comme Ahmed Zitouni,
Ahmed Kelouaz, Hassan Bouabdallah, Yahia Belaskri, Djamel Mati, Slimane
Aït-Sidhoum et bien d’autres ayant publié entre 1988 et 2003, loin des champs
altérés.
Dernier roman paru : Le Choc des ombres (Incipit en W- Novembre 2017).
Notes :
1- Charles Bonn, «Paysages littéraires algériens des années 90 et post-modernisme littéraire maghrébin», cité par Tristan Leperlier in page 171.
2- Il y a lieu de préciser que Aïssa. Khelladi «a participé au lancement du
Nouvel Hebdo à Alger en 1990, et co-fondé l’Hebdo Libéré en 1991»
(africultures.com)
3- http://leblogdeahmedhanifi.blogspot.com/2005/12/la-littrature-de-lurgence.html
4-http://www.lequotidien-oran.com/index.php?news=5245220
–
Cliquer ici pour lire l’article (1° partie) in Le Quotidien d’Oran
Cliquer ici pour la deuxième partie