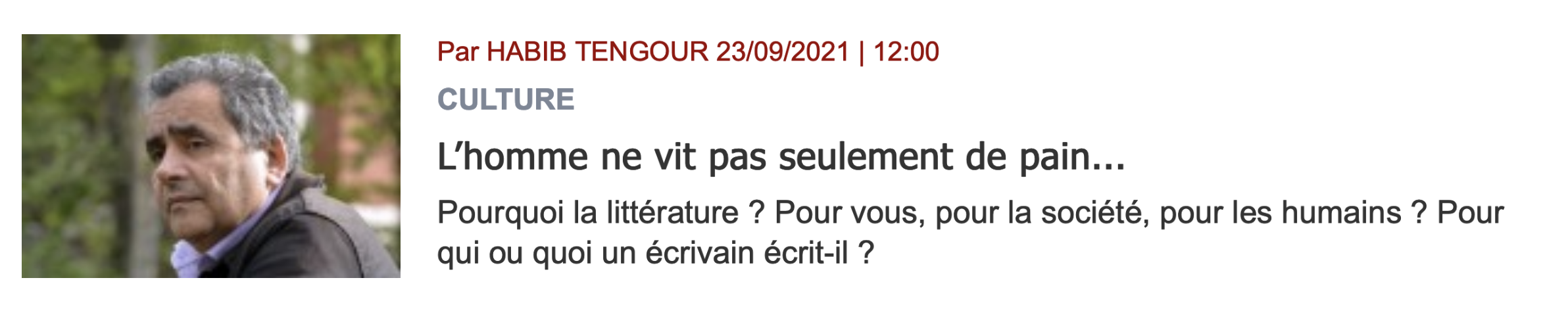

Par Habib TENGOUR, le 23-09-2021
Pourquoi la littérature ? Pour vous, pour la société, pour les humains ? Pour qui ou quoi un écrivain écrit-il ?
Questions que l’on pose toujours aux écrivains ! Questions auxquelles les écrivains n’ont pas toujours une réponse satisfaisante. Au fond, la réponse de Beckett, dans son laconisme, résume bien ce qui motive un écrivain à écrire, il n’est bon qu’à cela. Et c’est tant mieux. L’écriture est une nécessité à laquelle l’écrivain ne saurait se soustraire. N’est écrivain que celui qui se soumet à cette nécessité. C’est là un truisme. Souvent, quand l’écrivain sort de son domaine pour s’investir ailleurs (on l’y incite souvent et lui-même parfois le désire, titillé par de mauvais démons), le résultat est catastrophique, quand bien même il est encensé pour cet engagement. Cela ne veut pas dire que je défends l’écrivain retiré dans sa tour d’ivoire. L’art pour l’art n’a pas plus de sens que l’art reflet du social. Finalité sans fin, l’art se suffit à lui-même, exigeant de l’artiste une servitude volontaire. Je pourrais m’arrêter là, mais je ne voudrais pas frustrer le lecteur de votre journal. Et, puisque les questions sont posées, il faut bien y répondre franchement. Il s’agit bien sûr de ma réponse ; je ne saurais dire ce qu’il en est pour les autres écrivains, pour la société ou pour les humains. Une réponse personnelle qui ne se prétend pas à une vérité indéniable.
Pourquoi la littérature ? C’est que l’homme ne vit pas seulement de pain…
La littérature, pas dans le sens péjoratif d’artifice (et tout le reste est littérature), est à la fois nourriture terrestre et céleste. Loin d’être un supplément d’âme, la littérature, quand je parle de littérature j’entends par là la poésie (elle se trouve aussi dans le roman, dans le théâtre, dans l’essai…), est l’âme même du monde. C’est un peu grandiloquent, c’est comme cela, je le pense toutefois. La poésie est pour moi ce qui fonde l’être, ce qui l’assure dans son existence et l’ouvre à l’inconnu, non pas en le lui dévoilant, mais en le lui faisant pressentir tout en demeurant inconnu.
Elle lui permet de goûter à la beauté et d’en être ébloui et métamorphosé. Grâce à la poésie, l’homme communie avec le reste des humains, découvre toutes les ressources de son humanité et accède peut-être aux mystères de la divinité. Ce n’est pas un hasard si les mystiques de toutes les religions, et particulièrement dans le taçawwuf, ont exprimé leur extase dans des poèmes qui nous bouleversent encore aujourd’hui. Nous avons besoin de la littérature pour vivre en harmonie avec le monde et nous retrouver en communion avec les autres. La littérature est le trait d’union qui nous permet de nous orienter.
Maintenant pour qui et pour quoi écrire ?
Cela dépend bien sûr de ce que l’on écrit et du moment de l’écriture. Tout écrivain a en tête un lecteur idéal, celui que Baudelaire admoneste : Hypocrite lecteur – mon semblable –, mon frère !
En ce qui me concerne, certains de mes textes sont destinés à des personnes précises, mais la plupart s’adressent au lecteur inconnu amateur de poésie en espérant que ce frère soit animé d’intention pure. J’ai commencé à écrire pendant l’année 1962. J’étais au lycée, en troisième. Au programme de français, le romantisme. J’avais débuté par des saynètes satiriques sur mes camarades de classe. Un jeu ! Au printemps, avec la lecture de Lamartine, de Musset et du roman de Goëthe Les Souffrances du jeune Werther, je me suis mis à écrire des poèmes d’amour destinés à des copines de classe. Le jeu devenait plus sérieux, mais j’étais encore loin d’être pris au piège. C’est Victor Hugo qui m’inculqua le virus de l’écriture. La lecture de Victor Hugo en cette année-là – c’était le centième anniversaire de la publication des Misérables – me stupéfia complètement. J’ai dévoré tous les livres trouvés dans la bibliothèque municipale de Massy et celle du XIXe arrondissement de Paris ; j’ai acheté chez des bouquinistes Les Orientales, Les Odes et Ballades, Notre Dame de Paris, La Légende des siècles, Les Contemplations… Mustapha Kaïd m’avait offert Les Châtiments avec La Mère de Gorki et Le Matin des villageois de Tchao Chou Li pour ma réussite au BEPC. Je lisais beaucoup en même temps que j’écrivais. Ainsi allait se referma le piège des Temps Modernes sur mes frêles racines (Kateb Yacine). Comme Victor Hugo, je voulais tout faire, du théâtre, du roman, de la poésie. Être l’écrivain témoin de son temps, porté par son peuple et porteur d’une parole inouïe, expression d’un moi et d’une conscience collective. L’indépendance me donnait des ailes. Le rêve de produire un chant qui magnifie les souffrances endurées durant la colonisation. Ambition naïve ! Inconscience de jeunesse ! Peut-être fallait-il cette inconscience pour oser s’affronter à l’écriture… Avec l’été 1962 et les luttes fratricides pour la prise du pouvoir dans le pays, je lisais Guerre et Paix de Tolstoï, je perdis mes illusions dans une Algérie libre et démocratique. Pourtant, je continuais à espérer dans un avenir plein de promesses…
Paradoxalement, c’est en lisant Les Orientales d’Hugo que je retrouvais les mu’allaqât entendues dans mon enfance. Avec Le Voyage en Orient de Nerval, Les Paradis artificiels de Baudelaire, d’autres images me remontaient en mémoire…
Deux années plus tard, en 1964, la lecture de Gens de Dublin de Joyce allait me désorienter complètement et me faire réviser ma conception de l’écriture. Abandonner une ambition démesurée pour s’engager dans une autre tout aussi périlleuse. Pour qui et pour quoi écrire devenaient des questions oiseuses, inutiles ; seul comptait le fait d’écrire et d’explorer méthodiquement et sans complaisance toutes les arcanes de l’écriture. La langue d’écriture n’était plus un problème malgré les injonctions du pouvoir politique à n’écrire que dans “la langue nationale”. Je comprenais peu à peu qu’un écrivain n’écrit jamais dans sa langue maternelle ou nationale mais dans une langue étrangère qu’il traduit dans son étude pour en faire sa propre langue, trouver sa formule. La langue nationale est langue de l’information, de la paperasse administrative, du discours politique, alors que la langue littéraire est toujours langue étrangère apprivoisée par un auteur pour la rendre audible au public qui veut bien l’entendre.
Que de faux problèmes et de déboires subis par ma génération à cause de cette question linguistique ! Je comprenais aussi combien la traduction des littératures “étrangères” est indispensable pour partager ensemble les œuvres de tout temps et de partout dans le monde, car la littérature appartient à ses lecteurs. La traduction permet aussi à chaque auteur de remettre ses pendules à l’heure.
Pour se confronter au travail d’écriture, ne pas hésiter à prendre exemple sur des devanciers prestigieux, à s’attacher aux grands auteurs classiques de la littérature universelle, sans oublier les nôtres, Kateb, Dib, Feraoun, Mammeri, Sénac, Amrouche et tant d’autres qui nous ont ouvert la voie de l’écriture. Il y a aussi les contemporains avec qui on partage l’air du temps. En vérité, on n’écrit jamais seul bien que tout seul devant sa feuille blanche. Ne pas en tenir compte, c’est se fourvoyer…
Écrivant depuis tant d’années, j’ai fini par accepter ce que me répétait tout le temps Abdallah Benanteur : l’artiste est au service de son art, il n’a pas à s’en servir pour son propre compte. Il n’a rien à demander ni à se préoccuper de la réception de son travail, seulement à faire du mieux qu’il peut. À s’y atteler modestement, chaque jour, sans relâche.
Servir humblement l’écriture au lieu de l’utiliser à d’autres fins me semble aujourd’hui la seule façon de mener à bien une œuvre littéraire de qualité. Toute injonction extérieure à la nécessité intérieure d’écrire ne peut que dévoyer le résultat. En tout cas, cette posture me permet de mener tranquillement mon travail.
_____________________