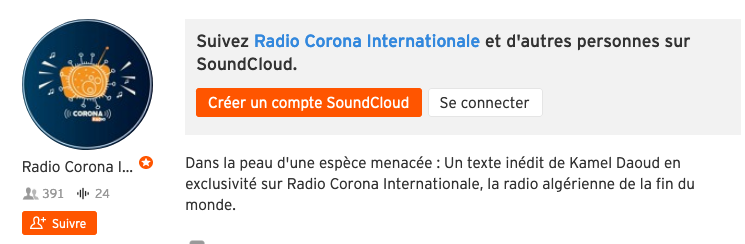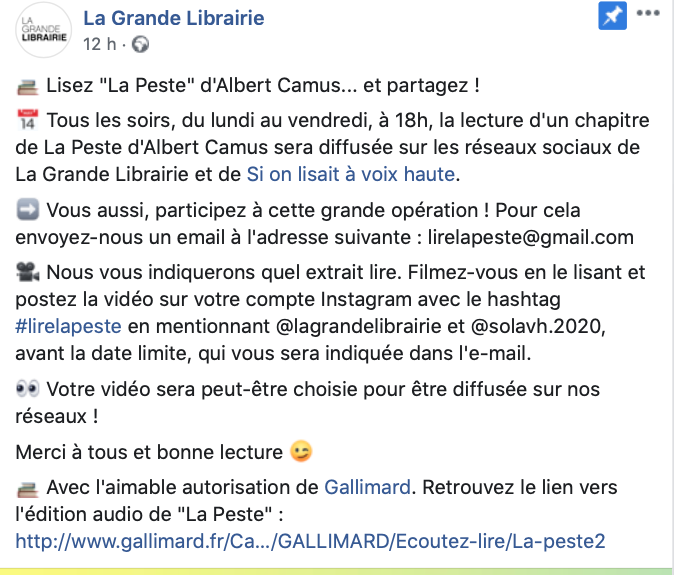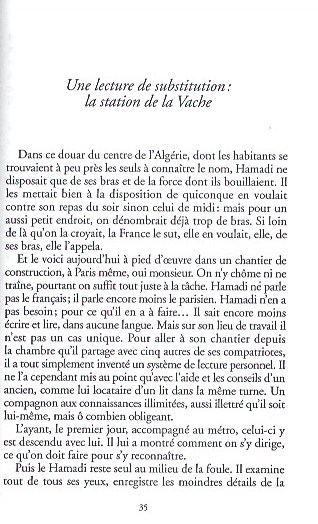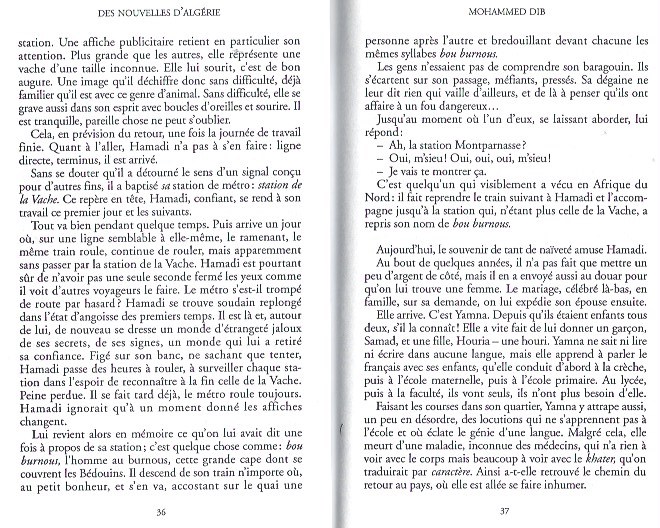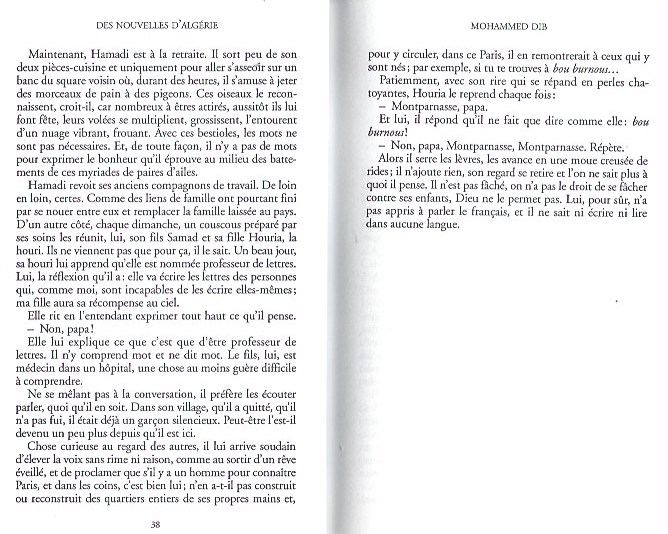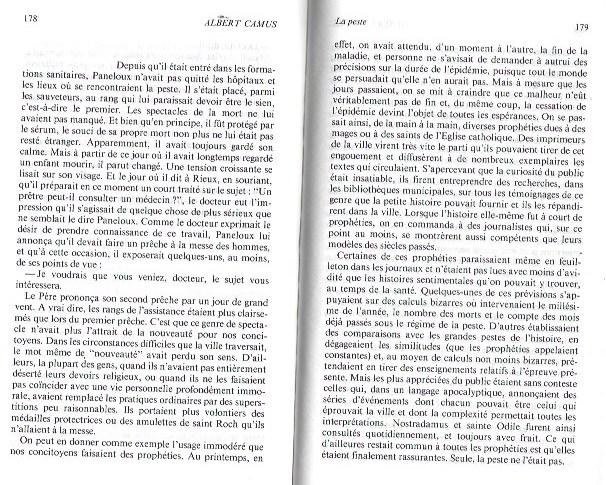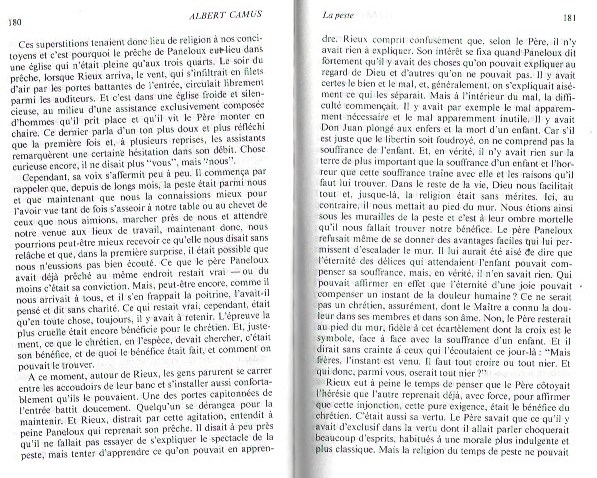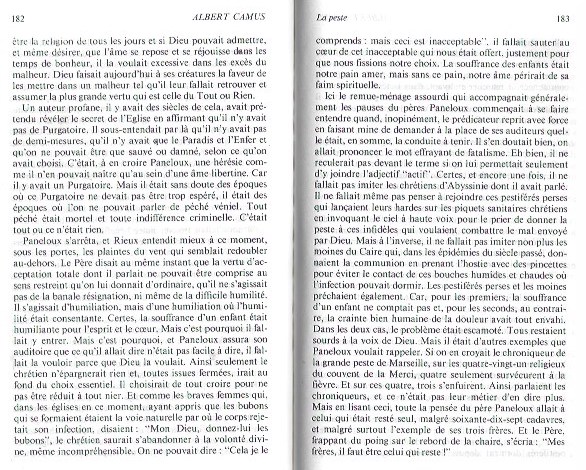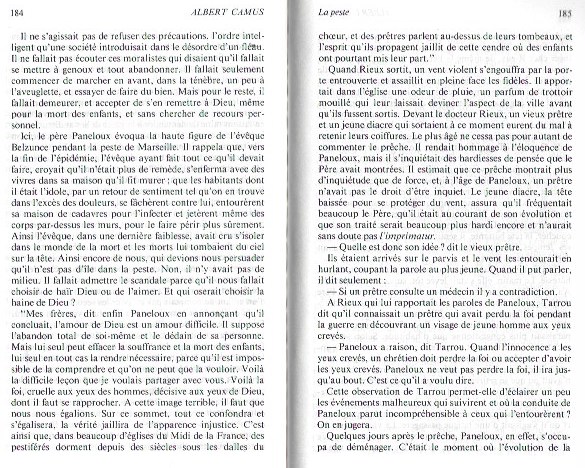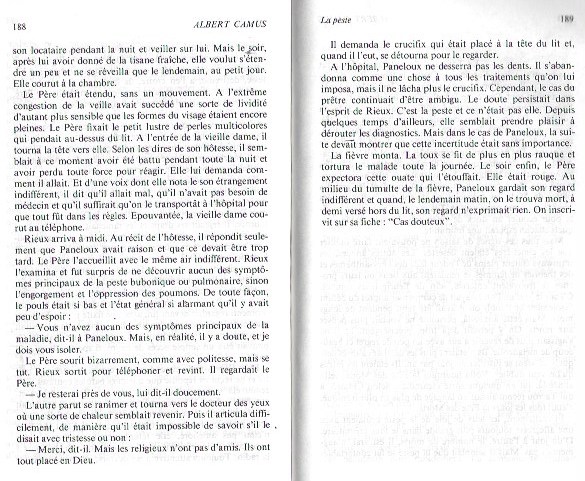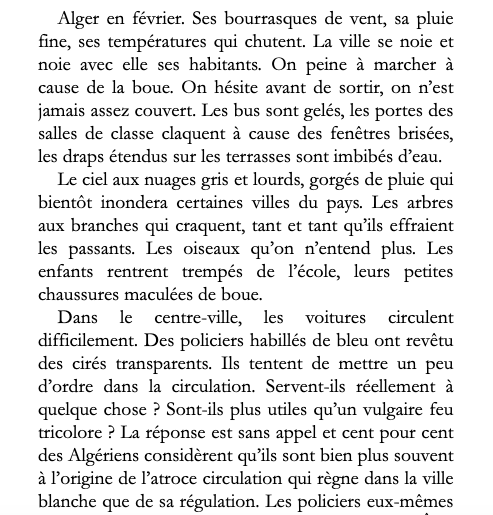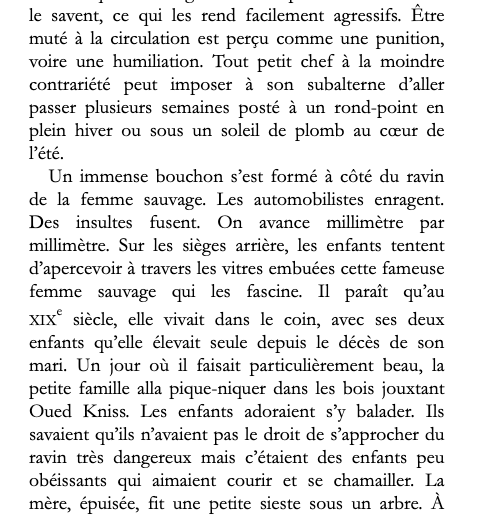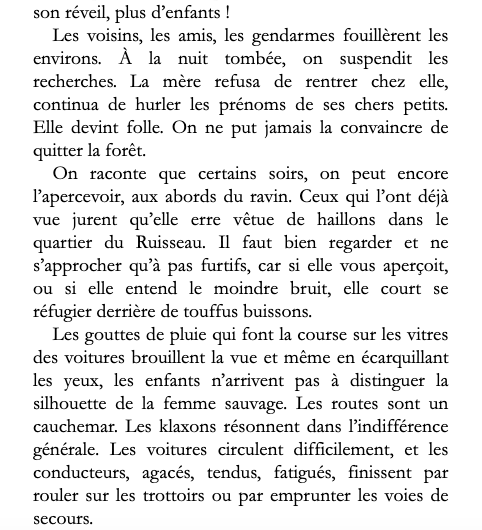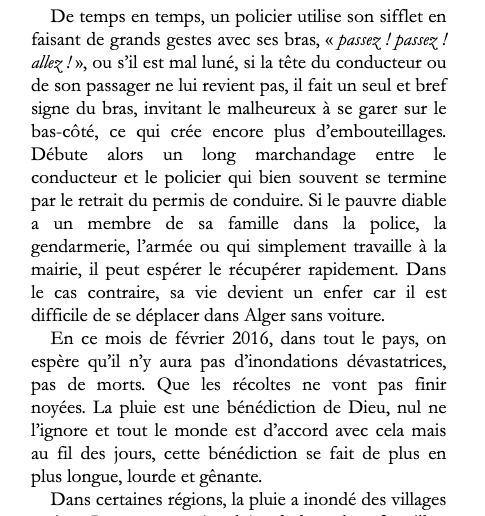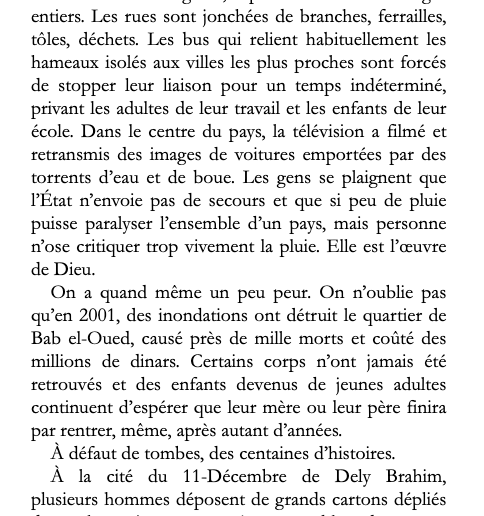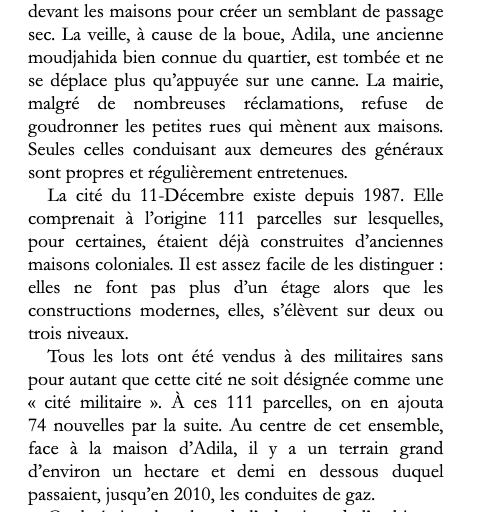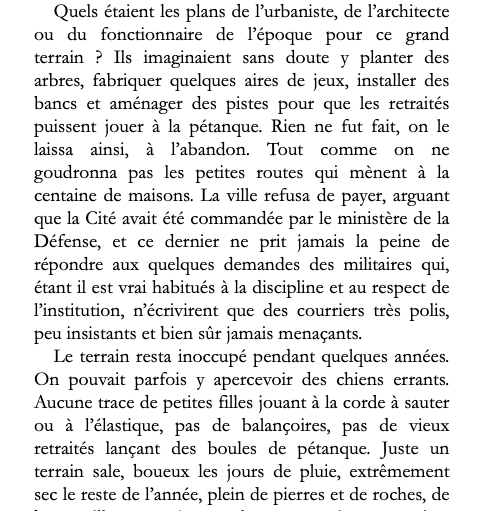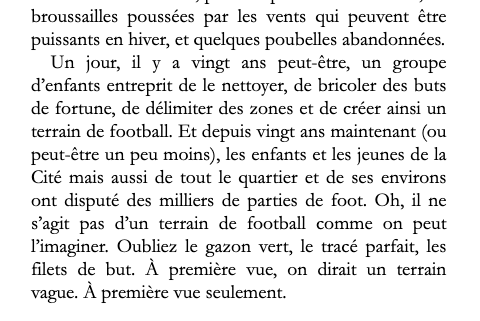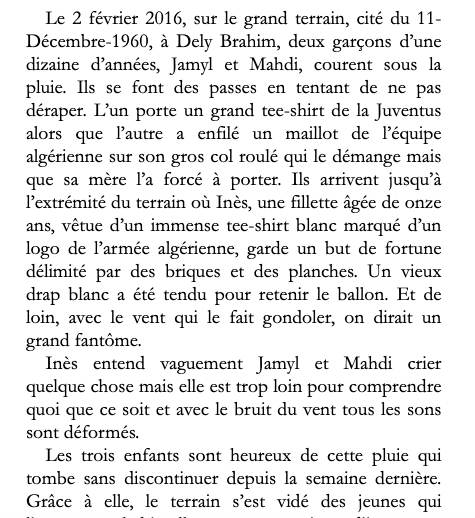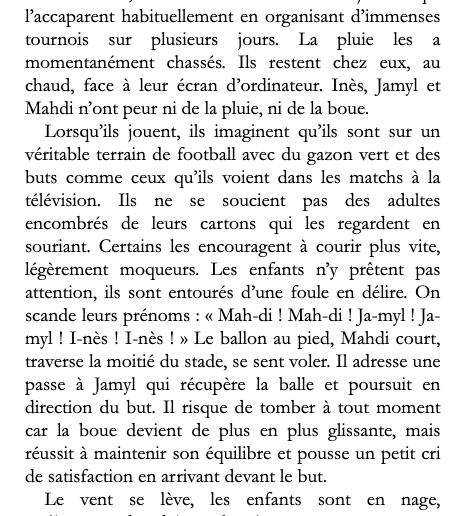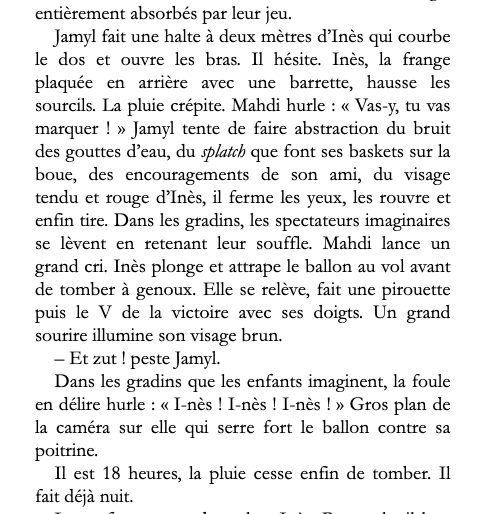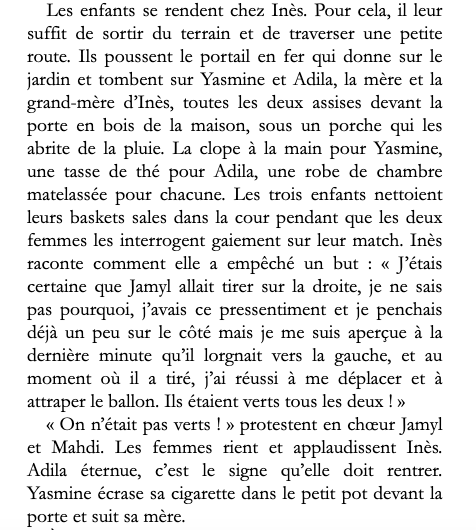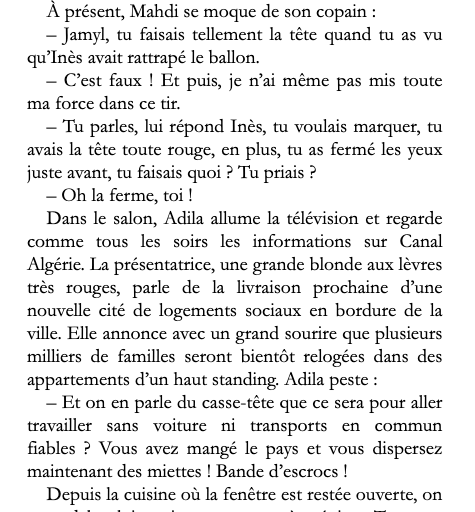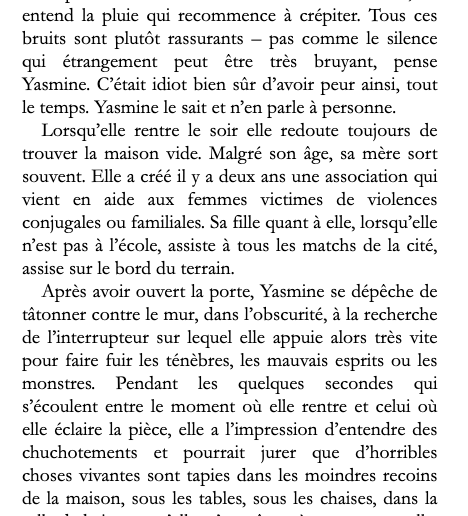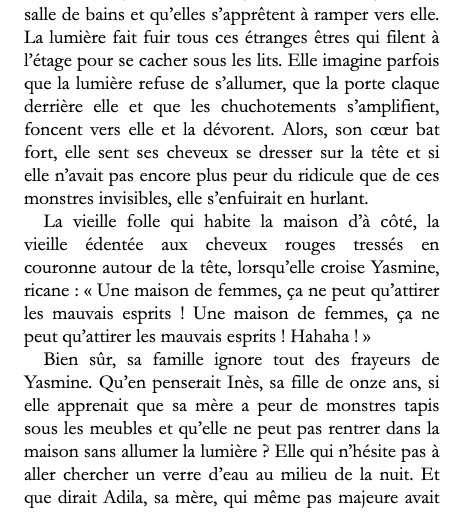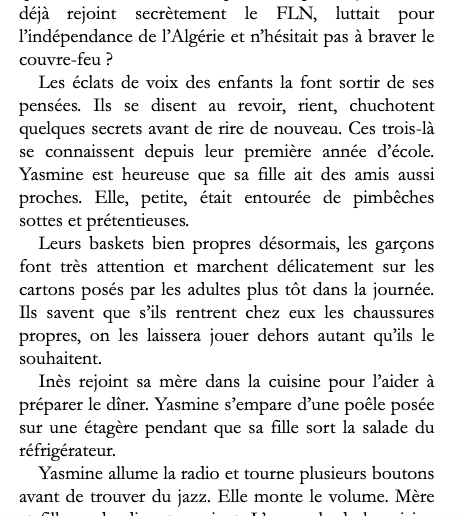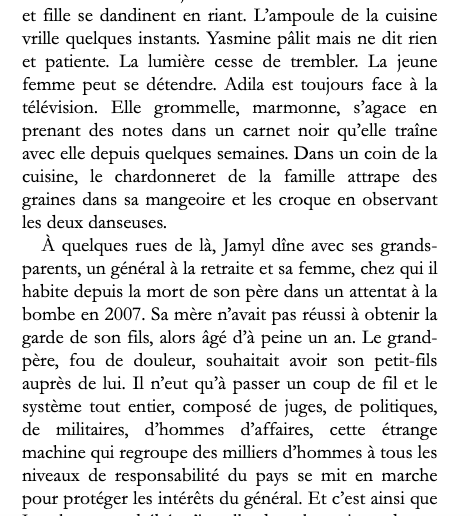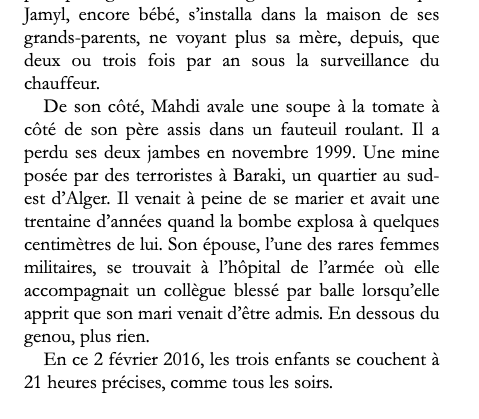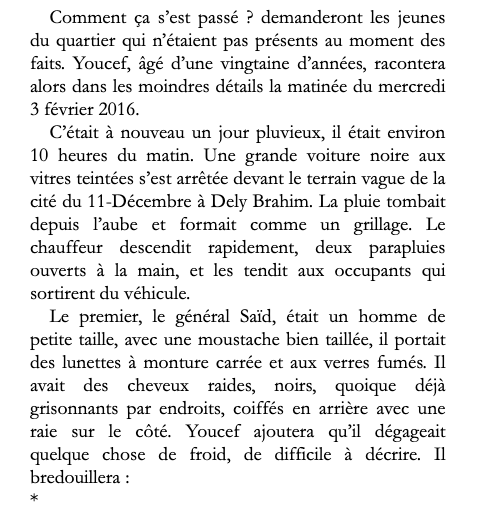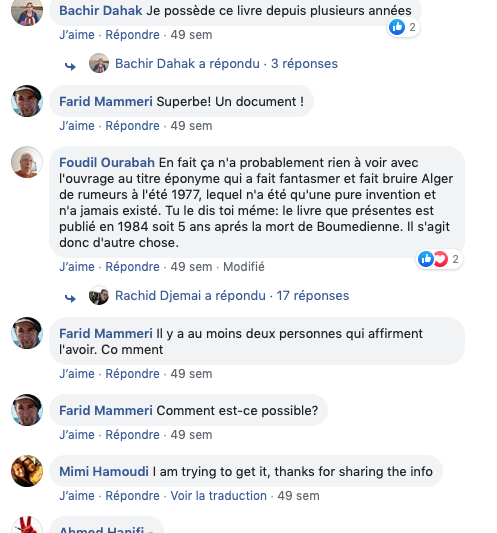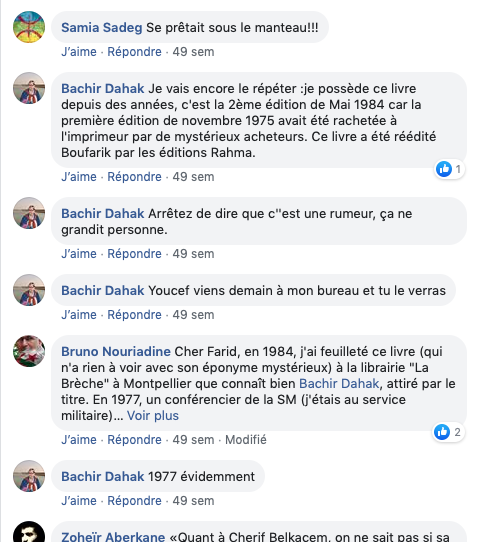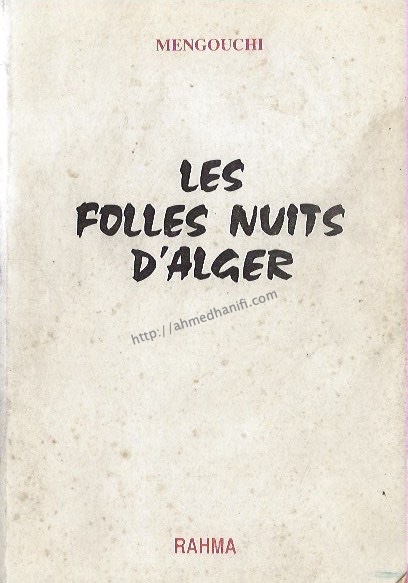LE QUOTIDIEN D ORAN
25 MARS 2019
Le Banc public- Ceci n’est pas une mise au point
Par Kamel Daoud
Un pays est à venir. Il est aujourd’hui
possible. Mais nous ne pouvons le construire ni par les radicalités intimes, ni
par la reconduction des mœurs du Pouvoir, ni par ce nombrilisme populiste. Lui,
le Régime, il aime contrôler les libertés, censurer, s’immiscer dans l’intime
conviction, douter et faire douter de la bonne foi. On ne doit pas lui
ressembler.
Internet nous a aidés à surmonter le manque de liberté, son impossibilité dans
notre pays. Il a été l’instrument de notre triomphe.
On ne doit pas transformer cet outil en espace pour des tribunaux populaires
qui s’installent et déjà jugent, condamnent, empoisonnent et lapident.
Aujourd’hui, certains ont prétendu que j’en suis venu à négocier avec un
représentant du Régime sur le dos des manifestants. Comme si j’étais un
politique, un élu, un chef de parti, un président ou un délégué qui a la
possibilité de négocier ou de dialoguer.
J’en fus blessé mais j’ai refusé, par fierté, d’y répondre dans l’immédiat et
sous l’injonction de l’affect ou des inquisiteurs. Parce que je n’aime pas me
justifier, ni le faire croire, ni me soumettre aux ordres de quelques nouveaux
commissaires politiques (je ne l’ai pas fait avec les anciens !). Et je n’ai
rien à cacher, ni à me faire pardonner. Fier et libre et révolté. Ce que je
vis, ce que je pense, je l’écris et depuis deux décennies. A l’époque des
grands silences de certains. Dans mon droit à la singularité, à la différence
ou à l’erreur.
Et si j’en parle aujourd’hui, dix jours après, c’est pour trois raisons.
D’abord, sur insistance d’amis, pour éclairer et aider à la lucidité : j’ai
rencontré Brahimi Lakhdar à Sciences Po où j’enseigne et où il est bénévole,
parfois. Deux fois. Et avant sa mission à Alger et bien sûr hors du cadre de
ses consultations tentées et jamais abouti à Alger. Je suis libre de le faire,
je ne suis ni représentant d’un mouvement, ni un politique, ni un chef de
parti, mais journaliste et écrivain. Je rencontre qui je veux et quand je le
décide. Si aujourd’hui au nom d’une révolution on veut me priver, par
inquisitions et insultes, de ma liberté, c’est que ce n’est plus une
révolution, mais une future dictature qui va seulement changer de personnel.
Certains médias électroniques y versent déjà pour décrédibiliser des gens qui
ne se casent pas dans leurs projets. Certains journaux électroniques en sont
déjà à la diffamation après avoir excellé dans le chantage et le régionalisme
pour obtenir l’argent des annonceurs.
Quant à moi, je fais mon métier, j’exerce ma vocation et ma liberté m’est
essentielle, pour mes opinions, mes livres et mes chroniques et je n’en rends
compte à personne, hier comme demain. J’ai écrit quand beaucoup se taisaient et
je vais continuer à écrire alors que certains bavardent et lapident.
L’autre raison, est plus urgente : dénoncer ce climat qui s’installe ou se
réveille en nous. Nous avons su entrevoir, dans le chant et la solidarité, la
possibilité de vivre ensemble dans nos différences. C’est encore fragile et
nous pouvons détruire cet espoir. Les tribunaux populaires d’internet, les
insultes et la méfiance radicale envers la bonne foi possible sont un danger
pour notre futur. Nous allons provoquer la rupture et l’hésitation chez ceux
qui ne nous ont pas rejoints, à force de ce révisionnisme comique. De ces
tribunaux rétroactifs sur les uns et les autres. La nouvelle république donnera
leur place aux héros, aux fervents, aux militants, mais aussi à ses enfants qui
reviennent à la raison, et ses femmes et hommes qui se sont trompés. La
radicalité peut nous mener aux pelotons d’exécution. Pas à la Réconciliation.
Il nous faut cesser avec cela. Respecter la liberté, sous toutes ses formes,
l’intimité des personnes, refuser l’inquisition et ne pas ressembler à ce
Régime. Il n’y pas de vérité, il n’y a que des femmes et des hommes de bonne ou
de mauvaise foi. Seuls les morts détiennent la vérité. Et elle leur est
inutile. Et si cette révolution commence par ma pendaison, elle ne m’est pas
utile, déjà.
Alors sauvons ce que nous n’avons pas encore vécu : la liberté de chacun, son
droit de penser, écrire, vivre. Arrêtons avec ce doute et cette fabrication du
traître. Arrêtons. Ou partons chacun de son côté. Qu’on en arrive à m’exiger ce
que j’ai dit et ce que m’a dit cette personne est un scandale moral. La liberté
et la sommation ne sont pas synonymes. Et si j’ai réussi à défendre ma liberté
face à un régime et face à ses corruptions durant toute ma vie professionnelle,
aujourd’hui je n’irais pas à me justifier devant des tribunaux derrière des
écrans. Devant des radicalités anonymes ou devant les procès de quelques agités
de l’ordre de mon métier.
Certains juges algériens en sont à se battre pour libérer la Justice de
l’injustice et il faut les soutenir. Alors que des amateurs des réseaux se
bousculent déjà pour mener les procès de ceux qui ne sont pas comme eux.
Ce pays je l’ai rêvé meilleur, par l’exigence sévère envers les miens et envers
ma propre personne. Et je vais continuer. Comme depuis vingt ans.
_______________
LE QUOTIDIEN D ORAN
19 MARS 2019
Le Banc public- C’est si nouveau pour nous que d’enfin choisir
Par Kamel Daoud
Le Mal est profond. En Algérie, on aime
bien le dire, le penser.
Parfois, cette sentence exaspère, ou aboutit au fatalisme. Mais parfois, elle
se révèle comme une occasion de dépassement. Aujourd’hui, les Algériens se
retrouvent dans la rue, puissants, rassemblés, rieurs et heureux, comme plongés
dans le vertige des retrouvailles. Et ils découvrent l’angoissante question du
«politique» dont ils ont été depuis toujours dépossédés. Qui est qui ? Qui
représente quoi ? Expérience de l’obligation de déléguer pour parler sans
cacophonie, mais aussi d’accepter les différences. Le Pouvoir nous a habitué à
la pensée unique, le parti unique et la non-pensée unique. Aujourd’hui, pour
nous, la différence est inquiétante, nouvelle, angoissante et presque heureuse.
On a l’intuition qu’être différent n’est pas être traître mais être riche. Mais
cette intuition est encore fragile.
L’angoisse de la représentativité face
au Régime, de l’obligation de trouver des «représentants», des porte-parole se
heurte à la méfiance. Le Régime a depuis toujours fraudé, corrompu la notion
d’élu et de délégué. Elle signifie, depuis des décennies, triche et trahison.
Du coup, on en a peur. On veut continuer une Révolution mais sans accepter son
aboutissement politique. «Il ne me représente pas» est l’autre slogan triste de
«Dégagez». Pire encore, on est dans l’élan de l’absolu : on croit que celui qui
va porter notre parole, aujourd’hui, va le faire à vie, pour toujours, alors
qu’il s’agit seulement de délégation pour une transition. Une période fixe pour
permettre de faire survivre l’Etat et la passion, au temps. La méfiance est de
mise mais la transformer en loi est une impasse. On se retrouve, alors, tenté
par l’exclusion au nom de l’unanimisme. Et pourtant nous sommes là dans nos
différences. Et si nous devons déléguer, nous le ferons avec le prisme large de
ces différences, pas avec l’idée de l’absolu et de l’exclusion. Aucun Algérien
ne peut représenter toute cette révolution, mais certains peuvent aider à
représenter certains de ses courants de fond, corporations, passions, régions,
classe d’âge… etc. Il ne faut pas trop se hâter, mais cette voie nous aidera
à apprendre ce qu’est le consensus tout en maintenant vives et riches nos
différences. Un pays n’est pas la terre uniquement. C’est cet équilibre qui
vous maintient debout ou vivant, entre les mille contradictions de l’apesanteur,
de l’histoire, des langues et des cultures. Un pays, c’est un choix de vivre
ensemble et pas un lot de terrain morcelé.
Cela fait donc peur cette question de
la représentation et du soupçon, réveille la paranoïa, le doute sur la bonne
foi des autres, le malheur. Et cela se comprend. Nous avons été soumis au
conditionnement de ce régime depuis l’indépendance. Nous avons été dépossédés
du choix si longtemps, qu’aujourd’hui il en devient angoisse. Nous avons été
poussés à nous exclure, les uns les autres, au nom de beaucoup de choses et
cela n’est pas facile à oublier.
Pourtant, la possibilité de guérison
est là : il suffit juste de remplacer l’affect par la raison et le souci de ne
pas être trahi, par le souci de ne pas trahir nos descendants.
Tant de choses à rétablir et à guérir :
l’effort, le salaire, le corps, la confiance, la différence, le désir,
l’acceptation, la souveraineté et la vraie, la grande réconciliation. Pas celle
des milices et du Régime. Nous avons déjà montré que l’on peut marcher tous
ensemble, on peut démontrer que nous pouvons continuer. Le ton peut paraître
sentencieux, mais ce n’est pas le but. Le chroniqueur essaye juste d’apporter
sa réflexion sur ce qui le concerne : le pays où il vit et où il mise sa vie et
celle des siens et de ses enfants. Une réflexion pour empêcher une pente
dangereuse : nous ne pouvons pas demander le départ du Régime et reconduire ses
tares, ses cultures, sa méfiance, ses inquisitions, ses diffamations et son
mépris. Nous ne devons plus ressembler à ces gens-là. Je me dis, avec
imprudence, que peut-être, que chaque fois que nous devons faire un choix,
examinons ce que fait ce Régime depuis toujours et faisons le contraire.
Souvent.
___________________
LE QUOTIDIEN D ORAN
11 MARS 2019
Le Banc public- Dissoudre le FLN pour le libérer
Par Kamel Daoud
«F LN dégage». C’est l’un des slogans
majeurs de ce soulèvement des Algériens contre la Régence d’Alger. Des jeunes
le criaient sous les murs du siège de ce parti, à Oran, ce premier Mars. Mais
aussi partout dans le pays. On y retrouve l’envie de naître, renaître,
retrouver Larbi Ben M’hidi sans passer par Ould-Abbès, se libérer des courtiers
et des Saidani. Car le FLN a été volé, depuis longtemps, pris en otage,
cambriolé et obligé à vivre par le faux et l’usage de faux. Ce parti, auteur
d’une magnifique épopée de décolonisation, a fini en sigle pour manger mieux
que les autres, grimper sur le dos des autres et parler en leur nom. Les
décolonisateurs en chefs, ou ceux qui se revendiquent de ce statut, en ont fait
un parti de nouveaux colons. Il faut libérer, donc, le FLN qui a libéré ce
pays.
Comment ?
Par la dissolution. Immédiate, sans
retard ni sursis. Dissoudre le FLN c’est le libérer, le restituer à la mémoire
collective, à tous les Algériens. Il nous appartient, à tous et pas à un
comité, un président d’honneur qui l’a déshonoré, ni à ces clowns cycliques que
sont ses récents secrétaires généraux et ses comités centraux. Le FLN est un
patrimoine, pas un club, ni une licence d’importation. C’est une mémoire, pas
une veste et un pin’s. C’est une épopée, pas une autobiographie ou une
association de malfaiteurs. Sauvons le FLN de ses kidnappeurs. Faisons-en un
souvenir et pas une machine de fraude. Il faut aussi consommer la rupture avec
les courtiers de notre mémoire : nous devons le respect à ceux qui se sont
battus mais le ministère des Moudjahidine ne doit plus exister. Ni
l’association de leurs fils, ni les autres appareils dentaires comme l’ONM,
l’organisation nationale des Moudjahidines. Il faut arrêter le scandale immonde
des fausses fiches communales.Fermer cette page. Cette population a le droit à
des prises en charge, une pension, l’immense remerciement d’un peuple, a le
droit à la mémoire et au respect, mais nous aussi. Il faut dissoudre cet apartheid,
ce système des intouchables avec ses privilèges honteux. Ceux qui ont fait la
guerre pour libérer ce pays n’ont pas le droit de transformer le pays en butin
pour eux et leurs enfants. Nous avons libéré la rue, le drapeau, l’hymne et le
vendredi, il reste à libérer la mémoire, le FLN, les nouveau-nés.
Tous les Algériens ont été, d’une manière ou d’une autre anciens moudjahidine.
Tous sont enfants de martyrs. Tous sont FLN sans en faire une mangeoire, tous
sont morts et tous sont vivants, tous sont égaux et il n’y a pas de privilège
autre que celui de sa propre vertu et de son courage.
Fonder une deuxième république passe aussi par la libération du présent, de
l’avenir et surtout, du passé.
Pour moi, c’est le premier pas. Le symbole fort d’une nouvelle époque.
C’est le signe radical d’une rupture
saine et courageuse. En attendant un conseil national de transition, une
assemblée constituante, une refonte de la gouvernance et un contrôle public
direct sur les dépenses locales, l’armée, la gouvernance des wilayas, un haut
conseil des Magistrats indépendant et autonome… etc.
Le FLN d’aujourd’hui est la liste
exacte des gens qui ne doivent plus avoir de postes de responsabilité, dans ce
pays, des personnes à écarter, des noms à ne jamais élire ni écouter, des
visages à qui il ne faut plus jamais faire confiance.
Alors commençons.
___________________
LE QUOTIDIEN D ORAN
04 MARS 2019
Le
Banc public- Un terrifiant retour de la beauté
par Kamel DAOUD
Un peuple peut renaître. Peut mourir.
C’est fragile, immense, rare et puissant, imprévisible. Nous étions longtemps
morts. Corps gris, muscles défaits, cheveux dressés, regards durs sur soi et
les siens, la peau en parchemin juste pour raconter le passé. Tout appartenait
à ce Régime et nous étions sur sa terre à lui, hagards et tristes, indignés et
en colère parce qu’indignes. Radicalisés ou démissionnaires. Tout était au
Régime : l’arbre, la route, l’eau, les choses courantes, l’histoire, le verbe,
la télé et le drapeau. Le seul territoire qui restait en dehors, un peu, de sa
poigne cendreuse était Dieu ou le ciel ou Internet. Alors beaucoup allaient à
la mosquée, ne la quittaient plus dans leur tête parce qu’il fallait remplacer
la terre par le paradis, espérer encore malgré l’état des routes, croire en
quelque chose, déplacer le souffle vers l’au-delà. A défaut d’un pays, un
paradis. Pour certains c’était Internet. A défaut de vivre, regarder. Se
regarder. Pour d’autre c’était la mer. Elle était un grand mur, une montagne,
un maquis, une épreuve, un chemin. On plongeait dedans pour ressortir ailleurs.
Il fallait retenir son souffle sous l’eau. Certains y arrivaient et
ressortaient vivants. D’autres non, mourraient. La chaloupe était un endroit
étrange : dès que des Algériens y embraquaient, dès qu’ils franchissaient les
eaux territoriales, ils se mettaient à chanter et à rire. Regardez leurs vidéos
: ce n’étaient plus des chaloupes, mais des salles de fêtes.
La chaloupe remplaçait la rue, l’espace, l’air et la salle des fêtes
impossibles. La prière enjambait le temps. L’écran et les réseaux sociaux
étaient le pays par défaut. Et tout le reste était le champ du Régime, ses
dents, ses hommes minables et carnivores.
Aujourd’hui, cela s’inverse. La chaloupe devient la rue. On peut y danser et
rire. Y respirer. Libérer le pays de la caste féodale de ceux qui croient qu’il
est à eux et que nous y sommes en trop. Trop nombreux, violents, haineux et
jaloux de leur immortalité.
Cela va-t-il durer, cette rue, cette liberté, cet espace, ce grand poumon ? Il
faut faire attention. Ce régime ne partira pas facilement, il est haineux,
méprisant et croit qu’il peut régler la question du sens par la matraque et la
semoule. Il nous méprise. Il va manipuler, corrompre, ruser, attendre, frapper,
tuer. Il ne faut pas se tromper sur sa nature, sa nature est mauvaise. Il a
pris trop d’argent pour céder aussi facilement. Il a trop mangé et tué. Il nous
faut aussi cesser la haine des élites. C’est une maladie du régime, pas la
nôtre. L’élite n’est pas la trahison, mais la possibilité d’éclairage, d’aide,
d’union. Ils nous ont appris à détester l’élite, à la mépriser, à la croire
traître et faible. Depuis la guerre de libération, et jusqu’à aujourd’hui. Le
22 février et le 01 mars n’ont été possibles que parce que, des années durant,
certains ont maintenu vivante l’idée d’être libre, l’idée d’être digne.
On peut être dépossédé de cet élan ? Comme en Égypte ou en Tunisie ? Oui. Mais
on peut aussi rester vigilant, car ce qui s’est passé dans ces deux pays, nous
l’avons connu il y a vingt ans. Il y a vingt ans nous avons subi le vol de la
démocratie comme en Égypte, la guerre comme en Syrie, le complot comme en
Tunisie, le cauchemar du chaos possible comme il advint en Libye. Nous avons
vingt ans d’avance et d’expérience. Cela ne garantit rien, mais rend possible
de sortir de ce cercle vicieux qui tue et fait s’agenouiller les bonnes
volontés.
Nous allons céder devant Bouteflika & Cie ? Si nous le faisons, nous sommes
morts pour toujours. Le Régime pourra nous faire élire un âne ou même un crachat.
Nous serions alors les serfs et nos enfants après nous.
Il faut donc accentuer, aller vers la grève, le sit-in permanent, la résistance
pacifique, la vigilance accrue pour contrer ses médias en mode chiens de
service. Il faut avancer. Démissionner de l’APN et du FCE pour les plus
honnêtes. Libérer le FLN et le rendre à l’histoire et le séparer de
l’alimentation générale. Contrer l’argument fallacieux de «il a le droit de se
porter candidat». Oui, s’il était vivant, en bonne santé et dans un système électoral
sain. Pas en mode photo. Pour retirer un chèque il faut la présence de
l’intéressé, disent les internautes, et pas pour gouverner un pays ?
Passons. Un peuple peut mourir. Nous le savons tous. Nous sortons tous d’un
cimetière qui avait un drapeau. Nous avons le corps désarticulé, le teint pâle.
Nous les avions jusqu’à ces dernières semaines. Nous nous sommes fait volé
l’indépendance et le 1er novembre. Il ne faut pas se faire voler le 01 mars. Il
faut continuer. Ils ont eu droit à soixante ans de dictature et de rapine, nous
avons droit à des années de protestation et de joie.
_______________
LE QUOTIDIEN D ORAN
26 MARS 2018
Le
Banc public- Un rêve simple et pratique
par Kamel DAOUD
«…Rares sont les journées heureuses.
Elles valent mille ans au décompte. Ou plus. Hier ce pays était beau
comme réconciliation. Des milliers d’Algériens candidats à la Omra ou au Hadj
ont rendu leurs «passeports spéciaux» et se sont fait rembourser. «L’argent est
pour vivre, pas pour tuer», a titré Echourouk. Ce journal comme tant d’autres,
a fait campagne pour que les devises algériennes restent dans le pays, aillent
aux écoles, à financer des lunettes ou à faire manger les migrants
subsahariens. «Le cœur peut être noir, pas la peau», ont crié des manifestants
solidaires avec les errants de nos rues. Des milliers d’Algériens ont préféré
donner leur argent à ces passants du continent qu’aux familles royales
saoudiennes. «Dieu est partout et pas seulement en Arabie», ont expliqué des
imams. L’argent réuni ainsi a servi à financer des campagnes de vaccination,
d’hygiène dentaire, à achever des chantiers de piscines dans les Hauts Plateaux
et à former les femmes dans les villages à exercer un métier au lieu d’attendre
des coups. «La femme n’est pas la moitié de l’homme, mais la moitié du pays, la
moitié de l’économie, la moitié de notre futur, la moitié de notre armée et la
moitié de notre produit intérieur brut», a conclu le cheikh Abou, cheikh qui a
compris qu’un sac vide ne tient pas debout, même avec cinq prières chaque jour.
C’est que le pays a changé. L’Algérie a retrouvé sa vocation ancienne d’être du
côté des spoliés et des endoloris, la Mecque des colonisés. Dans presque tous
les villages, il y a eu des rassemblements pour soutenir les Yéménites, les
Kurdes, les Nigérianes kidnappées par Boko Haram, etc. «Nous sommes avec la
Palestine, mais aussi avec les enfants tués au Yémen ou les gosses bombardés
par Erdogan au Kurdistan». Pas de distinction dans la compassion. «C’est quoi
la différence entre un enfant tué en Syrie ou à Gaza ? Aucune. Alors mon cœur
n’est pas raciste. Ce n’est pas parce qu’on est noir qu’on n’est pas
palestinien», expliquera un jeune enseignant à Bougtob. Nous avons connu la
guerre et la mort et nous savons qu’ils sont les mêmes, partout. Des associations
ont appelé à des dons et le gouvernent a autorisé un immense rassemblement à
Alger pour dénoncer les victimes au Yémen et au Tibet. Pas seulement en
Palestine. Des partis conservateurs et islamistes ont même soutenu des
campagnes de nettoyage des rues et villages, des appels au devoir écologique :
«Aller au paradis ne veut pas dire fabriquer un enfer pour nos enfants», a crié
un leader islamiste, soutenant l’imam de la Mosquée d’Alger qui avait appelé
les fidèles à faire des ablutions, une fois par mois, au pays au lieu d’en
faire cinq par jour pour eux-mêmes. Des campagnes pour «une heure de plus est
une zakat» ou «travailler c’est aussi prier» ont été lancées aussi, incitant
les fonctionnaires de l’Etat à faire du volontariat et à assurer les horaires
pour lesquels ils perçoivent un salaire. «Une heure de volontariat pour un
fonctionnaire, ce n’est rien et cela vaut mieux qu’une fatwa, qu’une prière
surérogatoire, une ablution, ou que le temps d’un café», expliquera un Algérien
sur la radio. Des leaders de partis islamistes et du FLN ainsi que du RND ont
décidé de s’investir dans le mouvement associatif bénévole au sud algérien et
de scolariser leurs enfants dans les villes du Sud pour mieux comprendre le sud
algérien, ses carences et ses besoins. «Un an de ma vie» est le slogan de cette
gouvernance tournante. Chaque ministre est soumis à cette loi solidaire. En
service civil.
Un vent de révolutions : à l’aéroport,
les policiers sourient et ne disent plus «passes !» avec colère et mépris, mais
disent «Bienvenue au pays ! Vous pouvez passer s’il vous plaît !». Les
Algériens refusent d’utiliser le sachet bleu pour leurs achats : «La tête est
une poubelle, pas le pays», lit-on sur les pare-brises des voitures. Les
écrivains algériens ne sont pas insultés mais enseignés, dans leurs différences
et leurs révoltes, dans les manuels scolaires. Pour la première fois depuis
l’indépendance, le nombre de PME/PMI a dépassé celui des mosquées et des salles
de loisirs ont été financées par des particuliers pour aider les jeunes à ne
pas se pendre aux cordes, aux chaloupes, aux minarets ou aux drogues. Les
Kabyles ne sont pas traités comme des Kurdes et les Kurdes ne sont pas traités
comme des champignons. L’arabité n’est plus une matraque mais une arabesque.
L’islam a été déclaré religion universelle, ouverte au monde. L’âge officiel de
l’Histoire algérienne a été reconnu comme de trois mille ans ou plus et ne
commence pas seulement en 1954 ou 1830. «L’identité c’est travailler, pas se
souvenir», a clamé un célèbre présentateur TV à Alger, surprenant ses invités
venus expliquer qu’ils «sont arabes, arabes, arabes !» en criant comme des
hystériques. Le pays bouge ! Il n’attend pas que le régime lui donne à manger
ou lui redonne le pays. «Le régime c’est nous !» a expliqué un célèbre
chroniqueur qui ne jette plus ses mégots dans la rue.
Oui, un vent de changement. Il n’y a
qu’à méditer le chiffre des baguettes de pain qui ne sont plus jetées dans les
poubelles : 20 millions de baguettes par jour il y a un an, presque trois mille
par jour aujourd’hui. Des gens sont morts, durant la Guerre de libération, pour
qu’on ait du pain, pas pour qu’on le jette. Quelqu’un l’a dit. On s’en est
souvenu. Tout le monde le pense aujourd’hui.
Un jour qui vaut mille ans. Chaque baguette vaut onze martyrs et demi de la
Guerre de libération. Dans les écoles, on enseigne à compter, écrire, parler
dix langues, penser même en dormant, dessiner et nettoyer les classes et les
lieux comme des Japonais. Il y a eu un consensus soudain et inattendu. Tous ont
compris qu’il fallait arrêter de tuer les enfants et de les manger chaque jour.
Personne ne parle de la CIA, d’Israël et du Mossad pour se laver les mains
d’avoir jeté sa poubelle en pleine rue. La France ? «La guerre est finie. On ne
veut pas être français, on veut être mieux. On ne lui demande pas des excuses
car nous avons vaincu. On demandera des excuses à nos enfants, car nous n’avons
pas tout réussi». Ce discours est resté dans les mémoires. C’étaient les
derniers mots du dernier moudjahid véritable, certifié vrai. Avec photos et
blessures sur la peau du dos. Oui, mille ans. J’ai déjeuné à Tunis, j’ai dîné
au Maroc, je suis passé par Alger pour serrer une main. En une seule nuit. Le
Maghreb est un train, pas une crevasse. «Que Dieu nous pardonne : il nous a
donné une terre, nous avons voulu en faire un trou pour chacun», murmura un
ancien cadre du MALG. Que dire d’autre ? Le pays a changé en une nuit sacrée,
en un jour long. D’un coup. Chacun a compris qu’il est responsable de tout,
lui, pas un autre. Que c’est à cause de lui qu’on a été colonisés depuis mille
ans, qu’on a de mauvaises routes et qu’on ne marche pas sur la lune. Chacun a
compris qu’il est responsable de tout ce qui s’est passé avant même sa
naissance car la preuve est que sa naissance n’a servi à rien depuis qu’il est
né. Chacun a saisi le sens angoissant de sa liberté et de sa responsabilité. De
chaque acte qu’il fait depuis son éveil, à sa mort, de chaque dinar dépensé,
chaque baguette de pain jetée.
Le régime c’est nous, nous c’est «je» et chacun est fautif de ce qui advient au
pays. «Moi», pas les mille autres…»
_______________
LE QUOTIDIEN D ORAN
19 MARS 2018
Le
Banc public- S’acheter une île dans sa tête
par Kamel DAOUD
Il neige à Paris. Cela provoque un
curieux effet ces flocons qui tombent sur des pierres et des monuments. Des
lions en fer, à un rond-point, mouillés par des blancheurs, luisants et
immobilisés dès la naissance. Ponts qui traversent des champs de dentelle, des
affiches aux couleurs chaudes et des passants aux pas prudents. A l’hôtel,
rencontre avec des documentaristes canadiens qui font un film sur Raïf Badaoui.
Ce jeune Saoudien, condamné à 1000 coups de fouet et dix ans de prison en
Arabie. Le monde l’oublie peu à peu. La mode est pour le nouvel homme fort qui
veut « réformer ». Le blogueur a ce malheur d’être le prisonnier le plus faible
de l’homme le plus fort. Personne n’y peut rien : l’Arabie est trop riche,
achète beaucoup à l’Occident. « Ne trouvez-vous pas paradoxal que le nouveau
prince héritier soit plus réformateur que Badaoui lui-même mais qu’il le
maintienne en prison ? », me dit l’intervieweur. Vrai. C’est le propre du
politique : décapiter l’opposant pour le remercier, quelques années plus tard,
pour ses idées. Ce que j’en pense ? « Le prince devrait réformer les prisons :
libérer Raïf qui appelle à la vie et mettre en prison ceux qui ont appelé à la
mort, chez eux, chez nous, partout dans le monde ». Libérer Raïf est la
meilleure preuve que peut apporter ce prince quant à ses intentions de réformer.
C’est loin, c’est flou, cela n’a aucun lien avec nos pains et nos villages en
Algérie, ni avec le 5ème mandat, mais il fallait en parler, le rappeler.
L’Arabie ce sont trente mille hadjis algériens et un prisonnier condamné à 1000
coups de fouet et dix ans de prison. Et que chacun décide en son âme et
conscience.
Dans la rue, encore la neige qui cède à l’eau dès qu’elle touche au sol.
Question qui taraude : comment « parler » en Occident ? Quels mots dire pour à
la fois ne pas être dans le spectacle de l’opposant, ni dans la complicité du
crime contre le sens chez soi, avec les siens ? Faut-il se taire sur nos sorts,
nos misères et nos lâchetés pour ne pas « faire le jeu de… » ? Ou parler,
quitte à être insulté comme traître pour avoir brisé l’omerta postcoloniale ?
La vérité est qu’on est témoin de son époque, ou son complice. C’est lent,
laborieux, parfois agaçant, mais il faut trouver les mots justes, dénoncer,
dire. L’Occident veut entendre certaines paroles et pas d’autres ? J’en profite
pour lui dire des mots qu’il ne veut pas entendre aussi. Mais la neige est si
belle qu’elle ressemble à une métaphysique apaisée. Pourquoi alors ne pas
écrire des contes, des livres, acheter une île dans sa propre tête, cultiver
l’apesanteur et voyager jusqu’au sommaire final du monde, sa dernière page ?
Parce que ce n’est pas aussi simple que de plier des bagages. Il faut avoir la
conscience apaisée, et celle du siècle ne l’est pas. Il faut voyager léger et
donc s’acquitter de son devoir de témoin, de lutteur et de refuznik de son
époque. Il faut que la prison change de lieu et de camps : elle ira enfermer
ceux qui tuent, appellent aux meurtres dans les prêches ou les discours, ceux
qui avilissent l’homme ou le sens de l’humain, poussent aux radicalismes qui
tuent et à marcher sur le corps du plus faible ; et il faut que la liberté soit
le royaume des Raïf et des autres qui veulent juste marcher sous la neige,
choisir un dieu ou une route, embrasser sans l’intermédiaire d’un courtier, et
travailler pour que le pain soit comme l’air, partout. Vœux naïfs ?
Oui,
mais bon Dieu à quoi s’accrocher sinon ? Que vaut une vie si elle n’a pas un
chant muet à l’oreille ?
Ces mots magnifiques et durs d’Asli Erdogan que je vais voir l’après-midi. Dans
« Le silence même n’est plus à toi », la Turque, fière et libre, écrira : «
l’écriture, comme cri, naissant avec le cri… une écriture à même de susciter
un grand cri qui recouvrirait toute l’immensité de l’univers… Qui aurait
assez de souffle pour hurler à l’infini, pour ressusciter tous les morts…
Quel mot peut reprendre et apaiser le cri de ces enfants arméniens jetés à la
fosse ? Quels mots pour être le ferment d’un monde nouveau, d’un autre monde où
tout retrouverait son sens véritable, sur les cendres de celui-ci ? Les limites
de l’écriture, limites qui ne peuvent être franchies sans incendie, sans
désintégration, sans retour à la cendre, aux os et au silence… si loin
qu’elle puisse s’aventurer dans le pays des morts, l’écriture n’en ramènera
jamais un seul. Si longtemps puisse-t-elle hanter les corridors, jamais elle
n’ouvrira les verrous des cellules de torture. Si elle se risque à pénétrer
dans les camps de concentration où les condamnés furent pendus aux portes
décorées et rehaussées de maximes, elle pressent qu’elle n’en ressortira plus.
Et si elle en revient pour pouvoir le raconter, ce sera au prix de l’abandon
d’elle-même, en arrière, là-bas, derrière les barbelés infranchissables… Face
à la mort, elle porte tous les masques qu’elle peut trouver. Lorsqu’elle essaie
de résonner depuis le gouffre qui sépare les bourreaux des victimes, ce n’est
que sa propre voix qu’elle entend, des mots qui s’étouffent avant même
d’atteindre l’autre bord, avant les rives de la réalité et de l’avenir… la
plupart du temps, elle choisit de rester à une distance relativement sûre, se
contentant peut-être, pour la surmonter, de la responsabilité du
“témoignage”… ».
Mais qu’y peut-on ? Que reste-t-il quand on n’a même plus le courage d’être
témoin ? De l’indignité. Contrairement à l’argent et au reste, elle peut vous
poursuivre dans la tombe.
____________
LE QUOTIDIEN D ORAN
12 MARS 2018
Le
Banc public- L’angoisse des chaussures neuves qui n’ont pas de routes
par Kamel DAOUD
Question obsédante : pourquoi on a peur
de la différence ? On répète que c’est à cause de la mer : tout ce qui est
différent nous vient de la mer et tout ce qui nous est venu par la mer nous a
tué, blessé, colonisé, spolié. Ottomans, Français, Romains…etc. La différence
est le signe avant-coureur de l’agression. Du coup, on n’aime pas la
différence. On n’aime pas les autres (Français, Marocains, Maliens,
Mauritaniens, Tunisiens, Libyens… etc.), on n’aime pas la pensée différente,
l’idée qui diffère, l’Autre. Le soupçon s’étend même à la notion du pluriel :
enfants de la guerre unique, née de l’histoire unique, aboutissant au parti
unique, on continue dans cette voie qui nous évite le poids du monde et la
naissance au monde. Nous nous rêvons, alors, unis, uniques, soudés, uniformes.
Cela va du religieux à la politique, à la culture. Le différent est toujours
accusé d’être traite, agent, venu d’ailleurs ou travaillant pour l’ennemi. Cela
frappe tout de la méfiance et colorie le monde en gris et nuit.
Du coup l’unanimisme nous a fabriqué une seconde nature de violence. On
l’exerce dès qu’un esprit, un leader ou un assis ou un croyant veut exprimer
une différence. L’unité nous obsède jusqu’à la catastrophe actuelle de la
gouvernance. Et la paranoïa carie notre regard sur le monde que l’on accuse de
tous nos malheurs.
L’unanime est fascinant : enfermant, refus de vivre, réclusion, pathologie de
l’universel, exacerbation du particulier. Nous sommes nous. En entier, en un
seul morceau et indifféremment jusqu’à en étouffer. Celui qui veut respirer ne
peut le faire que s’il part ou s’il meurt ou épouse une calotte glacière et un
méridien. Nous nous voulons en bloc, dans l’étreinte du dominé et dominant,
incapables de partage et de cohabitation. Tout est un. Le reste c’est zéro.
Nation binaire. Ou même pas.
Et tout ce qui est différent du Un majeur, est une menace. Alors on le
pourchasse et on le tue. On ne peut débattre, tolérer les champs des
différences, sortir de l’unanime sans se faire lyncher. Le mouvement est inacceptable
car il remet en cause le principe fondateur de cette nation : nous sommes le
tout. Il n’y a pas d’individu, de différence ou de droit de différence. La
règle n’est pas de dire «je ne suis pas d’accord avec vous car je pense
différemment», mais «je ne suis pas d’accord avec vous, donc vous êtes un
traître, je vous tue». Vous êtes un impie. Un agent de la main étrangère. Un
vendu. Il nous faut TOUS soutenir la Palestine par exemple. Celui qui fait
sienne la cause des enfants tués au Yémen est un traître. Vous devez soutenir,
d’ailleurs, la Palestine, non pas selon ce que vous pensez (construire une
nation souveraine et forte) mais selon moi : marcher en rond, cracher sur celui
qui ne pense pas comme moi (mais qui n’a pas d’armes pour répondre), puis renter
chez moi et attendre le prochain tour de piste des enthousiasmes. La guerre
d’Algérie ? C’est selon une unique version. Elle s’étend dans les journaux,
récit ravageur et soucieux, s’impose dans le film, les discours, les manuels.
Celui qui n’est pas dans le casting de cette orthodoxie est un traître.
L’histoire algérienne commence en 1830 (fondée donc non par notre mémoire mais
par l’invasion française !! La France, se retrouvant au centre de nos datations
est donc fondatrice de notre histoire, à la place de nos ancêtres !). La
religion ? C’est selon «je» qui parle au nom du «nous». «Et si je pense
autrement ?», Je te tue. L’Islam c’est moi car je suis le musulman. «mais vous
n’êtes qu’une personne, vous ne vivez pas être une religion?». Non, les deux
sont un et ce «un» c’est moi.
Je t’insulte d’abord en puisant dans la
poubelle pour l’insulte et dans un verset pour me donner du courage. Le reste
du monde ? C’est un ennemi composé des sionistes, de la France, la CIA et toi.
Mais c’est simpliste comme vision ? Et notre responsabilité dans le présent de
notre pays ? Non, cela est de ta faute à toi, comme le séisme est la faute de
la jupe et la saleté est la faute d’Israël. Et les langues ? Elles sont à nous
toutes ? «Une seule». Sacrée, venue du ciel et marchant pieds nus dans les
mosquées, pure et dure. Les autres langues sont des dialectes, c’est-à-dire des
blabla, c’est-à-dire des croassements, des restes de la France, des stratégies
pour nous affaiblir, des impiétés, des expressions des phalanges de la
colonisation qui n’ont pas été rapatriées. La langue c’est l’arabe et l’arabe
c’est l’Islam et l’Islam c’est Dieu et Dieu c’est moi. Pas d’issue. Sauf
l’échine courbée.
Et l’Algérie ? Elle est à nous
c’est-à-dire moi. Je suis son fils unique, son ancêtre, son chef et son peuple.
Je suis le peuple. Nous sommes «je» et je suis tout. Il n’y a qu’un seul
drapeau et c’est ma coupe de cheveux. Je déteste la femme belle mais je la
veux, la France est un ennemi mais je veux y vivre, l’Islam c’est moi, la
langue arabe est la langue du paradis, j’irai au paradis alors pourquoi me
fatiguer à le construire chez moi ? Je prie et le Chinois travaille et
l’Occidental invente, et le reste du monde doit se convertir. Je suis Tout.
Eternité, arabité, unanimité, café et thé et tu es le contraire. L’adversaire
donc. L’ennemi, évidemment.
Pourquoi avons-nous peur de la différence ? Parce que nous ne sommes pas
solides, nous sommes fragiles, peureux, impuissants devant la lourde variété du
monde. Nous sommes dans le repli. Alors tout est à nos yeux invasions, néo-
colonisations, traîtrises, menaces, peurs, agressions. Nous en devenons
violents par la force du déni. Nous tuons car c’est le versant le moins
fatiguant du suicide. Et le plus lâche. Nous ne voyageons pas et on ne laisse
personne, presque, venir chez nous. C’est une philosophie et pas seulement une
question de visa que les étrangers peinent à obtenir. Nous sommes une île sous
une veste qui sur le dos d’une personne qui tourne le dos à tous, y compris à
elle-même. Fiers que nous sommes. Parce que depuis l’indépendance nous avons,
tous, des chaussures. Mais pas de routes qui vont vers le monde. Alors nous
insultons. Nous nous insultons dans l’étreinte de nos paniques.
————————
LE QUOTIDIEN D ORAN
05 MARS 2018
Le
Banc public- Oran, Mostaganem… : on déteste ce pays !
par Kamel DAOUD
A
Mostaganem, à l’ouest du pays, un bidonville tout neuf. Il s’est installé, là,
entre nuit et lune, sur un terrain agricole à l’entrée sud de la ville. C’est
l’effet d’appel de la rente et des logements sociaux. C’est la nouvelle méthode
de chantage au social. Le régime « tient » la population par la promesse de
logement, il en obtient votes et soumission; les demandeurs « tiennent » le
régime par la demande de logement gratuit, le bidonville et les constructions
illicites ou le blocage des routes. Juste à côté, une immense mosquée, hideuse,
en deux ou trois étages. C’est la troisième donne de l’équation algérienne : le
religieux comme occupation de l’espace, de l’esprit, du bras, avant-bras, tête
et vision du monde.
La ville de Mostaganem, ses villages, sont devenus d’une saleté repoussante. Il
n’y a qu’à s’y promener pour en avoir le cœur en semelle. On compare alors,
sans cesse, la mémoire de l’enfance et le champ traversé de sachets en
plastique, de déchets de chantiers. Et revient cette interrogation métaphysique
: pourquoi ce peuple construit des mosquées partout, à bras-le-corps, sans
esthétique ni architecture, et ne s’occupe ni de la saleté ni du travail, de la
justice ou de la légalité, de l’école et de donner des noms aux étoiles ? Il y
a une mosquée inachevée chaque cent mètres presque et surtout près des plages,
dernier lieu de refuge du corps et de son droit au bronzage. Bien sûr, on va
crier à l’impiété du chroniqueur parce qu’il parle de hideur des mosquées, de
leur surnombre comparé aux entreprises, usines et fabriques, de l’insouciance
face à l’écologie mais de l’obsession face au rite. C’est chose habituelle et
facile de se réfugier derrière le dogme pour ne pas avoir à assumer le réel et
de lyncher le premier qui parle de nos défaites. Et pourtant, il faut le dire :
il y a trop de mosquées monstrueuses, construites n’importe comment, partout,
sans arts ni utilité, destinées au vide et à apaiser les consciences. Et il n’y
pas d’entreprises, de campagne pour un pays vert et propre, pour la santé de
nos enfants, les loisirs, la joie et la vie. Triste tableau des villages
traversés où s’adosser au mur et regarder la route est le seul pendant à la
prière aveugle et hâtive. Eucalyptus coupés, stationnement en mode chamelle et
pagaille et visages soupçonneux. Le pays est sans bonheur. Au village natal du
chroniqueur, une grande salle au centre : « la salle des fêtes ». On s’en sert
uniquement pour les obsèques et enterrements. Cela résume tout.
En ville, à Mostaganem, de même qu’à Oran, la nouvelle mode : des affichettes
sous les « feux rouges » qui vous appellent à consacrer le temps de l’attente à
la prière et au repentir. On rêve alors d’un pays où on appelle à ne pas jeter
ses poubelles par les vitres de sa voiture, où on appelle à ne pas salir et
cracher, insulter et honnir, qualifier de traître toute personne différente et
ne pas accuser les femmes en jupes de provoquer les séismes. On rêve de respect
de la vie, des vies. Mais ce n’est plus le but de la nation. La nation veut
mourir pour mieux vivre dans l’au-delà, plutôt que construire un pays, une
souveraineté, une puissance. On rêve de prier et de mourir. On rêve de mosquées
à chaque dix pas pour ne pas avoir à faire dix pas debout sur ses propres
jambes. On rêve que Dieu fasse la pluie, les courses du marché, la guerre, la
paix, la santé, les hôpitaux, la Palestine, les victoires, les récoltes et les
labours, pendant qu’on regarde descendre du ciel des tables garnies. On ne rêve
pas, on attend, pendant que les Chinois travaillent. Les Turcs l’ont bien
compris au demeurant : ils ont offert à Oran une grosse mosquée (encore une
autre tout près de celle de Ben Badis) et se sont fait offrir une gigantesque
entreprise de rond à béton. Les Turcs ont offert une mosquée, pas un hôpital,
pas une école de formation pour le transfert du savoir-faire, pas une
université. Non, juste une mosquée. Nous, on va prier et eux vont construire
leur puissance.
Ces mosquées sont construites dans une sorte de zèle, parfois par des hommes
d’affaires soucieux de se blanchir les os et le capital. Elles sont laides
comme celle construite en haut de Santa Cruz, à Oran, servant juste à
sanctifier un promoteur oranais, indécente de disgrâce et de pauvreté. Elles
sont partout et le travail et le muscle ne sont nulle part. Et pourtant, on
laisse faire l’affiche et l’architecte idiot. On ne demande pas d’autorisation,
on n’a pas la foi sourcilleuse et la légalité en alerte. Aucun administrateur
n’aura le courage de s’y opposer. On en aura pour fermer des locaux
d’associations féministes à Oran. Là, le DRAG a du zèle en guise de courage et
de la puissance. On a de la vaillance pour fermer deux églises car c’est plus
facile, c’est du djihad et de la bravoure. On prétextera des agréments qu’on
refuse de donner et de la fermeté qu’on n’a pas devant les affichages illégaux.
Une question de muraille et de courte muraille selon nos proverbes.
Le mauvais goût national
On rêve. Je rêve de ce moment où on aura une entreprise algérienne chaque dix
mètres, un appel à respecter la propreté de ce pays sous chaque feu rouge, une
loi qui aura la même force face à une association de défense des droits de
femmes que face à une zaouïa servile ou une mosquée clandestine ou une
association islamiste. On rêve d’un pays, pas d’une salle d’attente qui attend
l’au-delà pour jouir du gazon au lieu de le nourrir ici, sous nos pays, pour
nous et nos enfants. On rêve et on retient, tellement difficilement, ce cri du
cœur : pourquoi avoir tant combattu pour ce pays pour, à la fin, le maltraiter
si durement ? Pourquoi avoir poussé nos héros à mourir pour transformer la
terre sacrée en une poubelle ouverte ? Pourquoi avoir rêvé de liberté pour en
arriver à couper les arbres et inonder le pays de sachets en plastique ?
Retour. Encore des villages, des moitiés de villes aux constructions
inachevées, des hideurs architecturales, entre pagodes, bunkers, fenêtres
étroites alors que le ciel est vaste, ciments nus, immeubles érigés sur des terres
agricoles au nom du « social », urbanisme de la dévastation. La crise
algérienne, sa douleur se voit sur ses murs, son urbanisme catastrophique, son
irrespect de la nature. Les années 90 ont été un massacre par la pierre et le
ciment. Le « social » des années 2000 a consommé le désastre. Au fond, nous
voulons tous mourir. Camper puis plier bagage. C’est tout.
Arrivée près d’une plage à Mers El Hadjadj. Plage d’une saleté repoussante,
inconcevable. On comprend, on a l’intuition d’une volonté malsaine de détruire
les bords de mer, le lieu du corps et de la nature et de le masquer par des
minarets et des prières. Car il y a désormais une mosquée à chaque plage.
Insidieuse culpabilisation. Egouts en plein air. Odeurs nauséabondes. On
conclut à une volonté nette de détruire ce pays et de le remplacer par une
sorte de nomadisme nonchalant. Non, c’est une évidence : on n’aime pas ce pays,
on s’y venge de je ne sais quel mal intime. Tout le prouve : la pollution, le
manque de sens écologique, l’urbanisme monstrueux, la saleté, les écoles où on
enterre nos enfants et leurs âmes neuves pour en faire des zombies obsédés par
l’au-delà. Oui, c’est une volonté, on veut tuer cette terre. Et pendant ce
meurtre, on ne trouve rien de mieux à faire que de s’attaquer à deux
associations féministes à Oran. Bousculades, mots dans la tête, le cœur qui a
mal, la main qui tremble sur le clavier. Tellement mal après juste une balade
le long d’une route côtière. A revisiter les villages de son enfance devenus
des cités-dortoirs et de mosquées défouloirs, des décharges publiques aux
arbres coupés. Mais où est notre rêve de puissance et de liberté ? Pourquoi on
veut tous mourir pour aller au paradis en fabricant un enfer pour nos
descendants ? Pourquoi on veut tous construire des mosquées et pas un pays ?
D’où vient cette maladie qui nous a conduits à nous tuer, tuer nos différences,
tuer nos enfants qui ne sont pas encore nés et tuer le temps ?
Oran. La ville s’étend vers l’Est et mange ses terres et ses récoltes.
Immeubles en cohortes. Procession vers le vide. Cannibalisme de la terre. Il y
a de l’irréparable dans l’air. Près d’une cité-dortoir, sous un feu rouge, la
même affiche « occupe ton attente par la prière ! » Le pays est une grande
mosquée construite par des Chinois, meublée par l’Occident, ravagée par les
racines et destinée à surveiller le corps et la lune. On y prie pendant que les
Turcs travaillent, le monde creuse et conquiert, les nations se disputent les
airs et les cieux.
___________________


































































 ___________
___________
 .
.