

Depuis jeudi midi, la France est jetée dans un rare émoi. L’attribution à la mi-journée du prix Nobel de littérature à Annie Ernaux a fait l’effet d’une véritable tempête. Si, à l’instar de l’académie suédoise, le monde entier salue chez la romancière française son sens aigu de l’observation sociale ainsi que la mémoire interpersonnelle que son écriture, à l’unisson d’une société qu’elle traverse, sait porter, l’accueil en France se montre nettement plus mitigé. Agité, il se révèle profondément divisé, clivé, fêlé. Comme si, plus largement, l’annonce de la distinction d’Annie Ernaux rejouait toutes les fractures littéraires, nationales et politiques qui, depuis bientôt quelques courtes années, agitent le débat public et dont, à son corps défendant, Annie Ernaux serait, depuis la littérature même, l’incarnation la plus accomplie : à la fois le symbole patent et le symptôme latent.
Rarement, en effet, on a pu assister à un tel déchaînement de haine à l’égard d’une autrice qui, pourtant, depuis l’attribution du prix Renaudot pour La Place en 1984, jouit d’une vaillante reconnaissance critique et d’un plein succès public que chacune de ses parutions successives depuis lors reconduit avec une remarquable constance. Pourtant, dès 13h, avant la haine, tout semblait avoir débuté sous les meilleurs auspices : à l’annonce du prix, ce fut fêtes, éloges et réjouissances, notamment sur les réseaux sociaux.
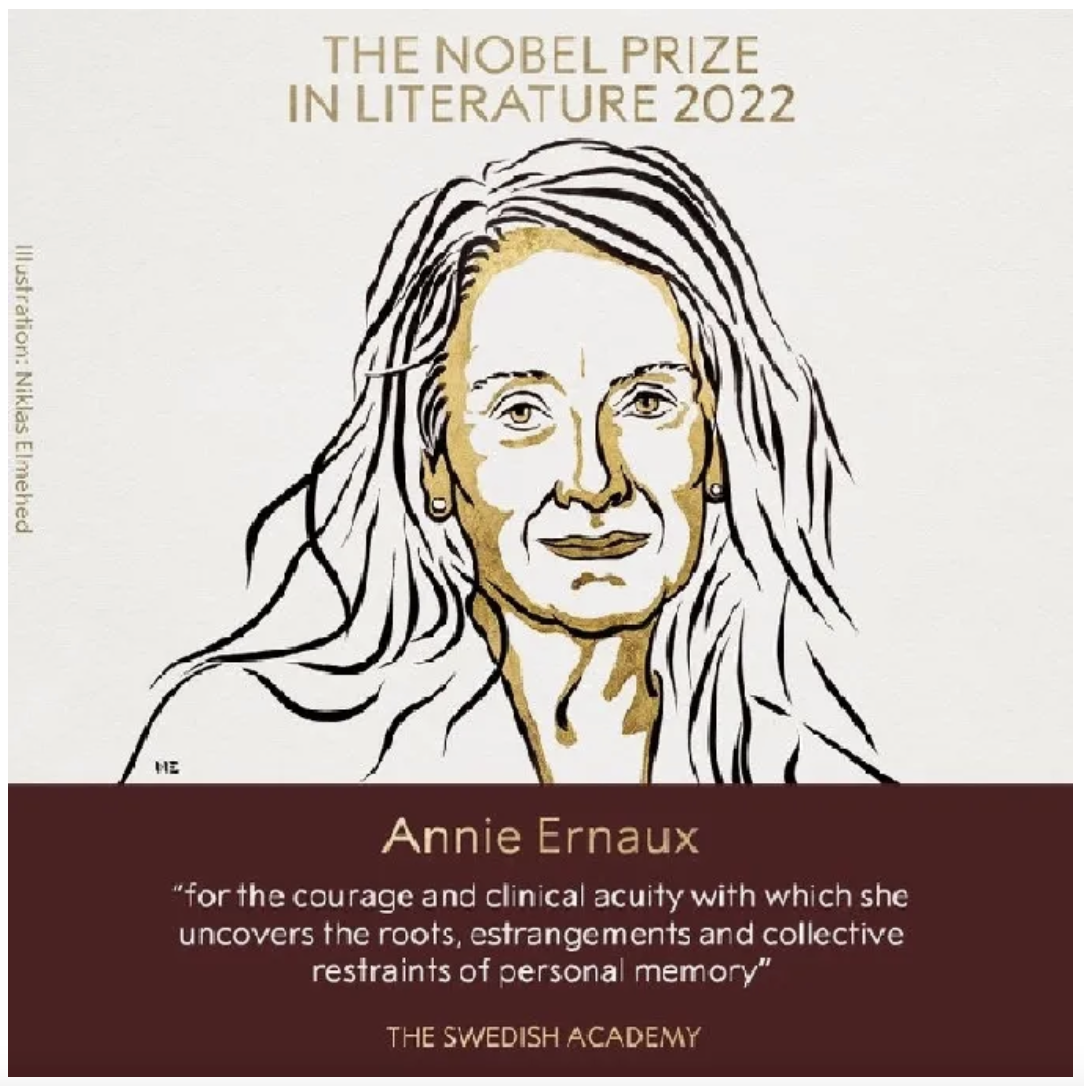
Annie Ernaux Prix Nobel de littérature 2022
Spontanément, chacune et chacun y allait de sa petite anecdote avec l’autrice fraîchement couronnée tant celle qu’on qualifie très maladroitement d’écrivaine de l’intime avait partagé un moment d’intimité avec nombre de ses lectrices et de ses lecteurs. Chaque photo émue était comme une mise en abyme de son œuvre : on était soudainement toutes et tous proches de celle qui, dans son œuvre et sa vie, sait se montrer proche de toutes et de chacun – comme si cette manifestation spontanée était l’œuvre par sa preuve. Qui avait dîné avec elle, qui l’avait croisée dans la rue, qui l’avait vue au supermarché et surtout qui avait reçu une lettre d’elle attentive et juste en témoignage d’un livre envoyé ou d’un récit sien admiré. C’est comme si, pour de vrai, chaque foyer français possédait une lettre manuscrite d’Annie Ernaux car, loin d’être un exercice égotique, une telle unanimité témoignait d’une paradoxale métonymisation du corps de l’écrit jusque dans sa matérialité même, comme une communion nationale, ou plutôt une communauté nationale. Comme si, plus largement, avec Annie Ernaux, le prix Nobel n’intimidait plus depuis son piédestal en réalisant le miracle démocratique absolu. Comme si le prix Nobel, avec Annie Ernaux, était enfin accessible : se révélait enfin simple.
Cependant, cette bonne nouvelle ne dura qu’un temps – très bref car, assez vite, politique atrabilaire des réseaux sociaux oblige, les diatribes et autres discours insultants et infondés commencèrent à se succéder tour à tour ou conjointement pour venir déplorer cette horreur ou plutôt ce Nobel comme contresens littéraire majeur qui revenait à couronner celle qui ne devrait pas l’être. Une violence inouïe, aux allures de cabale calomnieuse, commença dès lors à se déchaîner. On entendit tout et surtout, comme toujours sur les réseaux sociaux, absolument n’importe quoi : Annie Ernaux, antisémite. Annie Ernaux, racialiste. Annie Ernaux, séparatiste. Annie Ernaux, islamiste. Et même, surprise suprême, Annie Ernaux, pédophile. C’était le grand chelem de la Réaction qui se dévidait là : le débat public convertissait alors le discours positivement épidictique attendu autour de l’écrivaine en négativité polémique terrassante. À vrai dire, de manière paradoxale mais hautement violente, on ne parlait plus pour ce prix Nobel de littérature de littérature elle-même. C’est comme si ce Nobel d’Annie Ernaux était une littérature sans littérature : une monstruosité.

Mais, pour ces détracteurs, tous plus virulents les uns que les autres, ce qui sans nul doute dépossédait le plus Annie Ernaux de la littérature, c’est le fait insurmontable d’être une autrice. D’ailleurs, de manière frappante, les annonces du prix dans les médias ne reprirent que trop peu ce qui faisait pourtant l’événement de l’événement, à savoir qu’il s’agissait de la première autrice française jamais couronnée par le Nobel fondé en 1901. Même France Inter, qui se donne tous les deux matins des allures progressistes et n’a pas d’ailleurs hésité à recevoir Annie Ernaux dans sa matinale de centre droit dès le vendredi, avait pourtant usé d’une formule très problématique en titrant : « Annie Ernaux, 16e auteur français à recevoir le Nobel ». Au-delà de ce qu’on veut croire être une simple maladresse témoignant néanmoins de la vivacité de l’habitus lexical patriarcal, c’est bien vite sous le presque unique vocable d’« hystéro-féministe » que le Nobel d’Ernaux fut dénigré avec insistance. Là encore, c’était comme si son Nobel était usurpé et se révélait être une imposture parce que c’est, avant tout, une femme qui écrit.

Pour séduisante que cette hypothèse puisse paraître, elle ne se révèle pourtant pas exactement fondée ni même intégralement défendable. Elle ne se montre même que partiellement juste. En effet, dire du Nobel d’Annie Ernaux qu’il se voit rejeté parce que c’est une autrice qui est couronnée n’explique nullement un tel déchaînement de haines aussi diverses que variées. A l’évidence, quand Le Clézio et Modiano furent distingués, rien de tel ne se produisit : si l’un vit au Mexique retiré de tout sauf de Saint Germain des prés qu’il rejoint en vol direct pour feue la rue Sébastien-Bottin, l’autre poursuit, solitaire, une œuvre nocturne marquée par très peu d’apparitions publiques. Aucune attaque politique contre ces deux hommes n’eut alors lieu alors que l’un dénonce le sort réservé à certaines tribus reculées et que l’autre interroge avec insistance le passé collaborationniste de beaucoup de Français.
De la même façon, aucun dénigrement ne se produisit dans l’opinion française quand, les années précédentes, des lauréates furent cette fois préférées à de possibles lauréats. Ainsi, aucune animosité notable ne s’abattit sur Svetlana Alexievitch non plus qu’aucune campagne de dénigrement virulent n’ébranla la victoire de Louise Glück. Ce qui apparaît dès lors comme remarquable c’est combien cette absence de protestation lors du triomphe d’une femme étrangère met par contrecoup en lumière le problème nationaliste auquel, directement depuis jeudi, se heurte Annie Ernaux :

quand en France une femme écrit, elle écorne l’identité nationale. Elle la dégrade. Elle la vulgarise. Elle la rabaisse. Qu’une femme soit alors couronnée, c’est toujours un échec quand un homme pourrait toujours l’être à sa place. Car, plus profondément, si ce Nobel d’Ernaux suscite de telles réactions de la Réaction, aussi tranchées et virulentes, c’est que peut-être cette autrice a été préférée au mythe français du « Grand écrivain » auquel Annie Ernaux circonvient résolument. Mais, heureusement pour nous, Annie Ernaux n’est pas un « Grand écrivain ».
De fait, il ne suffit pas d’être femme à Annie Ernaux pour immériter son Nobel, encore faut-il qu’elle ait spolié et volé en tant qu’autrice un homme, c’est-à-dire fatalement pour certains critiques un « Grand écrivain » auquel ledit Nobel revenait de droit, à savoir celui sur qui les bookmakers internationaux et tout l’éditorialisme islamophobe français avaient parié : Michel Houellebecq. Car autour du Nobel chaque année en France et a fortiori quand la France en remporte comme cette fois la distinction convoitée se voit réactivée la délicate et sempiternelle question du « Grand écrivain » dans tout ce qu’elle peut avoir de passéiste, de suprémaciste et de nationaliste. Si bien que, on l’a compris, jamais une femme, et encore moins une autrice – notion qui s’élabore contre le « Grand écrivain » – ne pourra être une « Grand écrivain ».

En ce sens, toujours en opposition à Houellebecq, figure reine de la réaction littéraire, qui, lui, méritait le Nobel, Annie Ernaux ne correspond en rien à l’éloge masculiniste de la littérature et de la langue que véhicule le mythe du « Grand écrivain ». Car c’est la loi salique qui domine encore la vie littéraire française : on veut bien qu’Annie Ernaux soit une autrice mais qu’elle reste, comme les femmes, à la maison. On n’en veut pas sur la scène internationale. Parce que les femmes, comme le disait déjà Louise Labé, leur domaine, c’est la quenouille, c’est le rouet : elles sont toujours déjà assignées à la vie domestique. La littérature des femmes, ce serait au mieux une liste de courses. La morale réactionnaire se fait alors ici sans appel : n’importe quel homme se montrera plus digne de respect qu’une femme. A ce titre, à l’international, pour représenter la France, on préfèrera alors toujours un repris de justice comme Nicolas Sarkozy à une femme intègre comme Annie Ernaux. C’est manifestement moins dégradant.
Alors si Annie Ernaux se dresse comme l’antithèse du « Grand écrivain » et incidemment, à chaque instant, de Houellebecq, il faudra pour ses vaillants détracteurs déconsidérer l’autrice en deux temps pour en faire un épouvantail médiatique aux allures de contre-Houellebecq. Si bien que, depuis jeudi midi, les attaques contre Annie Ernaux s’organisent en deux groupes conjoints d’opposition assignant Annie Ernaux tantôt à un contresens littéraire, tantôt à un contresens politique.
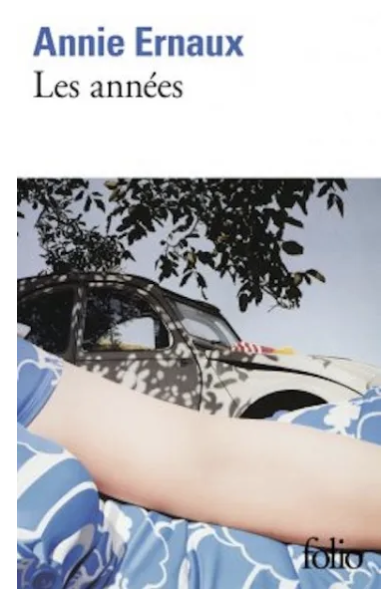
Un Nobel comme contresens littéraire tout d’abord. Sans surprise, ce premier groupe d’oppositions à Ernaux s’affirme comme exclusivement intra-littéraire : il concerne ce qu’on pourrait nommer les amateurs de littérature restreinte mais qui seraient plutôt ce qu’on pourrait désigner de manière éminemment négative, les puristes – ce qui ne peut manquer de faire sourire quand on prétend par ailleurs défendre Houellebecq. Pour ces hommes, très rarement des femmes, l’œuvre d’Annie Ernaux est une non-œuvre. Elle n’écrirait pas. La fameuse « écriture plate » dont l’autrice se réclame notamment depuis La Place ne figure rien d’autre dans la bouche de ces détracteurs qu’une platitude éhontée, un long défilé de banalités sur une vie quotidienne d’une femme de la classe moyenne – ou pire, l’œuvre d’un Bourdieu en jupons donc toujours de la non-littérature. L’écrivain du moi et de l’intime manquerait à chaque mot et à chaque phrase la dimension universelle que doit s’assigner la littérature même.
Dans ce type discours usé qu’on entend depuis bientôt 40 ans à son propos, Annie Ernaux irait même jusqu’à incarner l’antithèse de toute littérature : sa négation affirmée. La preuve, elle serait lisible voire trop lisible. Comme si seule l’illisibilité, c’est-à-dire un critère formaliste daté qui n’a plus cours depuis la fin des années 1970 en France, avait encore une quelconque actualité pour rendre compte du contemporain.
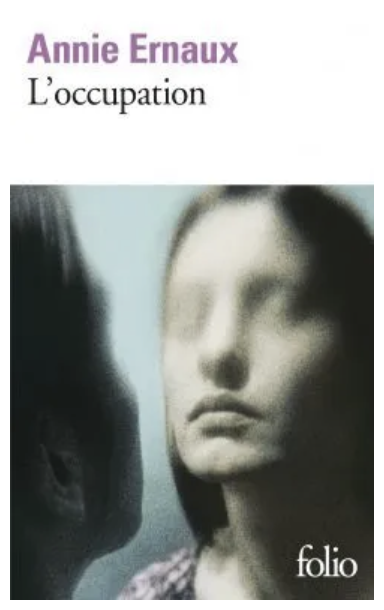
Comme si nous n’avions pas appris, depuis bientôt 40 ans, que la littéralité ne figurait plus comme l’antonyme ardent de littérarité. C’est peu de dire qu’une telle position critique assigne les unes et les autres qui la défendent, avec une rare hargne, à une position passéiste – éminemment réactionnaire qui cache mal l’amour de la belle langue et d’une Grande littérature qui est toujours une littérature d’extrême droite comme Céline ou Richard Millet.
Un Nobel comme contresens politique, enfin. La conséquence de l’assignation domestique aperçue plus haut, par laquelle les femmes doivent rester à leur place, prend ici tout son sens. Dans le débat public, la femme n’a aucune légitimité à s’exprimer, ce qui explique, dans un second temps, la virulence assourdissante qui frappe Ernaux. La politique n’appartient pas aux femmes, et encore moins à celles qui écrivent. En ce sens, non contente de ne pas être littérairement un « Grand écrivain », Annie Ernaux ne parvient pas à être politiquement ce même « Grand écrivain ». Elle serait alors celle qui, littéralement, ne sait pas parler : celle qui exagère, celle qui ne sait pas réguler sa parole. Elle n’est pas domestiquée, plus sauvage que l’enfant sauvage de Truffaut lui-même, rejetée dans un règne de la nature dont la barbarie serait le maître-mot. Par ses prises de positions politiques, Annie Ernaux serait hors civilisation, c’est-à-dire littéralement inculte et une fois encore hors littérature.
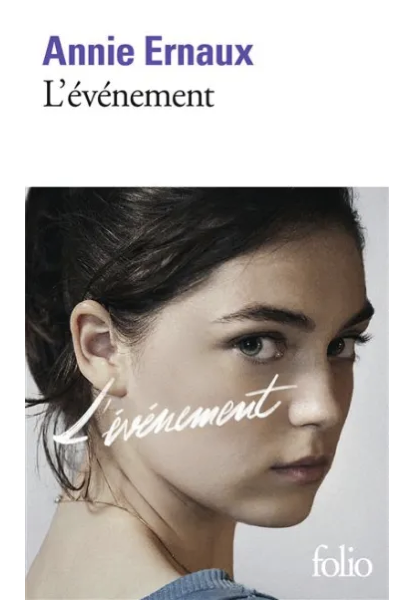
Véritable femme-animal, elle n’aurait alors en politique que de bas instincts telle une bête frappée de folie et de haine : depuis Cergy, Annie Ernaux ne pousserait qu’une série de cris féroces. Si vous n’y prenez pas garde, elle va vous mordre, heureusement qu’elle vit en banlieue. Cette rage ne s’offre-t-elle pas d’ailleurs comme l’essence du mélenchonisme dont Ernaux ne serait finalement rien d’autre, aux yeux de ses détracteurs, que le perroquet littéraire ? Une telle vision dégradante et dégradée n’a que pour visée ultime de désolidariser les choix politiques d’Annie Ernaux de la France des Lumières et comme s’ils témoignaient du caractère antipatriotique de leur autrice. La question est décidément celle de la représentation nationale sur la scène internationale qu’offre le Nobel : ce n’est même pas qu’Annie Ernaux représente mal la France, elle serait la négation surtout de l’esprit français.
Dès lors, Annie Ernaux constituerait un affront cinglant au « Grand écrivain » entendu comme tradition séculaire et comme essence de la France éternelle.

Car, on s’en souvient, née au 19e siècle avec l’empire colonial, la notion de « Grand écrivain » se voit avant tout forgée par la IIIe République comme un des outils majeurs de la France dans son arsenal de domination culturelle sur le monde. On ne s’étonnera guère qu’à chaque fois que la France a remporté le Nobel lors des deux dernières décennies une sorte de frisson d’aise patriotique sinon de narcissisme national a couru dans les médias. Il venait rassurer les Français sur la France comme superpuissance. Leur chère patrie rayonnait encore sur la scène internationale. L’honneur est sauf : elle n’était pas défunte.
Mais cette fois, pour ces gens d’un autre temps, l’honneur a comme violemment sombré à l’horizon d’eux-mêmes et de la France. Car ce que ne pardonnent pas ses détracteurs à Annie Ernaux avec l’attribution du Nobel, c’est d’apparaître sur la scène internationale comme les perdants humiliés d’un combat civilisationnel qu’ils mènent, dans l’hexagone, depuis pourtant nombre d’années. Ce qu’ils ne supportent pas, c’est combien ce Nobel d’Ernaux les défait mais surtout les dédit et les déjuge. Ils ne sont pas reconnus comme instance énonciative : c’est l’épreuve terrible de la déconsidération morale et critique, eux qui passaient leur temps à vomir ce qu’ils désignaient comme le prétendu « wokisme » d’Annie Ernaux, voilà que des étrangers – peut-on imaginer pire scénario pour ces gens-là ? – consacrent Ernaux comme l’incarnation contemporaine de la France contre leur avis. Depuis jeudi, ces gens vivent dans un cauchemar à ciel ouvert – ce qui n’est pas sans être assez savoureux, il faut bien le reconnaître.

De fait, ce Nobel pour Annie Ernaux créé un précédent absolument terrible dans le débat franco-français que ces réactionnaires entretiennent sciemment à longueur d’années : la distinction suédoise a valeur, pour des nationalistes acharnés dont Eugénie Bastié qui, sans rire, se présente comme un « grand reporter des pages Débats et Opinions » (sic) du Figaro, d’un interventionnisme qui vaut pour une agression territoriale. Il y a violation du débat national comme on parlerait de violation de l’espace aérien : dans cet affrontement civilisationnel entre le contemporain qui défend Ernaux et le passé qui loue Houellebecq, le Nobel a en effet tranché pour la France qui, dès lors, se voit dès lors dépossédée de son débat public. Les éditorialistes ne peuvent qu’être en émoi : le Nobel a opéré un putsch dans l’opinionisme français ambiant.
Survolant toutes leurs récriminations qui apparaissent comme autant de faux arguments, un pays étranger dénonce le contrat sadique que la critique réactionnaire et islamophobe impose à la France : l’intervention d’un tiers, ici le Nobel, permet de défaire le couple perverset inusable que le réactionnaire veut entretenir avec Annie Ernaux. Le Nobel est cette voix tierce qui, comme dans les psychoses, rappelle à l’ordre, à la loi, au Réel : à la marche contemporaine du monde telle qu’elle se fera sans cet éditorialisme français.

Annie Ernaux © Catherine Hélie / Gallimard
Peut-être cette dernière image pour nous sauver de ce contrat sadique imposé par l’éditorialisme, celle qui ouvre L’écriture comme un couteau, dialogues magistraux d’Annie Ernaux en compagnie de Frédéric-Yves Jeannet. Annie Ernaux y raconte qu’après la guerre, à Lillebonne, à l’âge de quatre ans et demi, elle assiste à sa première représentation théâtrale qui consiste en un magicien qui enferme une femme dans une boîte.

Avec application, cet homme enfonce des couteaux de toutes parts dans ladite boîte. Dans la salle, la jeune Annie Duchesne a alors très peur. La scène n’en finit pas. Mais, au bout d’un certain temps, comme par miracle, la femme qui aurait dû transpercée ressort vivante et immaculée. Depuis jeudi, avec le Nobel, le même épisode se reproduit mais cette fois avec Annie Ernaux dans la boîte et sur la scène. De longues piques sont enfoncées de toutes parts. La scène est identiquement interminable. Mais au bout d’un certain temps, alors qu’elle aurait dû être blessée, l’issue est heureusement la même, n’en déplaise à certains : Annie Ernaux ressort de la boîte, intacte.
_______________________________________
LA PLACE
par Wébert Charles
La place est le quatrième roman d’Annie Ernaux, paru pour la première fois en 1983 aux éditions Gallimard. Moins d’un an plus tard Le livre est distingué par le jury du prix Renaudot.
Le livre s’ouvre sur les épreuves du Capes que subies la narratrice dans un lycée lyonnais. La peur aux trippes, elle finit par réussir aux épreuves orales devant un jury composé d’un inspecteur et de deux assesseurs. Mais, ceci est une fausse entrée. Le lecteur pourrait bien se tromper en se fiant aux premières lignes du livre. Il ne s’agit pas d’un roman sur l’enseignement secondaire ou sur l’éducation. C’est un livre sur la figure du père, sa « place » dans une famille de campagnards aussi bien que dans une société en pleine mutation.
Deux mois, « jour pour jour », après le passage des épreuves, le père de la narratrice meurt suite à de longues douleurs d’estomac. Annie Ernaux revient sur la figure du père, le sien, et écrit un roman qui se propose d’actualiser la conception du père dans la littérature française. Si dans la première page du roman Annie Ernaux mentionne Le père Goriot de Balzac, elle ne laisse aucun indice au lecteur qu’il s’agira ici d’un roman sur le père. Si, également, dans le roman de Balzac , Goriot est le symbole de l’amour paternel, le père de la narratrice est loin de cette image caricaturale de la paternité. C’est un homme de chair et d’os, qui a autant de faiblesse que de force. Un personnage romanesque, si l’on se tient à la conception de la vérité romanesque de René Girard développée dans son livre « Mensonge romantique et vérité romanesque ». Pour Girard, « le roman romanesque dit la vérité de l’homme ». C’est peut-être à la recherche de cette vérité-là que part Annie Ernaux. Une vérité que Jean Cohen fait résider dans l’inautenticitéde l’homme. Sa construction dans une société de laquelle il est dépendant. Voilà la vérité de l’homme. N’est-ce donc pas la quête ultime de l’autofiction ? Mais si l’autofiction est souvent qualifié de « roman du je », le « je » d’Annie Ernaux n’est donc rien d’autre qu’un jeu. Un « je » trompeur. Car si Annie Ernaux dit « je », c’est de l’autre qu’elle finit par parler. De son père. Nous voilà encore revenu à la conception du roman de Girard évoquée plus haut, pour qui « le moi profond n’existe pas » et que tout homme s’accomplit dans l’autre ou s’explique par l’autre.
Le père est un vieux paysan, qui tient à Y…, un café-épicerie avec sa femme. Qui redoute, comme tous les commerçants, la concurrence, et qui est prêt à aller chercher son pain à des kilomètres que de l’acheter des mains de son voisin qui n’achète pas à son café-alimentation. Un père dur comme fer, qui déteste les gros mots, le patois des paysans, et qui envoie sa fille à l’école pour qu’elle n’ait pas la vie qu’il mène. « Les livres, la musique c’est bon pour toi. Moi, je n’en ai pas besoin pour vivre ». Qui essaie en vain de cacher ses mœurs paysannes devant les condisciples de sa fille et qu’un « comment ça va ti » finit parfois par trahir. À la mort de ce père singulier, il n’y eut aucun étonnement. « C’est fini », annonce la mère, froidement. Aucun sanglot. Sauf lorsque le cercueil entre sous la terre, quand elle éclate en sanglot « comme le jour de mon mariage », nous dit la narratrice. Un mélange de tristesse étouffée et d’indifférence.
Lécriture d’Annie Ernaux rappelle dans ce roman celle de Zola dans L’Assommoir, ou de Céline dans Voyage au bout de la nuit. Une langue « verte », mais sans émotions et combien douce. Qui donne aux mots vie et forme. Comme si pour parler des gens de la campagne, il fallait le faire dans leur langue. Avec des phrases hachées, dépouillées de la syntaxe classique du français. Des phrases très souvent pronominales, qui énumèrent au lieu de raconter, comme c’est aussi le cas dans « Les Années ». Le livre dégage un certain parfum exquis, par des fragments inégaux, qui vous tient à la gorge, et vous fait vivre cette autre partie-là, d’une France d’après-guerres, décrite par la « génération de la guerre ».
Lecture recommandée !
Annie Ernaux, La place, Paris : Éd. Folio, 1986, 114 pages
par Wébert Charles
5 août 2014
(lu sur Twetter page de W. Charles, vendredi 21 octobre 2022) et :
lelivre.mondoblog-org/2014/08/05