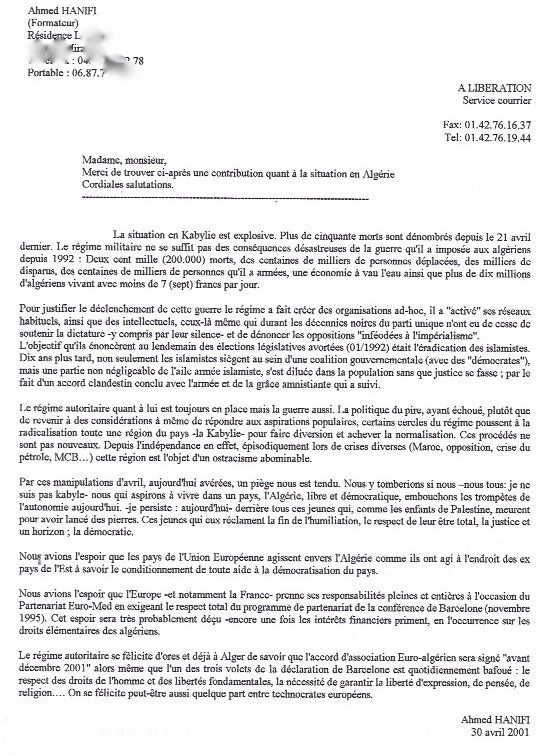La presse algérienne et le procès
« Nezzar-Souaïdia »
Ahmed Hanifi*, Algeria-Watch,
Septembre 2002
1- L’OBJET
« L’ancien ministre de la
défense algérienne, le général-major Khaled Nezzar a intenté un procès en
diffamation à l’ex officier Habib Souaïdia » aujourd’hui réfugié
politique en France pour des propos tenus le 27 mai 2001 sur la chaîne de
télévision La Cinquième lors de l’émission Droits d’auteur consacrée à
l’Algérie.
Le procès s’est déroulé au sein du
tribunal de grande instance de Paris du lundi 01 au vendredi 05 juillet 2002.
Il a fait couler beaucoup d’encre en Algérie et a « gêné tout le monde
à commencer par la presse » (El Watan 14/07/02).
Notre objet est d’analyser
qualitativement les contenus de la presse algérienne traitant directement ou
non de ce procès. Nous appelons presse algérienne la presse écrite francophone
gouvernementale ou privée, éditée sur papier en Algérie et accessible en France
(y compris par ses sites sur Internet). Les écrits d’Algéria-Interface, non
édités sur papier en Algérie sont considérés comme relevant de la presse
étrangère au même titre que des journaux comme Libération, L’Humanité, Le
Parisien ou Le Monde que nous évoquerons.
Pour la seule partie accessible en
France de la presse écrite francophone algérienne (Sites sur Internet,
Algéria-Interface, papier), nous avons relevé durant la semaine du lundi 01 au
dimanche 07 juillet 2002, près de 75 articles traitant du procès ; mais
près d’une centaine si l’on ajoute les écrits antérieurs au 01 juillet et postérieurs
au 07 juillet.
Il est à préciser que nous
observons les journaux comme une totalité, une organisation globale par
conséquent et en l’occurrence les signataires d’articles en tant qu’individus
importent peu. Des cas antérieurs très précis de rejets simultanés (malgré
l’humeur de tel ou tel journaliste de base) par des responsables de presse,
d’articles ou bien de communiqués –payants– car « n’entrant pas dans la
ligne éditoriale » de leur journal nous ont conduit à cette posture.
La lecture de ces contenus fait
apparaître un certain nombre de thèmes dont la redondance ou la pertinence a
retenu notre attention. Pour exemple : Comment la presse algérienne
« parle » du plaignant Khaled Nezzar ou de l’accusé Habib Souaïdia,
des témoins de l’un et de l’autre et de leurs témoignages. Comment elle traite
du procès ? D’autres thèmes qui auraient pu intéresser le lectorat de
cette presse ne sont pas analysés car ils n’ont pas été « ouverts »
par elle : la réaction des partis politiques sur le procès ; l’avis
des lecteurs sur le procès ; la question de la censure du livre de Habib
Souaïdia, …. ; néanmoins nous commenterons ces silences.
Notre corpus (« presse
algérienne » et « autre presse » ) est constitué d’un ensemble
d’articles papiers et d’autres constitués grâce aux différents sites sur
Internet et les dossiers « presse » d’Algeria-Watch. Ils sont les
plus importants : 1.323.342 caractères. Une première lecture, flottante,
de la partie du corpus constituant « la presse algérienne » fait
apparaître, du fait élevé du nombre d’articles, une diversité de contenus.
Nous partons du présupposé
suivant, à savoir que le procès a été inéquitablement traité compte tenu de la
position qu’occupe la presse algérienne dans le champ des enjeux de pouvoir.
L’étude s’ouvre sur le contexte
dans lequel s’est déroulé le procès, pour ensuite aborder l’analyse de contenu
par les questions qu’elle soulève : Quels ont été les titres choisis par
la presse algérienne, qu’a-t-elle écrit sur Khaled Nezzar et Habib
Souaïdia ? qu’a-t-elle rapporté des témoignages des uns et des autres,
qu’a-t-elle écrit sur le procès ?
Nous achevons l’étude par
l’analyse de l’appréciation que se fait la presse de l’opposition au régime
politique algérien ainsi que de la presse étrangère (française) ; et par
un constat.
2- LE
CONTEXTE
La tenue du procès la première
semaine de juillet coïncide avec le 40° anniversaire de l’indépendance de
l’Algérie ; avec le début des cycliques rumeurs estivales (avec notamment
cette année les sous-entendus concernant « l’affaire » Orascom
impliquant la personne du président de la République dans le choix d’un
opérateur économique tels que véhiculés principalement part El Watan et Le
Matin). Le Quotidien d’Oran du 18/07/02 écrit : « Cet été se
terminera comme les autres. Des attentats, des rumeurs, des voix «proches» et
«autorisées» dont il faudra se méfier comme de la peste gronderont, des
commentaires éclairés continueront de creuser le fossé imaginaire entre l’ANP
et M. Bouteflika ». Pour soutenir celui-ci et en réponse aux différentes
attaques dont il fait l’objet par une partie de la presse « une
association nationale dénommée Mouvement pour la concorde nationale est
officiellement créée. Celle-ci, selon ses initiateurs, se fixe pour objectif la
promotion du programme du président de la République. » (Le Jeune
Indépendant du 13/07/02)
Le procès coïncide avec la
commémoration de l’assassinat le 29 juin 1992 du président du Haut comité
d’Etat (HCE) qui est une présidence collégiale mise en place 166 jours
auparavant et composée de cinq membres : Khaled Nezzar, Mohamed Ali
Haroun, Ali Kafi, Tedjini Haddam et Mohamed Boudiaf son président. Le procès
coïncide également avec l’installation à La Haye de la Cour pénale
internationale (CPI). Le rôle de cette nouvelle institution est de « juger
les individus qui ont commis des violations graves du droit humanitaire
international et des droits de l’homme » (Le Soir d’Algérie du
01/07/02) quel que soit l’Etat et la « qualité officielle et
hiérarchique » de ces individus. Maître Comte le rappellera à Khaled
Nezzar lors du procès en ces termes : «En [vous] regardant, je pense à
l’Automne du patriarche. Les temps ont changé : de nouveaux instruments
internationaux permettent aux suppliciés de se faire entendre et empêchent que
la raison d’Etat fasse la loi.» (Libération du 06/07/02) même si « la
juridiction de la CPI n’aura pas d’effet rétroactif. Elle ne s’appliquera que
sur les crimes qui vont être commis à partir du 01 juillet 2002 » (La
Tribune du 01/07/02)
3- L’ANALYSE
DE CONTENU
Nous observerons les titres que la
presse algérienne a retenus durant la semaine du lundi 01 au dimanche 07
juillet. Que reflètent-ils ? Quels termes utilise la presse algérienne
dans ses articles pour qualifier Nezzar, puis Souaïdia, enfin leurs témoins et
avocats réciproques. Y a-t-il un parallèle possible entre les vocables utilisés
pour les témoignages des uns et des autres ? La presse algérienne a-t-elle
reflété dans ses écrits ce débat contradictoire au sein du tribunal dont elle
se réjouit ? Qu’écrit-elle sur le procès, sur son déroulement ?
3-1- LES TITRES : Guerre
des témoins
Entre le lundi 01 et le dimanche
07 juillet nous avons relevé près de 75 titres d’articles traitant directement
ou non du procès : les témoins, le rôle de l’armée, la décennie 1992-2002,
les médias.
Le premier jour les titres
réfèrent aussi bien aux témoins qu’à l’ANP au procès lui-même qu’aux médias. Le
deuxième jour la parole est donnée à El Hachemi Chérif : « Livrez
à l’opinion les documents en possession des services » dit-il (Le
Matin du 02/07/02), manifestement au fait des contenus des documents en
possession des « services ». En dehors des témoins au procès,
ce responsable politique est le seul (avec des généraux) dont la position à
l’égard du procès a fait l’objet d’un article de presse. D’autres titres se
rapportent à l’ANP. Le mercredi 03 juillet quatre titres se rapportent à
l’armée, quatre autres à l’arrêt du processus électoral. Le jeudi 04 juillet,
sur quinze titres, dix sont consacrés à l’ANP et cinq aux témoignages de la
veille :
– L’arrêt du processus
électoral en débat à Paris (Le Soir)
– Témoignage des familles victimes du terrorisme ( Le Matin)
– Au prétoire, les cris des victimes du terrorisme (El Watan)
– Guerre des témoins (L’Expression)
– Samraoui témoigne (Liberté)
Le samedi 06, trois titres
concernent Aït Ahmed qui a témoigné le jeudi 04 juillet ainsi que Nacera Dutour
et A. Mesbah (Lire le point 3.5 : Les témoignages) :
– Aït au secours de Souaïdia
(El Moudjahid)
– Aït Ahmed défend le petit lieutenant (L’Expression)
– Un témoin surprise : Aït Ahmed (Le Matin)
Le dimanche 07 enfin nous avons
relevé six titres dont celui-ci de Liberté : « Les révélations de
Semraoui. »
3-2- LE PLAIGNANT :
Général-major, soldat du combat pour la vie.
Le général est nommé « Général-major
à la retraite » (Le Jeune indépendant du 02/07/02), « ancien
ministre de la Défense (1990-1993) » (Le Matin du 01/07/02) « Général
à la retraite » (El Watan du 02/07/02) , qui « assume
individuellement [ce procès] » (Le Soir du 02/07/02), et qui a « provoqué
volontairement et voulu (…) un débat »(El Watan du 02/07/02) ,et
auquel « il faut reconnaître un courage politique rarissime, pour ne
pas dire inédit dans les us et coutumes des hommes forts du système (…) lui qui
« semble jouer sur du velours » (El Watan du 08/07/02). Un homme «serein,
direct, percutant, sans hésitation (…) d’un courage exemplaire » (El
Moudjahid du 02/07/02). Cet homme là, ce « soldat du combat pour la vie »
(Le Soir du 14/07/02) , sera « lâché » dès lors que le procès « a
viré ». « Ce général [qui] voulait laver son honneur et
celui de l’ANP dans un tribunal parisien s’est retrouvé à la place de l’accusé.
(…) On ne lave pas son honneur et celui de l’armée algérienne en croisant le
fer avec un soldat banni » (Liberté du 07/07/02).
La presse algérienne ne regrette
pas que le régime ait intenté un procès « pour laver son
honneur », mais ne comprend pas qu’il ait d’une part mal choisi sa
cible (« un soldat banni ») et d’autre part d’avoir
délégué ce général là dont « il est sûr aujourd’hui qu’il n’a pas
inventé la poudre ». (L’Expression du 13/07/02).
Alors, ce « général à la
retraite (…) et à l’heure actuelle sans fonction officielle », « qui
vient à peine de se remettre de son Waterloo parisien » doit cesser de
« persister à parler au nom de cette armée » écrit
l’Expression (13/07/02) au lendemain d’une intervention de Khaled Nezzar qui
accuse le directeur de ce journal mais qui en réalité « cherche
délibérément à atteindre une autre cible »
L’on pourrait être amené à penser
au vu de ces extraits que la presse algérienne prend ses distances avec le
régime.
3-3- L’ACCUSE : Un obscur
sous-lieutenant…sorti trois jours avant l’assassinat de Boudiaf
Comment la presse algérienne
« parle » de Habib Souaïdia ? Si pour Khaled Nezzar la presse
est prudente, tantôt le soutenant tantôt le critiquant, pour Habib Souaïdia sa
réaction est plus abrupte, arrêtée, unanime et définitive quelle que peut être
l’évolution du procès. Habib Souaïdia est franchement condamné par la presse
algérienne publique ou « indépendante ».
Deux exceptions à ce tollé, ce
soulèvement. Le Matin qui paraît plus sobre en ce premier jour du procès :
« Habib Souaïdia, ancien parachutiste de l’armée algérienne » (Le
Matin du 01/07/02) ou bien La Tribune du 02/07/02, qui écrit : « Alerte,
tantôt serein, tantôt ému, parfois nerveux, Souaïdia raconte sa vie de
militaire, sa condamnation à 4 ans de prison en 1995, son arrivée en France et
les circonstances de la publication de son livre ». Ces exceptions
confirment justement tout le reste. El Watan du 02/07/02, qui trouve dans un
premier temps que Habib Souaïdia « semble avoir bien travaillé ses
réparties » se ressaisit pour immédiatement relativiser « mais
perd toutefois de cette assurance lorsque les questions (…) deviennent plus
précises », « Souaïdia fait de grands efforts pour cacher son faible
niveau intellectuel » (L’Expression du 02/07/02), lui « qui a
voulu à sa manière cracher la contradiction » (Le Quotidien d’Oran du
02/07/02).
« Il faudrait une plongée
spéléologique dans les fausses de son âme pour discerner la haine et la
rancœur, la vengeance et le ressentiment » (El Moudjahid du 06/07/02)
de « ce malfrat » (Le Soir d’Algérie du 02/07/02) de ce «
faux (pseudo) auteur de La sale guerre (…) cet ancien voleur de pièces
automobile » (La Nouvelle République du 01/07/02). de cet « Officier
radié (ou : « ex-sous lieutenant cassé [Sic]) après avoir été
dégradé à la suite de sa condamnation (…) pour vol » (El Moudjahid du
01/07/02) .
Voici quelques exemples de
qualificatifs attribués à Habib Souaïdia :
« Officier radié, dégradé,
condamné, sous lieutenant cassé, calomniateur » (El Moudjahid du
01/07/02), « Faux auteur de « La sale guerre », ancien voleur »
(La nouvelle République du 01/07/02), « Auteur malgré lui de La sale
guerre » (Horizon du 08/07/02), « habillé en noir « comme
son cœur » » (El Moudjahid du 02/07/02), « Un obscur
sous-lieutenant »(Liberté du 14/07/02), « un vrai
rentre-dedans de l’armée algérienne » (Liberté du 02/07/02), « Un
paumé du petit matin (…) [et] du bord de Seine » (Le Quotidien
d’Oran du 18/07/02), « au regard perdu, droit et déterminé [qui]
n’épargne personne » (L’Expression du 02/07/02), «il fusille du
regard Nezzar » (Le Matin du 02/07/02). Et, suprême allusion, Habib
Souaïdia, ce « sous-lieutenant qui est de la promotion qui a enterré
Boudiaf, était sorti trois jours avant l’assassinat du président du HCE »
(L’Expression du 02/07/02).
3-4 LES TEMOINS : Des
témoins factuels contre des « témoins » aigris
Comment la presse algérienne
décrit les témoins, les avocats, de Khaled Nezzar ou de Habib Souaïdia. Comment
elle « parle » d’eux et de leurs arguments ? Qui dit quoi ?
La presse ségrégue les témoins en
deux camps étanches. Le premier est constitué de « témoins du drame,
venus de Bentalha », des témoins « factuels » (El
Watan du 02/07/02), « Des témoins factuels, soit des victimes des
islamistes armés, soit des personnalités algériennes qui ont eu à occuper de
hautes fonctions dans l’Etat » (Le Matin du 01/07/02). A ces témoins « haut
de gamme » (L’expression du 06/07/02) et « en béton »
(El Moudjahid du 01/07/02), font face du « côté adverse des témoins (…)
qui se sont retirés de peur d’être confondus. (…) Il semble qu’ils ne se
bousculent pas » (El Moudjahid du 01/07/02). Les «« témoignages« »
[de ces]
« « témoins« », double
guillemets insérés par El- Moudjahid des 01 et 08/07/02 sont liés par « Un
dénominateur (…) : aigris, ils ont tous une dent contre l’Algérie »
défendue par Khaled Nezzar.
Lorsqu’elle évoque les témoins à
charge, la presse algérienne associe leur nom à des symboles positifs ou les
fait suivre de qualificatifs valorisants et utilise l’affect ; « des
visages inondés de larmes » (El Moudjahid du 04/07/02) mais lorsque
cette même presse évoque les témoins de la partie « adverse », c’est
l’inverse qui se produit jusqu’à égratigner ou ignorer leur nom ou bien taire
leur titre.
Les titres, grades…
Lorsqu’elle évoque les témoins à
charge elle indique leur grade, leur titre : « Madame Leïla
Aslaoui, magistrate et ancien ministre de la jeunesse et des sports »
(Le Matin. du 04/07/02) [Ali Haroun] « L’ex membre du HCE »
(El-Moudjahid du 03/07/02), « L’ancien ministre des Droits de l’homme,
Ali Haroun » (Le Soir du 03/07/02) . « Rezzag Barra, ex
président de l’observatoire des Droits de l’homme » (Le Matin du 03/07/02),
Ahmed Djebar « ancien ministre de l’éducation nationale » (Le
Matin du 06/07/02). Cette propension à vouloir donner des titres conduit au
ridicule ainsi lisons-nous : « Mohamed Sifaoui l’ancien
journaliste et ex [Sic] -coauteur [ou nègre ?] de Souaïdia »
(L’Expression du 02/07/02)
Lorsqu’elle évoque les témoins de
la défense elle ignore leur grade, leur titre : « Omar
Benderra » (El Watan du 02/07/02), « José Garçon, considérée
comme un proche d’Aït Ahmed, de Nacéra Dutour, présidente de SOS-Disparus,
connu pour ses relations étroites avec la direction du FFS, de Salima Ghozali
[Sic] , membre du fameux cabinet noir du parti d’Aït Ahmed (…) Moment
historique et anecdotique: le général Nezzar s’est levé pour répondre «face à
face» à Aït Ahmed » (L’Expression du 06/07/02).
Lorsqu’il lui arrive d’en faire
autant avec « Haroun » c’est à dire lorsqu’elle n’indique que son nom
« ces avocats ne supportaient plus les longues explications fournies
par Haroun » (El-Moudjahid du 03/07/02) ou avec « Nezzar »
(El- Watan du 13/07/02), neuf fois dans le même article, Liberté sept fois dans
l’édition du 13/07/02), c’est pour indiquer une proximité politique, une
« solidarité » : Proximité et
« solidarité » s’expriment d’ailleurs dans le corps même du
texte : « Les détracteurs de Nezzar » (Le Matin du
02/07/02), « Les avocats de la défense très gênés par la culture de Ali
Haroun » « Nezzar est impassible » (El Moudjahid des 03 et
06/07/02)…
Les symboles…
Lorsqu’il s’agit des témoins de
Khaled Nezzar, la presse algérienne associe leur nom à d’autres noms ou
symboles positifs ou supposés l’être. comme Boudiaf, HCE… « Le chef du
gouvernement sous Boudiaf » (L’Expression du 03/07/02), « Ahmed
Djebar…reprendra largement [les propos] de Mohamed Boudiaf (…) La stature de
Boudiaf sera également dans les témoignages de Leïla Aslaoui » (Le
Matin. du 06/07/02). « Nezzar l’ex membre du HCE » (Le
Quotidien d’Oran du 02/07/02, El-Moudjahid du 03/07/02, Liberté du 14/07/02….)
Lorsqu’il s’agit des témoins de
Habib Souaïdia, elle associe leur nom à d’autres noms ou symboles négatifs ou
supposés l’être. Ces noms ou organisations associés aux témoins ont pour objet
d’agir comme repoussoir : MAOL, Chouchène, FIDH, Bouteflika, Chadli…
« Hidouci, ancien ministre et conseiller de Chadli » (Le Soir du
04/07/02). « Les témoins de Souaïdia : l’historien Mohamed Harbi,
M. Chouchène, ancien officier déserteur » (Le Matin. du 03/07/02), « Les
témoins à décharge ont été l’historien Mohamed Harbi et M. Chouchane, ancien
officier déserteur » (Le Matin du 7/07/02), « Mohamed Harbi
(historien), Ahmed Chouchène (ex. officier de l’ANP, radié, après sa
condamnation » (El Moudjahid du 03/07/02), « Premiers témoins
(…) Ahmed Chouchane, ancien militaire, membre du MAOL » (El
Watan du 02/07/02), « Patrick Baudoin, patron de la pseudo-ONG- la
FIDH » (El Moudjahid du 01/07/02), « Samraoui (…) actuellement
proche du MAOL » (Le Soir du 04/07/02) « membre du
MAOL » (El Watan du 02/07/02), « les rumeurs insistantes
sur un “rapprochement” Bouteflika-Aït Ahmed » (Liberté du 14/07/02)
Elle procède de même avec les
avocats : « Pour permettre au lecteur de situer cet avocat et son
carré politique, disons seulement qu’il plaide le dossier du défunt Mecili et
qu’il est un proche très lié à Aït Ahmed, il s’agit de Antoine Comte. »
(El Moudjahid du 06/07/02),
Des qualificatifs valorisants
ou non…
Elle accole aux premiers des qualificatifs valorisants ou les crédite de
capacités insoupçonnées
« Exposé franc et
rigoureux de l’ancien chef de gouvernement qui a été brillant de clarté et de
précision » (APS du 02/07/02) , « L’ex membre du HCE [Ali
Haroun] mettra hors d’eux les avocats de la défense très gênés par la culture
de Ali Haroun » (El- Moudjahid. du 03/07/02) , « Mme Saïda
Benhabyles, cette battante » (El Moudjahid du 02/07/02), « Serein,
sûr de lui, » l’homme au nœud de papillon » » (El Moudjahid
du 03/07/02), « Hamid Bouamra, serein, méthodique, [il] ne
néglige aucun détail » (El Moudjahid du 04/07/02). « Les
avocats de la partie civile Me Jean-René Farthouat et Me Gorni ont calmement
démonté tout l’argumentaire de Souaïdia » (APS, 06/07/02), « Ghozali
répond avec un calme exemplaire » (L’expression du 03/07/02)
Aux seconds elle associe des
qualificatifs dévalorisants
« Blême Yous, allègue (…)
Troublés, les avocats de Souaïdia » (El Moudjahid du 04/07/02), « Aït
Ahmed d’une arrogance infinie » (L’Expression du 06/07/02), « Benderra
récite la leçon (…), il est blême. Il tremble tout le temps, les yeux baissés »
(El Moudjahid des 08 et 09/07/02)
Mais aussi :
Alors que les unssont
venus témoigner pour« défendre l’ Armée et l’Algérie », défendre
« les janviéristes » (Le Matin des 01,11 et 17/07/02), ou « défendre
un général, une armée et un pays » (Liberté du 07/07/02) ; les
autres sont venus pour calomnier :« Les calomniateurs »
(El-Moudjahid. du 02/07/02) , « Les détracteurs » (Le
Matin du 02/07/02) ; pour « s’attaquer à l’Algérie ou à
l’institution militaire » (Le Matin du 11/07/02) ; d’ailleurs
parmi ces témoins « certains [ont approuvé le contrat de Rome] qui
engageait entre autres redditions l’application de la charia » (Le
Matin du 01/07/02), comme Aït Ahmed qui est « venu solder ses comptes
avec les généraux » (Liberté du 07/07/02). Ce sont des « calomniateurs
et diffamateurs (…) ivres de haine, bourrés de ressentiments, écrasés par la
vengeance » (El Moudjahid du 06/07/02)
La presse procède à des amalgames
pour confondre les témoins à décharge : « Témoignages contre Yous,
Souaïdia et les GIA » (El Moudjahid du 03/07/02), mais elle associe
les témoins de la partie civile dans un même combat passé : « Ali
Haroun l’ex compagnon du général Nezzar au HCE » [entendre, avec
Boudiaf] (L’Expression du 03/07/02)
Pour les témoins de Habib Souaïdia
elle ignore leur identité, doute de leur curriculum vitæ (aisément vérifiable)
ou égratigne (triture) leur nom : « Interventions (…) d’un
directeur de banque » (Le Matin du 04/07/02), il s’agit de Omar
Benderra, ex-directeur du CPA, « deux hauts responsables
« exilés » en France » (APS, 06/07/02), deviner Ghazi
Hidouci et Omar Benderra, « Mohamed Samraoui membre du MAOL »,
El Watan du 02/07/02, [et Ex officier de l’armée algérienne], « Samraoui
[qui…] se présente comme ayant été l’adjoint du responsable du
contre-espionnage » (El Watan du 04/07/02), « José Garçon
« journaliste » [guillemets] » (El Moudjahid du
08/07/02), Salima Ghezali devient Ghozali (Liberté du 01/07/02) et
(L’Exp. 06/07/02), Benderra est Bouguerra (El Moudjahid du 04/07/02) ,
Maître Comte est Compte (La Tribune du 04/07/02) et Maître Bourdon est
Maître Bourdou (Le Matin du 14/07/02) ou Bodin (L’Expression du
04/07/02)
Cela peut-être mis en partie sur
le compte de l’inattention, mais pas lorsque « l’erreur » est quasi
systématique ; ainsi Yous Nesroulah devient Nasroullah (Le Matin du
29/08/2001 – déjà – et 29/07/02) puis Nasrullah (El Watan du 16/06/02), Nesrallah
(El- Moudjahid. du 01/07/02), Nasrallah (4 fois dans un même article de
Le Matin du 04/07/02, 5 fois dans un même article d’El Moudjahid du 02/07, dans
L’Expression…). Ou alors très « exotiquement », Nasrullah (El
Watan du 16/06/02). L’erreur n’en est plus une.
3-5 LES TEMOIGNAGES
La presse algérienne s’élève
violemment contre les médias français , cette « machine médiatique
française », « si friande de ces joutes suicidaires
algéro-algériennes » qui use de « ruses, astuces, allégations,
désinformations et intox » . La presse algérienne dénonce cette presse
françaisepour sa partialité ; en l’occurrence à propos de ce
procès qui a permis « un débat qui n’a jamais été possible dans les
médias »
(Lire en rubrique : 3.8- Les
médias étrangers)
La presse algérienne
s’enthousiasme d’un débat au sein du tribunal correctionnel de Paris, débat
qu’elle ne reproduit pas. D’une part elle cite très largement les témoignages
de la partie civile, d’autre part elle fait silence sur les témoignages de la
partie adverse ou les réduits
Nous avons relevé l’ensemble des
« dires » de Khaled Nezzar et de ses témoins et avocats ainsi que
ceux de Habib Souaïdia de ses témoins et avocats parus dans la presse
algérienne entre le 01 au 07 juillet.
L’ensemble des témoignages
reproduits par la presse s’élève à 11377 mots (ou 64854 caractères)
Le constat est accablant : La
totalité des interventions de Khaled Nezzar, de ses avocats et de ses témoins
telles que reprises par la presse algérienne du 01 au 07 juillet 2002,
représente : 8961 mots soit 51082 caractères.
La totalité des dires de Habib Souaïdia, de ses avocats et de ses témoins
représente elle 2416 mots soit 13772 caractères.
Exprimé autrement cela donne
ceci : La surface des dires de Khaled Nezzar et ses témoins et avocats
représente 78,76% de l’espace total, quant à celle de Habib Souaïdia, de ses
avocats et témoins elle est donc de 21,24%. La presse algérienne a étouffé la
parole « adverse », celle qui ne confortait pas « les lignes
éditoriales globales »
Il y a lieu de préciser ce qui
suit : La presse a reproduit les paroles de Habib Souaïdia, de ses avocats
et celles de huit de ses témoins contre treize pour la partie civile. Mis
bout à bout ces (fragments de) témoignages de la partie civile tels que repris
par La Nouvelle République représentent 12000 caractères (11000 pour El
Moudjahid). La Nouvelle République à presque totalement ignoré les témoignages
adverses.
Le Soir d’Algérie reproduit moins
de 300 caractères afférents aux déclarations des soutiens de Habib Souaïdia ou
de lui même. La Tribune et El Watan ont réservé environ 40% de l’espace
« témoignages » à Habib Souaïdia et ses témoins. Liberté et Le
Quotidien d’Oran ont été plus équitables.
Si ces derniers journaux ont
réservé plus d’espace que les autres aux paroles de la « partie
adverse », il n’en demeure pas moins que cet espace, ces quantités de
paroles de témoignages, ne pèsent guère au devant des commentaires directs des
journaux. Ces commentaires qui accompagnent les témoignages ne souffrent
d’aucune équivoque quel que soit le journal. La condamnation de Habib Souaïdia
est unanime.
Nous traitons ci-après de deux cas
particulièrement « parlant » de types de témoignages escamotés par la
presse algérienne : Le témoignage de Mosbah, et ceux de la journée du 03
juillet.
3-5-1 LE CAS MEHDI
MOSBAH : Sur ces 40 jours de torture, 10 ont quitté ma mémoire, Nezzar me
les doit. C’est dur de naître algérien
Le cas de Mosbah (Abderrahmane/Mehdi) est assez
révélateur. Hormis Liberté (du 06/07/02) le nom de Mosbah ne figure quasiment
nulle part dans la presse algérienne. Il est seulement cité comme un des
témoins par L’Expression du 02/07/02 et El-Moudjahid du même jour qui ajoute
après le nom de Mosbah un point significatif d’interrogation. Son nom apparaît
aussi incidemment dans Le Matin du 14/07/02 qui fait parler L.
Benmansour : « Je n’aurais pas écrit ces lignes (…) si lors des
témoignages sur la torture par un jeune homme qui m’a brisé le cœur, il n’avait
pas prononcé cette phrase (…) Je l’ai croisé à la cafétéria du tribunal et je
lui ai dit : » Mon fils, vous m’avez brisé le cœur » » . Ce
journal parle de Mosbah mais les mots de Mosbah sont absents. Nous reproduisons
ce qu’a écrit Liberté et complétons par ce que la presse étrangère (française)
a rapporté.
« Mehdi Mosbah est dans le “camp” de Habib
Souaïdia. Ancien étudiant à l’Institut des études islamiques à Alger, il livre
un témoignage bouleversant. Arrêté pendant 40 jours dans les locaux de la
gendarmerie, il subit la torture. “J’étouffais. Je me débattais comme un
chien. Je cherchais la mort (…) J’ai été sodomisé. J’ai crié Maman putain parce
que quand une maman vous met au monde pour… ça.” Le jeune homme doit son
salut aux connaissances de son père, haut magistrat. “Si mon père ne m’avait
pas mis un visa pour la France dans la poche, j’aurais pris les armes aussi”, dit-il.
Lorsque l’avocat de Khaled Nezzar lui demande pourquoi il témoigne pour Habib
Souaïdia, Mehdi Mosbah a sa réponse : “Il aurait pu être mon tortionnaire
mais lui a eu le courage de dénoncer (…). La seule chose qui me choque c’est
que ce soit Souaïdia dans le box et pas le général Nezzar. Il est venu blanchir
ses compères et chercher sa feuille de route pour les dix prochaines années.” Khaled
Nezzar écoute et ne bronche pas. »
Le commentaire du journal sur ce point est
quelconque mais voici ce que ce journal ne rapporte pas :
« Abderahmane Mosbah (…)
torturé par onze hommes (…) il était quotidiennement forcé à garder au fond de
la gorge un chiffon constamment imbibé d’eau. « On vous le met dans la
bouche et on verse de l’eau. (…). C’est comme si on coulait. L’eau vous rentre
de partout dans les narines, dans la gorge, dans les poumons, jusqu’à
l’évanouissement. (…). Sur ces quarante jours, dix ont quitté la mémoire. Nezzar
me les doit » (…), puis [il raconte] son séjour dans les camps de
détention du sud saharien, la chaleur, le froid, la faim, les maladies, les
insultes, les coups, les humiliations. « Ces gens là sont nuisibles à
l’environnement humain de la planète », a-t-il déclaré en désignant le
général Nezzar. » (Bulletin de la FIDH : juillet 2002)
« Abdelramane Mosbah. jure n’avoir
« jamais été dans un groupe terroriste », a pourtant été arrêté et
torturé par l’armée en 1992, sans procès, dans un bâtiment « face à
l’état-major des forces armées » (…). J’e n’aurais jamais cru que j’allais
vivre, avoir un jour une femme, des enfants », a crié le jeune homme,
incapable de ralentir le flot de paroles qui le submerge. Fils d’un haut
responsable de la magistrature algérienne, Abdelramane Mosbah dit avoir eu « de
la chance » : il a été finalement libéré. (…) Torturé à maintes
reprises par les militaires. « J’ai passé quarante jours au cachot dans
le noir absolu. (…) Je veux savoir (…) C’est dur de naître algérien ». »
(Le Monde des 04 et 05/0/02)
« Mosbah est, « d’une famille où on
s’en sortait », un père haut magistrat, des proches dans l’armée. Bref,
ce que l’Algérie appelle « les réseaux ». raflé devant
l’université. « Je pensais m’en tirer. J’ai glissé le nom de mon père,
de hauts gradés. Normalement, ça suffit. Là, ils m’ont dit : on a des
ordres. Et je me suis retrouvé dans le trou, avec le bas peuple. » Les
camps de déportation, les cachots (…) « J’avais les épaules larges comme on
dit. Du piston. » Dehors, il voit ce qu’il ne voyait pas avant.
« La corruption brutale, étalée, onze jeunes raflés et fusillés en bas de
chez moi parce qu’un officier avait été tué, mes copains d’enfance qui
devenaient fous. Aucun avenir quand on n’a pas une famille derrière. Certains
devenaient islamistes, rien que pour faire peur à ce pouvoir installé depuis
trente ans. Ma génération, c’est celle de la révolte. » Un jour, il
croise le petit Saïd. Il lui dit : « Ils m’ont torturé. J’ai donné
des noms, n’importe lesquels. Mais je te jure, pas le tien. Je monte au maquis.
Ils m’ont pris une fois pour rien. Là, au moins, je mourrais pour quelque
chose. » (Libération du 05/07/02)
« Son seul tort: compter des islamistes
parmi ses relations. La trentaine élancée, réfugié politique en France depuis
l’été 1995, Abderahmane Mesbah a raconté dans un français parfait les
conditions de détention dans les camps du sud algériens: la chaleur, le froid ,
la faim, la maladie, les insultes, les coups et les humiliations.
Détenu pendant 40 jours à la brigade de gendarmerie de Aïn Naâdja, près
d’Alger, il a expliqué devant une assistance pétrifiée le «supplice du
chiffon» » (Algéria Interface du 05/07/02)
La presse fait silence sur des
témoignages comme celui de Mosbah, mais cela n’est pas nouveau. Durant
plusieurs années elle s’est tu sur les milliers de « disparus »
(Khaled Nezzar déclara au procès : « 15000 disparus,
passons… », Libération du 04/07/02). La presse a fini par céder car la
question a pris d’énormes proportions grâce à la ténacité des mères des
« disparus », ces mères courage nos «locas de la Plaza de mayo»,
grâce au soutien d’associations, notamment de la LADDH de Maître Ali Yahia
Abdennour, des ONG internationales (FIDH, AI…) ainsi qu’au travail
d’information de la presse internationale. Un autre exemple : les
activités de la fédération d’Oran du FFS, parti pacifique d’opposition radicale
au régime, ont été de nombreuses années durant (1990 et plus) frappées
d’ostracisme. Ce « parti des Kabyles » devait être contenu en
Kabylie.
3-5-2 – LES TEMOIGNAGES DU
MERCREDI DU 03 JUILLET
Ce 04 juillet la presse a réservé
de grands espaces à l’ANP. Ce qu’elle aurait pu faire le mercredi 03 (la
conférence de presse de Lamari ayant eu lieu le mardi 02, et El Watan commet
une « erreur » lorsqu’il écrit dans son édition du 04 juillet que la
conférence eu lieu « hier »). La surface réservée à l’ANP est donc
telle en ce 04 juillet que les déclarations de Samraoui, Benderra et Chevillard
ne sont pas retenues. Mais le manque d’espace n’est pas la réelle raison du
silence. Il y a lieu de préciser que les interventions des témoins ci-dessous
ont souvent trait à des sujets extrêmement sensibles que l’histoire récente de
l’Algérie nous montre qu’ils ne sont pas abordés sinon sous très haute
surveillance ou bien dans le cadre d’affaires subalternes ou de seconds
couteaux.
Voici tout ce que rapporte la
presse algérienne des témoignages de la défense de la journée du 03 juillet
2002 : Comme nous l’avons fait pour le témoignage de Mehdi Mosbah, nous
ajoutons ici les témoignages tels que parus dans la presse étrangère
(essentiellement française).
MOHAMED SAMRAOUI: Empêcher le FIS de parvenir
au pouvoir par tous les moyens.
Tout ce qu’ écrit la presse algérienne:
« Mohamed Samraoui, (…) se
présente comme ayant été l’adjoint du responsable du contre-espionnage au
service de recherche. «Notre objectif était d’empêcher le FIS de prendre le
pouvoir par tous les moyens, d’infiltrer les groupes extrémistes. (…) Il
fallait faire imploser le FIS de l’intérieur.» «On avait attiré l’attention du
commandement pour reporter les élections. On savait que le FIS allait vaincre.»
«Ils (les responsables) pensaient arriver à diviser le FIS qui sortirait
affaibli des élections. 17 éléments salafistes du FIS étaient proches du
pouvoir.» Il affirme que les GIA sont une création des services. «J’ai
vu Chabouti circuler à bord d’un véhicule appartenant à nos services.» (…)
«Ils nous demandaient d’un côté de lutter contre les intégristes et de l’autre
côté ils les relâchaient. (…) J’ai personnellement entamé un travail
d’approche avec le FIS pour atténuer la violence.» [Sur l’époque du
« double jeu »] Samraoui : «C’est vrai que c’était du temps de
Hamrouche.» » (El Watan, jeudi 4 juillet 2002)
« [Samraoui déclare] avoir «refusé de
servir de bouc émissaire» (…) «le GIA est une création des services de
sécurité» ; (…) assure «n’avoir pas compris pourquoi il y avait, d’un
côté, la lutte contre les intégristes et, de l’autre, un dialogue avec les
mêmes intégristes». (…) «les services secrets algériens étaient les
premiers à avoir pris conscience du danger islamiste» ». (La
Tribune, jeudi 4 juillet 2002)
« Samraoui [dit à propos des infiltrations]
du FIS. « Nous avons réussi à avoir « nos représentants » à la
direction du FIS » », (Le Soir d’Algérie, jeudi 4 juillet 2002)
« Mohamed Samraoui (…) raconte « les
infiltrations » , [il] explique que l’objectif des infiltrations
étaient [Sic – La même phrase et la même faute que Le Matin du même jour]
« de corser [casser ?] le FIS en lui attribuant des
actions ». Il affirme que « les militaires ont commencé à
l’époque à arrêter à tort et à travers des gens qui n’avaient rien à voir avec
le FIS, rien à voir avec les islamistes rien à voir avec les actions
violentes ». (…) Certaines personnes arrêtées par les forces de
l’ordre « subissaient des tortures » ». (Liberté,
jeudi 4 juillet 2002)
« Mohamed Samraoui s’appliquera à accabler
l’armée (…) Selon lui, « c’est en France, que les militaires algériens
ont des possibilités d’organiser des assassinats » « Dans
quelles circonstances, avez-vous été interpellé par votre
conscience ? », l’interpellera le président . « C’est à la
suite de ma fin de fonctions en Allemagne. On m’a téléphoné d’Alger pour me
signifier que j’avais quatre jours pour rentrer… » ».( El
Moudjahid, jeudi 4 juillet 2002)
« Dans un entretien accordé au site
algérien Algeria-Interface, l’ancien colonel du DRS, Mohamed Semraoui,
révèle avoir refusé d’exécuter deux missions qui auraient été commanditées par
sa hiérarchie. « En 1990, j’ai refusé de participer à un coup monté
contre l’ancien président Ahmed Ben Bella.” Cette affaire, dit-il, visait à
déstabiliser le gouvernement Hamrouche… “En 1996, je me suis opposé à
l’assassinat de dirigeants du FIS en Allemagne : Rabah Kébir et Abdelkader
Sahraoui.” Ce dernier a été assassiné à Paris » [Sic]
(Liberté du 07 juillet 2002)
« Mohamed Samraoui, (…) a témoigné des «
infiltrations » (…) Il a expliqué que le but de celles-ci [les
infiltrations] étaient [Sic – La même phrase et la même faute que Liberté du
même jour] de « casser le Front islamique armé (FIS) en leur[lui] attribuant
des actions ». Il a également raconté que les militaires ont commencé à
l’époque à « arrêter à tort et à travers des gens qui n’avaient rien à voir
avec le FIS, rien à voir avec les islamistes, rien à voir avec les actions
violentes ». (…) « L’ordre des exécutions venait du général
Lamari. L’ouvrage de Habib Souaïdia dit la vérité. » »(Le Matin, jeudi
4 juillet 2002)
Lorsque Khaled Nezzar reconnaît que « les
services » ont infiltré les islamistes, Le Matin (04/07/02) écrit :
« Face à ce témoignage, le général Khaled Nezzar, ancien ministre de la
Défense, qui est à l’origine de ce procès a répondu : “Les infiltrations, c’est
un travail de tous les services !“ » ; mais lorsqu’en 1995
Jacques Vergès évoque ces infiltrations (en des termes durs) voici ce
qu’écrivit alors Le Matin (du 19/09/1995, cité par El Hadi Chalabi, La presse
algérienne au-dessus de tout soupçon. Edition : Ina-Yas, 1999) :
« Incriminer les “services algériens“ d’avoir des hommes à eux parmi
les terroristes ne représente qu’un argument de force utilisé par cet avocat
pour discréditer l’Etat algérien (…) n’oublions pas l’origine asiatique de cet
avocat ! »
Extraits de ce qu’ écrit la presse
étrangère:
« La charge est venue d’un capitaine (…).
Mohammed Samraoui. [La mission qui lui était assignée :] « Barrer
la route du pouvoir au FIS [Front islamique du salut] par tous les
moyens. » (…) Les Algériens formés en Afghanistan, on les pistait,(…).
On connaissait tous les noms. On a arrêté des gens à tort et à travers, mais
pas eux, car on en avait besoin pour créer des organisations terroristes. Le
GIA, c’est la création des services de sécurité. On voulait radicaliser le
mouvement islamiste. Mais, par la suite, on n’a plus maîtrisé ces groupes.
C’était la pagaille » « Je lui [le patron des services de sécurité]
ai dit qu’on n’était pas en France, qu’on ne pourrait pas agir en toute
impunité. Nous avons lutté contre le terrorisme en utilisant ses
méthodes », (…) [Un récit fait sur un ton sobre pour] « défendre
l’honneur de l’armée » » (Le Monde, édition du 05 juillet 2002)
« Mohamed Samraoui : Pendant la
campagne des législatives à l’automne 1991,(…) . «Nous avons commencé à nous
occuper exclusivement de la lutte contre l’intégrisme»,(…) . «Notre
mission était de le faire imploser par tous les moyens, chantage, Corruption,
menaces»,(…) «Les actions violentes n’avaient pas commencé.
Nous avions établi la liste des personnes les plus dangereuses et demandé leur
arrestation. En vain : on avait besoin d’eux pour créer des groupes
terroristes. A la place, on a arrêté à tort et à travers. On cherchait à
radicaliser le mouvement.» (…) «On commençait par infiltrer les
noyaux des mouvements armés. Puis cela a pris une telle proportion qu’on ne
savait plus qui était qui. Plus personne ne parvenait à contrôler tous ces
groupes. Nous avons lutté contre le terrorisme avec des méthodes de
terroristes. Ce n’était pas une tolérance, mais une méthode de travail. Sinon
on n’aurait jamais atteint les 200 000 morts.» Quand Lamari lui demande de
préparer l’exécution de deux chefs du FIS en Allemagne. «Nous sommes en
Allemagne et pas en France, où vous avez des amitiés… En plus, je ne voulais
pas servir de bouc émissaire en cas de pépin.» » (Libération samedi 06
juillet 2002)
« L’officier Samraoui : Dès 1991, «
nous avions fait la liste de 1100 islamistes dangereux. Aucun d’entre eux n’a
été arrêté, mais des milliers de gens l’ont été à tort et à travers. Torturés,
exécutés. «Notre mission était de casser le FIS, l’infiltrer, le disloquer, attribuer
des actions violentes aux islamistes. On cherchait à radicaliser le mouvement.»
Puis il y eut «des infiltrations, la création de faux groupes». (…) Le GIA
est une création des services de sécurité algériens (…) violence et
manipulation» [étaient une tactique du pouvoir]. «Tous les officiers qui
se sont opposés au général Lamari ont été abattus par les GIA, tous ceux qui en
étaient proches n’ont pas eu une égratignure. Ceux qui revenaient
d’Afghanistan, on les connaissait. Ils prenaient tous le même vol par Tunis, 50
% moins cher. Dès qu’ils atterrissaient à Alger, ils étaient pris en main. Ce
n’était pas une tolérance, mais une méthode de travail (…) Mais les assassinats
quand même, mon général…» [En réponse au général qui a dit :
« Les infiltrations et les coups de Jarnac, c’est partout.»] » (Libération, 04 juillet 2002)
« Mohamed Samraoui, (…) « Notre
mission, martèle ce dernier, était de casser le FIS, l’infiltrer, le disloquer.
D’ailleurs le GIA (Groupe islamiste armé. NDLR) est une création des services
de sécurité algériens ». [Et lorsque le général dit « le GIA,
émanation des services, alors ça non »] Semraoui s’exclame : «
Mais les assassinats quand même, mon général ! » » (Le Figaro, 06
juillet 2002 )
« « Le GIA (Groupe islamique armé)
c’est la création des services de sécurité », est ainsi venu dire,
(…) Mohamed Samraoui (…) l’armée avait « infiltré »
les groupes islamistes pour les manipuler. Ce travail, qui revenait notamment,
à « créer la division », « amadouer » ou « corrompre »
les islamistes était destiné à « casser le FIS (Front islamique de
salut) en leur attribuant des actions ». Selon lui, parallèlement,
l’armée a « arrêté à tort et à travers des gens qui n’avaient rien à
voir avec le FIS, rien à voir avec les islamistes, rien à voir avec les actions
violentes », dans le but de terroriser les populations civiles ».
(AFP,06 juillet 2002)
« Mohamed Samraoui raconte (…) L’objectif,
dès 1990, est d’ « empêcher que le FIS prenne le pouvoir, par tous les
moyens ». « Nous avons infiltré les mouvements déjà existants
et créé des groupuscules », jure-t-il. « Il fallait casser le
FIS en lui attribuant des actions impliquant des islamistes » [Samraoui]
fait état d’ « opérations illégales, enlèvements, arrestations,
déportations, tortures, exécutions sommaires ». « Des Afghans (…),
les plus dangereux, n’étaient pas arrêtés, bien que parfaitement repérés. On
avait besoin d’eux » Samraoui a quitté l’armée le jour où, alors qu’il
était posté en Allemagne, « le général Smaïn Lamari lui a demandé d’assassiner
deux opposants, dont Rabah Kebir » ». (Le Parisien, 04 juillet
2002)
« Mohamed Samraoui (…) « On
avait crée des groupes, on avait infiltré. On se retrouvait avec des vrais
groupes et des faux groupes. A un moment, l’armée ne maîtrisait plus la situation.
Elle ne savait plus qui était avec qui ». M Samraoui, (…) a ajouté que
les militaires avaient arrêté « à tort et à travers des gens qui
n’avaient rien à voir avec le FIS, rien à voir avec les islamistes, rien à voir
avec les violences » ». (AP, 03 juillet 2002)
« L’ex-colonel Mohamed Samraoui, (…)
raconte qu’à partir de novembre 1990 l’armée a commencé à « infiltrer »
le FIS Ce travail (…) revenait notamment à « créer la
division », « amadouer » ou « corrompre »
les islamistes, poursuit le militaire. Le but: « casser le FIS en leur
[lui]
attribuant des actions ». (…) « On avait créé des
groupes, on avait infiltré et on se retrouvait avec des vrais et des faux
groupes. A un moment l’armée ne maîtrisait plus la situation. Elle ne savait
plus qui était avec qui, qui était ami, qui était ennemi »,
raconte-t-il. (…) L’armée a « arrêté à tort et à travers des gens qui
n’avaient rien à voir avec le FIS, rien à voir avec les islamistes, rien à voir
avec les actions violentes », (…) . « C’est à ce moment que j’ai
commencé à penser que l’on cherchait à radicaliser l’islamisme ».
Samraoui raconte qu’en 1994 le général Smaïn Lamari est venu le voir pour lui
demander « de coordonner l’assassinat de deux opposants » ».
(AFP, 03 juillet 2002 )
« Mohamed Samraoui enfonce le
clou. (…) «Notre mission était d’empêcher le FIS de parvenir au
pouvoir, par tous les moyens.» (…) [Il reproche au commandement de
l’armée de] «combattre le terrorisme avec les méthodes du terrorisme.»
La torture, les exécutions extrajudiciaires, les enlèvements sont «une
méthode de travail ordonnée par Smain Lamari», a-t-il affirmé ». (Algeria-Interface,
05 juillet 2002)
OMAR BENDERRA: Le secteur d’importation
s’alloue de façon médiévale à des familles du pouvoir.
Tout ce qu’ écrit la presse algérienne:
Quasiment aucun article n’évoque l’intervention
de Omar Benderra.
« L’un des avocats de la défense (…) tend la
perche [à Omar Benderra] : « Comment avez-vous vécu la corruption
en Algérie ? » Benderra répond : « Parmi les
200 généraux, il y en a cinq qui ont le monopole du blanchiment d’argent »
« Y en a-t-il un parmi ces cinq généraux, ici présent dans la
salle », insiste le même défenseur. Benderra répond : « Oui » »(El Moudjahid, 09 juillet 2002)
Extrait de ce qu’ écrit la presse étrangère:
« Ce «bunker au pouvoir absolu» se
déchire (…) «Des rapports de force permanents, incestueux, où se mêlent
rivalité et complicité», explique l’économiste Omar Benderra. (Libération
samedi 06 juillet 2002)
Omar Benderra, (…). «Clé de voûte, le pétrole
permet de faire l’impasse sur la production. Ne reste plus que le secteur des
importations, qui s’alloue de façon médiévale à des familles du pouvoir, sans
aucun bilan : à l’un les céréales, à l’autre le sucre. 30 à 40 généraux sont
autorisés à faire des affaires. 4 ou 5 sont les grands détenteurs financiers.»
Un avocat de la défense : «Y rangez-vous Nezzar ?» Omar Benderra : «Incontestablement.»,
Nezzar [hurle] tous les grands projets auxquels il s’est opposé. «Et qui
ne sont donc pas réalisés.» Comme s’il fallait une preuve du contrôle de
l’économie par les généraux ». [Nous soulignons] (Libération jeudi, 04
juillet 2002)
« Omar Bendera, (…) accuse : « Cinq
ou six généraux détiennent la réalité du pouvoir » économique et
politique. Nezzar est-il l’un d’eux ? « Indubitablement ! » »
(Le Parisien – jeudi 04 juillet 2002)
« Pour Omar Benderra, «l’interruption du
second tour des élections en 1992 a provoqué l’arrêt du processus économique
d’ouverture vers l’extérieur, avec des réformes qui refusaient alors les injonctions
du FMI.» Ce programme abandonné, il n’en restera que «la gestion de la
dette, puis plus rien.» Cela entraîne la faillite du pays, soit «l’arrêt
de la machine économique, l’assèchement des réserves de changes et
l’appauvrissement des couches populaires les plus fragiles.» (…) Parce que «le
système de pouvoir est un système de privilèges, et ses responsables allouent
de façon régalienne une partie de la rente économique à leur clientèle. (…)
De nouveaux groupes [entreprises] apparaissent spontanément, sans que l’on
puisse connaître l’origine de leurs fonds, comme cela, à partir de rien.»
(…) « Incontestablement les puissances d’argent ne doivent leur
situation qu’à la proximité avec César, le pouvoir militaire, plus exactement
une partie du corps dirigeant de l’armée. Les clans militaires ont la mainmise
sur les réseaux d’affaires et l’on peut déduire cela de l’observation du
milieu, car il est difficile d’apporter des preuves matérielles. Cependant, si
l’on se reporte aux profils des cadres nommés à des postes sensibles, on peut
voir la chaîne de commandement.(…) La situation économique est évaluée
par le FMI, la Banque mondiale et, au niveau interne, encore pour quelques
temps, par le Conseil économique et social, que l’on veut affaiblir, car il dérange.
Ce sont ceux qui ont confisqué les richesses qui disent vouloir rétablir la
démocratie, il s’agit là d’un double langage (…) Ils se croient dépositaires
exclusifs de la légitimité. Ils cherchent à pérenniser leur situation, et la
gestion de la question kabyle le montre, mais elle est moins vendable que celle
des islamistes. Ils ne savent gérer que de manière sécuritaire, néo-coloniale,
violente. Le pétrole est la clé de voûte du système, il permet de faire
l’impasse sur la production économique.» » (Algeria-Interface, 05
juillet 2002)
GHAZI HIDOUCI: On m’a présenté comme un
agent de l’étranger
Tout ce qu’ écrit la presse algérienne:
« Ghazi
Hidouci (…) Interrogé, il répond ainsi : « Nous n’avons jamais été
soumis à des instructions ou à des pressions quelconques de l’armée »
« Que pensez-vous de Souaïdia ? » [lui demande l’avocat de
celui-ci], « Il a l’âge de mon gosse. Il aurait dû aller à la plage au
lieu d’écrire un pareil livre » (El Moudjahid, le 9 juillet 2002)
Extrait de ce qu’ écrit la presse étrangère:
« Ghazi Hidouci (…) affirme être arrivé au
gouvernement pour «appliquer des lois mises au point auparavant.» (…) «On
m’a présenté alors comme un agent de l’étranger et l’on a même dit que ma mère
était juive. (…) On sentait que notre contrat se réduisait chaque jour.
Nous avons discuté jusqu’en février 1991 pour aboutir à un désaccord. En juin,
nous constatons l’échec, je pars alors en France. (…) Au sein de la
classe politique, il y avait peu de partisans des réformes, des réformes
finalement réduites à une ouverture «façon mesquine, comme en Orient, avec des
possibilités de faire des affaires de façon ancienne, non capitaliste.»
(…) [Hidouci] s’adresse à Habib Souaïdia: «Je suis peiné de voir un officier
de l’armée algérienne mêlé à des histoires dégoûtantes et atroces. Il a l’âge
de mon fils et j’aurais voulu qu’il ne connaisse pas cela.» (Algéria
Interface, 05/07/02)
NICOLE CHEVILLARD: Les véritables dirigeants
sont les militaires
Tout ce qu’ écrit la presse algérienne:
Comme pour Omar Benderra, la presse algérienne ne
rapporte rien sur l’intervention de Nicole Chevillard.
« Aujourd’hui, c’était le tour de (…) Nicole
CHEVILLARD, rédactrice en chef du magazine économique Nord-Sud Export du groupe
Le Monde. Du côté de la partie civile… ». (Le Soir du 04/07/02)
Extrait de ce qu’ écrit la presse
étrangère:
« Le constat [de Nicole Chevillard] sur
l’Algérie, est implacable : « Les dirigeants étaient au sein de la
hiérarchie militaire. Les cercles du pouvoir entretiennent des rapports de
force, et sous des changements de façade, les choses restent dans la
continuité. » Ainsi, quand le président Chadli a été « démissionné »
, les « trois généraux majors étaient d’accord » » (Le
Parisien du 04/07/02)
« Nicole Chevillard, analyse les
risques-pays (…) Concernant l’Algérie, son travail, (…) a permis d’analyser la
nature du pouvoir algérien. (…) Les «véritables dirigeants sont les
militaires, ce n’est pas là une originalité de notre analyse. C’est une
constante historique de l’Algérie», affirme-t-elle. (…) «Plusieurs
tentatives de combler le vide du pouvoir ont été essayées. On retrouve toujours
en position dominante Nezzar, Belkheir… » (Algeria-Interface, 05
juillet 2002)
JOSE GARCON : Le statu quo n’est pas
tenable
Tout ce qu’ écrit la presse algérienne:
« Mme José Garçon, (…) tonne : « Le
statu quo n’est pas tenable. » (…) « Les revendications du GIA me font
sourire. 70 % des massacres du GIA sont partis des services secrets algériens ».
(Le Matin du 4 juillet 2002)
« José Garçon (…) raconte qu’elle a eu une « découverte
brutale du pouvoir algérien » (…) [sa nature] est avant tout « violente
et sauvage ». (…) Elle a même suggéré [de] « laisser le FIS
gouverner et intervenir après s’il le faut ». (…) [sur la
revendication du GIA] José Garçon dira : « Cela me fait
sourire. » » (Le Soir d’Algerie, 4 juillet 2002)
3.6- LE PROCES
Dès l’ouverture du procès des
journaux indiquent qu’il « sera pendant cinq jours une tribune pour un
débat contradictoire sur l’Algérie de ces dix dernières années ». (El
Watan du 02/07/02) ; un « procès d’ores et déjà
politique » (Le Matin du 01/07/02) , « un procès
extraordinaire » (Liberté du 02/07/02) , où « l’Algérie défend
l’honneur de son armée » D’ailleurs « une victoire de Nezzar,
de l’Armée algérienne donc [Donc !] (…) constituerait une charge
symbolique inouïe » (Le Quotidien d’Oran du 04/07/02)
Le 02 juillet Le Soir d’Algérie
trouve que ce procès est celui du « « qui-tue-qui » (…), une
affaire hautement politique (…) un autre combat contre le terrorisme »
mais il trouve aussi – le même jour – qu’il est « une grande
supercherie ». Le Matin du même jour approuve : « un
pamphlet contre la souveraineté de l’Etat ».
D’autres quotidiens regrettent que
le procès se déroule en France. « Un procès algéro-algérien tenu dans
la capitale française » (Liberté du 01/07/02), « L’Algérie se
met en procès chez l’ancien colonisateur » (Le Quotidien d’Oran du
04/07/02). Sur cette question la presse est restée timorée lorsqu’on se
rappelle la quantité d’articles, les volées de bois verts, les « fleuves »
d’encre noire qui ont suivi les demandes de l’opposition pour que des
observateurs de l’ONU enquêtent sur la situation dramatique du pays et d’en
fixer les responsabilités ce qui est moins grave que de « se mettre en
procès chez l’ancien colonisateur ». Ce silence est aujourd’hui lourd
de signification.
Après le procès, Horizons écrit
(08/07/02) : « Le procès (…) cette « scène d’exorcisme »
(…) se meut inexorablement en procès d’une vision aliénante et légitimante du
terrorisme. Au banc des accusés : l’alliance contre nature de feu
Sant’Egidio. », tandis que pour le Quotidien d’Oran (18/07/02) le
procès « a été irréversiblement dévié »
« Le procès (…) a laissé
au sein d’une large partie de l’opinion un goût amer » (El Watan du
08/07/02) , mais, relativise Le Matin (02/07/02) « les questions posées
par le juge à Nezzar ne sont pas dénuées d’impartialité » et « L’opinion
publique retiendra la partialité du juge ». (07/07/02) ; pour
ajouter qu’en définitive le procès « fut un coup réussi pour l’armée :
l’abcès est crevé . Les militaires algériens se sont expliqués »
(Le Matin du 11/07/02). Selon ce journal la demande de Lamari est exhaussée
puisque c’est ce qu’il demandait : « Avec Nezzar, c’est un procès
qui va aller au delà de la diffamation. Qu’on crève l’abcès
définitivement » (El-Moudjahid du 03/07/02).C’est bien se
qu’avait compris Libération (du 01/07/02) : « Parce qu’il est le
plus impulsif d’entre eux, ou poussé par certains de ses pairs, Khaled Nezzar a
visiblement décidé de crever l’abcès. Et d’utiliser ce procès en diffamation
pour absoudre une fois pour toutes le haut commandement militaire de toutes les
accusations portées contre lui »
3.7- LES ENNEMIS
Durant les années de plomb (à
l’exemple du bloc communiste dont elle louait le modèle) à la moindre montée de
fièvre la presse algérienne montrait d’un seul doigt « les ennemis
intérieurs et extérieurs de la Révolution ». Aujourd’hui (par la grâce
d’une circulaire – N° 04/90 du 19 mars 1990 – de monsieur Mouloud Hamrouche
premier ministre de Chadli Bendjedid) aux côtés de journaux publics il y a de
nombreuses publications privées.
La presse est plus nombreuse et
officiellement « libérée » de tout lien avec le régime. Pour le moins
en ce qui concerne la presse privée. Les procédés qu’utilise cette presse
tendent « paradoxalement » à montrer que ce n’est pas le cas. Bon
nombre de journalistes de l’école des années ’70 se retrouvent membres de
journaux privés (responsables ou actionnaires ou/et rédacteurs).
Au vocable
« impérialisme » se substituent d’autres mais l’ennemi est toujours
extérieur avec la connivence « d’algériens factieux, ennemis internes,
traîtres » ou vice-versa.
Ainsi la presse algérienne
publique ou privée fait reposer la responsabilité des multiples manifestations
contre le régime et jusqu’à ce procès « intenté par Nezzar »
sur « les ennemis de l’Algérie » (intérieurs et extérieurs)
sur ces « moutons qui suivront (…) l’éditeur de La Sale Guerre
[aux]
méthodes sournoises » (La Nouvelle République du 29/06/02),
et sur « Ali Yahia Abdennour et toute la smala du Kituki » (Le
Soir du 14/07/02).
Pour ces journaux cette « machination
(Nouvelle République du 01/07/02) est le fait d’ une agrégation de
« collusions » allant des « criminels politiques »,
du «binôme FFS- FIS » à « l’Internationale socialo-islamiste »,
au « trotskiste Gèze », et aux « héritiers staliniens
de Mittérand » ainsi qu’ à « l’alliance de Sant ‘Egidio ».
[Les adversaires de Khaled Nezzar, ces] « calomniateurs de tous bords,
ont affûté leurs armes pour faire [du procès] une tribune de subversion
idéologique au service des intégristes » (El Moudjahid du 01/07/02). « Les
criminels d’alliés politiques [des égorgeurs du FIS] nationaux ou
étrangers [ont] le champ libre (…) la complicité de l’Internationale
Socialiste aidant » (Le Soir d’Algérie du 02/07/02) ,
On retrouve derrière ce procès qui
a vu se « confronter le FFS et Nezzar » (L’Expression du
06/07/02) (…) « les partisans acharnés de « la pensée unique »
médiatico-politique se rencontrant dans les laboratoires de l’Internationale
Socialiste. [Mais] la vision stalinienne des héritiers Mittérandiens a
failli en terre française (Horizons du 08/07/02). Finalement « en
toile de fond de ce procès (…) se dessine une réponse à la machination
échafaudée par l’intrigant F. Gèze, aussi dévoué que le plus servile des
bouffons » (…) avec l’aide de cercles socialo-islamistes. » (La
Nouvelle Republique du 01/07/02) . « Le procès (…) se meut
inexorablement en procès d’une vision aliénante et légitimante du terrorisme.
Au banc des accusés : l’alliance contre nature de feu Sant’ Egidio »
(Horizons du 08/07/02).
Des déclarations qui confortent et
complètent celles des « épigones » du régime selon le mot de Addi
Lahouari. ; tous « unanimes. A la manière de soldats disciplinés
ils étaient venus à la barre défendre pied à pied l’honneur de l’armée »
(Le Monde du 05/07/02). : « Devant une assistance scotchée à ses
propos, Ghozali affirme que sa “conviction profonde est de rétablir la vérité
contre des assertions qui entrent dans le cadre d’une stratégie de l’intégrisme
qui, pour accéder au pouvoir, table sur l’effondrement de l’État, en utilisant
la déstabilisation de l’Armée, seul rempart possible à ce projet »
(Liberté du 03/07/02). «Interrogé sur le livre de Souaïdia, M. Ghozali
a tout d’abord déclaré qu’il n’était pas venu témoigner contre Souaïdia, qui
est, selon lui, « l’instrument d’une opération médiatique et d’un
matraquage qui ne date pas de ce jour » ». (Le Matin du 03/07/02).
Ce type de déclaration et d’autres
du même acabit , de milieux proches de certains cercles du pouvoir sont relayés
par la presse algérienne comme nous le montrons ci-dessous à propos de ce
procès. Presse algérienne qui ne s’est jamais posé la question de la censure du
livre de Habib Souaïdia. « La Sale Guerre que « l’écrasante
majorité des algériens ne lira sans doute jamais [car elle] n’a aucun accès au
champ d’expression, monopolisé (…) par la minorité qui prétend détenir
l’exclusivité de l’honneur national » lit-on dans une pétition
[in : www.algeria-watch.org]
3.8- LES MEDIAS ETRANGERS
Ce point est
« naturellement » à relier (au vu des contenus d’articles analysés de
la presse) au point précédent. Il est à préciser que ce qu ‘écrit la
presse algérienne sur les témoignages des journalistes étrangers durant le
procès est porté à la seule rubrique 3.5 : Les témoignages.
La presse algérienne accuse les
médias français de partialité, lorsque ces médias justement et au contraire
donnent la parole à des hommes et des femmes censurés par les médias algériens.
Ce procès a permis « un
débat qui n’a jamais été possible dans les médias[entendre : « en
France »] » (El Watan du 02/07/02), « ces médias qui
doivent déjà se lécher les babines » (L’Expression du 03/07/02) Mais «
la machine médiatique française » (L’Expression du 01/07/02) ou parisienne
« si friande de ces joutes suicidaires algéro-algériennes »
(Liberté du 14/07/02) a lancé « une campagne » (La Tribune du
02/07/02) où « ruses, astuces, allégations, désinformations et intox
sont employés » (El Moudjahid du 04/07/02). Cette campagne « assimile
la plainte de Nezzar à celle de l’armée algérienne » (L’Expression du
03/07/02). Or, rappelons les déclarations de monsieur Ghozali après le
procès : « Dans une entretien accordé à l’hebdomadaire « El
Khabar Hebdo » l’ancien chef du gouvernement reconnaît que l’État algérien
a pris en charge tous les frais liés à ce procès. Il déplore cependant que
l’État ne se soit pas impliqué politiquement dans le procès » (Algéria
Interface du 26/07/02). « Des journaux (…) ont sous-entendu que
Khaled Nezzar défend l’honneur de toute l’armée algérienne à travers ce procès.
Les médias, il faut le craindre, ont donné une orientation de mauvais aloi aux
débats ».(l’Expression du 03/07/02).
Heureusement que les socialistes
français ont été battus aux dernières élections se réjouissent les journaux car
« Sans ces facteurs [le recul des socialistes] particulièrement
favorables au plaignant, le traitement médiatique aurait [sic] été plus
mis [sic] en valeur. Aucun journal [français] en effet, n’a
accordé hier son ouverture au procès (…) Des articles particulièrement
« orientés » n’en ont pas moins été faits. L’information brute,
objective, n’occupe que très peu de place dans la plupart de ces articles. Un
cachet politique très clair est collé au procès alors que Nezzar ne mène
bataille que pour une simple histoire de diffamation » (l’Expression
du 03/07/02).
L’expression fait l’impasse sur la
déclaration de Me Jean-René Farthouat avocat de Khaled Nezzar, sur la
politisation du procès «Nous n’avons pas engagé cette procédure pour rien.
Nous entendons faire une large mise en perspective de tout ce qui s’est passé
en Algérie ces dernières années», a-t-il déclaré » dès le 29 juin
2002, (El Watan du 02/07/02)
L’Expression insinue que « sans
ces facteurs » c’est à dire si les socialistes n’avaient pas été
vaincus aux dernières élections « le traitement médiatique »
eut été plus orienté, à l’image de ce qu’écrit « cette journaliste
acharnée [et] du qui tu qui [Sic] (…) [et] dans sa haine
contre l’Algérie » (APS du 06/07/02).
3.9- LE SILENCE
La presse tut les témoignages de
Mehdi Mosbah, de Mohamed Samraoui, de Omar Benderra…Elle se tut aussi sur la
falsification de faits historiques.
Lorsque des témoins de Khaled
Nezzar (Leïla Aslaoui et Omar Lounis) laissent entendre que la marche du jeudi
02 janvier 1992 a été appelée et organisée par le CNSA (comité national de la
sauvegarde de l’Algérie) ils falsifient les faits. Cela est une contre-vérité
historique. Ces déclarations sont délibérément incomplètes.
Aslaoui dit (Le Soir, 10 juillet 2002) : « Je
peux affirmer qu’il [Aït Ahmed] était fatigué très fatigué même, en
proie à de sérieuses difficultés de mémoire (erreurs sur des dates) [Aït
Ahmed] a refusé l’idée que c’est à l’appel du CNSA que nous avions manifesté
le 02 janvier 1992. Fort heureusement un des artisans- M. Lounis Omar
syndicaliste- a expliqué au tribunal comment le CNSA avait été créé et dans
quelles conditions la marche a eu lieu. Je me souviens pour ma part que j’avais
crié avec d’autres : « Non au deuxième tour, armée, avec nous ». »
Cette personne tente de semer le doute sur les facultés intellectuelles de
Hocine Aït Ahmed en suggérant sa sénilité. Ces procédés à l’égard notamment de
Monsieur Aït Ahmed qui sont anciens, ont cet avantage de caractériser à eux
seuls leurs émetteurs.
Ce commentaire d’El Moudjahid (du
06/07/02) : « Omar Lounis (…) fera une large rétrospective sur la
création et les actions du CNSA avant d’aborder les objectifs de la grande
marche du 02 janvier 1992 » ainsi que celui de l’APS (06/07/02) :
« [Aït Ahmed] a soutenu des contre-vérités allant jusqu’à dire
que son parti avait organisé une grande manifestation à Alger pour s’opposer à
l’arrêt du processus électoral » abondent dans la même tentative de
désinformer. Les autres journaux se bandent les yeux se bouchent les oreilles
et se taisent. Ce silence participe d’une certaine manière à la falsification
de faits historiques.
Quels sont ces faits ?
Le 30 décembre Le Quotidien
d’Algérie écrit : « C’est au siège du FFS que Aït Ahmed a tenu [le
dimanche 29 décembre 1991] une conférence de presse (…) [Il appelle] à une
marche le jeudi 02 janvier 1992 »
Les objectifs de cette marche sont
formulés dans un encart publicitaire paru notamment dans Le Matin et El Watan
du 31/12/91 : « Refuser la fatalité de la République intégriste
après avoir refusé l’Etat policier (…). Sauver la démocratie… » mais « La
machine politique qui prépare publiquement l’arrêt des élections se met en
branle le 31/12 par la création du CNSA » (Abed Charef, Le grand
dérapage. Edition de l’Aube). Le CNSA est créé le 30 décembre 1991 dans des
circonstances troubles, notamment par la direction de l’UGTA, des cadres de
l’administration publique et des membres du patronat. Cette association est
agréée le lendemain 31 décembre. Cette célérité de l’administration est unique.
Inouïe. Ce comité est « né dans le bureau du ministre de l’information
M. Abou Bakr Belkaïd » (Louisa Hanoune, Une autre voix pour l’Algérie.
Edition La Découverte).
Le CNSA appelle (encart dans Alger
républicain du 02 janvier 1992) « tous les algériens à exprimer leur
attachement au développement du processus démocratique (…) à exiger le respect
par tous, de la légalité constitutionnelle… ». Le jour de la marche, « Des
centaines de milliers d’algériens ont répondu à l’appel de Hocine Aït
Ahmed » (Le Matin du 04/01/1992). « Du balcon de l’hôtel [Aït
Ahmed] s’adresse brièvement à la foule, appelant « au respect de la
légalité pour éviter une guerre civile » en soulignant
« qu’interrompre le processus électoral signifierait cautionner les
institutions au pouvoir ». (Le Monde du 04/01/1992).
« La fièvre
anti-électorale est relayée par la presse francophone qui multiplie les
« une » catastrophiques (…) L’objectif est clair : montrer que
la « société civile » appelle de ses vœux l’interruption du processus
électoral » (José Garçon ; in Reporters sans frontière « Le
drame algérien ». Edition La découverte.). Il est vrai que la presse
martèle cette demande d’interruption du processus électoral . Les 5 et 6
janvier « le ministre de la communication organisa une grande
conférence nationale sur la presse (…) pour sonder les patrons de presse et les
journalistes, et les préparer à la remise en cause des élections. »
(Abed Charef, Le grand dérapage). Une des trois tendances qui se dégagent
durant cette conférence « est prête à collaborer avec le pouvoir [mais]
demande des garanties et des contreparties, essentiellement financières »
(Abed Charef).
En définitive qu’est-ce que cette
association dénommée CNSA ?
« Une structure politique
mise en place à l’initiative de l’armée, dont Khaled Nezzar était le
chef » (AP, le 11/07/02), « La presse salue la naissance du
CNSA, une structure née pour défendre la démarche des décideurs » (Le
Jeune Indépendant ; avril 2001)
« Appelée par le FFS
explicitement pour sauver le processus démocratique à la fois contre la menace
islamiste et celle d’un coup de force militaire, la gigantesque marche
populaire du 02 janvier devient de glissement sémantique en exégèse
journalistique, un refus du verdict des urnes » (La Nation du 06 au
13/01/1992)
CONCLUSION
Les titres de la presse durant la
semaine du 01 au 07 juillet sont peu signifiants. Ils reflètent peu le contenu
des articles. Les formules utilisées pour désigner le plaignant ou ses témoins
si elles ne sont pas élogieuses, le plus souvent elles les valorisent
positivement. Parfois, pour faire bonne mesure la presse égratigne Khaled
Nezzar lui même ou tel ou tel ancien « haut responsable », témoin de
la partie civile.
Habib Souaïdia et ses témoins sont
autrement traités. Le parti-pris est manifeste notamment dans le choix des
vocables et des symboles que cette presse leur associe.
La presse algérienne ignore
certains témoignages, accompagne d’autres de ses commentaires auxquels la
majorité des témoins ne peuvent très probablement pas répondre. L’objectif de
ces commentaires est d’en réduire la portée. Le procès lui même est diversement
apprécié par la presse qui choisit de s’attaquer ouvertement aux ennemis
extérieurs et intérieurs ainsi qu’à la presse étrangère (française).
L’espace quantitatif que la presse
algérienne a réservé aux témoignages de Khaled Nezzar et ses soutiens avoisine
près de 80% de l’ensemble de l’espace consacré aux témoignages. Le traitement
réservé par la presse au procès « Nezzar-Souaïdia » est donc à
quelques extraits d’articles ou signatures prêts, « orienté ».
Le régime algérien a voulu
affaiblir l’opposition démocratique et reprendre l’initiative devant une Europe
qui, malgré la signature de l’accord d’association prêtait à nouveau une
oreille attentive à l’opposition surtout depuis la parution d’ouvrages
dénonçant les pratiques de certains segments de l’armée algérienne et l’immense
écho international qui en a résulté. Profitant de « l’aubaine du 11
septembre 2001 », il engage un procès par l’intermédiaire du général
Khaled Nezzar, « pour absoudre une fois pour toutes le haut
commandement militaire de toutes les accusations » (Libération du
01/07/02) et convie par la même la presse à le suivre . « Le
11 septembre a éclairé la communauté internationale sur l’ampleur du drame que
les Algériens subissent depuis des dizaines d’années du fait d’un terrorisme
d’inspiration islamiste » (El Watan du 11/09/02).
« Ghozali reconnaît que l’Etat algérien a
pris en charge tous les frais liés à ce procès ». (Algéria Interface
du 26/07/02). Il ne s’agit donc pas d’un procès en diffamation intenté par «
un ex-général à la retraite contre un ex- sous-officier voleur de pièces
automobiles ». Il s’agit d’une offensive politique du régime contre
l’opposition démocratique qui n’a de cesse de porter les débats sur la nature
du pouvoir en Algérie.
L’Humanité (du 01/07/02) écrit : « ouverture
du procès à l’initiative de l’armée algérienne représentée par le général
Khaled Nezzar [qui] fait partie de ces hommes forts qui, dans le cercle
très restreint des décideurs militaires algériens, exercent dans l’ombre le
vrai pouvoir en Algérie ». « Ce qui importe pour les avocats
du général c’est (…) de contrecarrer la campagne médiatique, laquelle a porté
un coup à la réputation de l’armée algérienne ». (La Tribune du
02/07/02). « Aujourd’hui, les militaires ont vraisemblablement décidé
de laver ‘’l’honneur de la tribu’’ (…). Tout porte à croire que leurs dernières
sorties ne sont pas spontanées. Ils se sont décidés enfin à se défendre (…).
Les militaires algériens se sont expliqués » durant le procès. (Le
Matin des 13 et 11/07/02).
Cette offensive contient en elle
un traitement médiatique approprié au procès. Lors d’une conférence de presse
le général Lamari Mohamed déclare : « ce procès (…) Nezzar l’a
intenté pour aller au delà de la seule diffamation. Il faut crever l’abcès une
fois pour toute » (Le Quotidien d’Oran du 03/07/02). La veille de
l’ouverture du procès le ton est donné par un des avocats de Khaled Nezzar qui déclare :
« nous entendons faire une large mise en perspective de tout ce qui
s’est passé en Algérie ces dernières années ». (AFP, le 29/06/02) car
il est insuffisant de dénoncer le seul Habib Souaïdia, qui n’est qu’un « instrument
d’une opération médiatique » déclare Ghozali (Le Matin du 03/07/02).
Il faut donc dépasser le prétexte de la diffamation et dénoncer toute
l’opposition et ses alliés qui veulent « s’attaquer à l’Algérie ou à
l’institution militaire » (Le Matin du 11/07/02), d’où la virulence
contre toute l’opposition démocratique appelée « alliés de
l’internationale socialo-islamiste » , de Sant’Egidio aux « héritiers
staliniens de Mitterand »
La presse peut-elle se positionner
autrement qu’elle l’a fait ? Non même si, écrit-elle ce procès la gêne. « On
comprend que la presse ne puisse se poser (certaines) questions parce qu’elle a
des enfants et des parents à nourrir ». (El Watan du 14/07/02) mais
surtout parce qu’elle a des engagements de collaboration à respecter.
Il y a lieu de rappeler ici ce qu’écrivait
Le Matin (du 11/07/02) : « Le procès Nezzar-Souaïdia fut un coup
réussi pour l’armée : l’abcès est crevé. Les militaires algériens se sont
expliqués, dans une capitale occidentale [nous soulignons] (…). C’est
fait » ; ou bien ce commentaire sans ambages du Quotidien d’Oran
(du 04/07/02) : « Une victoire de Nezzar, de l’armée algérienne,
donc, [nous soulignons] en France, constituerait ensuite une charge
symbolique inouïe. Au quarantième anniversaire de l’indépendance du pays, c’est
plus qu’une victoire, c’est l’affirmation d’un rôle qui, (…) devient un
facteur de légitimation politique pérenne ». [nous soulignons].
Le Matin ajoute : « Le
procès va déborder (…) pour devenir un réquisitoire contre l’armée algérienne,
et à ce jeu là, pourquoi se le cacher, il n’y a guère de place pour la
neutralité : cette cause est la notre » (01/07/02). Comment alors
ne pas rapprocher ces prises de position de ce témoignage de M. Mohamed Harbi
qui : « n’hésite pas à dire que «la presse demeure le secteur le
plus infiltré par la SM et qu’en l’occurrence, elle demeure le meilleur allié
de l’armée». » (L’Expression du 03/07/02)
La presse s’est positionnée et
elle avoue sa dépendance : « Nezzar tisse avec certains journaux
une véritable lune de miel » écrit Liberté (du 13/07/02) qui se voit
vertement répliquer par Le Soir d’Algérie (du 14/07/02) et qui prend pour lui
l’écrit de Liberté : « C’est maintenant qu’il faut se mouiller
pour un Smic démocratique (…) après il sera trop tard pour (…) venir remuer du
popotin ». Mais L’Expression (du 13/07/02) qui écrit : « En
s’attaquant à Fattani [le directeur de ce journal], Nezzar cherche
délibérément à atteindre une autre cible » confirme ce qu’écrit
Liberté mais ne précise pas qui est cette cible qui se dissimule derrière les écrits
de Fattani (ou du journal).
Lorsque le Quotidien d’Oran (du
18/07/02) écrit : « L’interview fleuve de Mohamed Lamari, précédée
de confidences énigmatiques d’un autre officier supérieur (…) suivie d’une
série de commentaires et d’analyses visiblement commandées », il
confirme à son tour ces « liens tissés ».
En 1992 deux directeurs (à des
périodes différentes) du même hebdomadaire Algérie Actualité, s’accusent
mutuellement d’être à la solde des « patrons de la direction générale
de la sûreté nationale » , une autre fois un journaliste de L’Hebdo
Libéré écrit que son directeur « a mis à la disposition des policiers
les dossiers administratifs de certains journalistes » (Ali Yahia
Abdennour, Algérie raison et déraison. Edition de l’Harmattan)
« Dans son livre les Nouveaux Boucs
émissaires Abderrahmane Mahmoudi [ex directeur de l’Hebdo Libéré qu’il a
lancé] qui voue une fascination extrême pour les services de renseignements (…)
soutient que « la disparition brutale » du colonel Salah, de
la DRS «a très probablement un lien avec sa participation à un mouvement
d’officiers supérieurs qui, (…) décident d’installer à la présidence de l’Etat
le général Liamine Zeroual, sans passer par la fameuse conférence nationale de
janvier 1994. Quelques journalistes, dont deux ont été par la suite contraints
à l’exil, et un autre assassiné, avaient été approchés pour assurer la partie
médiatique de l’opération». (In Libre Algérie n° 56, 23 octobre 2000).
Depuis de nombreuses années
certains cercles du régime « tissent » avec des journalistes ou
directement avec des responsables de journaux des liens. Des liens sont tissés
sur la base de compromis. La presse est prête à « collaborer avec le
pouvoir » (Abed Charef), en contrepartie de quoi le régime la tolère.
Ces arrangements ou compromis d’intérêts sont ici entendus au sens de sociation
(Vergesellschaftung) que leur attribue Max Weber ; une « entente
rationnelle » fondée sur une « constellation » d’intérêts. Il ne
peut en être autrement. « Comment pourrait-il exister une presse libre
dans un pays sans Etat de droit ? » s’interroge Salima Ghezali
(In La lettre de la FIDH, 04/1999).
Les journaux d’opposition ont
disparu de la scène médiatique algérienne dans un silence approbateur ou
accompagnés de commentaires inacceptables tels que ceux d’El Watan. Lorsqu’en
effet à la suite des coups de boutoir répétés de l’administration
l’hebdomadaire La Nation disparaît, El Watan (notamment) affirme dans son
édition du 13 mars 1997 : « c’est la commercialité qui lui sera
fatale » sans autre précaution bien que plusieurs autres journaux qui
avaient des dettes beaucoup plus élevées n’ont pas été inquiétés.
La presse algérienne est nombreuse
et traite des quantités de questions. Elle met en lumière un certain nombre de
problèmes. Elle est indépendante lorsqu’elle aborde des sujets perçus comme non
sensibles.
Il arrive que la presse comme nous
l’avons écrit donne la parole à l’opposition pour tenter de se départir de
l’image, de la position qui sont réellement les siennes mais c’est pour aussitôt
cerner cette parole par des flots de commentaires autres, dont l’objectif est
précisément de noyer la parole octroyée parfois jusqu’à caricaturer le
journalisme, tel cet exemple à propos du procès : « Les témoins de
Souaïdia ne disaient pas que des mensonges quand ils pointaient du doigt (…) la
responsabilité de l’armée » (Le Matin du 11/07/02).
Mais cette presse est aussi une
presse qui soulève des questions très sensibles. Elle est une presse de combat
bien qu’il faille distinguer les journaux zélés « va-t-en guerre »
(ou outranciers comme la presse gouvernementale) et les autres, ceux qui par la
sobriété de leurs commentaires laissent entendre leur incapacité à aller au
devant de certains événements, « sans ordre ». Ceux-ci existent
difficilement. Lorsqu’elle révèle des compromissions dans le cadre
« d’enquêtes » sur des dossiers très sensibles (douanes, importation,
islamisme, contrats internationaux de gaz et pétrole) ou lorsqu’elle s’attaque
à de hauts dignitaires du régime, ou à des membres de la haute hiérarchie
militaire (Betchine, le général Beloucif, les « magistrats
faussaires » …) la presse le fait avec le consentement direct ou tacite ou
encore sur « ordre » d’autres hauts dignitaires du régime ou d’autres
membres de la haute hiérarchie militaire, les « marionnettistes »
avec la garantie d’une certaine protection.
Lorsqu’en cet été 2002 une partie
de cette presse tente de déstabiliser le président de la République Abdelaziz
Bouteflika (« affaire » Orascom), L’Expression (du 08/08/02) écrit
pudiquement : « un lien direct, clair et tranché existe entre
cette campagne et celle de 98 [campagne médiatique contre le
ministre-conseiller du président de la République Liamine Zeroual les amenant à
une réaction « épidermique » : démissionner]. Les
mêmes médias (…) et, sans doute, les mêmes sources, pour ne pas dire
marionnettistes, sont en charge de la campagne de 2002 (…). Impossible de
croire que cette brusque montée au créneau ne répond à aucun besoin
politicien ». Abondant dans le même sens Algéria-Interface (du
06/09/02) écrit : « Le « feuilleton de l’été 2002 » ne
semble guère, faute de combattants, se terminer par un remake de celui qui a
contraint les généraux Mohamed Betchine puis Liamine Zeroual à passer la main,
en 1998. (…) Il n’y a pas eu d’unanimité contre Bouteflika ».
Lors de la conférence de presse de
Khaled Nezzar durant laquelle il annonçait qu’il allait porter plainte contre
Habib Souaïdia, « une vieille révolutionnaire » qui a
bruyamment perturbé la conférence interpelle les journalistes présents : « Et
vous, vous venez lui faire la cour et lui sourire (…) Venez, ne vous sauvez
pas ! Je peux vous apprendre à parler, à être courageux ! (…) Nezzar
n’a été qu’un Pinochet, un assassin, un criminel sans scrupule et sans
envergure ! » (L’Expression du 23/08/02)
Là aussi, à une ou deux
exceptions, les suppliques de cette vieille mère de disparu furent l’objet d’un
dédain médiatique général.
« Il y a longtemps que je ne
lis plus la presse algérienne (…). Ma conviction est devenue inébranlable lorsque
j’ai eu l’impression sordide qu’elle faisait corps à l’unisson dans des
campagnes de conditionnement de l’opinion à l’occasion de massacres de
populations civiles (…). Elle vire de bord au gré des ordres reçus ».
(Maître Hocine Zahouane, Ligue Algérienne de Défense des Droits de l’homme
–LADDH- cité par El Hadi Chalabi, La presse algérienne au-dessus de tout
soupçon).
La presse algérienne
gouvernementale ou privée est dépendante. La formule « à son corps
défendant » est ici inadéquate. Cette presse ne pouvait par conséquent
traiter équitablement, objectivement le « procès Nezzar-Souaïdia ».
Telle est notre conclusion.
Ahmed HANIFI
POUR LIRE LA SUITE DE L’ARTICLE CLIQUER ICI


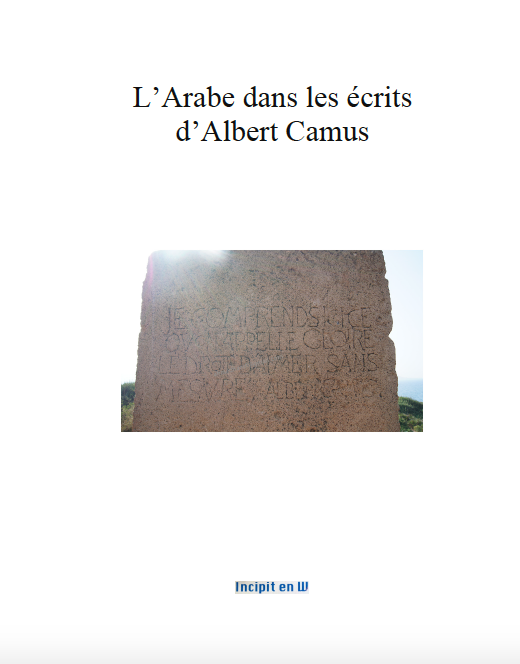
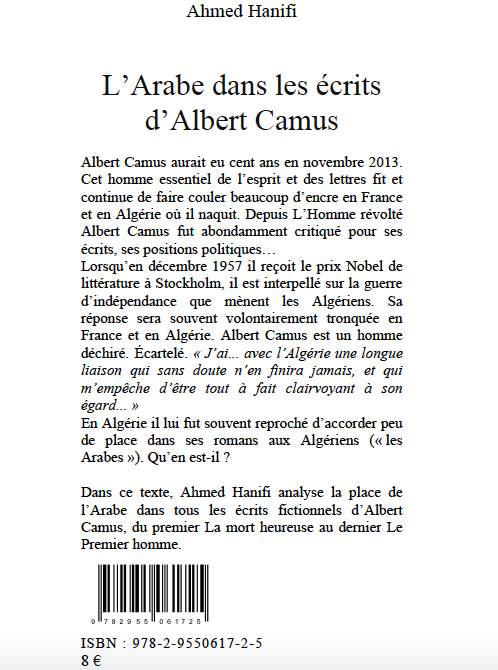


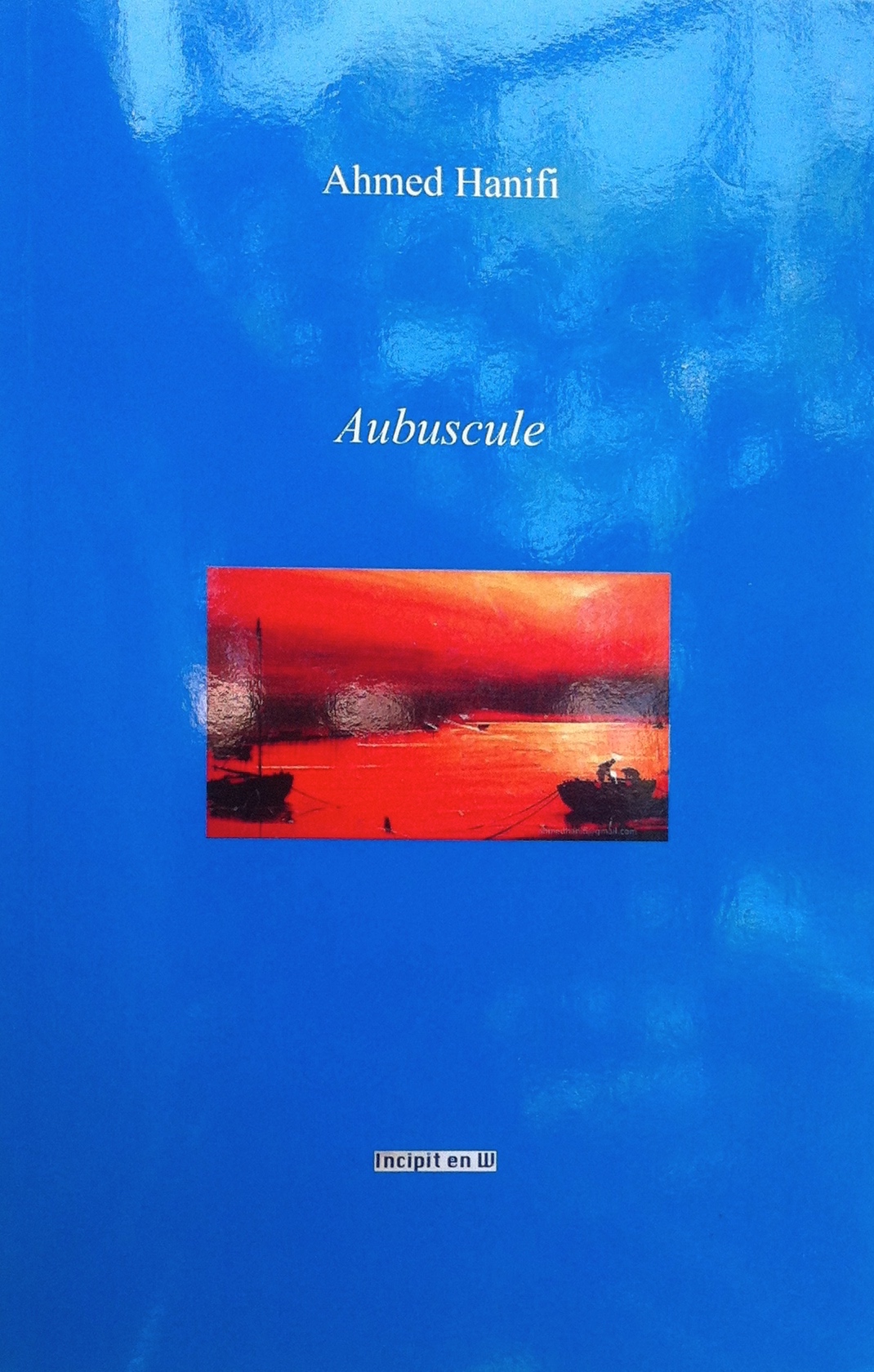
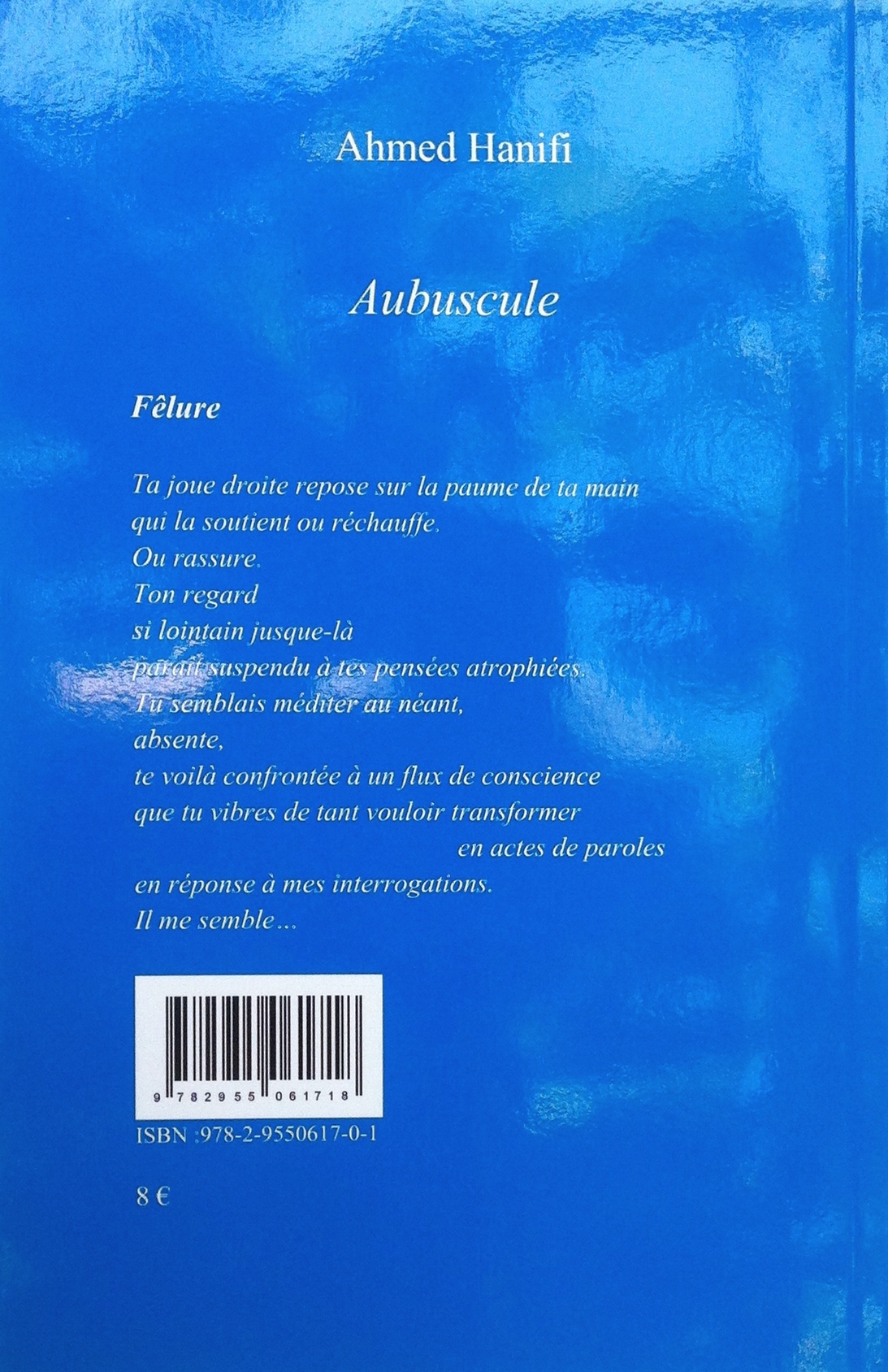
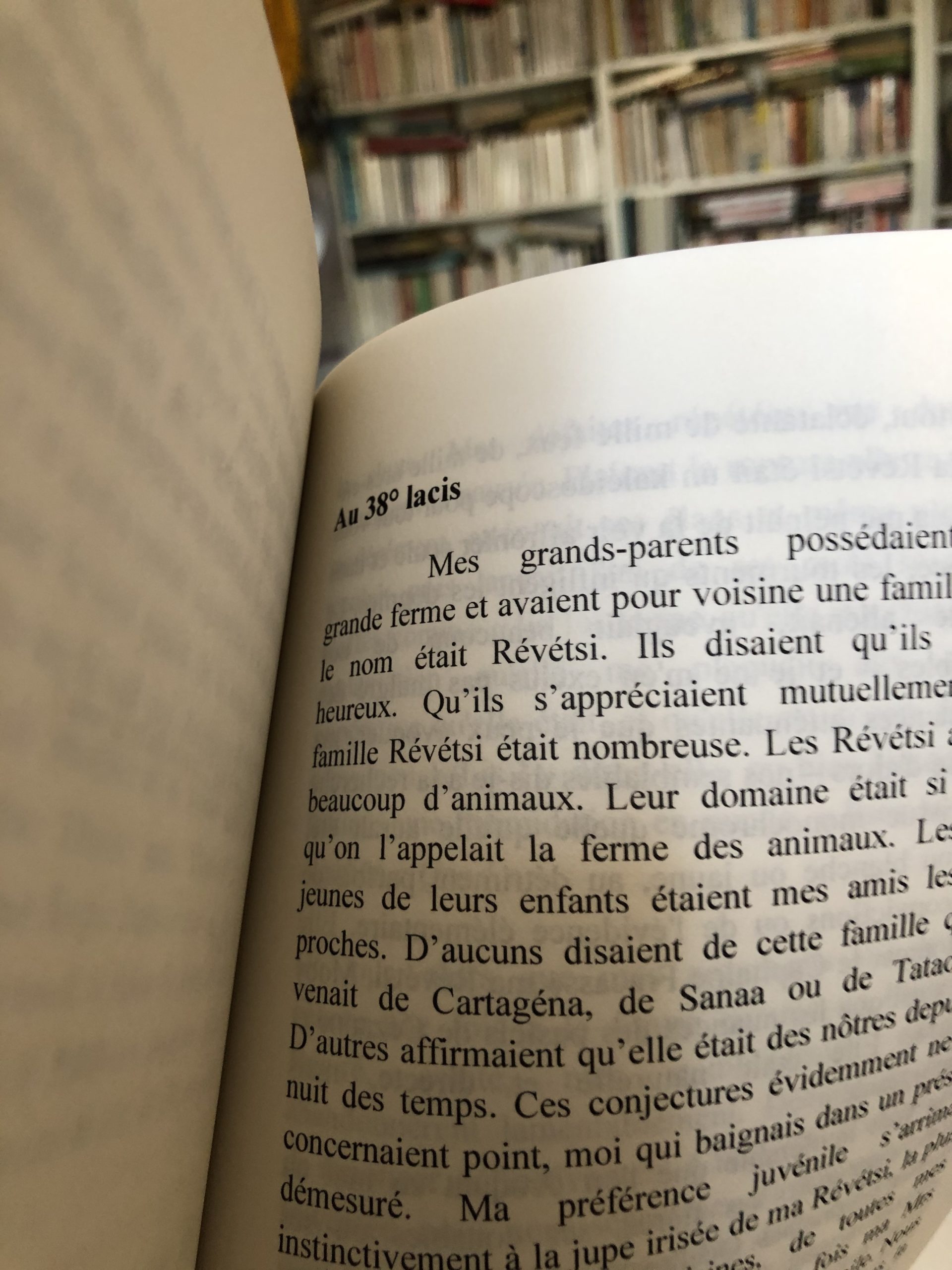

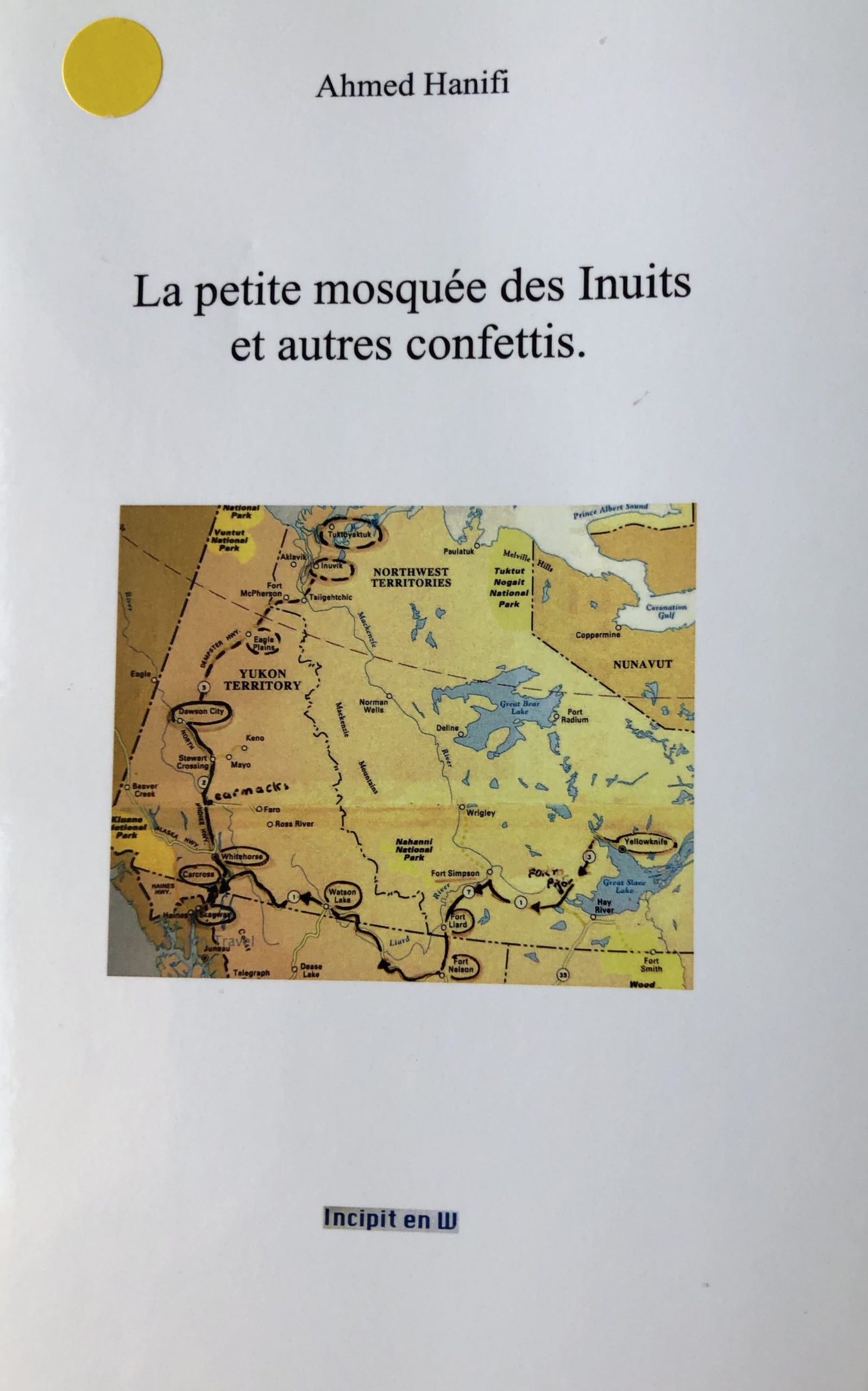
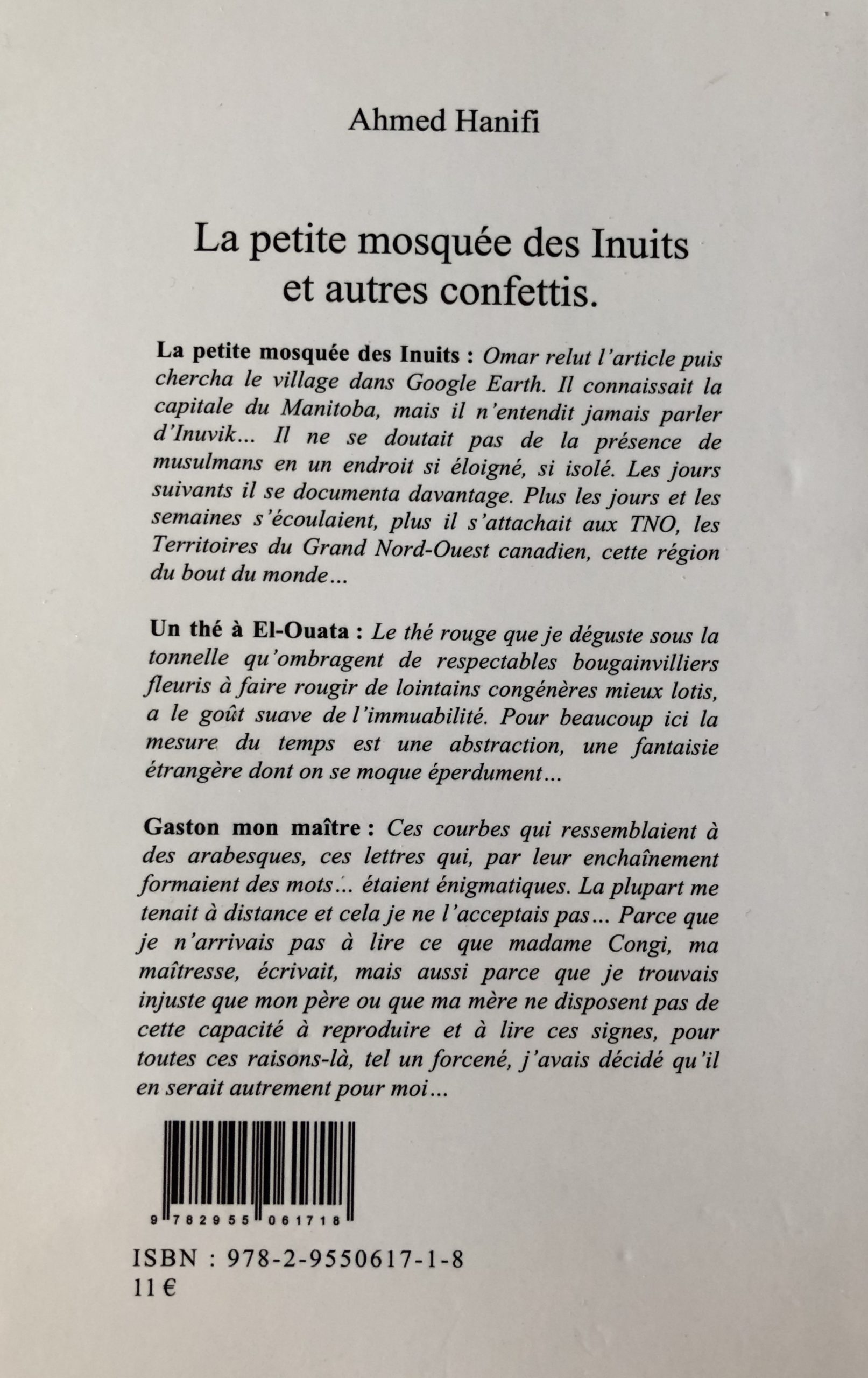





 Le siège du PCF en 1982_ Place du Colonel Fabien – Paris 19° _ Photo DR
Le siège du PCF en 1982_ Place du Colonel Fabien – Paris 19° _ Photo DR




















 A
A





























































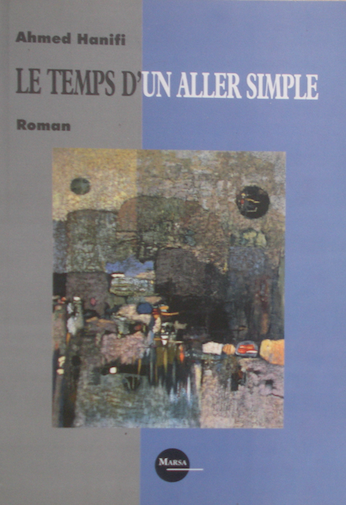 C
C