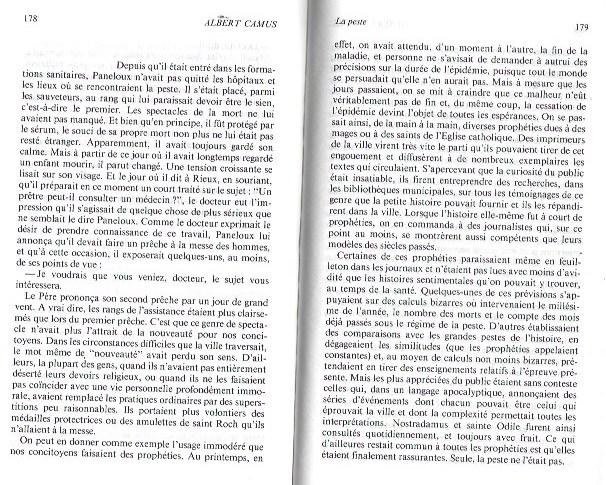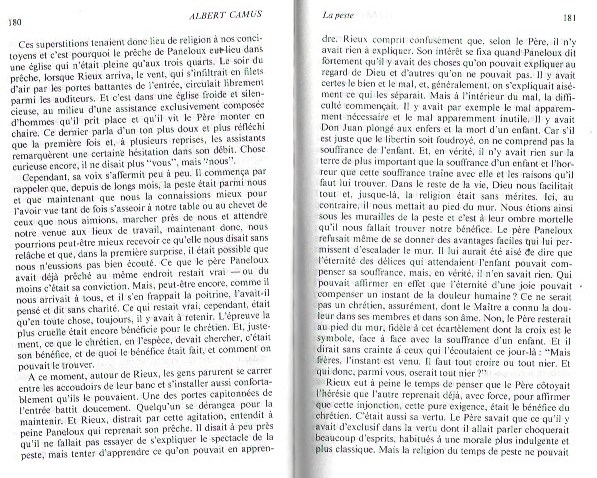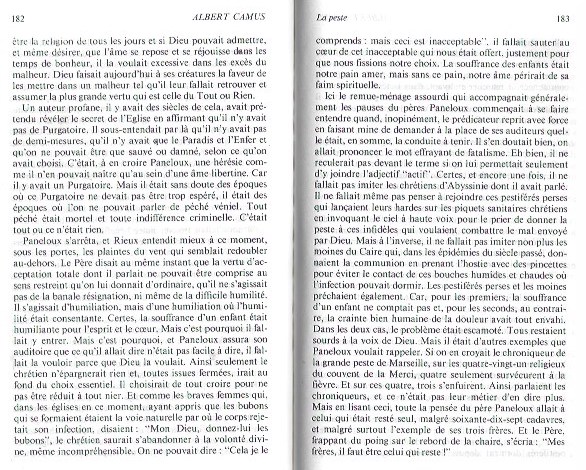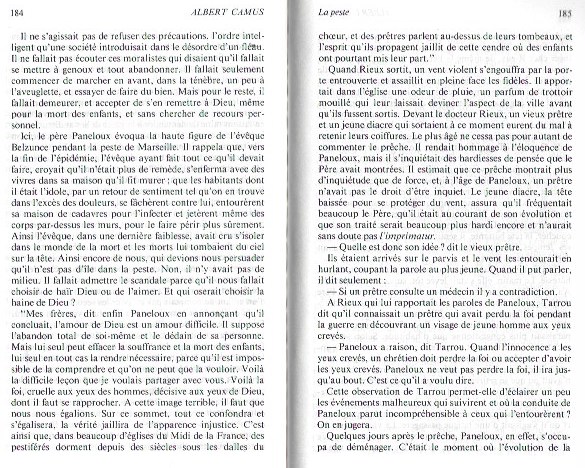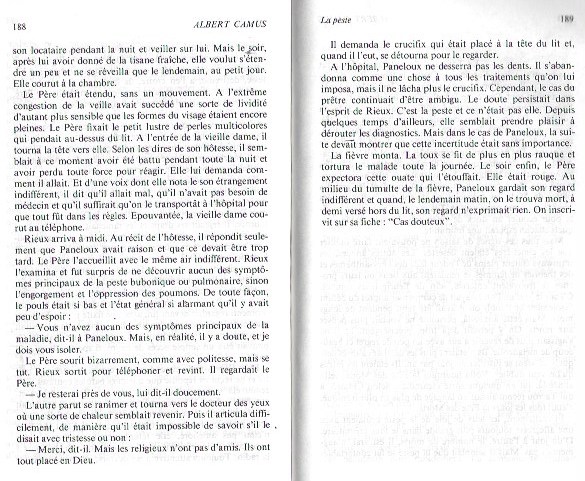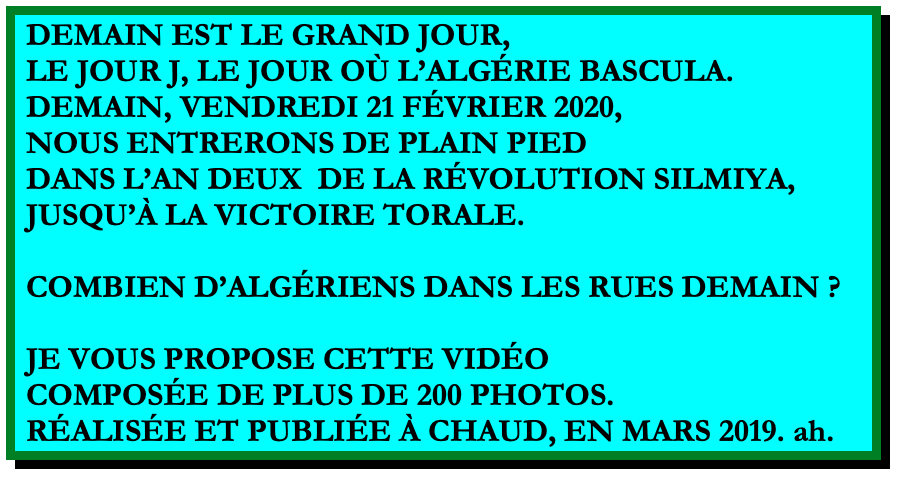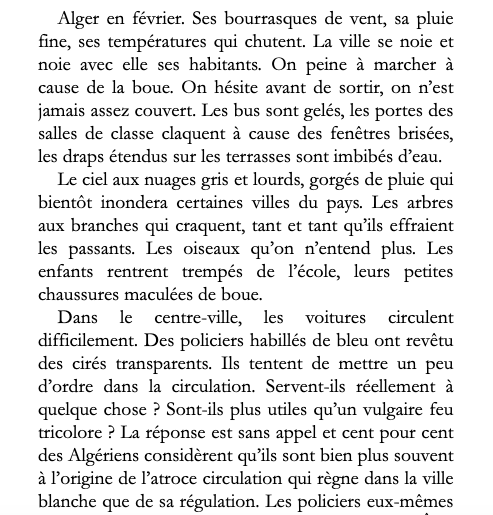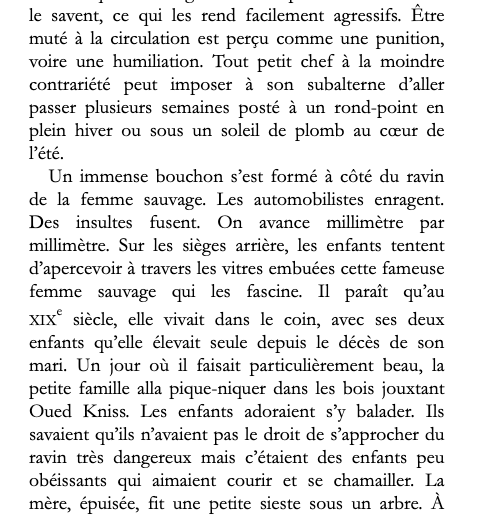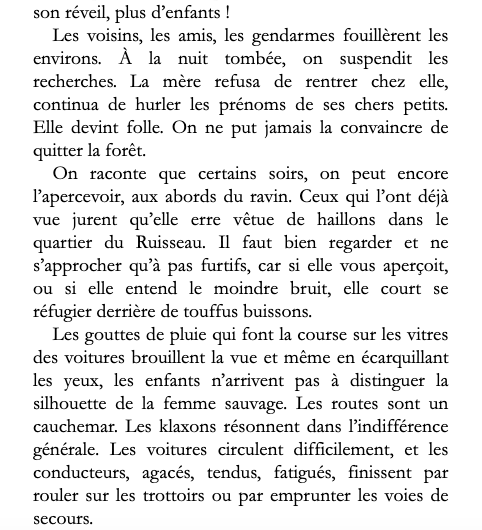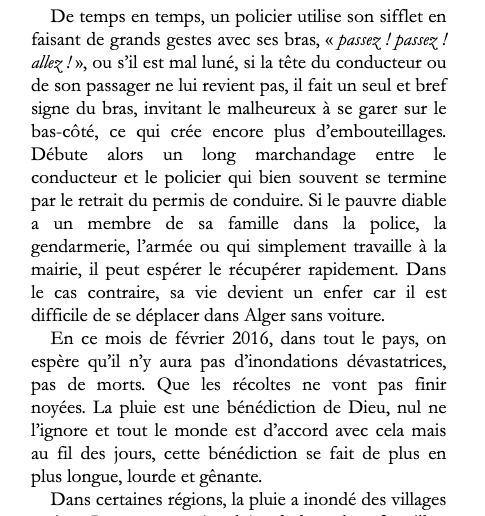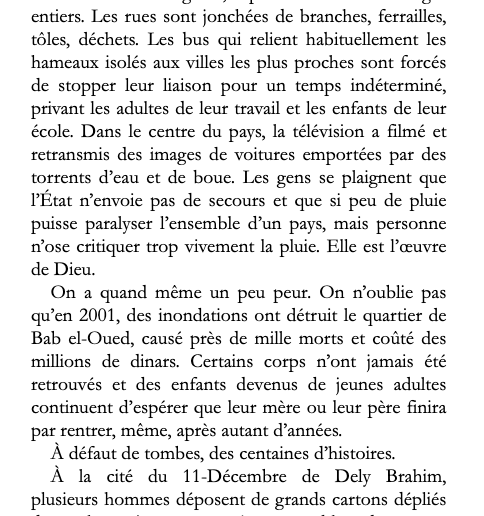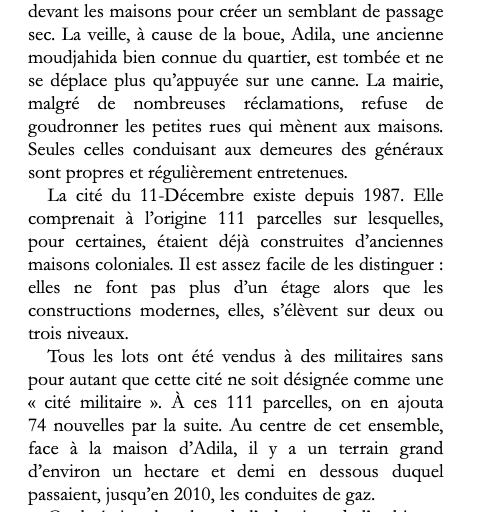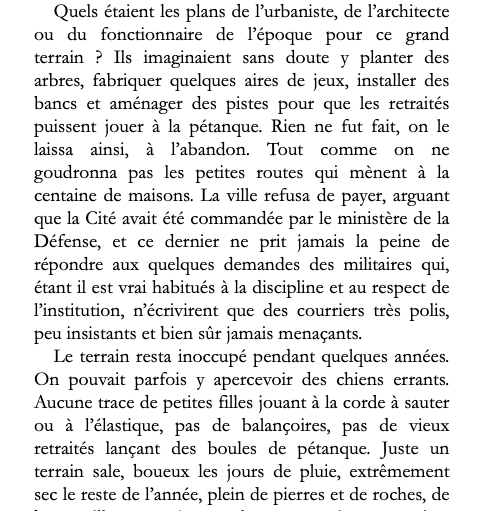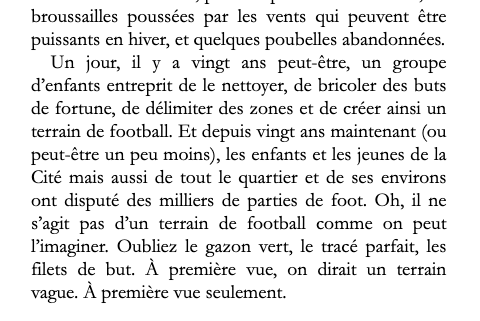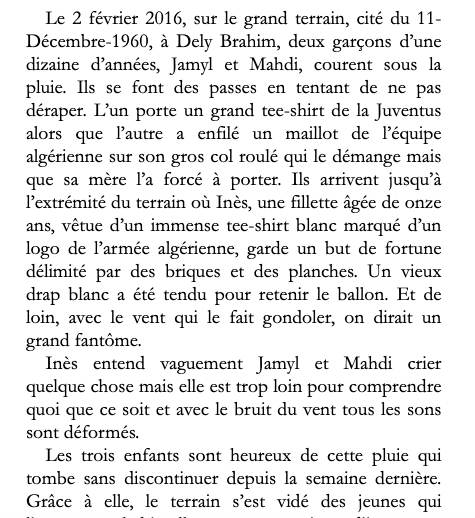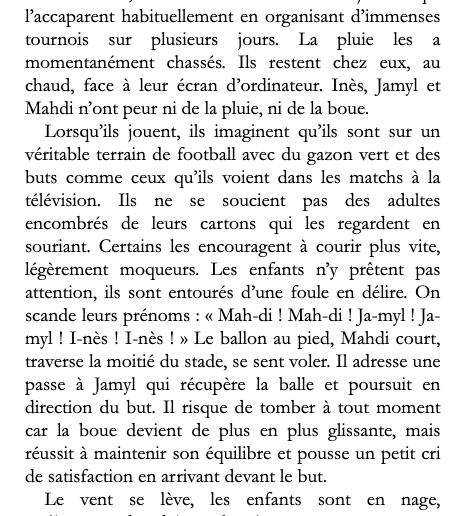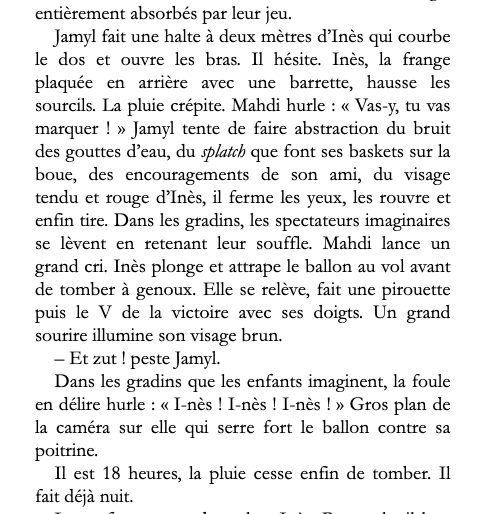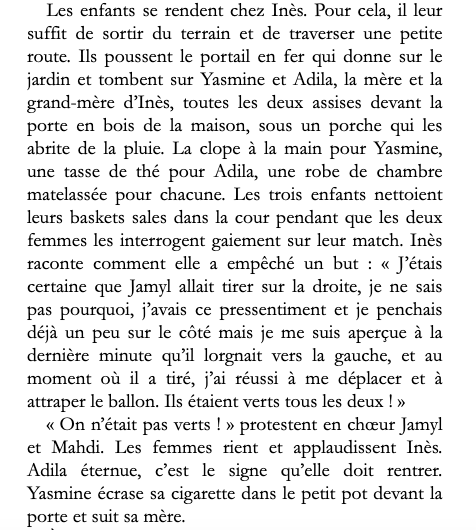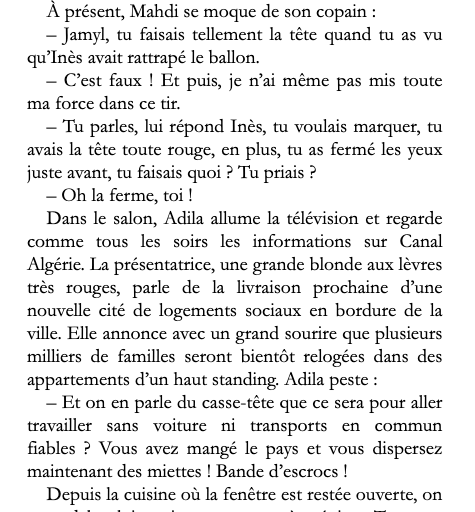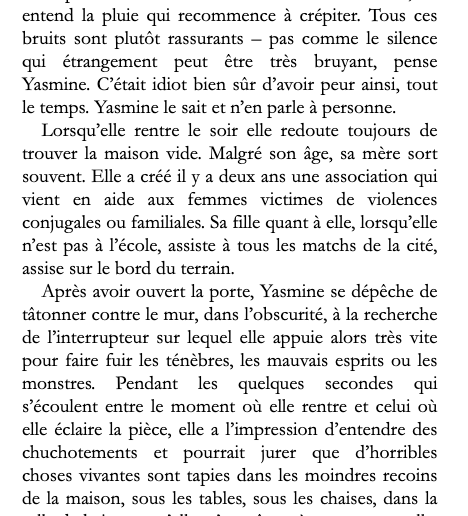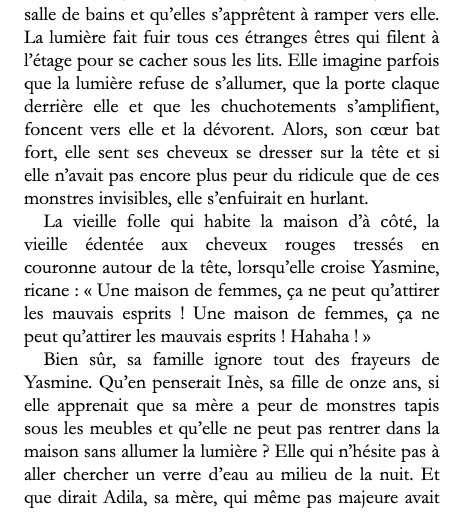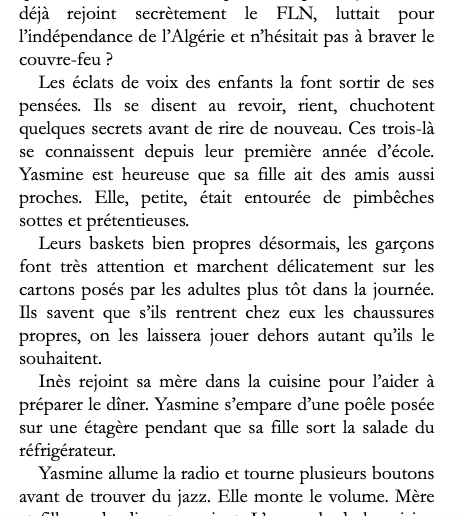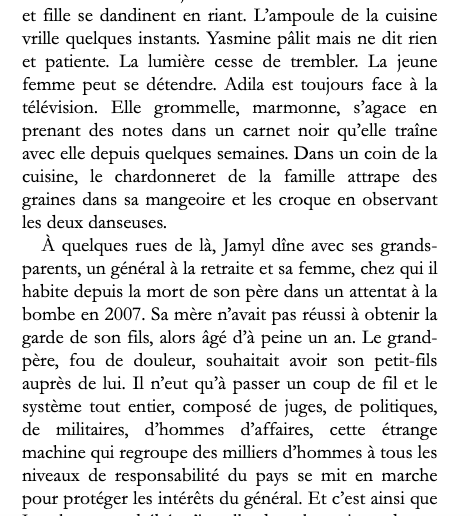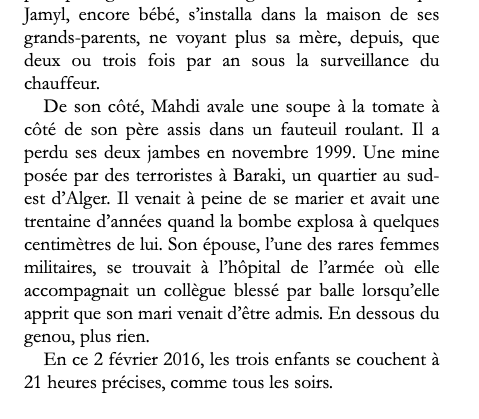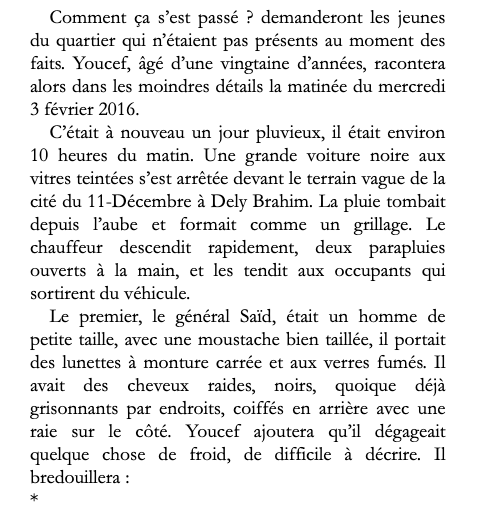Algérie, islamisme, pouvoir, démocratie…
Vendredi 28 février 2020

« Ni Kant, ni Marx, ni Bourdieu ne seraient d’accord avec votre position, M. Addi. Expliquez-vous ! »
J’ai reçu d’un ami internaute sur ma boîte privée messenger un texte dont je cite la fin ci-dessus à la suite de mon post « Faut-il avoir peur des islamistes ? ». Ma réponse à cet ami internaute se fera à un niveau idéologico-historique et ensuite au niveau politique.
1. Le niveau idéologico-historique : L’islamisme est un phénomène idéologique (idéologisation de la religion) qui provient de la société et de son histoire. L’Algérie a connu la modernisation à partir de l’extérieur à travers la domination coloniale. (Nous aurions besoin de définir ce qu’est la modernisation. Nous le ferons plus tard). Cette modernisation suscite des peurs quant à l’identité culturelle et religieuse. Le sens des perspectives historiques (que nous devons avoir) est de dire à ceux qui expriment cette peur que notre société est aussi capable de produire une modernisation endogène à laquelle aujourd’hui s’oppose l’interprétation médiévale de l’islam. Un islam compatible avec la liberté de conscience est possible. C’est ce qu’il faut expliquer aux islamistes et qu’ils renoncent à excommunier des musulmans (takfir) et qu’ils acceptent le principe du monopole de la violence à l’Etat, violence exercée dans le cadre de la loi. L’islamisme est susceptible de suivre l’évolution de pays européens qui ont vu apparaître des partis dits démocrates-chrétiens ou sociaux-démocrates. Rachad en Algérie est sur cette voix, ainsi que Nahda en Tunisie. Ceci indique un début de sécularisation de la conception politique des courants islamistes ou ce que des universitaires appellent le post-islamisme. Surtout que la sécularisation des pratiques sociales est plus avancée dans la vie quotidienne qu’on ne le croit. Je prends un exemple. Une femme qui se verrait proposer un mariage religieux (deux témoins et un imam d’occasion) dirait non. Elle exigera la transcription du mariage à la mairie, parce qu’elle sait qu’elle a besoin de la protection de l’Etat pour la stabilité de son mariage. Même si elle est islamiste, elle ne fera pas confiance à la seule foi religieuse de son futur mari. C’est cela la sécularisation des rapports sociaux qui sont plus en avance que le discours tenu par les gens sur eux-mêmes. Ce qu’il faut, c’est créer un discours nouveau conforme à ces rapports sociaux.
2. Le niveau politique : Les commentaires hostiles à mon post contiennent une contradiction de taille. Leurs auteurs demandent que les militaires ne dominent plus l’Etat et, par ailleurs, ils veulent exclure un courant politique qui pèse, me semble-t-il, entre 15 et 20% de l’électorat. Comment l’exclure si ce n’est pas en appelant l’armée ? Comment faire ? Créer un Code de l’Indigénat de l’administration coloniale où une voix d’un non-islamiste vaudrait 5 voix d’un islamiste ? Il faut garder raison et reprendre le contrat de Rome (Sant’Egidio), et y inscrire en outre le scrutin à la proportionnelle. Les islamistes auraient 15à 20% d’élus à l’Assemblée Nationale et ils seront obligés de faire des alliances et de s’adapter à la réalité. Car un islamiste qui affirme que « le Coran est la constitution », il faudra lui apprendre le contenu du Coran et ce qu’est une constitution.
Voyez-vous cher ami internaute, c’est parce que j’ai lu Kant que j’arrive à cette conception des choses. Un des impératifs catégoriques de la morale de Kant est : « ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu’on te fasse ». Il se trouve que c’est aussi un hadith du prophète. C’est aussi parce que j’ai lu Marx que je suis toujours avec les classes sociales exploitées et avec le peuple, même quand ils ont une conscience peu claire de leurs intérêts. C’était la position de Sadek Hadjeres au congrès du Pags avant de quitter le parti. L’intellectuel doit participer à la prise de conscience des masses et non pas les combattre. C’est la position de l’Iranien Ali Shariati qui a créé un courant politique islamo-marxiste. Enfin, j’ai appris de Bourdieu à écouter la société et non pas à parler en son nom. Un sociologue, disait-il, fait parler la société, et ne parle pas en son nom.
En conclusion, si nous arrivons à construire un champ politique où il n’y a pas d’ennemis à exterminer, mais seulement des adversaires politiques qui s’affrontent par la compétition électorale et qui acceptent le verdict des urnes et l’alternance électorale, nous serons alors prêts à construire la démocratie au profit de tous.
_____________________
Mardi 25 février 2020
_
La visite du commandant Bouregaa, Mustapha Bouchahchi et Samir Belarbi à Ali Belhadj à son domicile, ainsi que la rencontre entre Sadek Hadjeres et Larbi Zitout, et d’autres rencontres avec des militants du mouvement Rachad, ont suscité des interrogations et des débats sur les réseaux sociaux. Certains internautes se sont dits choqués que des démocrates laïcs comme Moshsen Belabbès, Zoubida Assoul et autres universitaires acceptent de participer à des débats sur la chaîne de télévision Al Magharibia dirigée par un des enfants de Abbassi Madani, ancien dirigeant du FIS dissout.
Ce débat a pourtant été tranché par le hirak où islamistes et non islamistes se côtoient tous les vendredis pour demander une transition vers un régime civil. La conscience collective du hirak a compris que la société contient plusieurs courants idéologiques qui ne doivent pas s’exclure, même s’ils doivent s’opposer pacifiquement sur le terrain électoral pour laisser les électeurs décider à qui confier la majorité parlementaire pour une période de 5 ans. Les rencontres entre islamistes et non-islamistes, dans la phase actuelle, sont nécessaires pour écrire les règles de jeu de la compétition pacifique pour le pouvoir.
On ne peut pas interdire à un islamiste d’être un islamiste, mais on peut exiger de lui qu’il signe un contrat où il s’engage à ne pas utiliser la violence, à ne pas décider qui est musulman et qui ne l’est pas (interdiction du takfir), à accepter que la croyance religieuse n’est pas une affaire de l’Etat. L’urgence est d’arriver à un consensus qui stipule que l’Etat est un bien public et que la religion un bien privé. De plus en plus d’islamistes sont ouverts à ce consensus qui vise à établir les règles juridiques entre le citoyen et l’Etat et non pas entre les citoyens et Dieu. Ce qui lie le croyant à Dieu, c’est la foi et non la règle juridique. La raison est simple : Dieu peut pardonner un péché, mais l’Etat ne peut pas pardonner un délit.
L’autre argument avancé par ceux qui sont hostiles à toute rencontre avec les islamistes est qu’ils ont du sang sur les mains. Il est vrai qu’au lendemain de l’annulation des élections remportées par le FIS, des islamistes ont pris les armes et ont exercé une violence militaire. Il s’est ensuite installé une période de confusion où les Algériens se posaient la question « qui tue qui ? ». La question était légitime car dans tout Etat la culpabilité est établie par des juges à la suite d’un procès équitable. Or durant cette période trouble, c’étaient les communiqués de la police qui désignaient le coupable. En la matière, il ne s’agit pas d’être contre ou pour les islamistes ; il s’agit d’être pour le droit qui a des règles qui désignent le coupable.
En conclusion, les islamistes sont un courant d’opinion dans la société et il n’est pas question de faire appel à l’armée pour les exclure du champ politique. Il faut les combattre idéologiquement et pacifiquement, si on ne partage pas leur vision de l’Etat, et avoir confiance dans la société qui, lors des élections, choisira la majorité parlementaire. Deux perspectives se présentent : demander aux militaires d’éloigner par la violence les islamistes du champ politique, ou demander aux militaires de se retirer du champ politique pour affronter pacifiquement les islamistes sur le terrain idéologique. Personnellement, j’ai choisi la deuxième perspective.
_____________
_________________________ AUTRES ÉCRITS DE LAHOUARI ADDI_________________
LAHOUARI ADDI
TSA_
A qui appartient la souveraineté nationale : au peuple ou à l’état-major ?
Débats et Contributions- Par: Lahouari Addi* 10 Avril 2019 à 07:05
Tribune. L’un des premiers résultats de la contestation populaire du 22 février est d’avoir mis à nu le système politique algérien dans lequel il y a désormais deux acteurs politique visibles qui se font face : le peuple qui occupe la rue chaque vendredi et l’état-major qui espère une baisse de la mobilisation pour reprendre l’initiative.
Engagés dans un rapport de force sans concessions, ces deux acteurs cherchent à influer sur le cours des événements pour atteindre leurs objectifs respectifs divergents. Le peuple veut enlever à l’état-major l’attribut de la souveraineté nationale qui lui a permis jusqu’à présent de désigner le président à travers des élections truquées et de choisir les députés qui représentent la population.
En s’attribuant une prérogative qui appartient au peuple, l’état-major se comporte comme le Bureau Politique d’un parti stalinien et non comme le commandement militaire d’une armée républicaine. En confiant au DRS la mission de gérer le champ politique, le commandement militaire a coupé l’Etat de ses racines sociales et idéologiques et l’a orienté vers la corruption généralisée.
L’objectif du peuple est de casser ce mécanisme qui empêche les institutions de l’l’Etat d’être représentatives de la population. Il veut que l’Etat se réarticule à la société et qu’il tienne compte de ses demandes. Le peuple veut le transfert de la légitimité militaire, héritée des vicissitudes de l’histoire, à la légitimité populaire véhiculée par l’alternance électorale.
Face à la revendication exprimée par des millions d’Algériens depuis le 22 février, l’état-major a donné l’impression d’avoir entendu le peuple, et a congédié le cadre à la chaise roulante qui faisait fonction de chef d’Etat. Le général Gaid Salah a même affirmé son attachement à l’article 7 de la constitution stipulant que le peuple est la seule source du pouvoir.
Les révolutionnaires du 22 février avaient le sourire en croyant que la fibre nationaliste et l’amour de la patrie avaient enfin pénétré les bureaux du ministère de la défense. Mais la désignation le 9 avril de Bensalah comme président intérimaire, sur instruction de l’d’état-major à ses marionnettes du FLN et du RND, a montré quelles étaient les véritables intentions de la hiérarchie militaire.
Avec le recul, la stratégie de l’état-major devient plus claire ; elle cherche à remplacer les anciennes marionnettes discréditées et démonétisées par des marionnettes qui n’ont jamais servi. Ce qui signifie que le général Gaid Salah a menti, et qu’il a confié à Bensalah la mission de mener une transition avec un nouveau personnel coopté à travers des élections truquées.
Ceci n’est pas un procès d’intention puisque le président par intérim n’avait pas de légitimité en tant que président du Conseil de la nation. En tant que sénateur, il n’était pas représentatif de la circonscription où il habite. Par conséquent, la transition ne peut être menée par le personnel discrédité et illégitime de l’ère Bouteflika. Le peuple parle de la légitimité et l’état-major parle de la légalité. Mais quelle est la source de la légalité si ce n’est pas la légitimité populaire ?
C’était cependant naïf de croire que les généraux allaient accepter une transition réelle vers l’Etat de droit qui signifie la séparation des pouvoirs et la liberté de la presse. Non pas qu’ils soient opposés à l’Etat de droit pour des raisons idéologiques. La réalité est qu’ils ont peur que le nouveau régime leur demande des comptes sur les violations de droits de l’homme et sur la corruption. Ils comptent sur une décrue de la mobilisation pour faire sortir les chars à Alger. Les généraux jouent avec le feu car ni l’Etat et encore moins l’armée ne leur appartient. Ils font face à un problème politique qui demande une réponse politique. Et les Algériens sont décidés à entrer en possession de ce qui leur appartient : l’Etat et l’armée.
Les généraux répondent par la ruse en attendant d’utiliser la force. En pleine tempête révolutionnaire, comme tout régime sur le point de s’effondrer, ils se réfugient derrière « leur » constitution. Mais les Algériens savent, par expérience, que la constitution a toujours été invoquée pour réprimer leurs revendications légitimes. La constitution algérienne a été conçue pour protéger le pouvoir exécutif et non le peuple ; c’est un texte qui donne une base juridique à l’autoritarisme du pouvoir exécutif et qui lui permet d’emprisonner les syndicalistes et de poursuivre devant les tribunaux les défenseurs des droits de l’homme.
En invoquant la légalité constitutionnelle pour remplacer Bouteflika par Bensalah, l’état-major se coupe de la nation et prend la direction de la contre-révolution. Les généraux devraient demander à Vaujour et à Massu ce qui se passe quand un peuple entre dans une phase révolutionnaire.
* Lahouari Addi est universitaire
Important : Les tribunes publiées sur TSA ont pour but de permettre aux lecteurs de participer au débat. Elles ne reflètent pas la position de la rédaction de notre média.
___________________
TSA
Débats et Contributions: Par: Lahouari Addi* 29 Mars 2019 à 07:55
Cette question se pose depuis longtemps en Algérie dans les discussions quotidiennes et dans les articles de presse où est utilisée l’expression « le pouvoir » pour désigner les gouvernants. Malgré le flou qu’elle implique, nous savons cependant plus ou moins que cette expression renvoie à un mécanisme d’exercice de l’autorité de l’Etat au centre duquel il y a la hiérarchie militaire.
Pour des raisons historiques, l’Etat algérien s’est construit à partir de l’armée, mais l’élite militaire a raté l’occasion d’octobre 1988 pour se retirer du champ de l’Etat. Se substituant à la souveraineté populaire, la hiérarchie militaire ne déclare pas officiellement qu’elle est la source du pouvoir en lieu et place de l’électorat. Mais tout le monde sait que c’est elle qui désigne le président.
Comment alors analyser le régime algérien alors qu’il est incompatible avec l’ordre constitutionnel ? La science politique a des difficultés à étudier le régime algérien qui relève plutôt de l’anthropologie politique mieux outillée conceptuellement pour analyser les rapports d’autorité formels et non formels. Sa particularité est que les institutions ne véhiculent pas toute l’autorité de l’Etat. Ces derniers jours, des responsables de partis de l’administration parlent de « forces extraconstitutionnelles » qui interfèrent dans la prise de la décision politique.
Quelle est la structure officielle de l’Etat en Algérie ? Théoriquement il est dirigé par un président élu au suffrage universel à l’issue d’une campagne électorale à laquelle prennent part différents partis, y compris ceux de l’opposition légale. Le président met en œuvre une politique traduite par des lois votées à l’Assemblée nationale par des députés eux aussi élus au suffrage universel. Théoriquement, il y a donc un pouvoir exécutif issu des urnes, un pouvoir législatif représentant de la volonté populaire et un pouvoir judiciaire indépendant qui protège l’exercice des droits civiques des citoyens. Il y a même un conseil constitutionnel qui veille à la constitutionnalité des lois et décrets. Cette structure institutionnelle est portée par des partis politiques qui expriment les différents courants idéologiques de la société et qui se disputent le pouvoir exécutif à travers des élections libres et pluralistes.
Le seul problème est que ce schéma ne correspond pas à la réalité. Par le trucage des élections, le pouvoir exécutif, mandaté par la hiérarchie militaire, empêche le corps électoral de se donner les représentants qu’il veut. La réforme de la constitution de février 1989 a mis fin au système de parti unique, mais le régime a perverti le pluralisme en truquant les élections pour empêcher toute alternance. Le pluralisme a été une façade derrière laquelle l’armée a continué d’être la source du pouvoir en lieu et place du corps électoral.
Si le régime post-88 est sur le point de s’effondrer, c’est parce qu’il n’a pas de cohérence politico-idéologique. En comparaison, le régime de Boumédiène était plus cohérent. Celui-ci disait : les chouhadas m’ont demandé de diriger le peuple pour faire son bonheur. Par conséquent, je suis l’Etat, et celui qui n’est pas content, il n’a qu’à quitter le pays. L’autoritarisme de Boumédiène était cohérent et clair et ne s’encombrait pas d’arguties d’une constitution copiée sur celle de la 5èm république française. Le modèle de Boumédiène a survécu à son fondateur avec un faux pluralisme.
Evidemment, les militaires n’interviennent pas directement en tant que tels dans le champ de l’Etat. Les généraux de l’Etat-Major ont d’autres tâches à accomplir, notamment l’entretien du niveau opérationnel des troupes. Ils ont cependant confié à la direction de l’espionnage la tâche de gérer le champ politique. A l’exception du président désigné par la hiérarchie militaire, ce service d’espionnage appelé DRS, désigne le Premier ministre et supervise avec le président la formation du gouvernement.
Les dernières déclarations de Amar Saidani à TSA le confirment. Ouyahya est désigné comme premier ministre par le DRS. Ce qui signifie que Bouteflika ne nomme pas le premier ministre, et ne choisit pas son équipe ministérielle. Tous ses fidèles ont été éjectés du gouvernement : Belkhadem, Zerhouni, Ould Abbès, Benachenhou.
Le DRS filtre aussi les listes des candidats aux fonctions électives nationale et locale (APN, APW, APC). Il décide des résultats électoraux en donnant aux partis des quotas de sièges en contrepartie de la fidélité au pouvoir administratif. En outre, il noyaute toutes les institutions de l’Etat (police, douanes, gendarmerie…) pour s’assurer que les fonctionnaires ne remettent pas en cause la règle non écrite du système politique algérien : l’armée est seule source du pouvoir. Le service politique de l’armée infiltre aussi les partis d’opposition, pour les affaiblir de l’intérieur en créant des crises au niveau des directions. Le dernier parti victime de cette pratique est le FFS. Il contrôle la presse par le chantage à la publicité.
La mission du DRS est de dépolitiser la société pour se poser en seule expression politique émanant de la hiérarchie militaire. Ce modèle a pu fonctionner dans les années 1970 parce que l’armée comptait 40 colonels. Il ne peut pas fonctionner aujourd’hui avec 500 généraux qui exercent peu ou prou une parcelle de l’autorité de l’Etat, avec en plus leurs réseaux de clientèle se disputant des parts de la rente pétrolière. L’anarchie militaire au sommet de l’Etat a empêché celui-ci de fonctionner conformément à ses institutions formelles. L’affaire Tebboune le montre clairement.
Après l’annulation des élections par les généraux janviéristes en 1992, le DRS a eu un rôle stratégique dans la lutte anti-terroriste, ce qui lui a donné un poids important dans la prise de la décision politique. Au fil des années, il s’est quasiment autonomisé de l’Etat-Major dont formellement il dépend organiquement. Des généraux se sont plaints de la concentration de pouvoir entre les mains du chef du DRS, le général Tewfik Médiène, connu aussi sous le nom de « Rab Edzair » (Dieu d’Alger). Un conflit larvé divisait la hiérarchie militaire, surtout que les officiers du DRS occupaient des places stratégiques dans les circuits de répartition de la rente pétrolière.
Le conflit entre l’Etat-Major et la direction du DRS éclatera au lendemain de l’attaque du complexe gazier de Tiguentourine en 2013. Selon les informations qui circulent à Alger, l’Etat-Major a reproché au DRS soit d’avoir manipulé des islamistes pour planifier l’attaque de ce complexe gazier (c’est ce que affirme Amar Saidani), soit d’avoir été incapable de protéger un endroit stratégique d’extraction de la rente pétrolière. L’Etat-Major a décidé la réorganisation du DRS, après avoir mis à la retraite plusieurs généraux. L’un d’eux, le général Hassan a été arrêté et condamné par un tribunal militaire à 5 ans de prison.
Mais l’Etat-Major n’a pas informé le public sur les raisons de cette restructuration des services de sécurité. Il a demandé à Amar Saidani, responsable du FLN à l’époque, d’attaquer le général Tewfik qu’il a accusé de s’opposer à l’Etat de droit, à la liberté de la presse et à l’autonomie de la justice. Un étudiant en sciences politiques avait écrit sur sa page Facebook : « A la tête du FLN, Saidani a eu le temps de lire Jean-Jacques Rousseau ! ». Une fois le DRS réorganisé, l’Etat-Major a mis fin aux fonctions de Saidani à la tête du FLN.
Suite à cet épisode, le DRS a été divisé en deux parties. L’une sera chargée de l’espionnage pour défendre les intérêts du pays contre les ingérences de puissances étrangères, et l’autre confiée au général Bachir Tartag chargée de la gestion de la société civile et aussi de la surveillance des fonctionnaires de l’Etat. Le bureau de Tartag a été domicilié à la présidence pour montrer qu’il est sous l’autorité du président. Le DRS propage les rumeurs selon lesquelles Bouteflika aurait domestiqué l’armée. Avant de mettre à la retraite le puissant général T. Médiène, il aurait mis fin aux fonctions de Mohamed Lamari, alors chef d’Etat-Major. La vérité est que ce dernier a été démis par l’Etat-Major après ses déclarations au journal Al-Ahram et à l’hebdomadaire français Le Point en 2004 où il montrait que l’armée est au-dessus du président. Les généraux, dont l’autorité est en effet au-dessus de celle du président, ne veulent pas que cela se sache.
Cette propagande vise à cacher la véritable nature du régime algérien où la hiérarchie militaire exerce le pouvoir réel. Il existe bien sûr le clan de Bouteflika, composé de ses frères, d’importateurs et d’entrepreneurs de travaux publics. Ce clan a le pouvoir de relever de ses fonctions un responsable de douane qui refuse de violer la règlementation, de suspendre un wali qui aura été nommé par un clan rival, de muter au sud un magistrat soucieux de l’application de la loi, de bloquer une entreprise comme Cevital, etc. Mais le pouvoir, ce n’est pas violer la loi. Ces abus de pouvoir ne se produisent que parce que l’armée refuse que la justice soit autonome. Le clan de Bouteflika est né et a grandi à l’ombre d’un système politique centré sur l’armée. Il a donné naissance à une bourgeoisie monétaire vorace et prédatrice qui se nourrit de marchés publics, associant des enfants de généraux dans des activités commerciales d’importation.
Où en est-on aujourd’hui et comment sortir de la crise actuelle ? Composée de jeunes généraux nés dans les années 1950 et 1960, la hiérarchie militaire doit répondre à la demande de changement de régime exprimée par des millions de citoyens. Elle ne devrait pas faire les erreurs fatales des hiérarchies précédentes qui ont opéré quatre coups d’Etat (1962, 1965, 1979, 1992), tué un président et fait démissionner deux.
L’évolution de la société algérienne exige un réajustement de l’Etat en fonction des transformations culturelles et sociales des dernières décennies. Si ce réajustement est refusé, le mouvement de protestation va se radicaliser et beaucoup de sang coulera. Les jeunes généraux doivent être à la hauteur des exigences de l’histoire.
*Lahouari Addi est Universitaire
__________
MAGHREB EMERGENT 14 03 2019
DYNAMIQUE RÉVOLUTIONAIRE ET CHANGEMENT DE LÉGITIMITÉ EN ALGÉRIE (contribution)
Depuis le 22 février, l’Algérie est entrée dans une période révolutionnaire qui fondera un nouveau régime. La période révolutionnaire est une phase durant laquelle s’exprime un changement de légitimité demandé par l’ensemble de la société que la violence d’Etat ne pourra pas neutraliser.
Pour des raisons historiques, l’Etat algérien et ses institutions tirent leur autorité de l’armée qui a toujours coopté les élites civiles soit dans le cadre du système du parti unique avant 1988, soit dans le cadre d’élections truquées après 1992. C’est ainsi que la hiérarchie militaire choisit le président, tandis que son instrument politique, le DRS, façonne le champ politique en noyautant les partis d’opposition, les syndicats, la presse, etc. pour les soumettre à la règle non écrite du système : l’armée est seule source du pouvoir et seule instance de légitimation.
Dans un tel schéma, l’autorité du président ne provient pas de la légitimité électorale mais plutôt du soutien de l’armée qui l’aura désigné pour faire fonction de chef d’Etat. Même si la constitution lui donne des prérogatives de chef d’Etat, dans les faits le président ne fait qu’entériner les orientations décidées par la hiérarchie militaire.
La présidence est l’institution par laquelle transitent les décisions prises au ministère de la défense, appliquées par les ministères et justifiées par les partis de l’administration, FLN et RND. Pour la hiérarchie militaire, il est crucial de choisir un président docile et obséquieux qui accepte ce schéma car sa hantise est de se retrouver face à un Erdogan qui lui enlève le pouvoir de légitimation.
L’histoire montre que sur les quatre présidents après la mort de Boumédiène, deux ont été poussés à la démission brutale après menace physique, (Chadli Bendjedid et Liamine Zéroual) et un a été assassiné (Mohamed Boudiaf). Si Bouteflika est depuis 20 ans en fonction, c’est parce qu’il a accepté la suprématie du militaire sur les institutions, tout en manœuvrant pour essayer d’opposer des généraux les uns contre les autres. En 2003, le DRS lui avait interdit de s’adresser directement aux Algériens, suite à un discours où il avait dit que « 14 généraux contrôlaient le commerce extérieur ».
C’était indigne d’un président qui parlait comme un citoyen ordinaire qui se plaignait dans un café à Alger. La propagande selon laquelle Bouteflika s’était imposé aux généraux provient du DRS dont la tâche est de montrer que les généraux sont sous les ordres d’un président devenu autoritaire. Il s’agissait de cacher le mécanisme d’appropriation de la légitimité par la hiérarchie militaire qui n’a jamais été aussi puissante que sous Bouteflika.
Que la famille de Bouteflika et ses amis se soient enrichis, ce n’est pas étonnant dans un pays où la justice n’est pas autonome. Mais le pouvoir, ce n’est pas la capacité de voler l’argent de l’Etat. Il faut savoir qu’en Algérie, le président (et c’est encore plus vrai pour Bouteflika) n’a pas le droit de promouvoir des officiers supérieurs et de s’immiscer dans l’équilibre de la hiérarchie militaire, de chercher à résoudre la question du Sahara occidental, de définir les relations avec la France. Ce n’est pas lui qui désigne le premier ministre, ni les ministres des affaires étrangères, de l’intérieur et de la justice.
La répartition de la rente pétrolière dans le budget de l’Etat entre les différents ministères ne relève pas de sa responsabilité. La lourde maladie de Bouteflika depuis 2013 est une preuve supplémentaire que le président algérien n’a qu’un rôle symbolique. Il est une poupée, rendue pathétique par la maladie, entre les mains de décideurs qui se réunissent régulièrement pour évaluer la situation politique du pays et qui prennent des décisions envoyées à la présidence pour application. Les dernières mesures annoncées lundi 11 mars ne pouvaient être prises par une personne à peine consciente de son état.
Cette structure politique de l’Etat a atteint ses limites avec une société plus exigeante et plus cultivée. Les jeunes générations n’acceptent plus que leur Etat soit dirigé par des structures clandestines dépendant du ministère de la défense. Ellesmettent en avant le projet de Abane Ramdane, et pour lequel il a été tué, et celui du Congrès de la Soummam, en exigeant la primauté du civil sur le militaire.
A cette demande, les généraux leur répondent par la ruse : extension du 4èm mandat et transition menée par des civils porte-parole des généraux. Si la politique, dans tous les pays, est 80% de compromis, 10% de ruse et 10% de violence, pour les généraux algériens, la politique c’est 48% de ruse, 48% de violence et 4% de compromis. Mais cette fois-ci, les jeunes manifestants ne rentreront chez eux que lorsque le changement de légitimité s’opérera.
Ils ont avec eux l’histoire, la société et même une partie de l’armée qui ne se reconnaît pas dans les choix politiques des généraux. Ils veulent un changement de légitimité de l’autorité publique et rien ne les arrêtera jusqu’à la satisfaction de cette demande. Ils obligeront les généraux à ne plus choisir le président et les députés à leur place.
Les jeunes manifestants ne sont pas contre l’armée, et ils voudraient être fiers d’elle. C’est le sens du slogan « djeich chaab khawa khawa ». Ils veulent une armée moderne, républicaine, épurée de généraux faiseurs de rois. Ils veulent une armée qui obéisse à l’autorité civile exercée par des élus du peuple. Les jeunes manifestants ont montré plus de maturité que les généraux lorsqu’ils crient que l’armée appartient au peuple et non à une hiérarchie militaire qui a donné naissance à un régime corrompu.
L’Algérie est entrée dans une phase révolutionnaire qui rappelle les révolutions française, russe et iranienne. C’est une révolution de changement de légitimité et l’ancien régime ne peut s’y opposer ou la détourner. Si des généraux font l’erreur d’utiliser la force pour réprimer des manifestants, l’unité de l’ANP serait en péril parce que de nombreux officiers sont au diapason avec la jeunesse.
Il vaut mieux que le régime ne s’oppose pas la demande de changement de légitimité des institutions de l’Etat. A cette fin, les décideurs doivent accepter le caractère public de l’autorité de l’Etat. Ils doivent demander à celui qui fait fonction de président aujourd’hui de démissionner et de nommer une instance de transition qui exerce les fonctions de chef d’Etat.
Mustapha Bouchachi, Zoubida Assoul et Karim Tabbou devraient être sollicités pour exercer les prérogatives d’une présidence collégiale qui nommera un gouvernement provisoire qui gérera les affaires courantes et préparera les élections présidentielle et législative dans un délai de 6 à 12 mois. Les généraux doivent aider à la réalisation de ce scénario et se dire une fois pour toute que l’armée appartient au peuple et non l’inverse.
LahouariAddi
Professeur émérite de sociologie
—————-
L’ULTIME APPEL À LA RAISON
El Watan- 27 février 2019 à 10 h 02 min
La vague de manifestations pacifiques du vendredi 22 février à travers l’ensemble du territoire national marque un tournant décisif dans l’évolution de la situation politique dans notre pays. Les Algériennes et les Algériens de toutes les régions du pays ont montré une maturité que n’ont pas les dirigeants.
Les citoyennes et les
citoyens ont exprimé sans ambiguïté leur ferme volonté de reprendre leur destin
en main.
Cette mobilisation historique a libéré les consciences, brisé les barrières de
la peur et du silence et mis du mouvement dans le statu quo. Elle est porteuse
d’espoir.
Aucune force ne peut venir à bout d’un consensus né d’une mobilisation commune autour d’une aspiration partagée.
La reprise de l’initiative politique par la société revêt un sens profond. L’ignorer condamnerait le pays à revivre les drames d’un passé récent.
Par ses extravagances et la persévérance dans la gabegie, le pouvoir a provoqué l’exaspération des citoyens. La candidature de Bouteflika pour un 5e mandat fut la provocation de trop. Qui peut croire que les populations déjà éprouvées par des années d’humiliation puissent accepter sans réagir un affront d’une telle énormité ?
Le pouvoir ne peut plus persister dans le déni des droits et des libertés. Il est inconcevable qu’au XXIe siècle, l’Algérien soit encore privé du droit de choisir librement ses représentants ou de les sanctionner. Plus révoltant encore, les décideurs en Algérie sévissent dans l’anonymat. Ils ne sont ni identifiés ni soumis au devoir de rendre des comptes.
Le refus de l’institutionnalisation est un héritage du mouvement national. Inaugurée par l’assassinat de Abane et la répudiation des principes consignés dans la Plate-forme de la Soummam, cette tradition demeure à ce jour en vigueur.
Les vicissitudes de notre histoire ont imposé un schéma politique où le commandement militaire s’est d’emblée posé en détenteur exclusif de la souveraineté nationale. Cette configuration est désormais dépassée.
Elle l’est, d’autant plus que le long règne de Bouteflika a provoqué des mutations perverses dans le système comme dans la société et imprimé au mode de gouvernance une dérive oligarchique maffieuse jamais observée par le passé.
Cela a accéléré la
déliquescence du système. L’impasse est totale. Elle est par ailleurs
indépassable.
Vouloir maintenir coûte que coûte le statu quo fait courir des risques graves à
la stabilité et l’unité nationales. L’option électorale, avec ou sans
Bouteflika, ne peut constituer une solution.
Certes, le départ de Bouteflika est une exigence populaire légitime et indiscutable. Mais il ne peut à lui seul créer les conditions d’une compétition libre et sincère, conforme aux standards internationaux. Le système autoritaire est un objet monstrueux fortement enraciné et innervant l’ensemble des institutions et structures du pays. Sa déconstruction nécessite de la volonté, de l’effort, de la pédagogie et de la patience.
La seule issue salutaire pour le pays est une transition démocratique orientée vers la construction d’un Etat de droit. Elle doit être la plus courte possible, loin de tout esprit de règlement de comptes et se conclure par l’organisation d’élections générales. Avec un bilan des plus désastreux et une révolte populaire grandissante, le régime n’a plus de marge de manœuvre. Le pays se trouve à la croisée des chemins.
Il a le choix entre la transition démocratique, à l’exemple de nos voisins tunisiens, et l’aventure destructrice, comme c’est le cas en Libye et en Syrie. La fonction historique de ce système est épuisée depuis déjà fort longtemps. Les émeutes d’Octobre 1988 ont imposé une ouverture dans la douleur. Cependant, par son génie maléfique et ses échafaudages diaboliques, le système est parvenu à se maintenir. C’est, hélas, au prix d’un drame incommensurable. Va-t-il céder aujourd’hui à cette même tentation ? Rien ne peut l’en empêcher, si ce n’est un sursaut patriotique fort et immédiat.
Dans ce contexte d’une extrême tension, l’institution militaire est fortement interpellée. Elle se trouve devant un choix historique. L’intérêt stratégique du pays lui commande de se mettre du côté de la population et au service de la solution. Elle doit jouer le rôle de facilitateur et de garant de la transition démocratique. L’ordre ancien est fini. Vouloir le maintenir ou le ressusciter autrement serait désastreux.
La restitution de la souveraineté au profit du corps des citoyens est une obligation dont les indus détenteurs actuels, civils ou militaires, ne peuvent s’affranchir. Ce transfert est au cœur du processus de changement. C’est également l’objet central de la transition.
Enfin, l’opposition est condamnée à se mettre au diapason du mouvement populaire. Il n’est dans l’intérêt de personne d’aller vers un face-à-face pouvoir/société. Il est vain de vouloir construire une démocratie dans le calme et la sérénité sans intermédiation.
Par Lahouari ADDI (sociologue engagé) et Djamel ZENATI (militant de la démocratie)
_____________
DZVID_ 01.09.2019
Lahouari Addi : « Dire que l’armée accompagne le hirak est faux, Belhimer »
Par La Rédaction
Le sociologue Lahouari Addi et Ammar Belhimer, membre du panel, ont échangé au sujet du hirak et les réseaux sociaux.
Le hirak, le dialogue, la transition sans l’armée sont entre autres les sujets débattus entre Lahouari Addi et Ammar Belhimer dans cet échange. Nous vous proposons de le lire.
« Monsieur Belhimer, personne n’est contre le dialogue, mais le dialogue exige que l’autre partie soit prête et qu’elle le soit sincèrement. Or, le commandement militaire ne montre aucune prédisposition au transfert de la souveraineté vers une autorité civile. Peut-être qu’il pense que ce transfert doit s’étaler sur un ou deux mandats présidentiels (5 ou 10 ans), alors qu’il le dise publiquement. Qu’il dise qu’il y a des dossiers trop lourd hérités de la décennie 90 qui empêchent un transfert du pouvoir aux civils dans l’immédiat (affaires Boudial, Merbah, Khalifa…).
Les citoyens comprendront et un compromis sur ces affaires délicates sera trouvé. Par ailleurs, le dialogue ne peut pas se mener avec un champ médiatique sous embargo. La chaîne de TV publique ressemble à celle de la Corée du Nord. Les journaux privés subissent le chantage de la publicité, El Watan est au bord de l’étouffement. Il est impossible qu’un dialogue serein et sérieux se mène dans ces conditions. Les membres de l’État-Major tablent sur un essoufflement du mouvement populaire, et je pense qu’ils se trompent. La revendication d’un pouvoir civil vient des profondeurs de la société et elle ne disparaîtra pas d’elle-même.
Les manifestants disent: « Nos parents ont créé une armée pour défendre le pays et non pour qu’elle choisisse les civils qui dirigent l’Etat ». Ils sont dans le sens de l’histoire et rien ne les arrêtera. Il faut trouver un compromis qui satisfait cette revendication de pouvoir civil tout en tenant compte des craintes de l’EM quant à d’éventuels règlements de compte et de chasse aux sorcières.
Ammar Belhimer. Cher confrère. Pour l’avoir déjà écrit, deux tendances lourdes se disputaient l’alternance au régime autocratique antérieur au 22 février 2019, en dehors de toute règle de droit préétablie et obéie: une tendance prétorienne, affairiste, de parvenus – résultat d’une accumulation aussi fulgurante que phénoménale qui oeuvre à être aussi bien dirigeante politiquement que dominante socialement- d’une part, une tendance patriotique, héritière de la légitimité historique en phase finale d’existence, de plus en plus marginalisée, d’autre part.
Les deux monnaient leur existence et leur développement avec une vague islamiste en quête d’un statut identitaire de substitution, l’ensemble évoluant sur fond de parrainages extérieurs divers.
Ces contradictions ont, depuis peu, dépassé le cadre étroit des vieilles superstructures héritées de la guerre de libération et des espaces étroits de conciliation qui ont survécu à la répression (syndicats, partis, etc).
Enfin, la demande de changement se focalise sur des revendications à caractère républicain, démocratique, de libertés. L’armée accompagne le processus sans prendre directement partie à la gestion politique directe des choses. Elle a bien raison de faire ainsi car dans le vide sidéral hérité de l’ancien système, elle est la seule institution qui supplée la carence affectant tous les autres espaces de médiation, d’arbitrage, de surveillance, etc. Elle accompagne une révolution pacifique, la protège et se refuse de la confisquer, à la sécurisation des frontières, compte tenu des instabilités des pays voisins (Libye, Mali en particulier).
L’institution
judiciaire me semble reprendre laborieusement mais courageusement son souffle
après une longe période de vile instrumentalisation et c’est tant mieux pour
l’Etat de l’droit auquel nous aspirons tous les deux.
Lahouari Addi. Cher
collègue, merci pour votre réponse rapide ; elle n’est cependant pas
satisfaisante. Les divergences au sein de la hiérarchie ne sont pas celles que
vous décrivez. Les affairistes ne sont pas un courant politique, ce sont des
individus fragiles politiquement (Hamel est en prison, Chentouf est en fuite…).
Beaucoup d’entre eux ont été écartés parce qu’ils ont discrédité l’institution
militaire (affaires de la cocaïne, entre autres).
Au-delà des convictions idéologiques des généraux qu’ils n’étalent pas entre eux, la hiérarchie est divisée sur un critère: le rôle de l’armée dans le champ de l’Etat. La vieille garde (Gaïd Salah) considère que si l’armée renonce au pouvoir souverain de désigner les dirigeants civils, l’unité nationale sera en danger et le pays perdra son indépendance. L’autre courant, qui regroupe de jeunes généraux, pense qu’il est temps de se retirer du champ de l’Etat et faire ce que les Turcs ont fait. Ce qui handicape ce deuxième courant, c’est l’héritage de la décennie 90.
Si les militaires se retirent du champ de l’Etat brutalement, beaucoup d’officiers supérieurs craignent d’être poursuivis par la justice. La solidarité de corps empêche la jeune génération d’officiers d’imposer sa solution.
Quant à dire que l’armée accompagne le hirak, c’est faux. La protestation est si massive que l’armée ne peut pas réprimer.
Le colonel Belhouchet a démissionné de l’armée fin 1988 en laissant une phrase célèbre. Il était outré que l’armée tire sur des jeunes. L’armée algérienne n’est pas une armée qui défend un roi pour qu’elle tire sur des manifestations pacifiques où il y a des enfants et des grand-mères. Par conséquent, l’EM n’est pas en capacité politique de donner l’ordre de tirer sur les manifestants.
S’il n’y avait à Alger que 2000 manifestants, ils auraient donné cet ordre. Donc dire que l’EM accompagne le hirak, est faux. Il fait tout pour l’étouffer.
Ammar Belhimer. Je m’appesantis sur les tendances lourdes, tu fixes les personnes, dans un échange qui ne relève pas de cet espace, mais qui mérite d’être poursuivi sur un terrain plus approprié. On reste en contact. Amitiés
Lahouari Addi. C’est une reconnaissance explicite que les conditions du dialogue ne sont pas réunies. C’est ce que disent les manifestants. Amitiés
__________________
news algerie.com
Lahouari Addi et Djamel Zenati signent un texte commun
Par Lynda Meziane
novembre 26, 2019
Nous publions dans son intégralité un texte signé conjointement par Lahouari Addi et Djamel Zenati. Le texte est un appel au peuple algérien.
APPEL AUX CONSCIENCES
La contestation populaire est à son dixième mois. Loin de s’affaiblir, elle ne cesse de s’intensifier et de s’élargir. Elle est installée dans la durée. La longue mobilisation pacifique et unitaire a réussi à faire émerger une nouvelle conscience collective dans le pays. Elle a constitué un rempart solide contre toutes les tentatives de division et de diversion. La détermination sans faille du mouvement a enfin mis en échec les opérations de répression et d’intimidations. Les murs de la peur et du silence sont définitivement brisés et rien ne pourra désormais arrêter les citoyennes et les citoyens dans leur marche pour la liberté et le progrès.
Le commandement militaire, en véritable pouvoir réel, ne semble pas avoir pris la mesure de ce bouleversement profond ni le sens de cette irrépressible aspiration populaire au changement. Otage de paradigmes éculés, il tente par la manière forte de contourner la volonté du peuple.
L’élection présidentielle prévue pour le 12 décembre prochain est inadaptée aux exigences de la situation. Elle est à l’opposé des revendications du Hirak. Le seul but de cette consultation est de garantir la survie du système en place. En effet, le pouvoir réel, en l’occurrence le commandement militaire, est en quête d’une représentation formelle devant lui permettre de poursuivre l’exercice d’une souveraineté confisquée sans avoir à apparaitre ni à rendre des comptes.
En voulant à tout prix imposer une élection massivement rejetée par les citoyennes et les citoyens, le commandement militaire s’inscrit dans la défiance et fait le choix de l’affrontement. Le risque est grand de voir le pays à nouveau plonger dans le drame.
L’évolution qualitative survenue dans l’opinion est incompatible avec le maintien du statu quo ou le retour au régime ancien. La rupture est réelle et demande une traduction politique appropriée. Par leur engagement soutenu, les algériennes et les algériens ont collectivement ressuscité l’utopie libératrice inaugurée par les pères fondateurs de l’Algérie indépendante. Le Hirak est le prolongement logique du mouvement de libération nationale. Ne pas le voir c’est se mettre en marge de l’Histoire. Le Hirak est porteur d’une ambition nationale.
Aussi, le devoir patriotique aujourd’hui commande en priorité à tout un chacun de se mobiliser pour empêcher la tenue de cette aventure électorale. Il commande ensuite de construire les convergences nécessaires à l’élaboration d’une alternative démocratique au chaos programmé. Les énergies du Hirak sont dans ce sens interpellées.
Dans le cas spécifique de notre pays, la première étape de la transition consiste en un transfert de souveraineté du commandement militaire vers le corps des citoyens. C’est une étape incontournable et décisive car elle déterminera tout le reste du processus.
Les algériennes et algériens sont attachés à l’institution militaire. Ils refusent de se projeter dans une opposition avec celle-ci car une telle perspective est absurde et destructrice.
Les officiers supérieurs de l’armée doivent se mettre au diapason des exigences populaires. Il y va de l’intérêt de l’Etat et de l’avenir du pays.
Lahouari ADDI _ Djamel ZENATI
______
–