LE CHOC DES OMBRES – Éditions Incipit en W – Miramas, 2017
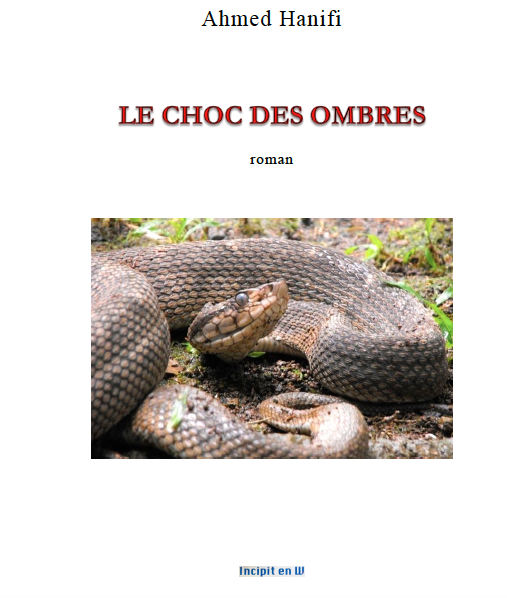
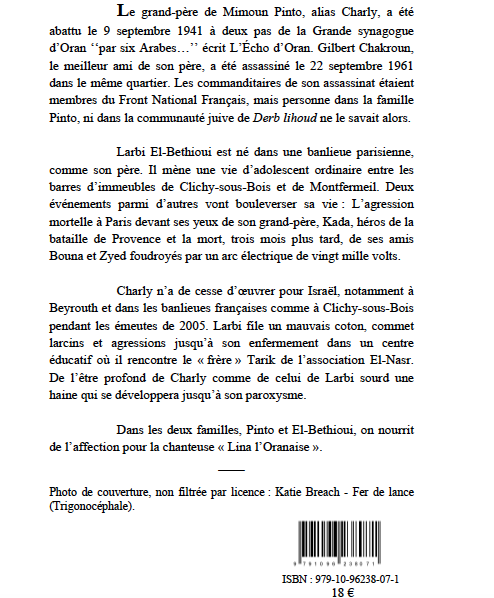
« La conception d’une littérature miroir d’elle-même, s’écartant des phénomènes historiques et sociaux qui constituent ‘‘le politique’’, ou les déréalisant, si bien qu’ils ne peuvent plus toucher ou déranger, je ne la comprends pas, elle m’est presque douloureuse. » Annie Ernaux
« Où que nous regardions, l’ombre gagne. L’un après l’autre, les foyers s’éteignent. Le cercle d’ombre se resserre, parmi des cris d’hommes et des hurlements de fauves. Pourtant nous sommes de ceux qui disent non à l’ombre. Nous savons que le salut du monde dépend de nous aussi. Que la terre a besoin de n’importe lesquels d’entre ses fils. Les plus humbles. L’Ombre gagne… » Aimé Césaire
————–
4° de couverture: Le grand-père de Mimoun Pinto, alias Charly, a été abattu le 9 septembre 1941 à deux pas de la Grande synagogue d’Oran ‘‘par six Arabes…’’ écrit L’Écho d’Oran. Gilbert Chakroun, le meilleur ami de son père, a été assassiné le 22 septembre 1961 dans le même quartier. Les commanditaires de son assassinat étaient membres du Front National Français, mais personne dans la famille Pinto, ni dans la communauté juive de Derb lihoud ne le savait alors.
Larbi El-Bethioui est né dans une banlieue parisienne, comme son père. Il mène une vie d’adolescent ordinaire entre les barres d’immeubles de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil. Deux événements parmi d’autres vont bouleverser sa vie : L’agression mortelle à Paris devant ses yeux de son grand-père, Kada, héros de la bataille de Provence et la mort, trois mois plus tard, de ses amis Bouna et Zyed foudroyés par un arc électrique de vingt mille volts.
Charly n’a de cesse d’œuvrer pour Israël, notamment à Beyrouth et dans les banlieues françaises comme à Clichy-sous-Bois pendant les émeutes de 2005. Larbi file un mauvais coton, commet larcins et agressions jusqu’à son enfermement dans un centre éducatif où il rencontre le « frère » Tarik de l’association El-Nasr. De l’être profond de Charly comme de celui de Larbi sourd une haine qui se développera jusqu’à son paroxysme.
Dans les deux familles, Pinto et El-Bethioui, on nourrit de l’affection pour la chanteuse « Lina l’Oranaise ».
+++++++++++++++++++
LE TEXTE COMPLET
Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé ne serait que purement fortuite. Toutefois, le lecteur reconnaîtra ici et là dans cette fiction des propos tenus par des hommes ou des femmes appartenant à la sphère intellectuelle, politique ou médiatique…
« La conception d’une littérature miroir d’elle-même, s’écartant des phénomènes historiques et sociaux qui constituent ‘‘le politique’’, ou les déréalisant, si bien qu’ils ne peuvent plus toucher ou déranger, je ne la comprends pas, elle m’est presque douloureuse. »
Annie Ernaux
« Où que nous regardions, l’ombre gagne. L’un après l’autre, les foyers s’éteignent. Le cercle d’ombre se resserre, parmi des cris d’hommes et des hurlements de fauves. Pourtant nous sommes de ceux qui disent non à l’ombre. Nous savons que le salut du monde dépend de nous aussi. Que la terre a besoin de n’importe lesquels d’entre ses fils. Les plus humbles.
L’Ombre gagne… »
Aimé Césaire
« La mer ! Partout la mer ! Des flots, des flots encore… » La houle cogne inlassablement contre la coque du navire. En pleine mer, il n’y a qu’elle, la mer. Le lancement du compte à rebours de l’opération Anvil Dragoon est inscrit sur le tableau des souvenirs depuis une quarantaine d’heures, et Naples n’est plus qu’un nom. Le soleil est sur le point de précipiter les débris de la nuit dans sa lumière vaporeuse. Le Golfe de Saint-Tropez se trouve maintenant à quelques dizaines de miles, et à cette distance il figure un croissant de lune déformé. Le chef du 3e Régiment des tirailleurs algériens, le colonel de Linarès, porte une nouvelle fois son regard sur sa montre à gousset. Sous peu, il commandera à ses troupes de se préparer à l’accostage. Kada El-Bethioui et son camarade Hamid Ben Merzouga rassemblent leur paquetage avec un enthousiasme que ne refrène pas l’incertitude des jours à venir. Ils sont tous les deux parmi les deux cents turcos de la 1re compagnie du 3e RTA. On les appelle « les hirondelles de la mort ». Ils ont hâte de retrouver la terre ferme après tout ce temps passé en mer à chanter et à jouer aux cartes lorsqu’ils n’exécutaient pas un ordre ou ne dormaient pas.
Huit jours avant, les tirailleurs embarquaient à Oran. À Naples, étape imprévue, ils n’eurent pas l’autorisation de quitter le navire. Kada ne mit jamais les pieds dans un avion, et c’est aussi la première fois qu’il prend le bateau. Autour de lui, des soldats montrent des points à l’horizon qui se transforment au fur et à mesure de l’avancée du bâtiment de guerre en monts, en blocs, en immeubles. Le rivage enfin s’offre aux tirailleurs impatients. Le débarquement du croiseur Duguay-Trouin se déroule sur la plage de Sainte-Maxime dans un mélange de bousculades, de bavardages et de chants. L’excitation va crescendo, les troupes braillent :
« … Les turcos sont des Français noirs
Ils sautent dans l’herbe sanglante
Allah ! Ils grimpent à l’assaut
Et quand ils arrivent en haut
Les turcos ne sont plus que trente
Les turcos, les turcos sont de bons enfants… »
Derrière la plage, les premiers monticules passés, les effluves enivrants des plantes et les stridulations des insectes incitent à la légèreté. Les exhalaisons vont, de nouveau, se développer jusqu’à saturation. La chaleur appréhendée le matin est torride en milieu de journée de ce mardi de l’assomption, lorsque les troupes prennent la route de Cogolin. Elles pénètrent dans le massif des Maures, de Collobrières à Pierrefeu-du-Var. Dans ces bourgs en détresse, des chiens hurlent à la mort. Les bouches sont fermées, les regards suffisent à dire toutes les difficultés éprouvées, parfois un geste. Les soldats contournent Solliès-Pont et plus au sud La Valette-du-Var. Le but assigné est d’atteindre Toulon dans les meilleures conditions possible. Kada se demande s’ils vont encore marcher deux ou dix heures avant d’atteindre le but. Il parle peu, préoccupé par le poids de son barda et du fusil à baïonnette, du casque, de la gourde, du piolet… C’est que Kada est chétif, pas grand, « un mètre soixante-six tout au plus » lui avait annoncé le médecin de la compagnie, un brin moqueur. Le beau sourire accroché aux lèvres et la fine moustache carrée posée sous un nez aquilin lui donnent un air des plus sympathiques. Il avance dans ces terres inconnues écrasées de soleil, comme chez lui, tellement semblables à la corniche oranaise. La végétation aspire puissamment le feu des rayons de soleil avant de le répandre, parfumé. Il pénètre alors jusqu’au plus profond des corps engourdis des soldats. Soleil et chaleur qu’aussitôt la brise marine tombée à la fin du jour, les militaires regrettent. Kada est épuisé. Son souffle court est celui du marcheur arrivé au terme d’un long et harassant parcours. Hamid est autant fatigué, mais il continue de parler. Son désir, sa faiblesse immédiate il la confia à son ami, « cahwa hamia khouya Kada kima taâ echibaniya », un café chaud mon frère Kada, comme celui de ma mère. Les soldats de la première compagnie du 3e RTA, menés par le lieutenant Alland rentrent les premiers dans Toulon nord le vingt août en fin de journée, aidés par des résistants des FFI, les Forces françaises de l’intérieur. Les rues de la ville sont quasiment désertées par les habitants. Quelques hommes hagards, paralysés par l’épuisement et l’incertitude, avancent à tatillon en longeant les façades calcinées des bâtiments contre lesquelles chancellent des poteaux électriques déracinés. Les accrochages avec l’ennemi sont nombreux. Les jours suivants, d’autres troupes accourues en renfort, pénètrent dans la ville : 3e RSAR, 1re DFL, 6e RTS… Les Allemands sont désorientés. La reddition du colonel Widmann a lieu le samedi 26. Toulon est libérée par tous ces hommes venus du Maghreb et d’Afrique noire, soutenus par les alliés et tous les résistants, « des gens de toutes les couleurs, de toutes les religions, de toutes les opinions politiques, mobilisés pour libérer la France ». Le lendemain, Kada, son camarade Hamid et des milliers d’autres Français musulmans d’Algérie, exténués, mais heureux, défilent fièrement auprès de leurs frères d’armes sur le boulevard de Strasbourg, acclamés par des centaines de Toulonnais enthousiastes, désormais libres.
Hamid Ben Merzouga fut tué la semaine qui suivit la libération de Toulon, écrasé par une jeep conduite par un soldat français ivre. Il semble à Kada qu’il ne pourra jamais dissocier de la victoire remportée sur l’ennemi, la disparition de Hamid.
Assise à même le parquet, sur le pont principal, côté poupe, Ginette murmure à l’oreille de sa mère son refrain préféré,
« Ya ommi ya ommi ya ommi
Essmek deymen fi fommi
Men youm elli âyniya chafou eddouniya
Chafouk ya ommi-laâziza âaliya… »
Dans la salle de projection du navire, on tue le temps en regardant Destins ou En cas de malheur. Pour beaucoup, la ligne d’horizon ne cesse de s’éloigner alors même que la ville de tous les espoirs est annoncée dans le haut-parleur pour quelques heures. Les yeux humides des enfants suivent les pirouettes des puffins au-dessus des eaux calmes, trop calmes. Pleurent-ils de fatigue ou sont-ils attristés par la mort du serin de Yacoub ? En ce début des années soixante, des centaines de milliers de pieds-noirs abandonnent l’Algérie pour la France, « la mère patrie ». Ces départs massifs, auxquels s’associent les indigènes israélites et les harkis, traduisent l’agonie de la colonisation française. La perte de l’Algérie annonce pour eux plus que le terme d’une période ou d’un monde, elle marque la fin d’une vie concrète traversée de chaleur, faite de petits riens, de petites relations, de petites combinaisons où, en définitive, l’on gagnait à chaque coup et qui se manifestait à travers les petites fêtes et les pratiques de l’entre-soi, un petit verre d’anisette à la main dans un petit appartement ou une petite ferme, dans un quartier ou un village où l’on vint au monde, où l’on grandit. De mémoire de Mimoun, aucun membre de la famille ne naquit hors de l’Ouest algérien. La France, on ne la connaît que par l’Écho d’Oran et les actualités projetées dans les cinémas le Familia, le Plaza, le Rex, le Victoria, et l’Empire bien sûr… Mimoun Pinto ainsi que son père, sa mère, ses grands et arrières grands-parents, tous naquirent à Oran. Et nombre d’ancêtres aussi. À Oran ou dans sa région. Et tous les disparus, lorsque la faucheuse leur avait de leur vivant enjoint de regarder vers elle, d’avancer vers son champ, son antre, tous sans exception se tournèrent vers cette même terre qui les vit naître. Et voilà que ce qui reste en ce monde de la grande famille doit se résoudre à tout abandonner y compris les cimetières.
La famille Pinto fut emportée dans la tourmente, mais à aucun moment elle ne pensa en arriver à rompre complètement avec les voisins « arabes ». C’est pourtant bien ce qui se passe. La défaite française n’est plus une vue de l’esprit et « les événements » prirent une tournure hallucinante. Comme les Pinto, l’écrasante majorité des israélites choisirent de suivre la France qui les avait distingués en 1870. En définitive, ils décidèrent de taillader leur identité, nier leur passé, trahir la mémoire des leurs, mourir un peu. Les militants juifs de la cause indépendantiste comme Pierre Ghenassia, Daniel Timsit, Martine Timsit-Berthier, André Akoun, Jean et Andrée Beckouche, ou comme Georges Hadjadj, Guy Bensimon, Claude Sixou, Claude Ouzana, ne sont pas légion. Pendant les manifestations de 1960 et au printemps de cette année aussi, à Oran, à Alger, de nombreux israélites arboraient des épaulettes aux couleurs de la France et d’Israël. L’assassinat de Samuel Azoulay, un jeune chauffeur de taxi — « par les malfrats musulmans Cheriet Ali Cherif et Brahim Abdelkader qui le forcèrent à se diriger vers le dépôt de munitions d’Eckmühl » — et plus tard, l’incendie de la Grande synagogue d’Oran qu’on impute aussi à des musulmans, scellèrent le choix des plus réticents. Comme les pieds-noirs, les juifs craignent une Algérie future, totalement « arabe » et musulmane. Et totalement indépendante. L’allocution du général de Gaulle il y a un an les mit définitivement devant le fait accompli. Ils la vivent comme une trahison : « J’ai décidé au nom de la France de suivre un chemin nouveau. Ce chemin conduit non plus au gouvernement de l’Algérie par la métropole française, mais à l’Algérie algérienne… » Alors, deux mois plus tard, à la question « approuvez-vous le projet de loi concernant l’autodétermination des populations algériennes ? » Gaston et Dihia son épouse répondirent en glissant dans l’urne le bulletin beige, « Non », les yeux et le cœur dans les talons. Gaston avait arrêté sa décision. Suivre la France, mais pas le général. Il répétait à Dihia « le grand Charles il ne comprend rien, qu’est-ce qu’il comprend, rien, il nous a trahis oui ! » Pourtant c’est pour marquer son admiration pour le général qui leur avait permis de recouvrer la citoyenneté française que le régime de Vichy leur avait retirée en 1940 que Gaston avait offert un second prénom, Charly, à son fils Mimoun, né six ans après la fin de la guerre. À l’école, en début d’année, cela déconcerta quelque peu ses camarades qui entendaient la maîtresse l’appeler Mimoun alors que lui leur jurait que son nom est Charly. Puis ils s’habituèrent. Mimoun préfère le moderne Charly au désuet et très local Mimoun que lui avait choisi Habiba, sa grand-mère, en souvenir à la fois de son propre père à elle Mimoun Dahan et de son mari assassiné. Lorsque son fils le lui reproche, Gaston le renvoie à son histoire « mais tu le sais, c’est le prénom de mon père mon fils, combien de fois je te l’ai dit ! Et ton frère, qu’est-ce que tu crois, ton frère il s’appelle Yacoub comme mon grand-père, c’est kif-kif. C’est une tradition mon fils, une tradition, il faut toujours honorer les parents. »
Dans les travées du cimetière israélite, au cœur du quartier « arabe » — les pieds-noirs disent « le village nègre » —, Gaston rappelait à son fils qu’il porte « le prénom de cet homme » en pointant de son index une tombe reposant à l’ombre d’un cyprès de grande élégance qui veille le jour avec son ombre et le soir avec les Djinns sur elle et sur deux ou trois autres. Sur la pierre tombale, Mimoun lisait son nom et son prénom. La première fois qu’il avait été confronté à cette situation, qu’il s’était rendu compte qu’il portait les nom et prénom d’un mort allongé dans cette tombe devant lui, il ressentit ses os se glacer : « à la mémoire de Mimoun Pinto, 1905–1941. » Plus loin, devant la tombe de l’arrière-grand-père « Yacoub Pinto, 1875–1942 », en lisant le nom et prénom de son jeune frère, Mimoun fut de nouveau saisi d’effroi, eut un mouvement de recul irréfléchi. Son père se tenait près de lui, la main posée sur sa kippa pour le rassurer. Gaston ne se rendait jamais au cimetière sans se prosterner devant la tombe de son père. Plus loin encore, dans un autre carré, devant les tombes de l’arrière-grand-mère « Lalla Bensaïd, 1885–1957 », et du grand-père maternel de Dihia, « Shlomo Benaroche, 1885–1920 », il lisait des psaumes et récitait El Male rahamim. Shlomo Benaroche est mort lors d’un combat dont nul n’a plus souvenir de sa cause. Une rumeur persistante avait pourtant couru que sa fille n’était pas de son sang. Elle était la fille d’un porteur d’eau que Sadia avait rencontré à un mariage. Il était porteur d’eau etberrah attitré dans de nombreuses fêtes. C’est cet homme, Ben Mohammed El Houari qui tua Shlomo Benaroche, lors d’un duel au sabre. Ginette avait dix ans. Les deux hommes étaient ivres et avaient le même âge : trente-cinq ans. Personne n’a plus entendu parler du porteur d’eau.
Jusqu’au dernier moment, Gaston ne dit rien à personne de sa décision d’abandonner le pays qui les vit naître et grandir, hormis aux plus proches de sa famille, pas même à son chef de groupe à la SOTAC, la compagnie de transport qui l’employait jusqu’à vendredi dernier. Gaston était conducteur d’autocar sur la ligne Oran–Aïn El-Turck. Jusqu’au jour du départ, il ne dit rien parce qu’il avait peur d’être confronté à un problème quelconque qui l’eut obligé d’annuler ou de différer leur départ, alors que le pays est à feu et à sang, que le FNF, le Front national français, attise les haines et fomente des attentats aveugles, que la mort rôde à chaque coin de rue. L’assassinat en juin de Cheikh Raymond, un homme aimé par tous les amoureux du Malouf, par tous les mélomanes, va opérer comme un déclic pour de nombreuses familles juives. Mais pour les Pinto la goutte qui fit déborder le vase fut le meurtre de Gilbert Chakroun, devant la Grande synagogue, le premier jour de Rosh Hashana le 22 septembre dernier. Gilbert était un commerçant très aimé dans le quartier. Personne ne comprend rien. Il faisait crédit à tout le monde. Aux Juifs, aux Français, aux « Arabes ». (On disait systématiquement Arabes. Jamais on ne désigna autrement que comme Arabes les musulmans d’Algérie. Jamais ou presque jamais on ne disait Chaoui, Kabyle, Mozabite, Sanhaji… Par méconnaissance ou par inconscience, la plupart de ceux-ci se nommaient eux-mêmes ainsi, hna el-ârab.) Gaston était bouleversé « j’ai perdu un frère » répétait-il, lui qui n’en avait pas. Gilbert et lui avaient le même âge, un peu plus de trente ans. Entre 1949 et 1951, ils accomplirent ensemble le service militaire, soldats de deuxième classe, dans la caserne d’Eckmühl. Cette expérience les rapprocha beaucoup. Ils restèrent amis jusqu’à la fin. En semaine ils passaient des heures entières dans sa boutique à refaire le monde et le samedi au bistrot chez Bartolo ou bien au Claridge où, avec d’autres amis, ils s’offraient un verre ou deux d’anisette. Le dimanche ils se retrouvaient encore à l’entraînement ou au stade de foot, Gaston dans les gradins et son ami sur le terrain. Gilbert portait le numéro 11, ailier gauche du CALO, le Club athlétique liberté d’Oran. Gaston était un fervent supporter des rouge et noir. Gilbert faisait partie de ses joueurs préférés avec Anderson, Benssousan, Embarek et Sanchez.
La famille Pinto monta la veille dans Le Ville d’Oran. Chaque membre de la famille transportait une valise et des baluchons. Rares sont les voyageurs qui respectèrent la consigne « deux valises maximum par personne » écrite à la craie et à la hâte sur un tableau noir de collégien dans la salle d’embarquement. Ils sont tous là les Pinto : les enfants Mimoun, Yacoub et Yvette, les parents Gaston et Dihia. Il y a également Habiba la mère de Gaston et du côté de Dihia, ses parents Zohar Zenata et Ginette Benaroche ainsi que sa grand-mère maternelle Sadia Benhakim. Les autres sont morts : les parents de Zohar, le grand-père Shlomo Benaroche, Mimoun Pinto, le père et les quatre grands-parents de Gaston. À Mimoun on confia une valise et un gros carton en sus de l’appareil photo de son père qui pend depuis vendredi à son cou. Il avait insisté pour l’emporter. Yacoub avait pris sa cage, Yvette ses poupées de chiffons. Mimoun est l’aîné et le plus chargé des enfants. Il a presque trois ans de plus que Yacoub, mais cela se voit à peine au premier regard, à moins de le forcer. Mimoun est frêle. Dans le quartier, pendant les matches de foot, ou à l’école, ses camarades lui lançaient méchamment « enano ! » Ils savaient que cela le blessait et sa réaction à leur rosserie, une insulte, un jet de pierre, un cri, les réjouissait. Mimoun est petit comparé à ses copains de même âge, mais pas nain. Aucun de ceux-là ne se trouve sur le paquebot. Son frère porte une cage dans laquelle ne se trémousse plus son canari jaune. Il va et vient d’un bout à l’autre de la coursive, il court, saute, tombe, geint. Leur sœur Yvette est allongée dans son impressionnant landau encombré de toutes sortes d’objets qui limitent ses mouvements. Elle ne peut ni tourner la tête ni balancer les bras ou les pieds. La mère est étendue devant la poussette, les yeux fermés. La jeune grand-mère, Ginette — serrée contre Sadia sa mère, aveugle — pleure et chante en même temps, entourée de Habiba, et de nombreux passagers qui la reconnurent sous ses grosses lunettes, et son foulard noir et blanc qui ne laisse rien paraître de ses cheveux de jais, courts « c’est Lina, oh, Lina ! » Leur peine est aussi lourde que la sienne, aussi inconsolable. Les murmures d’amour froissé ou de détresse que Ginette offre à sa mère effleurent son visage humide et celui de tous ces inconnus autour d’elle, avant de se perdre dans le ciel :
« Ya ommi ya ommi ya ommi
Essmek deymen fi fommi
Ô mère, ô mère, ô mère
ton nom emplit ma bouche
Depuis qu’ils se sont ouverts au Monde
mes yeux se sont ouverts à toi
Ô mère ma très chère… »
Alors que les adultes traversent les eaux de la Méditerranée comme une éternité de larmes en faisant pour la énième fois les cent pas sur le pont ou en regardant Destins dans la salle de projection, avec Armand Bernard, Micheline Francey… et bien sûr Tino Rossi. « Destin, lorsque ta main frappe à la porte, Destin, sur le chemin tu nous emportes… » Les plus jeunes s’impatientent autrement. Il leur semble que plus le paquebot s’approche de l’horizon au-delà duquel, espèrent-ils, toute leur souffrance s’annihilerait, plus celui-ci s’éloigne. « C’est quand c’est qu’on arrive ? » répète Yacoub en fixant les eaux létales de cette mer qui désormais ne traversera plus la France comme la Seine parcourt toujours le cœur de Paris, et en pleurant sans discontinuer la mort inexpliquée de son canari qu’il fut obligé de jeter par-dessus bord
Mimoun Pinto et sa famille vécurent toujours dans Derb lihoud, le quartier israélite d’Oran. Leur dernière adresse se trouve derrière la maison Darmon, précisément au 34 rue d’Austerlitz, la longue rue du marché, à quelques dizaines de mètres du temple protestant qui est, lui, dans la rue de la Révolution. Les plus jeunes comme les plus âgés des Pinto, enfants, parents, arrières-parents, tous n’habitèrent que dans ce quartier où ils naquirent. Les Pinto sont établis dans l’Ouest algérien depuis une vingtaine de générations. Leurs ancêtres, originaires de l’extrême ouest de la province de Valencia, furent condamnés pour impureté raciale et chassés d’Espagne à la fin du 15e siècle, à l’instar de plus de cent mille autres juifs victimes, avec les musulmans, de la Reconquista et de la Limpieza de sangre. Et, depuis, dans ce Maghreb central qui les reçut les bras grands ouverts, les Pinto arpentent les dimensions du temps, au gré des événements, heureux ou malheureux, des naissances et des morts. Mimoun ne se vanta jamais de cette origine. Il ne la récusa jamais non plus. Ces discussions n’encombraient pas les enfants. Sa mère, Dihia Zenata, est une Berbère juive Zénète dont les aïeux prennent source dans la région de Tlemcen. Lorsque dans les années trente une première tragédie vint directement les frapper ici même, les Pinto vivaient humblement, sans éclat, comme l’écrasante majorité des populations indigènes, entourés d’amis et d’anonymes. Dans les territoires du nord, entre les deux guerres mondiales, la Communauté juive était mise à l’index par des hommes et des femmes qui avaient laissé couler en eux la haine qu’on exaltait partout. Quelques années auparavant, dans ces contrées-là, un capitaine de confession juive avait été injustement accusé de collusion avec l’ennemi allemand. Ces mêmes hommes et femmes étaient venus jusque dans ces terres arides, vierges, mais plutôt paisibles et accueillantes, où les différentes communautés vivaient en symbiose depuis les temps les plus reculés, qu’ils fussent temps de paix ou de guerre, pour répandre leur venin. La nuit et le jour des groupuscules sillonnaient les rues d’Oran, particulièrement celles du Derb lihoud, en scandant des rengaines outrageantes. Ces provocations se répétèrent jusqu’à la grande catastrophe :
« Y a trop longtemps qu’on est dans la misère
Chassons l’étranger ça fera travailler
Chassons chassons de notre pays
Cette sale bande de Youdis… »
L’État national abrogea le Décret qui avait fait des israélites des membres à part entière de la communauté française en leur octroyant la pleine citoyenneté, mais en semant en conséquence les graines de la discorde entre juifs et musulmans.
Le matin du 9 septembre 1941, comme tous les matins, Mimoun Pinto accompagnait son fils Gaston, le père de Mimoun, à sa nouvelle école qui se trouvait derrière la mairie, dans la rue Eugène Étienne. Des hommes les suivaient depuis la place Foch en sifflotant l’air de chansons scandaleuses, haineuses et antisémites. De temps à autre ils s’exclamaient « Señor cura ! Señor cura ! » en tapant dans leurs mains. Ces hommes partageaient avec l’ancien abbé et maire d’Oran, Gabriel Séraphin Lambert — Señor cura—, la haine des juifs. Dans l’esprit de l’ancien maire en soutane et col blanc « ces gens ne poursuivent qu’un but, se rendre maîtres du monde. Ils ont crucifié le Christ et attendent le Messie pour nous tenir sous leur domination. » Curieusement, de nombreux israélites avaient rallié les comités de soutien à l’abbé qu’on appelait « les Amitiés Lambert ». Ce n’était pas la première fois que ces individus intimidaient Mimoun et son fils, parfois jusqu’à la porte de l’immeuble qui abritait l’école. Ce mardi-là, alors qu’ils traversaient le boulevard Sébastopol, un des hommes donna un coup d’épaule au père en l’injuriant. Mimoun eut un geste défensif, et ce faisant, involontairement, libéra la main de Gaston qu’il avait serrée fort durant tout le trajet au point de lui en écraser les doigts. L’affront renouvelé que lançaient ces voyous à Mimoun, en même temps qu’il développait chez lui un courage dont il ignorait jusqu’alors être capable, réduisait la honte qu’il avait de son impuissance à réagir, de sa paralysie. Ce matin-là, contrairement aux jours précédents, Mimoun ne baissa pas la tête, ne fit pas le sourd, ne se laissa pas faire. Porté par une énergie dont il ne s’expliquait pas les ressorts, il ralentit le pas, se retourna vers les hommes qui redoublaient d’outrages, et se jeta sur celui qui le bouscula, en criant « ¡matones ! » Puis il les menaça de porter plainte. Sa colère était si grande qu’il s’adressa à eux dans la langue des aïeux, en espagnol, dans une gestuelle théâtrale qu’il n’aurait pu, pour sûr, rejouer si on le lui avait demandé, « ¡ que son tarados ! » À la maison, les Pinto parlent indifféremment le français, l’espagnol ou derja, l’arabe algérien très coloré. Du berbère il demeure quelques expressions qu’on retrouve dans la bouche de Habiba et Dihia sa bru. L’hébreu ils le connaissent suffisamment pour pratiquer les prières et les rites religieux en général. Pas les enfants. Mais dans certaines situations, lorsque l’émotion atteint son comble, de toutes les langues, c’est l’espagnol qui s’impose aux aînés comme un recours inévitable, une nécessité absolue dictée par la fidélité à la lignée paternelle. Les racistes reprirent à tue-tête « Y a trop longtemps qu’on est dans la misère/Chassons l’étranger ça fera travailler… » L’un des bandits, celui-là même qui donna à Mimoun un coup d’épaule, le somma « répète, répète voir, sale race » et Mimoun répéta « vous n’êtes que des abrutis, des voyous ! » « Sale youpin » reprit l’homme en glissant sa main dans la poche révolver de son pantalon. Il en sortit un couteau à cran d’arrêt qu’il actionna et planta à plusieurs reprises d’abord dans la gorge, puis dans le ventre de Mimoun Pinto en hurlant « Les Youpins hors de France ! » Mimoun s’écroula devant son fils qui se jeta sur lui en criant « papa, papa ! » Des dizaines d’hommes et de femmes s’étaient regroupés autour des malheureux et tenaient des propos incompréhensibles. Un homme, penché sur Mimoun, déboutonna sa chemise en bafouillant « je suis médecin, appelez la police ! » tout autour, d’autres personnes s’étaient agglutinées de sorte qu’on ne voyait plus le médecin incliné sur le père, ni celui-ci, ni Gaston. Lorsque l’ambulance s’immobilisa, il était trop tard et les agresseurs s’étaient volatilisés. On gesticulait, parlait haut, mais on ne comprenait rien. Deux fillettes pleuraient. Le cercle s’était encore renforcé quand la police arriva. Son chef s’adressa à la foule « Allez, poussez-vous ! » avant de se tourner vers le médecin : « comment étaient-ils, combien étaient-ils, c’étaient bien des Arabes ? » Le docteur répondit qu’il ne savait pas, mais une dizaine d’hommes et de femmes disaient être prêts à témoigner. Un policier nota leur nom et adresse. Puis les ambulanciers emportèrent le corps. Bien après leur départ, on continuait de s’agiter avec gravité. C’est un parent d’élève de l’école Bénichou qui raccompagna jusqu’à son domicile le petit Gaston pétrifié. Il avait douze ans ce jour-là. Il s’en souviendra toute sa vie. Régulièrement il racontera l’agression dans le détail à Mimoun, son propre fils. Comment les bandits les regardaient, comment ils les avaient bousculés et fait tomber à terre son père. Comment l’un d’eux, ils étaient six, exhiba un couteau qu’il brandit entre ses propres yeux comme dans les films noirs de Fritz Lang, puis le plaqua contre la gorge de son père. « Je ne voyais à ce moment-là que la lame et la lumière qui papillotait sur la surface », se rappelait-il. Il se souvenait de l’attroupement des curieux, de leurs commentaires souvent incompréhensibles. De l’ambulance et de sa sirène insupportable. Et du vacarme qui suivit. Gaston se remémorait aussi de parents tenant fermement la main de leurs petits qui s’agitaient comme s’agiterait tout enfant mis devant une même situation, dans le désordre, bruyamment. Il se souvenait de ce jeune enseignant, chétif, qui répétait en toussant et en balançant son cartable « Depuis des années, ce monde est livré à un déferlement de haine qui n’a jamais eu son égal ! Depuis des années, ce monde… » Mimoun Pinto allait sur ses trente-cinq ans. Il accompagnait son fils aux cours privés de la rue Eugène Étienne comme il le faisait depuis la nouvelle rentrée. On disait « L’école de Bénichou », mais en réalité c’était l’appartement d’un de ses proches. Depuis les lois raciales d’octobre 1940, le décret Crémieux qui accordait la citoyenneté française à tous les israélites indigènes d’Algérie fut abrogé et les enfants juifs interdits de scolarité publique. Parce que Juifs.
Le lendemain, dans sa rubrique des faits divers, L’Écho d’Oran reprenait les termes du communiqué du commissaire de police. Sur la même page, dans un encadré officiel, le journal listait les professions interdites désormais aux Juifs : avocat, médecin, enseignant… Gaston ressortait tant de fois cette agression à son fils que le jeune Mimoun pouvait la dérouler dans son imagination dans le moindre de ses détails. Peut-être en atténuait-il certains, en accentuait, noircissait ou ajoutait d’autres. Gaston lui racontait avec précision les échanges qu’il avait avec son père lors des sorties au Théâtre de verdure, à la Promenade de Létang ou même au lointain Parc municipal. Tant et si bien que Mimoun avait appris à connaître son grand-père aussi bien que son père. Ainsi, il lui arrivait de lui attribuer telle qualité ou tel défaut dont la justesse, de l’une comme de l’autre, surprenait à peine Gaston. Évidemment, Mimoun ne vit jamais le corps de son grand-père allongé sur le trottoir devant l’immeuble qui abritait l’école fréquentée par son père. Il ne le connut naturellement pas. Et pourtant, il pouvait décrire les lieux et discourir sur les circonstances comme s’il avait vécu le drame dans sa chair. Son père lui racontait cette agression régulièrement en prenant soin de toujours présenter à son enfant la même source de son récit. « N’oublie jamais mon fils », répétait-il en agitant L’Écho d’Oran. Mimoun ne savait pas encore lire. Son père reprenait : « Zakhor, mon fils, zakhor… »
Plus tard, dans le petit appartement familial de la rue des juifs à Derb lihoud, alors que des rumeurs affolantes se répandaient dans tout le quartier, que des événements secouaient le pays d’est en ouest, qu’une guerre indigène de libération avait succédé à une guerre mondiale, le père de Mimoun lui proposa de lire l’article du quotidien oranais. Mimoun avait appris à lire et ne trébuchait plus trop sur les mots. Ce jour-là il était plongé dans la page 29 de son Manuel d’histoire de Bernard et Redon pour élèves de CM1 que son maître d’école avait demandé d’apprendre par cœur : « Il faut aller faire la guerre aux Turcs, dit le pape Urbain. Pourquoi ? Parce que les musulmans maltraitent et quelquefois tuent les pèlerins, c’est-à-dire les chrétiens venus à Jérusalem pour prier sur le tombeau du Christ. La foule a crié : ‘‘Partons ! Dieu le veut !’’ » La révision du cours d’histoire achevée, Mimoun débita la leçon à son père, sans regarder le livre. Mimoun hochait de temps en temps la tête, car il n’approuvait pas ce qui était écrit dans le livre. Ce n’était pas la première fois. « Tiens » dit-il à son fils. Mimoun s’empara du journal que lui tendait son père. L’Écho d’Oran, daté mercredi 10 septembre 1941. « Tiens, lis mon fils, lis », avait répété le père. Il lut, d’abord le titre de la rubrique « Agressions », puis le texte : « Un homme, Monsieur Mim… moun… Mimoun… » Il buta sur son nom. Il reprit : « Un homme, Monsieur Mimoun Pinto, 35 ans, de confession israélite et son fils Gaston qu’il accompagnait au collège, ont été attaqués par six Arabes à hauteur du boulevard Sébastopol, non loin de la Grande synagogue. Les agresseurs ont été arrêtés. Il s’agit de : Mokhamed Lakrim, Khamed Amrani, Ali El-Torki, Kadour Betouil, Mohamed Soundouci et Amar ou Omar Lakhal. Ces individus sont encore, à l’heure où nous mettons sous presse, entendus au Commissariat du deuxième arrondissement. Les truands ont tenté de voler l’israélite qui ne s’est pas laissé faire. »
De nouveau, un frisson parcourut son dos. « Il parle de l’attaque de saba » fit le fils. Gaston, lui qui savait, ne lui dit pas que le journal avait travesti la vérité. Il ne le lui dira jamais. Mimoun relut le papier sans que son père le lui ait demandé. Il s’exclama : « dans mon livre, c’est écrit ! ‘‘Les Arabes sont méchants.’’ » Mimoun ressentit une grande et indéfinissable douleur dont il ne pouvait saisir sur le moment ni les contours ni même les prémices des transformations radicales qu’elle infusera dans son être. Comme si l’histoire de l’agression de son grand-père, saba, figée sur du papier jauni qu’il lut et relut jusqu’à ne plus pouvoir — une histoire partagée par de nombreux lecteurs — prenait soudain une dimension nationale, comme si elle délivrait la clé d’entrée dans cette guerre qui les enserrait tous. Mimoun avait punaisé l’article dans le couloir de l’appartement, à l’écart des photos de famille sous verre, comme étaient placardés autrefois sur les murs des saloons américains les wanted dead or alive, ces avis de recherche des bandits de grand chemin. Mimoun avait soigneusement recopié sur une feuille quadrillée le nom de chaque Arabe mentionné en gros caractères d’imprimerie qu’il scotcha au bas de l’article du journal. À cette époque les journaux pullulaient de noms d’Arabes — dans la presse aussi, on présumait que tous les autochtones musulmans étaient des Arabes — que l’on recherchait pour une raison ou une autre, ou de photos d’Arabes morts.
Recroquevillé dans une canalisation défectueuse, Kada grelotte dans son costume déchiqueté. Il tremble de froid, d’épuisement et de peur. De temps en temps il passe le bras sur son front pour éponger la sueur. Ainsi ramassé il s’aperçoit combien il est desservi par ce corps maigre et abîmé. Il lui faudra tenir dans cette position jusqu’aux premières lueurs du matin. Il s’applique à remuer le moins possible pour n’émettre aucun signe de présence. Il a soif et faim. Il a l’impression que son crâne est fendu. Il n’en revient pas d’être toujours en vie et de pouvoir appréhender le fil des événements de la veille, et plus encore ceux des jours et des mois passés. Il se tâte la cuisse lourde, l’épaule endolorie, la tête. Du sang séché colle à son cuir chevelu et à ses vêtements déchirés. Tous ses membres souffrent. À quarante ans, l’agilité qui était la sienne à vingt semble l’avoir abandonné. « Pourquoi ? » ne cesse-t-il de se questionner, même s’il sait qu’au cœur de la nuit la réponse ne lui sera pas offerte. « Pourquoi cette haine ? » Il a subitement honte. Il a une pensée pour sa mère, pour son père, pour sa famille, restés au bled. Pour son épouse. Une autre, épaisse, traverse son esprit comme un éclair : et si Messaoud et Hadj El-Khamis lui étaient arrachés ? Un sentiment de répulsion noue son cœur. Il s’en veut. De son poing serré, il martèle sa poitrine, puis sa tête. Il résiste aux larmes. « Pourquoi tant de haine ? »
Kada El-Bethioui est originaire de Saint-Leu, un village situé à l’est d’Oran que les musulmans désignent du nom éponyme de la tribu berbère des Bethioua qui, selon le géographe andalou Al-Bakri, vécut sur ces terres durant des lustres. Les aïeux de Kada passèrent l’essentiel de leur existence autour de Bethioua, chaque segment familial vivant de quelques arpents de terre de labour, le plus souvent à la lisière du dénuement. Et cela demeura ainsi. Aussitôt la Grande Guerre achevée, Kada est renvoyé auprès des siens. Il était couvert d’honneur et le cœur rempli de fierté. Il fut, avec d’autres, accueilli comme un héros. Une fête fut organisée à Oran au sein de la grande caserne d’Eckmühl à laquelle assistèrent les plus hauts gradés de la région. Lorsqu’il entendit son nom dans le haut-parleur, Kada avança devant la tribune bondée. D’un geste lent, il inclina son tarbouch rouge, fit le salut militaire et attendit au garde-à-vous. Il n’était pas très à l’aise, mais il se rassurait en se disant qu’il n’était pas le seul à s’être levé à l’aurore et à entendre battre son cœur comme celui du Duguay Trouin dans la tourmente. Le commandant de la caserne lui posa sur le torse la croix de guerre pour services rendus en chuchotant une amabilité de circonstance. Kada sourit timidement. Il s’entendit dire « merci » en levant haut la tête. Il s’interrogeait toutefois. « Ils me remercient pour mon sérieux, pour mon courage ou pour avoir abandonné les miens ? » La médaille se présentait sous la forme d’une croix en bronze au centre de laquelle était incrustée une tête de la République traversée par deux épées croisées. Elle était accrochée à un ruban rouge parcouru par quatre fines bandes vertes. Quelques jours plus tard, une autre médaille lui était attribuée par le maire de Saint-Leu en personne lors d’une identique cérémonie spéciale. Toute cette reconnaissance le rassurait, le valorisait dans son groupe, et même chez beaucoup de pieds-noirs. Kada était fier d’avoir participé à la libération de Toulon et d’autres villes de France de la barbarie allemande. Il ne maîtrisait, certes pas, les dessous des cartes de ce conflit mondial, mais il parvenait à hiérarchiser les grands maux. Certains allèrent jusqu’à l’appeler par son nom de famille qu’ils précédaient d’un titre distinctif, très modeste, mais qui le touchait, « Monsieur El-Bethioui ». Ces amabilités avaient pour effet de l’émouvoir, car, aussi loin qu’il s’en souvienne, cela ne lui était jamais arrivé auparavant, ni à son père ni à ses oncles. Jamais on ne l’appela « monsieur ». Il était plus habitué aux sarcasmes qu’on débitait sur sa silhouette, sa taille, sa moustache. « Comment va notre Charlot ? » lui demandait par exemple en frottant ses mains sur son tablier bleu usé, madame Patron, l’épicière du village, lorsqu’il venait lui acheter du café Nizière, une tablette de chocolat Poulin ou des bâtons de réglisse pour ses neveux. Il était solide, mais sa force ne pouvait l’aider à cicatriser les plaies de l’animosité et du racisme « Ya bon Banania » qui le marquèrent et marqueront à jamais. Ces plaies avaient pour auteurs des voisins du village, nombre de soldats français, souvent issus de la même région que lui, du même régiment, des Oranais, des Algérois, des Bônois. Alors toute cette reconnaissance officielle était-elle satisfaisante ? Kada ne le pensait pas. Elle relativisait les injustices, mais n’était pas suffisante tant que l’accès à son destin lui était proscrit.
Comme ses quatre frères et sœurs, Kada aidait son père, Hadj Omar, dans la ferme familiale. La famille est nombreuse et les céréales de son lopin de terre de quatre hectares ne couvraient pas les besoins de tous ses membres, moins encore les quelques animaux de la basse-cour, volaille et lapins, ou les deux moutons qu’ils engraissaient autant qu’ils le pouvaient chaque année en prévision de l’aïd ou d’un événement quelconque, heureux ou malheureux. « Dieu sait qu’on y met notre cœur et toute notre énergie », soupirait le père. Le travail permanent manquait dans cette région et les démarches que Kada effectuait demeuraient infructueuses. Périodiquement lorsque monsieur Bertrand, le patron de la Coopérative vinicole Lallemand, devait remplacer un de ses ouvriers, c’est en priorité à Kada qu’il faisait appel. Il connaissait tous les membres de sa famille, du plus âgé au nouveau-né. Il appréciait son abnégation au travail. Kada embauchait un jour, une semaine, ou trois, de manière continue, pas plus, pour quelques francs. « Khir men walou », c’est mieux que rien, se consolait-il. Souvent, il pensait à la proposition de son cousin Lahouari. Périodiquement il le relançait pour qu’il le rejoigne à Nanterre où on gagnait mieux sa vie. Son père et même sa mère Messaouda n’y voyaient pas d’inconvénient, bien au contraire. Mais ils souhaitaient le marier avant qu’il ne fît le grand saut, si tel était son désir. Sa cousine Khadra lui était dédiée depuis plusieurs années, bien avant la puberté, et, comme elle, Kada le savait. Khadra serait d’une grande aide aux parents disait-on. Kada qui battit la question comme le lait de chèvre dans une guerba, l’outre familiale, qui la retourna dans tous les sens, finit par se décider. Il suggéra de laisser passer l’hiver avant de traverser lemwèj, les vagues.
La cérémonie religieuse eut lieu en juillet 1950, âm ejrad, l’année des sauterelles. Les parents et les oncles Abdallah et Mohamed se chargèrent de l’essentiel, mais toute la famille y mit du sien, les grands comme les plus jeunes. Pendant trois jours, la plupart des villageois se retrouvèrent dans la zaouïa Bouabdelli. Par leur présence ils consacraient la nouvelle alliance, mais pas seulement. Ils l’auréolaient d’un poids, celui de leur nombre, validé par la confrérie. On chanta, dansa, psalmodia en tapant dans les mains. Les hommes sous les guitounes du haut, sur le flanc ouest de la goubba — le mausolée de la zaouïa —, les femmes sous celles du bas, derrière, face au souffle marin. Les actes officiels municipaux suivront lorsque, pour une raison ou une autre, les Bethioui seront dans l’obligation d’en faire la demande, ou quand l’autorité administrative les imposera, ce qui revient au même. Kada pouvait désormais rejoindre son cousin. Le jour de son mariage, on fit quitter à Khadra la maison de son père pour l’installer chez ses beaux-parents qui sont aussi ses grands cousins. Émigrer en métropole devenait un mal indispensable pour de nombreuses familles. Mais Kada était convaincu que la place de sa femme était à ses côtés. Alors il lui fit cette promesse distinguée : « je te ferai venir à Paris dès que j’aurai trouvé eddar, la maison ». Pour elle cet engagement n’en était pas un, c’était un ensemble de mots chargés d’apaisement pour qu’elle supporte avec le moins de tristesse possible, son quotidien auprès des parents de Kada, bien qu’elle ne fût pas en terre hostile ou inconnue. Des mots pour qu’elle accepte la solitude et les difficultés inhérentes à la vie de toute nouvelle mariée confrontée au changement induit par son nouveau statut, ses nouvelles responsabilités et charges. En attendant de vivre ensemble leur vie de couple. L’indispensable bénédiction familiale étant acquise et les ressources pécuniaires réunies, c’est par Le Président de Cazalet que Kada rejoignit Port-Vendres. Il savait qu’il lui faudrait travailler longtemps pour apurer le prêt contracté. De Port-Vendres il prit l’autocar jusqu’à Toulouse et de là le train jusqu’à Paris. Il était alors nouveau trentenaire en ce premier mois de 1951.
Ce retour en France ravivait en l’ancien tirailleur à la fois des douleurs profondes et des moments de franches rigolades passés dans les tranchées ou le long des routes pour dompter la peur qui nouait les ventres. Mais il se demandait s’il n’avait pas toutefois précipité les choses. Kada fut hébergé par son cousin Lahouari qui habitait dans un minuscule deux-pièces avec w.c. dans la cour de l’immeuble, dans le quartier du Moulin des Gibets. C’est à l’opposé des Guilleraies où se trouve l’usine de fabrication de pâtes alimentaires Milliat frères. Le contremaître de Lahouari jugea en quelques minutes que le jeune cousin — Kada a quelques années de moins que Lahouari —était en parfaite condition physique pour embaucher la semaine même de son arrivée. Les deux hommes s’y éreinteront durant des années pour moins de dix francs du lever au coucher du jour. Les quelques ajustements obligatoires ne changent rien aujourd’hui encore au salaire de misère, 294 francs lourds nets par mois en 1961 contre 242 les années précédentes, 24 200 anciens francs.
Deux années plus tard, un ami de Lahouari, rentré en Algérie pour résoudre un important litige familial, un problème d’héritage, lui confia sa cabane, une pièce de seize mètres carrés dans le bidonville de la rue des Pâquerettes à Nanterre même. Cet ami ne céda pas la baraque directement à Kada qu’il ne connaissait pas, mais à son cousin. Il lui demanda d’en prendre soin le temps de son absence « quelques mois » avait-il dit sans autre précision. « Quelques mois », cela pouvait bien signifier quatre-vingt-dix jours, trois cents ou plus. Kada accepta d’occuper la bicoque, mais il n’était pas tranquille, même si Lahouari était persuadé que son ami ne reviendrait pas de sitôt. Kada était conscient qu’il pouvait en être expulsé à tout moment. Mais il ne pouvait non plus s’éterniser chez son cousin bien qu’il ne lui eût jamais fait aucune allusion concernant son hébergement et qu’il participât lui-même aux dépenses alimentaires. Kada s’installa dans la baraque. Le taudis était composé de planches, de cartons, de plaques de tôles ondulées, enfin de toutes sortes de matériaux hétéroclites, et ne disposait ni d’électricité ni d’eau. Les familles s’approvisionnent dans l’unique fontaine du bidonville, située à son entrée. Kada répétait qu’il était habitué à une vie de misère depuis sa naissance. Les conditions de subsistance dans la Chaaba ne l’effrayaient guère par conséquent, même si la pauvreté en Algérie est chaude sous les rayons du soleil. « Après tout, se consolait-il, je ne vais pas m’éterniser en terre étrangère. » Ce qu’il appréhendait alors avec l’arrivée prochaine de sa très jeune épouse c’était les difficultés inhérentes à la solitude. Khadra — elle a treize ans de moins que lui —s’accommoderait-elle de l’environnement hostile ? De crainte d’être incompris ou, pire, d’être désavoué par sa famille et celle de ses beaux-parents — lesquelles l’une et l’autre, à y regarder de près, n’en forment qu’une, élargie certes, mais une seule grande famille, toutes deux du ârch des Bethioua — de crainte donc, Kada évoquait peu dans les lettres qu’il leur adressait sa vie quotidienne en France, sinon par des formules lapidaires en s’en remettant à Dieu : « Essabr Welhamdoullah ». « Et puis, pensait-il, les écrivains publics n’ont pas à connaître nos vies, à pénétrer nos intimités ». Kada échangeait des nouvelles avec sa famille à raison d’une lettre par mois environ, du moins les premiers temps. Des mots simples qui disaient l’essentiel : la santé, le travail, le transfert d’argent.
Lorsque son épouse le rejoignit au printemps 1953, Kada avait depuis peu quitté son cousin pour occuper cette misérable cabane des Pâquerettes. Depuis huit ou dix semaines. Pour se rendre quotidiennement à l’usine de pâtes, il avait acheté, dans le bidonville même, un vélo d’occasion Motoconfort, avec un porte-bagages et des sacoches comme neuves, en cuir. Il lui fallut près d’un mois d’entraînement laborieux, encouragé par Lahouari et des voisins du camp, avant de parcourir entièrement en pédalant, assis sur la selle, la distance qui séparait sa baraque de l’usine à pâtes. Khadra n’était guère désappointée, car elle n’attendait rien de son nouveau lieu de vie. Passées les premières semaines durant lesquelles elle ne cessait de pleurer, de se lamenter sur tout, elle était plutôt contente de se trouver auprès de son compagnon, et cela lui suffisait. Les mois qui défilaient l’installaient malgré tout dans une routine pétrie par la solitude — hormis son mari et de temps à autre une voisine de taudis, toujours la même, elle ne rencontrait personne — et la nostalgie de ses parents dans le souvenir des chaudes journées du bled. Certaines nuits de l’hiver suivant, la température atteignait quinze degrés au-dessous de zéro à la périphérie des baraquements et à l’intérieur même de certains bouges. L’appel de l’abbé Pierre émut la plupart des résidents du bidonville, qui, pour éviter que le pire n’advînt, dormaient tout habillés et laissaient les fourneaux fonctionner toute la nuit. Dans les rues de Paris et de sa banlieue, on mourait de froid et de misère. L’appel au secours des hommes de Dieu demeurait sans réel écho officiel. Le nouveau printemps était toutefois arrivé, chargé de mauvaises nouvelles du Tonkin. Les journaux titraient sur la défaite française face aux forces Vietminh : « À Dien-Bien Phu, l’évacuation des blessés se poursuit. » Quelques mois plus tard, en août, alors que son épouse s’apprêtait à accoucher, Kada s’alarmait, car avec ces choses-là il ne savait comment s’y prendre. Heureusement, une jeune bénévole du Service civil international, très dévouée fit le nécessaire pour qu’une sage-femme dont elle était proche se déplace jusqu’à leur taudis. Kada l’appelle « Madame Monique ». C’est une jeune femme élégante, de taille moyenne, à peine plus âgée que la sienne, quatre ans de plus. Ses cheveux noirs sont coupés court. C’est une dame au cœur aussi grand que ses convictions, autrement dit aussi grand qu’on y logerait la générosité du monde. Depuis quelques années, elle s’était engagée dans les chantiers de volontariat international après avoir été scout de France. Elle qui vécut une partie de son enfance dans un hôtel meublé du 18e arrondissement de Paris sait ce que signifie l’habitat précaire. Depuis le grand incendie du carré nord du bidonville, « à côté de la gare de triage », la bénévole passait des nuits entières avec des familles en détresse. La sage-femme ne connaissait pas le bidonville et risquait de perdre beaucoup de temps, c’est pourquoi « Madame Monique » se rendit sur le lieu des rendez-vous, au 127 rue de la Garenne chez Ali le gérant du café-hôtel, à La Folie, pour attendre son amie. « Le 127 » est une adresse connue par tous les Algériens de Nanterre. La plupart d’entre eux l’utilisent. Moins pour l’hébergement —l’affichette scotchée sur la porte indique souvent « coumpli » — que pour siroter un café ou un thé avec les amis en écoutant M’hamed El Anka, Slimane Azem, Farid El Atrache, Lina l’Oranaise, ou Fadéla Dziria. C’est aussi leur adresse postale.
La sage-femme examina Khadra. Elle la rassura et lui certifia que l’accouchement était très proche. Depuis une semaine Monique se présentait tous les jours pour s’enquérir de la santé de Khadra, réduisant par conséquent ses interventions dans les autres bidonvilles. Le six août c’est en taxi que toutes les trois, Monique, la sage-femme et Khadra se rendirent à l’hôpital de Nanterre. C’était bien la première fois que Khadra quittait le bidonville sans son mari, ou même derrière lui. Monique resta à son chevet jusqu’à l’heure de clôture des visites. Le lendemain elle revint à la première heure autorisée. Messaoud naquit à l’aube du samedi sept, « à deux heures ». Monique se chargea d’enregistrer le nouveau-né, puis de régulariser leur mariage à l’état civil où on avait l’habitude de ce type de situation. Mais cela nécessita quelques semaines néanmoins. Ainsi, Messaoud naquit avant le mariage civil de ses parents. Il en fallut des papiers.
Avant d’enfourcher le vélo pour se rendre au travail, Kada prend toujours soin, cela devint une seconde nature, d’ajouter dans le sac à dos, à côté de sa gamelle émaillée, de sa baguette de pain et de sa bouteille d’eau, protégées dans un sachet, ses chaussures. Les sacoches contiennent des clés, deux boîtes de rustines, une chambre à air de rechange et une pompe, on ne sait jamais. De chez lui jusqu’à l’usine il porte des bottes en caoutchouc. Lorsqu’il arrive, elles sont entièrement recouvertes de boue. Kada ne pédale pas comme le ferait un sportif, pas même comme un adolescent. Il zigzague bien malgré lui, il n’est jamais rassuré. Un jour, à cause d’un morceau de bois qui s’était introduit dans les rayons de la roue avant, il tomba la tête la première. La bicyclette fit un tour sur elle-même. Kada se releva aussitôt, un peu étourdi et peu fier, ramassa le contenu des sacoches et du sac à dos. Puis il essuya avec le revers de la main le sang qui coulait de son front et débarrassa autant qu’il put son pantalon et sa veste de la poussière. Aux collègues de travail et à Lahouari, ainsi qu’à sa femme en rentrant, il raconta qu’il évita de justesse un automobiliste qui fonçait sur lui. Il ajouta qu’il l’avait aveuglé. Arrivé dans la rue Lavoisier, à proximité de l’usine, Kada se change. Il met ses chaussures de ville et de travail, puis glisse les bottes dans un autre sac en plastique qu’il pose à côté de son sac à dos dans la partie du placard qui lui est attribuée.
Au cinéma, les Parisiens préfèrent les blondes comme Marilyn ou un Premier rendez-vous avec Danielle Darrieux. Les habitants du bidonville invitent souvent Monique à reprendre du thé et à rester un peu plus avec eux. À ses côtés ils sont rassurés, presque heureux de découvrir qu’il n’y a pas que de la haine qui est offerte à l’étonnement de leurs yeux. Monique Hervo transcrit au mieux qu’elle peut leur parole sur des feuilles blanches avec une plume trempée dans l’encrier bleu de Waterman qu’elle transporte toujours dans son gros cartable. Elle écrit à leurs familles restées au bled des lettres qu’ils lui dictent comme ils peuvent, avec une infinie précaution chargée de retenue et de respect. Elle écrit à l’administration, leur explique toutes sortes de démarches à entreprendre, comment utiliser les médicaments… En juin 1956, peu avant la naissance de Hadj El-Khamis, leur deuxième enfant, Kada et son épouse emménagèrent dans une baraque du bidonville de La Folie, toujours à Nanterre, acquise au prix de deux mille nouveaux francs. Une somme importante qu’ils mirent plusieurs années à amasser. Comparé au premier taudis, le nouveau toit semble à Kada moins inacceptable. Il n’a bien évidemment ni eau, ni électricité, ni fenêtre, ni sanitaire. Le toit est constitué de toile goudronnée. À l’intérieur, des cartons sont cloués aux planches. Sur certains, on colle des photos de magazines, et on colmate les espaces avec du papier journal pour empêcher le froid de pénétrer. Il y a un coin cuisine avec un évier au-dessus duquel Kada accrocha un miroir de barbier avec un contour rouge plastifié. Des w.c. turcs furent aménagés près d’une décharge d’ordures, suffisamment éloignés des taudis pour ne pas suffoquer. Comme dans le bidonville des Pâquerettes, il n’y a qu’un seul point d’eau, une fontaine pour dix mille personnes, installée dans la rue de la Garenne. L’eau est transportée souvent dans des poussettes Terrot ou des voitures à pédales. Les enfants remplissent une ou deux bouteilles, parfois un seau. L’insalubrité et générale, mais l’insécurité est aggravée pour les Algériens par les effets de la guerre engagée contre la colonisation française. Effets qu’ils subissent quotidiennement. Les provocations sont permanentes. Elles émanent le plus fréquemment de la police qui s’installe devant les bidonvilles des jours durant. Les protestations de monsieur Raymond Barbet, le maire, restent sans conséquence. Des cellules discrètes du Front de libération nationale furent montées au sein même du bidonville. Pour les forces de l’ordre qui encouragent les « harkis de Paris » à dénoncer tout mouvement ou individu suspects, les Français musulmans sont musulmans étrangers plutôt que citoyens français. Pour éviter tout problème, les habitants du bidonville qui ne sont pas Algériens le font clairement savoir en peinturant en toutes lettres sur leur porte et en lettres majuscules « JE SUIS TUNISIEN » ou « ICI MAROUKEN », en choisissant des couleurs criardes. Ils ne sont pas nombreux. Les Portugais se comptent sur les vingt doigts et orteils. Eux aussi placardent leur origine — et un crucifix en bois le plus souvent — sur la porte d’entrée. Ils vivent à l’est de La Folie, après la zone des célibataires. Les Maghrébins se trouvent à l’Ouest vers la place El Qahira. On ne se mélange pas. Les contrôles policiers sont très nombreux, vexatoires et racistes. Les pleurs des mères et des enfants n’affectent guère les officiers très remontés. Ils extraient les hommes des taudis pour les entraîner brutalement, mains croisées sur la tête, jusqu’aux fourgons bleu sombre stationnés dans la rue. Parfois ils incitent leurs bergers allemands à sauter sur les moins dociles, ceux qui posent des questions, qui rouspètent. De temps à autre une baraque brûle et son occupant emmené menottes aux poignets vers une destination inconnue ou bien assassiné devant son gourbi sans que l’on sache si l’agression était une provocation des FPA, les Forces de police auxiliaire, des Calots bleus, ou bien un règlement de compte politique interne, car les Algériens sont partagés entre messalistes, ceux qui apportent leur soutien au Mouvement national algérien (MNA) de Messali Hadj, et frontistes, ceux qui l’offrent à El-djebha, le Front de libération nationale (FLN). Beaucoup d’Algériens paient de leur vie cette division. Lorsque El-djebha et l’Union des travailleurs algériens ordonnèrent la grève générale, Kada, qui est plutôt messaliste, ne sut pas trop comment il devait réagir. Et puis dans son travail, Mario le représentant de la CGT, auquel il fait grandement confiance, lui dit qu’il n’avait aucun conseil ni consigne à lui donner. Dans l’entourage de Kada on est plutôt FLN. Son cousin l’est, ses proches le sont. Kada se résolut alors à la discrétion. Mais lorsque ce parti lança il y a quelques jours l’appel à manifester le mardi 17 octobre pour dénoncer le couvre-feu discriminatoire instauré par Papon aux seuls « FMA », Français musulmans d’Algérie, et pour revendiquer l’autodétermination, il n’hésita pas longtemps. L’appel — « habillez-vous comme au jour de l’aïd » — fit le tour du bidonville et remplit les cœurs d’espoir. À la sortie du travail — il finit son service à 13 h — Kada se rendit directement aux Bains-douches, au 20 rue des Pâquerettes à deux cents mètres du camp. Il cadenassa son vélo à l’entrée. Il se lava dans la cabine N° 8 qu’il choisit chaque fois qu’il se rend dans ces douches. Si elle est occupée, il attend. Hier elle était libre. Il se rasa et rentra chez lui pour se changer. Exceptionnellement il s’habilla de son pantalon et veste de tergal noir et d’une chemise blanche, son unique costume qu’il réserve aux belles occasions. Puis il lissa ses cheveux avec de la brillantine, aspergea son visage et la chemise d’eau de Cologne. Lorsqu’il finit, il demanda à sa femme silencieuse dont il voyait bien les larmes couler sur ses joues de n’ouvrir à personne avant son retour. Puis il l’embrassa sur le front et lui dit « arrête, ça sert à rien ». Kada ne veut pas que Khadra manifeste. Une autre fois peut-être. Pourtant beaucoup d’hommes accompagnés de leurs enfants et épouse quittèrent le bidonville par petits groupes après avoir été fouillés par des responsables du Front. Aucun manifestant ne devait porter d’arme ou d’objet contondant. Ils sont tous convaincus que la cause qu’ils défendent est juste, qu’elle seule les extirpera de leur misérable condition. Lorsqu’il arriva à hauteur de l’entrée principale du bidonville, Kada se prépara à la fouille. Il leva les bras pour faciliter les palpations du frère de El-djebha. Seuls les hommes étaient palpés. Kada avait rendez-vous avec Lahouari au café-hôtel de la rue de la Garenne, mais il ne l’y trouva pas. C’est son adresse, celle du café de Ali, que beaucoup parmi les habitants de La Folie donnent pour toutes leurs correspondances, parfois même pour les rendez-vous. C’est chez Ali également que l’on dépose très discrètement les cotisations pour le FLN. Lors d’une ronda entre deux distributions de cartes ou d’une pioche pendant une partie de dominos, on adresse un signe à la personne chargée de la collecte et le tour est joué. À la fin de la partie, le militant attend le donateur derrière le comptoir, l’échange est voulu banal avec salamalecs et embrassades. Le client remet discrètement au militant une enveloppe (les billets sont toujours glissés dans une enveloppe qu’on cachette sans y porter d’inscription), on rajoute quelques mots et on se quitte jusqu’à la prochaine rencontre. Parfois c’est dans l’escalier interne qui mène à l’hôtel, ou dans une chambre que l’enveloppe passe d’une main à l’autre. Si la personne ne peut se présenter, c’est Ali qui a la charge de donner l’argent au collecteur en spécifiant le nom du bienfaiteur. C’est précisément à Ali que Kada remet plus ou moins régulièrement les 9500 anciens francs que ses parents récupèrent à Saint-Leu. Kada continue d’aider sa famille, même si c’est encore plus difficile qu’aux premières années. Lorsque Ali ou quelqu’un d’autre pose des questions, parfois délicates, concernant l’engagement politique de Kada, Lahouari remet aussitôt les choses dans l’ordre qu’il décida. Il protège en toutes circonstances son cousin. Ce mardi, Ali ferma plus tôt son café pour signifier aux habitués leur responsabilité. Mais lui-même ne se rendit pas à la manifestation, il resta pour avoir l’œil sur les va-et-vient dans son hôtel. « Wallah je ne l’ai pas vu » dit l’hôtelier à Kada qui alla alors se fondre parmi les milliers de manifestants partis à l’assaut des beaux quartiers de Paris. Kada trouve que même sous un temps maussade comme hier, sombre et pluvieux, ces quartiers sont magiques, comme sortis d’un rêve de vacances. Lorsqu’il s’y rend, à l’occasion de circonstances extraordinaires, il les traverse les yeux rivés au sol, car il ne veut déranger personne ni quoi que ce soit, « mais aujourd’hui c’est une autre histoire » pensa-t-il alors qu’il atteignait Neuilly. Il transita par le Rond-point de La Défense, un des lieux de rassemblement. Il continua sur l’interminable avenue de Neuilly avant de gagner la Seine et le pont qui porte le même nom. Ni la nuit qui s’installait, ni le froid qui se faisait plus vif, ni la pluie qui se remit à tomber, fine et perçante, ne découragèrent les manifestants qui arrivaient de toutes parts par flots ininterrompus : Puteaux, Courbevoie, Asnières, La Garenne… La masse des gens était devenue si dense que rares étaient les véhicules à moteur qui pouvaient circuler normalement. On n’entendait aucun slogan, juste le bruit des pas sur la chaussée mouillée, le clapotis de l’eau et les voitures au loin. C’est là, sur le pont de Neuilly, au-dessus de l’Île du Pont, que Kada reçut les premiers coups de bidules. Au loin on entendit des bruits secs, comme des coups assenés avec violence, suivis d’un mouvement de foule, des cris de femmes. Lorsque des fusillades retentirent, se sont ses enfants qui apparurent spontanément à Kada. Il prit peur et aussitôt se déprécia de se laisser gagner par cet état et les tremblements qui s’emparaient de ses jambes, mais c’était au-delà de ses forces. Il tenta de se ressaisir, fit demi-tour. La peur gagnait d’autres manifestants. Des enfants et des femmes couraient dans tous les sens et, de nouveau, Kada pensa à sa famille, à ses fils. Monique avait promis de passer à la maison, comme souvent les mardis, pour consacrer une heure de son temps — qu’il ne lui viendrait jamais à l’esprit de compter — au petit Messaoud pour qu’il apprenne à lire correctement et comprenne la leçon. Mais le matin il avait entendu dire que Monique avait la ferme intention de se joindre aux manifestants. Il la revoyait dans ses pensées. Il l’entendait : « Messaoud, retiens bien ceci, le mot qui dit ce que font les personnes, les animaux, ou les choses… » Kada ne savait plus, il ne retint pas la suite, « est un verbe, un verbe. » Il la voyait, penchée sur son enfant « lit Messaoud, lit : la fille rit. Le chat miaule. Le train roule. » Et Messaoud reprenait les phrases écrites sur son premier livre de grammaire française, à la lueur de la bougie, en faisant glisser son doigt le long des jambages et traverses des lettres, et il répétait encore à la demande de Monique : « la fille rit… » Kada sourit à cette pensée. Comment son fils, qui n’a que sept ans, pouvait saisir ce que lui-même ne comprend pas ? Des policiers, groupés, chargèrent de plus belle : « ratons ! », « fellouzes ! », « crouillats ! » La présence des Français musulmans d’Algérie dans les rues est perçue comme un défi, comme la violation du couvre-feu instauré pour eux seuls, dès 20 h 30. Des Forces de police auxiliaire sautèrent des cars Renault noirs qui venaient des rues adjacentes et se mirent à frapper au hasard avec leurs armes. L’un d’eux se rua sur Kada qui avançait le long des immeubles, tête basse. Plongé dans ses pensées il ne comprit pas de suite ce qui lui arrivait. Il projeta ses bras devant lui pour protéger son visage, son corps. L’agent de police redoubla de férocité. Il lui assena de violents coups avec la crosse de son arme qui causèrent de nombreux hématomes et fendirent son arcade sourcilière. Le policier hurlait, ahanait entre deux injures « pourri, fellaga ! » Dans sa tentative de se dégager de l’emprise de cette force tombée sur lui qu’il ne voyait pas, Kada ne réalisait pas qu’il avait affaire à un agent de l’ordre public. Il était submergé par une force physique, un rocher, un camion, un monstre. Il revit madame Hervo, son fils Messaoud, sa mère. Puis il bascula. Il tomba à terre, face contre le trottoir ruisselant d’eau boueuse. Il demeura ainsi, immobile, pendant un temps dont il ne sait s’il dura dix minutes ou soixante, avant de se relever, aidé par des manifestants. Les FPA avaient, lui dit-on, embarqué dans leur fourgon plusieurs marcheurs. Kada entendait comme des échos au loin, un brouhaha. Il devinait les slogans : « les racistes au poteau, l’Algérie algérienne ! » Celui-ci avait fait plusieurs fois le tour du bidonville. L’homme qui le soutenait par la main lui demanda de relever la tête « Rfâ rassek ya si Mohamed ». Au ton sec de sa voix, Kada supposa que l’homme appartenait au service d’ordre ou d’encadrement. Il le remercia du regard. Ses lèvres tremblaient comme ses paupières. Puis il reprit la marche, incertaine, sur une centaine de mètres. Les tiraillements de son cuir chevelu l’obligèrent à des grimaces qui déformaient son visage. Kada décida d’abandonner. Il s’éloigna des marcheurs malgré la garde des membres du FLN. L’homme qui aida Kada poursuivit son travail, loin de lui. Mais la surveillance devenait moins sévère, du fait de la nuit. Kada entama une marche à travers d’autres rues moins chargées, une marche à contresens des manifestants. Il atteignit La Folie en rasant les murs, trempé, flageolant sur ses jambes, la honte au cœur et la peur au ventre d’être découvert ou d’être tué. La semaine précédente, à Gennevilliers, un jeune Algérien qui sortait d’un cours du soir de rattrapage, fut froidement abattu. Un autre, âgé de 13 ans, fut tué par une rafale tirée par des policiers à Boulogne-Billancourt, rue Heinrich. Depuis le début du mois, il ne se passe pas un jour sans que l’on apprenne l’assassinat ou le meurtre d’un homme, parce qu’il est Algérien ou apparaissant comme tel. Un Portugais et un Sicilien basanés furent ainsi tués durant ce mois d’octobre. Un journal titra : « Événements d’Algérie : deux Européens victimes d’une bévue policière à Paris. »
Dans le tuyau asséché, Kada se remet peu à peu. « Pourquoi cette haine ? » se demande-t-il. Il tente de se redresser, mais la canalisation dans laquelle il se terre est trop étroite, même pour lui. Ses bras, ses jambes, sont endoloris. Il ne s’en veut pas d’avoir fait le choix de la manifestation contre les autorités, mais il ne s’attendait pas à une telle fureur. Mourir pour avoir marché avec les frères ! Tôt le matin, il abandonne discrètement sa cache. Il est transi de froid. Il a faim et soif. Avant que l’animation plus ou moins habituelle ne gagne de nouveau le bidonville, Kada atteint sa baraque, de l’autre côté. Lorsqu’il ouvre la porte, il comprend à la vue de ses yeux rougis que Khadra ne dormit pas de la nuit et qu’elle pleura toutes les larmes de son corps. Elle ne se risque pas à flageller ses cuisses comme elle est tentée de faire et comme il est de coutume de procéder dans de telles situations, et la situation en l’occurrence se manifeste en cet homme devant elle, hagard, au front marqué par des plaies, le corps recouvert de lambeaux dégouttant d’eau sale, un homme qu’elle reconnaît à peine. Mais c’est la guerre et Kada la prie de se calmer, de reprendre ses esprits « ma ândi walou, ma ândi walou », je n’ai rien répète-t-il. Khadra, nerveuse, va chercher du bois pour lui faire chauffer de l’eau, en gémissant, la main sur la bouche. Les enfants dorment.
Ce mercredi, un autre silence plus grand et plus lourd, semblable à ceux de trois cimetières réunis, plane sur le bidonville. Dans un murmure partagé, des hommes de bonne volonté soulagent les blessés qui se comptent par centaines et qui ne veulent surtout pas se rendre à l’hôpital. Ils prendraient le risque d’être arrêtés et torturés. Il faut à Kada trouver des arguments suffisamment solides pour justifier son absence et son état physique auprès du chef d’équipe. Il soupire à la pensée qu’il aura le soutien de Mario, même si son chef n’est pas dupe.
Alors que Le Populaire de Paris compare la vie des Algériens à celle des prolétaires du siècle passé, l’Express fait un long compte-rendu de son correspondant « chez les melons, les crouillats, les bicots… » et titre en une sur le visage d’un fils de ceux-là : « Jean Cau chez les ratons ». Pour 1,25 NF.
Mais alors que le cher pays, l’Algérie, est abandonné par eux, la France n’offre ni fleurs ni royaume aux pieds-noirs et leurs alliés. Au mieux les Marseillais les accueillent-ils avec une indifférence portée par le même dédain qu’ils ont pour les ingrats en général. La population, selon Paris-Presse, remisa sa compassion. Sur de grandes banderoles, on lit « PIEDS-NOIRS RENTREZ CHEZ VOUS !! » en lettres majuscules avec deux points d’exclamation ou encore « ALGERIE LIBRE ! » en lettres majuscules également, mais un seul point d’exclamation. Gaston n’avait pas de mots pour répondre à Mimoun qui tirait sur un pan de la veste, « papa, c’est nous aussi les pieds-noirs ? » La renommée de Ginette, Lina l’Oranaise, ne semble manifestement pas avoir une quelconque prise de ce côté-ci de la Méditerranée. Confinée à sa communauté sa célébrité n’est par conséquent d’aucune aide à la famille Pinto face aux services administratifs marseillais. Pas de coup de piston. Heureusement, elle est prise en charge par Le Secours catholique qui l’héberge un temps avant de l’orienter vers un hôtel du troisième arrondissement pour quelques semaines. Mimoun reprend le chemin de l’école avec un retard de près de trois mois. Pour Yacoub tout est nouveau : la cour de récréation, la maîtresse, ces grappes d’enfants, tout ce remue-ménage. En Algérie Gaston et Dihia souffraient chaque jour de voir Mimoun quitter la maison pour aller à l’école, de ne plus l’avoir à leur côté avant la fin de la journée. Avant de refermer la porte derrière lui Dihia le mettait en garde, « surtout n’accepte rien de personne, tu entends ? » Les derniers mois étaient terribles, Radio-Alger alertait, « les morts et les disparitions se comptent par centaines ». Quant à Yacoub — il avait six ans et demi — les parents préférèrent le garder auprès d’eux.
Face au questionnement moqueur du directeur de l’école de la rue de Sery à la Belle de Mai où est affecté son fils, Gaston ne s’égara pas au-delà du rappel d’une réalité que nul, y compris les chefs d’établissement, n’était en mesure d’ignorer : « c’est à cause des événements, on vient de là-bas ». Le maître d’école n’apprécie pas ces écoliers venus d’Algérie. Dans la classe de CM1 que fréquente Mimoun, deux autres élèves arrivent comme lui du bled. À tous ceux qui fuirent le pays en guerre, on fait systématiquement redoubler l’année scolaire. Le maître répète à son directeur « les jeunes pieds-noirs sont taciturnes, absents, préoccupés par je ne sais quoi ». Il dit les avoir à l’œil, mais cela n’échappe pas à Mimoun qui rentre souvent en pleurs, car ses camarades moquent son accent, son accoutrement, ses oreilles décollées, sa maigreur, sa taille. Il n’est plus « enano », mais « rasqueux ». Et chaque soir il se plaint auprès de son père des sarcasmes et des injures dont il est l’objet. Un jour, n’en pouvant plus d’accumuler ses jérémiades, Gaston finit par le rabrouer vertement « défends-toi, ti es plus grand, casse-leur la gueule leche, qu’est-ce que ti attends ! ti as pas honte ! »
Gaston supporte de moins en moins cette ville et le minuscule appartement de la rue Guibal que lui sous-loue un Arménien, beaucoup moins cher qu’une chambre d’hôtel. « Arménien mon œil, il me prend pour un coño » Le père ne le croit pas. Il dit à qui veut l’entendre que « ce type c’est un Arabe, ils nous chassent d’Algérie et on les retrouve ici à faire la loi déguisés en Russes, en Arménien ou je ne sais quoi, me cago en tu madre », fulmine-t-il. Gaston se sent rejeté par cette ville et ses habitants et cela s’aggravera avec le déferlement de plusieurs centaines de milliers de pieds-noirs, harkis et israélites mêlés, au courant de l’année 1962. « Les Français ils ne veulent pas de nous, de notre drôle d’allure comme ils disent. Ils nous accusent de tous les maux, de tous les vols commis dans la ville, de toutes les misères. Ils veulent qu’on aille nous ‘‘réadapter ailleurs.’’ » Gaston est très déçu par les Français. Déçu et désemparé. Il se demande si Zohar vit le même calvaire à Port-Vendres. Hormis quelque temps comme ouvrier à la Manufacture de tabacs, il ne bénéficie toujours pas d’un emploi stable. Journalier, c’est tout ce qu’on lui propose. Manutentionnaire quelques jours par semaine ou par mois. Comme elle n’a plus les moyens pour payer le loyer, les aides ayant fortement diminué, la famille est expulsée. Gaston ne sait plus à quel saint se vouer désormais. Il reprend les prières qu’il avait abandonnées à l’époque du service militaire. D’abord discrètement, puis à haute voix, dans un coin de la chambre, toujours seul. Il se met debout, face contre le mur. De temps à autre, il fait trois pas en arrière puis trois en avant. À un moment précis qu’il renouvelle, il récite en fléchissant les genoux et en inclinant le buste : « Ado-Naï Séfatay Tifta’h Oufi Yagid Téhilatékha : —Baroukh ‘Atah AdoNaï, ‘Elo-heinou Vé’lohei Avotéinou ‘Elohèi Avraham ‘Elohèi… »
Il les a acceptées à leur arrivée, mais aujourd’hui Gaston ne supporte plus la charité et les aides officielles ou communautaires. Plutôt que le réconforter ou le fortifier, ces soutiens le diminuent. En son être profond, il estime ne pas valoir plus qu’un misérable. La vie lui semble injuste et la nouvelle sur les vrais assassins de son ami ajoute à son désarroi. Lorsqu’il a pris connaissance de cette information, Gaston demeura sans voix pendant de nombreuses minutes. Il tentait confusément de reconstituer le fil des événements de ces infernales journées de septembre 1961 à Derb lihoud, particulièrement la semaine de Rosh Hashana. Puis soudain il se sentit comme libéré. Il se leva du banc où il s’était laissé tomber pour reprendre ses esprits, tapa du poing contre la paume de son autre main, puis aussitôt joignit les deux mains et dit « merci Éternel », il ajouta en levant les yeux vers le ciel « aide-moi » et il baisa ses doigts. La révélation concernant les véritables assassins de Gilbert Chakroun n’est pas étrangère à la décision qu’il est sur le point d’arrêter. C’est elle qui fera avancer le curseur de plusieurs crans en sa direction. En cette fin de printemps 1963, l’information qui se propagea dans toute la Communauté comme une traînée de poudre bouleversa Gaston. « Les commanditaires de l’assassinat de Gilbert Chakroun sont membres du FNF ». Pour attiser les haines et répandre le chaos chez les israélites, ils firent croire que les assassins étaient Arabes. C’est pourquoi Gaston envisage une réponse radicale, catégorique et non négociable. Chaque jour il accumule des informations, des indices, pour lui donner une forme en phase avec la tragédie. Chaque jour elle devient de plus en plus claire et évidente, de plus en plus enthousiasmante, exaltante même. En quelques semaines ses émotions se métamorphosèrent. Gaston y croit fermement, cette résolution rendra son honneur à toute la famille. Le moment venu, lorsqu’il aura pesé tous les facteurs positifs et tous les inconvénients, pesé tous les pour et tous les contre, Gaston la livrera à Habiba qui — depuis l’assassinat de son mari — n’a plus que Gaston sur qui compter. Il y a Dihia et Zohar évidemment lui rappelle son fils, mais « ce n’est pas pareil » répond-elle. Il y a aussi les petits-enfants, mais « ils sont trop jeunes les petits ! » Gaston lui fera part de sa volonté à elle d’abord qui s’en réjouira.
Ce moment tant attendu arriva, c’est désormais une décision arrêtée plus qu’une idée projetée ou en maturation : quitter la France pour la aliya. C’est sa mère qui s’émut la première, « nous serons heureux dans notre Eretz mon fils ». Puis Gaston en parla à sa femme et à ses enfants. Les mois à venir donneront jour au grand rêve du père, à leur aspiration à tous, « rejoindre la Terre promise, c’est l’espoir de tout juif en ce bas monde ». Lorsque Gaston fait part aux agents des services sociaux de son désir de quitter la France pour Israël, ils le soutiennent aussitôt en lui proposant de rejoindre le flot des juifs au Grand Arenas, un ancien camp de transit jadis réservé aux prisonniers allemands, où les conditions de vie, lui disent-ils, seront moins mauvaises, « un transit de quelques semaines avant le grand saut ! » Les employés, submergés par l’empathie que leur conscience leur impose à l’égard des rapatriés — à l’inverse des officiels de la ville — ou débordés par la charge de travail tant le nombre de cas à traiter ne cesse de gonfler, ne supportent plus de voir Gaston et sa famille embourbés dans un quotidien chaque jour plus difficile, ou de le voir, lui, venir fréquemment se plaindre de sa situation. Ils ont hâte de lui trouver une place dans la grande famille d’Arénas avant l’été.
Les rayons de soleil de plus en plus mordants et familiers annoncent une saison estivale prometteuse et cela réconforte quelque peu la famille. Yacoub finit sa première année en cours élémentaire et Mimoun le cycle du primaire, mais il n’est pas autorisé, vu son jeune âge, à passer le certificat d’études. Les nouvelles que reçoivent Gaston et Dihia de Port-Vendres où les parents de Dihia et la grand-mère Sadia emménagèrent dans un deux-pièces sont rassurantes. Zohar fut, peu de temps auparavant, embauché au service de la confection des caisses et boîtes en carton de l’usine d’explosifs de Paulilles malgré ses cinquante-huit ans. La belle Ginette ne quitte presque pas l’appartement. Lorsqu’elle s’y résout, c’est pour faire quelques courses en compagnie de sa mère. Alors elle s’habille « comme il faut », met ses belles grosses boucles d’oreilles en forme de cœur et ses élégantes lunettes noires lorsque le temps est au soleil. Sa voix chaude elle la réserve à son mari et à Sadia. Personne dans la ville au-delà des pieds-noirs, au-delà de la Communauté, ne se doute de la fierté qui hier la portait elle et sa famille, ni de l’humilité et l’anonymat qui secrètement l’accablent aujourd’hui. À leur tour Gaston et Dihia confirment à la famille leur décision de quitter la France pour Israël, « notre rêve va bientôt se concrétiser Bezrat Hachem, N’challa. »
Pendant la récréation, les camarades de classe de l’école du Petit Nanterre où est inscrit Messaoud, plutôt que de jouer aux billes, à la balle, à saute-mouton, ou d’admirer la beauté du grand sapin de Noël illuminé au milieu de la modeste cour, s’amusent à prendre à partie tous les Mohamed et les Fatima autour d’eux. Ils chantent et dansent à proximité de l’arbre en tapant des mains une-deux-trois, une-deux, une-deux-trois fois, en syllabant : « Les Arabes – ratons – dégoûtants », puis de nouveau trois fois, deux et encore trois fois « les Arabes – melons – les pouilleux. » Certains enseignants, comme monsieur Moro, évoquent fréquemment « l’invasion des Arabes stoppée grâce à Charles Martel en 732 » et « la croisade à Damiette de Saint-Louis notre honneur. » Messaoud est persuadé que l’instituteur eut des problèmes personnels soit avec des Arabes soit avec Damiette soit avec l’Islam, soit avec sa propre famille, « pourquoi y nous aime pas ? » Messaoud se demande aussi si monsieur Moro reportait dans le journal de classe, toutes les tares dont il couvre les Arabes. Il est également persuadé que cette école-là n’est pas faite pour lui. Parfois son père lui répond pour se consoler soi-même et passer à autre chose : « la guerre, mon fils, c’est à cause de la guerre. » La guerre que la France perdit il y a quelques mois à peine. Le 5 juillet, il y eut autant de larmes de joie, que d’interrogations chez tous les Algériens de France. « Et maintenant que va-t-il se passer ? » Cette interrogation tournait en boucle au milieu d’autres entre les habitants des bidonvilles parmi les chants des montagnes, min jibalina, les envolées de youyous et les drapeaux approximatifs hâtivement conçus. On dansa, chanta jusqu’à n’en plus finir. Des journalistes prirent des photos, interviewèrent les plus en vue des résidants, « les leaders ».
Lorsqu’au printemps 1962 Kada apprit qu’on lui avait attribué un logement, il ne sut comment exprimer sa gratitude à Monique, car sans son aide il n’est pas sûr qu’il aurait bénéficié de quoi que ce fut. S’il fallait aux autorités montrer leur fermeté à l’encontre du FLN, il leur fallait également montrer qu’elles prenaient en considération les revendications du puissant parti communiste et des nombreuses associations qui ne cessent depuis des années d’attirer leur attention sur l’insoutenable quotidien des familles dans les bidonvilles autour de Paris. Le premier week-end de septembre, Kada emménagea dans un logement de la Cité des grands prés. Plusieurs officiels étaient là, ainsi que des agents de l’ordre public. Kada était content de quitter La Folie et plus content encore que Monique fut présente. « Si je suis arrivé là, c’est grâce à toi Monique » lui dit-il, « tu restes manger le couscous ». D’autres familles bénéficièrent de logements identiques. La cité de transit est constituée d’un ensemble de baraquements individuels de même forme, de même surface, semblables dans la couleur, alignés comme les soldats d’une armée alpine. Depuis que Khadra l’avait rejoint, Kada rêvait, la nuit comme le jour, d’un abri décent et ils en discutaient souvent. Kada y songeait plus qu’à n’importe quoi d’autre, enfin presque. Il y pensait autant qu’à l’indépendance de l’Algérie. Ouvrir le robinet et admirer longuement l’eau qui coule fut l’un de leurs premiers gestes, elle dans la cuisine, lui dans la salle d’eau. Les deux premiers dimanches après son emménagement, tous les amis de Kada, Houari son cousin et quelques collègues vinrent manger le couscous de la baraka, celui qui transporte sur le sol des aïeux et éloigne le mauvais œil de tous les présents. Les enfants de Khadra et de Kada ne courront plus derrière une boule de tissus alourdie par la boue, n’auront plus froid dans la maison, ne se chaufferont plus au bois de palettes.
Hadj El-Khamis découvrait les joies et peines de l’école et Messaoud entamait sa troisième année. Trois mois après la rentrée, les seuls amis des frères El-Bethioui sont Algériens ou Marocains. Rayan est le plus proche de Messaoud. Autour du sapin, les élèves chantent et dansent en tapant des mains : « Les Arabes sont dégoûtants… » Messaoud et son ami sont assis sur le rebord du trottoir, près des toilettes. Messaoud regarde ses camarades de classe, pensif. Ses deux poings posés sous le menton retiennent sa tête, lourde, déjà, de tant d’interrogations, de tant d’incompréhensions. La blondeur de Rayan le sert bien, autant que sa rondeur. Lui, à moins d’énoncer son nom, a beaucoup moins affaire aux injures que Messaoud, mais il est très solidaire. « Tapettes ! » se hasarde-t-il parfois en levant le bras. Ces temps sont très douloureux pour Messaoud qui se questionne et questionne son père qui se contente le plus souvent de hocher la tête : « pourquoi mes copains sautent autour de nous en tapant dans les mains et en répétant ‘‘ratons, melons’’ ? » Ratons, melons, bougnoules et d’autres mots qui hanteront l’esprit du jeune Messaoud après avoir longtemps tourmenté celui du père.
Le centre de transit du Grand Arénas se trouve derrière la prison des Baumettes. Des milliers d’israélites s’y entassent en attendant le grand jour. On attribua à la famille Pinto un espace au sein du bloc numéro 17. Les blocs, qu’on appelle aussi « les tonneaux » sont de grands baraquements construits par monsieur Fernand Pouillon. Ils sont semblables aux cantonnements militaires tout en tôles ondulées, rouillées le plus souvent. Un bloc peut accueillir entre dix et trente familles, plus elles sont importantes, moins le bloc en contient. La plupart des familles sont nombreuses. Aussi dans certaines situations la promiscuité frôle la limite du supportable. Pour s’isoler des autres familles, avoir un peu d’intimité, Dihia tendit une corde sur laquelle elle fait pendre des draps. Le camp est infesté de rats jusque dans les cuisines. Les bruits courent que certains transitaires, acculés par la faim, s’en nourrissent en cachette. Les conditions de vie sont exécrables. On est assailli par la maladie au milieu de monticules de détritus. Devant le dispensaire, on fait la queue pour être soigné de la tuberculose, de la teigne et du trachome. Avec le Kodak Brownie flash de son père, Mimoun prend en photos ses camarades, ses parents debout derrière Yacoub et Yvette, les mains posées sur leurs épaules, tantôt à l’intérieur du baraquement, tantôt sur la grande place, devant les marches de la synagogue ou devant l’épicerie. Il fixe aussi des espaces du camp comme l’entrée du grand tonneau où ils logent. Et bien sûr le drapeau juif qui flotte sur la façade de La Maison de l’espoir, la Mizrahbé. « C’est à Arénas que j’ai découvert le drapeau de notre Communauté, celui de tous les israélites, le drapeau d’Israël. » Il y a quelques années madame Eleanor Roosevelt y était venue encourager les résidents. Mimoun n’est pas trop dépaysé dans cet ensemble peu affriolant fait de bric et de broc. À Oran il se rendait bien avec ses camarades à la grande basura de P’tit-lac face au « cimetière américain » à la recherche de câbles et objets en bronze ou en cuivre qu’ils revendaient au kilo aux récupérateurs de Lamur ou du « Village nègre » — c’est ainsi que les pieds-noirs désignent M’dina Jdida, le « Village nègre » — sans jamais rien dire aux parents. La basura était leur jardin initiatique. Quand sur la route qui la longeait, passait un Saviem poussif surchargé de cinsault de Rio Salado, les enfants criaient « la huvas ! » en courant après. Parfois ils réussissaient à s’aggriper à la ridelle et chapardaient quelques grappes. À la basura Mimoun et ses copains n’hésitaient pas à se jeter à la figure toutes sortes d’immondices, mais aussi à partager le contenu de boîtes de conserve d’olives, de sardines, glanées dans les monticules de déchets, cabossées rouillées et tellement usées que les dates de péremption en étaient devenues complètement illisibles. À Arénas, pour avoir une boîte de conserve ou un sachet de riz il faut faire la queue durant dix ou vingt minutes, parfois beaucoup plus. Les résidents sont tellement nombreux que les autorités de l’Agence juive, en charge avec le commandant de la gestion du camp, plantèrent des centaines de tentes supplémentaires entre les baraquements. Malgré la situation désastreuse, la solidarité n’est pas un vain mot. On sait gré à l’administration qui vient en aide aux faibles, même si certains lui reprochent la minceur et l’inefficacité des couvertures militaires qu’elle leur distribua. Les transitaires qui disposent d’un laissez-passer pour sortir du camp descendent en ville pour s’abriter dans les hangars moins froids, dans les couloirs désertés du métro ou dans les cafés populaires s’ils ont de quoi s’offrir un café ou une limonade. Au bar de La Fontaine, lorsque Martine, la patronne, veut bien brancher la télévision, Mimoun et ses copains regardent des films comme Au nom de la loi. C’est plus agréable que de voir au camp un documentaire élogieux sur Israël ou un film projetés sur un drap blanc, plus gris que blanc, tremblotant entre deux baraques, retenu à ses extrémités par quatre morceaux de corde accrochés aux tôles. Des films qu’on ne comprend pas toujours à cause des bruits environnants et de la mauvaise qualité du son. En dehors des cafés et des films, il n’y a rien d’intéressant à faire, chahuter les filles peut-être, courir après un chien errant, se chamailler comme à la basura. Il semble à Mimoun que le temps s’immobilisa. Voilà trois semaines qu’ils reçurent leur passeport et aucune date de départ ne leur est encore proposée pour le grand voyage. Les documents — un « Titre de voyage tenant lieu de passeport » pour chaque adulte — ils les reçoivent rapidement grâce à l’Agence juive et à la mobilisation des employés des services sociaux. Chaque titre comprend l’identité du candidat à l’aliya, sa photo et un timbre de 100 francs. Le titre de Gaston Pinto porte le numéro 6317. Celui de Dihia Zenata (avec les trois enfants Yvette, Yacoub et Mimoun) le numéro 6318. Le 6319 est celui de la mère de Gaston, Habiba Dahan. La photo du titulaire est collée sur le titre. Celui de Dihia est bien chargé.
Mimoun vit des moments que l’insouciance propre à son âge empêche d’en mesurer la gravité ou la profondeur. Seul le temps présent qu’il dépense avec ses camarades sans modération, le préoccupe ou le comble : parfois, le prenant de court, une marque de lucidité submerge son adolescence. Elle lui donne cette impression que leur situation est figée et que c’est cet interminable temps, ce temps présent, qui leur avait été promis, celui du froid et de l’indigence. Comme son père, il n’accepte plus ces conditions de vie au milieu de poubelles, d’eau stagnante et de toute cette misère qui finit par coloniser leurs habits et leurs pensées, leur patience. Puis par le truchement d’une voix, d’un anodin événement, d’un jeu, la légèreté propre à son âge s’impose de nouveau.
Plus tard, Mimoun se souviendra que dans leur malheur ils vécurent dans le camp d’Arénas des moments de joie, de franche rigolade. Dans le flot des souvenirs, lui reviendront des épisodes fort amusants comme ce jour où, aidé de camarades d’infortune, il était tombé à bras raccourcis sur un Arabe, aussi meurtri par la vie qu’ils ne l’étaient eux-mêmes, qui venait de remettre à son père, cuisinier dans le camp, sa gamelle de soupe et son gros pain. Alors que le gamin s’apprêtait à quitter les lieux, Mimoun et sa bande le pourchassèrent derrière les grillages qui entouraient une partie du camp, jusqu’aux Îlots, la cité où il habitait, en criant « Un raton, un crouillat, un raton, un crouillat ! » Le jeune Arabe, effrayé par les hurlements et les ricanements, s’écrasa sur un monticule de détritus. Lorsqu’il se releva, Mimoun et ses amis avaient disparu vers la station d’épuration, à proximité de l’infirmerie. Le lendemain, des inconnus lancèrent à l’entrée du camp, entre l’infirmerie et le bureau du chef de centre, un drapeau israélien auquel ils venaient de mettre le feu. Une importante bagarre avait suivi. Un homme utilisa même un pistolet. Il y eut peu de blessés, trois ou cinq, mais beaucoup de peur et un fort mouvement de panique. Dans sa solitude onirique, Mimoun se demandera s’il y avait un lien de cause à effet entre les deux événements.
Le Trans Europ Express s’ébranla à 13 h 07 de la gare Saint-Charles. Messaoud occupe une place dans un compartiment de la voiture 6, au milieu du train. C’est dimanche, il y a peu de passagers. Ce matin ses parents quittèrent définitivement la France pour l’Algérie. Le navire largua les amarres à 10 h pour trente-six heures de traversée avec à son bord des centaines de voyageurs et pour nombre d’entre eux leurs véhicules abondamment chargés. Messaoud dut s’absenter de son travail jeudi et vendredi pour les accompagner jusqu’au port de Marseille. Le responsable du personnel lui accorda les deux journées. Il lui demanda par contre de ne rien souffler à Michèle Bauvoir, la directrice de l’agence d’Intérim, « cela n’est pas nécessaire » précisa-t-il. Kada avait acheté deux véhicules d’occasion. Le premier, un fourgon de marque Peugeot qu’il chargea de tout ce qu’il possède et qu’il revendra au bled, le second, un véhicule léger de marque Renault 18, lui aussi bien chargé, qu’il compte garder. La hauteur des bagages entassés sur la galerie dépassait les limites autorisées, mais la chance leur sourit, car ils ne croisèrent aucun gendarme sur les routes. En Algérie « tout se vend, tout s’achète ». Ou se garde. Le matin du premier jour Messaoud participa au chargement du J5 qu’il conduisit jusqu’au port de Marseille. Son père le suivait au volant de la berline. Ils prirent la route à trois, en fin de matinée du jeudi 4 mai. Ils passèrent la nuit dans un hôtel avec parking sécurisé, au sud de Mâcon. Les deux nuits suivantes, ils furent hébergés chez d’anciens voisins de la cité des Grands prés installés dans la cité phocéenne. Les véhicules furent parqués non loin de leur domicile, dans un grand garage spécialisé, dans la rue du Petit Saint-Jean. Ils se réveillèrent très tôt ce dimanche pour embarquer sans précipitation ni bousculades. Kada dut solliciter son hôte pour introduire le J5 dans le navire. Il ne voulut pas solliciter les manutentionnaires du paquebot, car il s’en méfiait. Contrairement à Messaoud, Hadj ne put se libérer et donc accompagner ses parents, mais il resta avec eux jusqu’à la fin du chargement des véhicules jeudi matin, ce qui l’amena à reprendre son travail à 14 heures. Pendant ce mois de mai, Hadj El-Khamis — que peu de connaissances désignent encore par les deux parties de son prénom — devra se rendre plusieurs fois par semaine sur les lieux des stages pratiques de ses élèves afin d’évaluer leurs compétences avec les tuteurs qui les encadrent. Hadj est enseignant à Bobigny dans un centre de formation en alternance. Quatre à cinq fois par an, les apprenants sont tenus d’effectuer des stages en entreprise pendant deux semaines, parfois trois, à des dates et en des lieux arrêtés dès le début de l’année de formation, et de présenter un rapport de fin de stage. Toute modification de période, de lieu, de formateur… eut perturbé tout l’édifice administratif et créé des discussions byzantines lors des réunions hebdomadaires. Hadj ne voulait rien de cela.
Kada retourne dans son pays, presque heureux. De la France il est très déçu. Comme ses enfants, il reçut des tonnes d’insultes, fut la cible de tant de brimades. Longtemps il garda pour lui les injures et les vexations, ces mêmes haines dont il souffrait au travail, chez les commerçants, dans les transports et partout ailleurs en se disant qu’elles étaient circonstancielles, « ça leur passera… » Kada évitait autant qu’il le pouvait d’évoquer les rejets dont il fut l’objet depuis son installation en France. Il ne pourrait même pas dire s’il vécut le pire dans les tranchées, en 1944 et 1945, ou toutes ces dernières années. Les dirigeants français s’emportent violemment contre la nationalisation des hydrocarbures décidée par le colonel Boumediene. De leur côté les officiels Algériens sont outrés par la « mansuétude » dont jouissent les assassins de nombreux frères en France. C’est El-Moudjahid, le journal du parti unique, qui utilise les termes de « mansuétude » et de « connivences ». Les relations diplomatiques entre l’ancienne puissance coloniale et le nouvel État jaloux de sa fraîche indépendance se tendirent gravement. En France les Algériens subissent le contrecoup de ces exécrables relations, elles-mêmes nées des tensions sociales et des intérêts géostratégiques. Les journaux français titrent sur « le pétrole rouge » pour discréditer la qualité des hydrocarbures algériens. « Notre pétrole est rouge du sang du million et demi de martyrs » répondirent du tac au tac le journal El-Moudjahid et l’unique chaîne de télévision. C’est ainsi, dans ces circonstances malsaines, que l’empressé chef du personnel de l’usine de pâtes Milliat mit abusivement fin au contrat de travail de plusieurs ouvriers algériens, dont Kada. Au port de Marseille, l’agent de la Police de l’air et des frontières, tout en faisant signer à Kada l’attestation de sortie définitive volontaire du territoire français, lui lança cette dernière pique en guise d’adieu : « Alors, tu touches dix mille balles et tu rentres rejoindre Mesrine au bled ? » Que Dieu maudisse tes parents fils du pêché, « N’âal weldik ya weld el hram », s’insurgea Khadra contre l’agent qui accusa le coup. Il comprit que derrière cette phrase qu’il devinait dépourvue de douceur, et dont il saisit le sens du mot weldik, parents, se cachait une grande colère. Il dit « Ana weld Maâscar, Tizi ». L’agent des frontières est un pied-noir de Tizi, un village créé de toutes pièces par l’administration coloniale, qui se trouve à douze kilomètres de Mascara. Ses agissements et ceux de ses semblables se nourrissent aussi de l’actualité extrêmement tendue. Il leur fit signe de passer, ou plutôt — vu la brutalité du geste et la moue dessinée par ses lèvres — de dégager. Kada ne supportait plus le racisme qui le visait directement. Il l’attristait, parfois le rendait malade, plus encore, le désespérait. Il y a quelques semaines, le hall d’entrée d’un cinéma qui projetait Élise ou la vraie, vie fut endommagé. Sa façade était badigeonnée d’inscriptions vengeresses comme « Mort aux Arabes ! », « Assez de parasites algériens ! » Face au déferlement de haine qui s’abattait sur lui et les siens, Kada demandait à ses enfants de ne pas baisser les bras, d’être fiers de leurs origines. « Il n’y a pas d’arbre sans racines, leur répète-t-il, vous êtes français et algériens. Vos branches se développeront peut-être ici, mais vos racines sont là-bas, pas ici, attention ! » Parfois il s’étranglait : « les Français disent qu’on est sournois, paresseux et malpropres. Ils n’ont pas honte, ils disent aussi qu’on est vicieux et cruels ! C’est la honte de dire ça, c’est inhumain de dire ça. » Il lui arrivait d’être intransigeant, catégorique : « si par malheur un jour une loi venait à vous sommer de choisir entre la France et l’Algérie, j’espère que vous saurez faire le choix qui s’impose. » Les parents de Messaoud quittèrent définitivement la France, subissant jusqu’au dernier jour, jusqu’à la dernière, la plus éloignée portion de terre de ce pays, le racisme de nombre de ses citoyens, mais Kada n’entreprit pas de démarche pour restituer l’appartement à l’Office des HLM, car les enfants continueront d’y résider quelque temps. Eux ne veulent pas entendre parler de départ.
Le conducteur actionne les freins, le train ralentit, on distingue les quais. « Gare d’Avignon, trois minutes d’arrêt… » Messaoud ouvre un journal provençal abandonné sur la banquette par un voyageur. En page 7, un article critique « Les 21 heures de Munich », c’est le titre d’un téléfilm américain qui n’était pas encore programmé en France. Il raconte la prise d’otages lors des Jeux olympiques de Munich, il y a six ans. Messaoud se souvient que la même année une autre prise d’otages défrayait la chronique. Il se rappelle que les auteurs, Roger Bontems et Claude Buffet, avaient été exécutés à la prison de la Santé le matin du 28 novembre. La majorité des Français étaient satisfaits du dénouement. Certains avaient même applaudi à l’annonce de la condamnation à mort. Messaoud se souvient également qu’à la rentrée il ne reprit pas le chemin du lycée. Un temps s’était écoulé, un autre présenté. À presque dix-huit ans, il pensait qu’il était temps de trouver un emploi qui lui permette de s’occuper de sa propre personne, de son aspect vestimentaire, et si possible d’aider les parents. Son ami Rayan avait quitté définitivement la France pour l’Algérie. Ses parents avaient acheté un camion, y fourrèrent tous leurs biens et prirent la route en direction de l’Andalousie où ils embarquèrent dans un bateau pour le Maroc. Ils poursuivirent leur route jusqu’en Algérie où ils s’installèrent. Le père préférait la grande ville, Oran, où il avait acheté « cash » à un pied-noir sur le départ, une maison de maître, à Ghazaouet la provinciale d’où ils sont, père et mère, originaires, précisément de la réservée et modeste Tounane. « Nous avons voyagé pendant une semaine ! » dira plus tard Rayan. Ses études il les poursuivra au Lycée Pasteur. Quant à Messaoud, il traîna deux années durant à ne rien faire ou presque. L’oisiveté et les poches trouées avaient fini par imprégner son comportement à tel point qu’il se demandait parfois s’il ne valait pas mieux intégrer un réseau de revendeurs de cannabis des Puces de Saint-Ouen ou de la Porte de Montreuil. Ses camarades s’esclaffaient, mais lui ne plaisantait pas. Sa situation était désespérée, mais il ne sauta pas le pas. Parler, s’énerver est une chose, mettre un pied sur le sentier de la délinquance en est une autre. Il se répétait souvent cette phrase pour rassurer son égo. Messaoud fut astreint à occuper des postes précaires, tous dans le cadre de l’intérim, alternant avec de longues périodes de chômage. Ces emplois ne duraient pas, s’étalant sur deux jours ou sur deux voire trois semaines, pas plus : manutentionnaire, magasinier, manœuvre… Un jour il répondit à l’annonce d’une société de courses, placardée dans les locaux de l’ANPE : « Vous avez une Mobylette, vous êtes fiable, nous avons un emploi pour vous ». Lorsque l’employé de l’agence lui confirma qu’il s’agissait d’une proposition de CDI — c’était le premier travail stable qui s’offrait à lui — Messaoud demanda à l’employé de préciser à son interlocuteur, il faillit dire « avertir », qu’il était Arabe. Perplexe, celui-ci sourit en hochant la tête, puis s’exécuta. Messaoud entendit dans le combiné du téléphone l’éclat de rire du responsable de la maison de courses. Un rire franc, « sincère » pensa-t-il. Il eut alors cette sensation réconfortante que l’homme à l’autre bout de Paris le prenait par l’épaule et qu’il riait d’une bonne blague. Il frémit d’émotion. « Des gens bien ça existe » se dit-il.
— Vous avez une bonne Mobylette ?
— Oui
— Alors présentez-vous dès que possible…
En répondant par l’affirmative, Messaoud avait menti, mais il s’arrangea dans la semaine avec son père.
À la gare de Lyon-Perrache, un couple d’une cinquantaine d’années prend place en face de Messaoud. Chez eux comme chez lui le bonjour est discret, ce faisant Messaoud se redresse et reprend la lecture de son journal. Dans un petit encart il lit : « La maison de la radio a organisé le 3 mai dernier une rencontre sous le thème ‘‘Que reste-t-il de Mai 68’’ avec l’écrivain et chroniqueur Gabriel Matzneff et le professeur Georges Lapassade… » « Lapassade ? mais c’est un des profs de Razi… » pensa-t-il.
Durant deux ans, sur sa Mobylette bleue, Messaoud sillonna rues, avenues et boulevards de Paris, dans tous les sens, d’est en ouest, du sud au nord. Dans ses moindres recoins, la ville lui était devenue aussi familière que les rues boueuses de La Folie. Quel que fût l’état du ciel, pluvieux ou ensoleillé, il distribuait lettres et paquets, de 9 h à 19 h, parfois au-delà. Messaoud ne pouvait s’offrir le luxe de rouspéter contre deux ou trois courses supplémentaires tardives au risque de se mettre à dos ses amis employeurs. Il était comme un facteur payé au bon — une course pouvant valoir un ou plusieurs tickets selon le trajet parcouru —, chacun valant 2,85 francs nets. Les patrons de Quick Courses, Aline et son mari Martin, deux anciens maos de Mai 1968, l’appréciaient, mais ne le ménageaient guère pour autant. Lui-même les avait en estime sans être dupe de leur équivoque relation. Un jour Messaoud dut abandonner ses tournées, car sa Bleue comme il aimait désigner son outil de travail, rendit l’âme. Chaque semaine elle avalait trois à quatre cents kilomètres de bitume, parfois elle rouspétait à sa manière, surtout le matin quand il faisait trop froid ou lorsqu’il pleuvait. Il fallait à Messaoud insister pour que son cœur, celui de la Bleue, daigne reprendre ses pétarades. Parfois il devait gonfler une chambre à air, réparer un pneu, plus rarement décalaminer le pot catalytique. Affectueusement, et parlant d’elle, il disait aussi « ma bécane ». Les patrons estimaient bien Messaoud, mais pas au point de lui offrir une nouvelle Mobylette ou même de contribuer à son achat. L’idée n’effleura pas Messaoud qui s’en remit une nouvelle fois à Central-Intérim qui l’avait perdu de vue. C’est par cette même agence du pont de Bondy, qu’après une période alternant chômage et travail en intérim comme veilleur de nuit dans un hôtel, comme manœuvre, et comme enquêteur de rue, il fut retenu pour travailler chez Darty. Une première mission de trois semaines comme employé de bureau au service comptabilité. Son activité consistait, comme encore aujourd’hui, à tamponner les doubles de factures en utilisant un tampon encreur, à la fois chiffreur et dateur. En fin de journée le chef de service rassemblait, comme aujourd’hui, tous les doubles de factures pour les remettre au bureau de l’Analytique. Messaoud est un employé appliqué et rapide à la fois. Il en faisait tant et tant, comme aujourd’hui encore, que sa mission fut plusieurs fois renouvelée au grand dam de certains de ses collègues qui le trouvaient, et le trouvent encore, plutôt zélé. « Je fais mon travail c’est tout », se contente-t-il de leur répondre. La semaine prochaine son dernier contrat arrivera à terme, mais il préfère ne pas trop y penser. D’ailleurs le rhodanien entre en gare de Lyon. L’horloge indique 19 h 42. Messaoud prendra le nouveau Réseau express, puis le bus jusqu’à Nanterre. Il pense ne pas bouger de chez lui jusqu’à mardi, le lundi 8 mai étant un jour sans.
Le jour décline et les côtes provençales ne sont plus qu’une masse de plus en plus informe, incertaine. Elle disparaîtra, emportée par la distance et l’immense manteau noir. Mimoun est assis sur le dernier banc, à l’arrière du Phocée, devant le parapet. Il fixe un point imaginaire, au large, comme d’autres passagers, chacun le sien. Dans le nouveau transistor Radiola que son père, allongé un peu plus loin derrière lui, lui prête de temps à autre, il écoute Salut les copains. Les radios françaises sont encore audibles. Sheila chante joyeusement la fin de l’école et Enrico Macias pleure après elle son pays perdu. C’est lui que Mimoun préfère. Sheila est trop contente et puis « Enrico, lui, il est de chez nous » : « J’ai quitté mon pays/J’ai quitté ma maison/Ma vie, ma triste vie… » Un jeune homme à quelques mètres arrête de discuter. Il lui dit « Fais-nous écouter ! » Gaston est étendu sur une chaise en toile grise sur laquelle est imprimé, en bleu, « Compagnie française de navigation ». Le bleu du ciel se défait de plus en plus de son intensité, car le jour commence à s’engouffrer dans l’obscurité qui s’offre à lui. Les premières ombres n’entament nullement le moral de Gaston, au contraire. Il se laisse bercer par la pensée de la joie immense qui se profile et qu’il pressent si puissante qu’elle anéantira bientôt le souvenir de toutes les frustrations qu’il endura, jusqu’à ces derniers temps. Gaston arrive encore à lire le titre principal de L’Express qui annonce un candidat mystérieux contre le général qu’il n’aime plus : « Monsieur X contre De Gaulle ». Le répit est de courte durée. Alors que le jour agonise, qu’il ne permet plus maintenant de distinguer la ligne d’horizon, une pluie fine et glacée entreprend de contrarier le ciel et d’arroser le paquebot de poupe à proue, du pont avant au pont arrière et tout le reste, et les voyageurs ne peuvent tous s’abriter. Depuis quelques heures, des grésillements succédèrent à l’émission de radio qu’écoutait Mimoun. Les ondes, grandes et courtes, s’embrouillent et Naples, annonce-t-on dans le haut-parleur, n’est plus qu’à quelques dizaines de miles. Mimoun sort son appareil photo. Fixer sa famille et d’autres passagers du bateau — le flash B ne se visse pas facilement — et qu’importe l’Italie. Son père lui demande d’être économe, car il y a peu de pellicules pour épreuves noir et blanc « et le flash, attention au flash ! » Les plus petits s’agitent. Yacoub a tantôt faim, tantôt soif, souvent s’ennuie. Yvette s’égosille pour un rien, encouragée par d’autres enfants de son âge qui braillent autant qu’elle. Dihia passe presque toute la traversée allongée, malmenée par le mal de mer, parfois cajolée par sa belle-mère qui fait toujours preuve d’empathie, mais qui n’a plus la sérénité d’antan ni la santé des grands jours. C’est elle, Habiba, qui compose les repas, rarement chauds, souvent des sandwichs faits de fromage Primula, Caprice des Dieux ou Vache qui rit, et de tomates. Mais Dihia ne peut rien avaler. Un sentiment étrange la saisit lorsqu’elle sent qu’elle va craquer. Elle pense « ça y est je vais pleurer », mais les larmes ne montent pas. Elle appréhende l’inconnu même si elle est heureuse de découvrir le pays où elle rêva toujours discrètement vivre et mourir. Dans le Phocée il y a près d’un millier de passagers sur le point de concrétiser la aliya. La Terre promise est enfin à portée d’une poignée d’heures. Après le dîner, pendant près de deux heures Yeshua Kadosh, Oseh Shalom sont diffusés par les haut-parleurs, suivis par des danses et d’autres chants : « Chantons le Seigneur, car Il est souverainement grand ; coursier et cavalier. Il les a lancés dans la mer. » Une partie des passagers, les plus pauvres, sont mis en quarantaine, dans les cales, en quatrième classe. On les entend sans jamais les apercevoir. Ils sont interdits de pont durant tout le voyage. Ce sont les Tunisiens, hommes, femmes et enfants, qu’on appelle « les sans-culottes », habillés comme ils le furent toujours, nombreux sont couverts de haillons. Eux aussi prient dans les ténèbres du Phocée. Ils ne voient rien du monde extérieur ni de cette nuit qui avance à la rencontre du jour qui l’absorbera.
Ce sont des enfants insomniaques et vigies, allongés sur les coursives qui alertent les premiers : « des lumières, des lumières ! » Elles apparaissent au loin annonçant la ville de Haïfa dont les formes se précisent dans les heures qui suivent. Des dizaines d’Israéliens arrivent à la rencontre des voyageurs. Constitués en comité d’accueil, ils accompagnent le paquebot pendant ses derniers miles entassés dans de petites embarcations. Ils chantent Hatikva. Sur certaines on peut lire « Exodus 2 » ou encore « Exodus AFN », et sur une banderole « Bienvenue aux Ma’aariviim ». Les passagers les remercient en leur adressant de grands signes, certains agitent des mouchoirs, sur leur joue il pleut les larmes d’un bonheur que du plus profond de leur être, de leur croyance, ils désirent définitif. De leur passé ils ont tous hâte de faire table rase. Un navire à quai sur le point de larguer les amarres accueille le Phocée en actionnant en long signal sa corne de brume. Le débarquement se déroule dans un désordre indescriptible qui dure des heures entières. On peut enfin mettre un visage sur chacun des passagers des cales auxquels on tend une grande échelle. Les hommes grimpèrent les premiers. Leurs yeux sont vides de toute expression, des billes creuses. Leurs bras se meuvent avec le peu de force qui leur reste. « À l’aide ! » ou « venez ! » semblent-ils implorer, qu’on les approche, les touche, qu’ils ne se sentent plus seuls enfin.
Les autocars en stationnement depuis la veille engloutissent les arrivants. Les véhicules sont blancs avec deux bandes rouges sur les côtés, de bout en bout. Sur leur fronton, sous trois ampoules rouges, dans un encadrement métallique, on peut lire le nom de la compagnie דגא, Egged, des lettres blanches sur fond noir. Les premiers autocars quittent le port vers midi trente. Certains passagers prennent la direction d’Ashkélon et de Beer-Sheva. La famille de Mimoun s’installe dans l’autocar 158-835 qui l’emmène à Ashdod, dans le sud, où elle arrive un peu moins de deux heures plus tard complètement épuisée. Les agorotnécessaires à l’achat des tickets furent offerts par des officiels locaux mobilisés pour cette occasion. En sus de ces derniers, les familles sont reçues par des compatriotes, des « Algériens » qui habitent là depuis deux ans ou plus. L’accueil aux sons de la ghaïta, du bendir et des youyous est chaleureux, mais les Pinto ne disposent plus suffisamment d’énergie à dépenser aux festivités. Les habitants d’Ashdod et d’autres localités ne se présentent pas comme Israéliens, mais comme Algériens, Marocains, et cetera. L’un d’eux est le responsable des services sociaux. Il fait un beau discours de bienvenue, dans un mélange de derja, de français et d’hébreu, au cœur d’un buffet disposé en U dans une salle aménagée pour l’occasion, où se pressent aussi les enfants. À tous ces olims, nouveaux immigrants juifs en terre d’Israël, il leur dit tout le bien que la Communauté les bras tendus leur réserve et tout l’espoir qu’elle place en eux. Après la collation on se dirige tous ensemble, à pied, dans une sorte de procession à la tête de laquelle on reconnaît le responsable des services sociaux discutant avec les plus âgés des olims et derrière des dizaines d’autres hommes, suivis eux-mêmes par leurs femmes et enfants jusqu’aux nouveaux bâtiments, construits pour eux, pas totalement achevés. Des commerces en tous genres s’étalent le long des immeubles, à même le sable pour la plupart. Tout le village, que les plus anciens appellent « La petite Algérie », est ainsi ensablé, et jusqu’aux maabarot, des baraquements étranges faits de bric et de broc, comme ceux d’un bidonville de Casa, d’Alger ou de Marseille. Les familles sont portées par la fierté de s’assimiler à la Communauté comme tous les autres juifs d’Israël.
Dans la semaine de leur arrivée, Gaston embauche comme journalier dans ces mêmes constructions. Il travaille quand on a besoin de main-d’œuvre. Il lui arrive parfois d’exercer comme conducteur de camion. Les premiers mois il s’y rend quatre à cinq jours par semaine. Le ministère de l’intégration alloue aux nouvelles familles des aides de subsistance qui ne dureront que le temps d’une ou deux saisons. Dihia s’occupe de l’intérieur de l’appartement, secondée parfois par sa belle-mère lorsqu’elle n’est pas prise par une autre occupation qu’elle juge plus importante ou lorsqu’elle n’est pas de mauvaise humeur, ce qui lui arrive. Vivre des semaines et même des mois sans électricité, sans gaz, sans eau courante, ne perturbe que peu toutes ces familles dont la foi en Israël est abyssale. Mimoun intègre une école spéciale pour garçons où tous les élèves sont des olims. Il y a des Américains, des Polonais, des Africains du Nord. La plupart de ses camarades sont Français, mais son meilleur ami est un Polonais au nom de Zeev Friedman. Zeev est grand, ses épaules sont larges et il est bien portant. C’est un garçon très gentil. Il est surtout ce grand frère qui parfois manque à Mimoun. Il ressemble à Joselito avec ses sourcils fournis, ses longues pattes de cheveux et surtout ses gilets en V qu’il met presque tout le temps. Mimoun et ses camarades passent deux ans dans cet établissement à apprendre l’hébreu. Les élèves sont ensuite orientés vers des centres spécialisés pour une formation de deux autres années. Mimoun et son ami Zeev qui rêve de devenir entraîneur de foot se retrouvent dans le centre de formation. Au terme des deux premiers mois dédiés à la découverte de la géographie et de l’histoire du pays ainsi que des treize métiers enseignés, lorsque le responsable pédagogique demande à Mimoun quel est son choix, il répond spontanément « photographe ! » Zeev fait le même choix. Au retour de la première semaine de vacances, ils commencent par apprendre l’histoire de la photographie depuis la caméra de de Vinci à la conservation des images créées par les frères Niepce et jusqu’aux inventions des frères Lumière… puis le développement des photos : comment utiliser le révélateur, respecter la température et le temps, comment stopper l’action du révélateur avec de l’acide acétique, et comment stabiliser le négatif. Surtout éviter durant l’opération tout contact du film avec la lumière. L’apprentissage dure des semaines. Il y a des cours théoriques en studio et des séances de prise de photos, le plus souvent en extérieur, suivies par des ateliers de développement. Mimoun aime beaucoup cette école bien qu’aucun de ses trois enseignants ne maîtrise le français et malgré son hébreu approximatif qu’il parle, certes, mais comme on parle une langue étrangère, avec des approximations et des incertitudes aussi lourdes que contrariantes. Dans l’atelier du centre, il développe les photos qu’il avait prises avec son Brownie. Les responsables acceptent que les élèves utilisent leur propre appareil photo lorsqu’ils en possèdent un. Mimoun et Zeev sont ensemble en semaine, et plus encore les week-ends. Ils s’arrangent toujours pour être dans la même équipe de football.
Au début de la deuxième année de formation, en novembre, à l’occasion de reportages qu’effectuent des journalistes français sur la vie des nouveaux Israéliens, Mimoun et d’autres élèves du centre sont interviewés à la sortie de l’école. Pour nombre de journalistes occidentaux chargés d’une mémoire troublée, Israël est une curiosité. Comment ce jeune État d’à peine une quinzaine d’années d’existence et aux dimensions ridicules, né d’une monstruosité européenne plus que d’une catastrophe qu’aucune région au monde depuis que le monde est monde n’égala, s’y prend-il pour intégrer toutes ces populations venues en masse des nouveaux territoires indépendants d’Afrique du Nord dont elles ne voulurent pas, après qu’il eut assimilé des centaines de milliers d’Européens ?
Les élèves sont questionnés aussi bien par des reporters de la première chaîne de l’ORTF que par ceux de radio Luxembourg et d’Europe numéro1. Zeev est présent, mais il ne parle que le polonais, alors Mimoun répond pour lui-même et pour son ami autant qu’il peut. Les journalistes commencent par leur demander leur nom, leur âge, leur ville de naissance, depuis quand sont-ils à Ashdod… Ils leur posent d’autres questions dont certaines demeurent sans réponse, car trop compliquées pour des enfants qui n’ont qu’un désir, celui de retrouver leur terrain vague. Les journalistes insistent, ils veulent les questionner plus longuement, questionner leurs parents également promettant aux gamins quelques billets. Les adolescents acceptent le marché et s’engagent à en parler à leurs familles. Les rendez-vous avec elles sont arrangés. Ils ont lieu à domicile sur deux journées à raison de deux heures en moyenne par famille. Le pari est tenu. Les entretiens se déroulent plus ou moins laborieusement, mais tout le monde est content, les journalistes d’avoir bouclé leur travail et d’avoir goûté aux matsot et à la Mouna, les olims adultes d’avoir dit tout le bien qu’ils pensent de leur nouvelle patrie et les jeunes d’avoir reçu quelques sous. Le dimanche après-midi les journalistes et les adolescents s’affrontent lors d’un match de foot « six contre six » sur un terrain vague, derrière les immeubles. Après le match gagné par eux sur un score fleuve (deux buts de Zeev) les jeunes se dirigent vers leur coin favori du port d’Ashdod où ils se retrouvent souvent. Ils plongent pour se rafraîchir, se débarrasser de la sueur et engager des batailles d’eau dont eux seuls connaissent les règles. La plupart des journalistes rejoignent leur hôtel alors que trois d’entre eux préfèrent rester avec les adolescents. Eux aussi goûtent aux joies de la mer. Durant tous ces jours, il fait très chaud. Des jours d’été égarés à l’orée de l’hiver. Mimoun affectionne ce port qui, avec ses imposants rochers et la végétation autour de vieilles baraques en bois — quoique sans falaises ni majestueux front de mer — lui rappelle Cueva del Agua à Oran. Lorsque les jours étalaient leurs parures estivales ou même printanières, Mimoun dévalait avec ses amis les tortueux escaliers taillés à même la roche de la falaise de Gambetta, avec sous le bras des chambres à air de camions ou de tracteurs qui faisaient office de bouée, jusqu’à la source d’eau douce, défiant les zarzas, orties et autres plantes peu amènes, jusqu’aux cabanons des fêtards Mamia et Dakiya, au seuil desquels gisaient à même la terre des dizaines de bouteilles de bière et de vin vides, avant d’atteindre la jetée cent mètres plus bas. Ils lançaient alors les chambres à air à l’eau, puis ils se laissaient ondoyer jusqu’au « premier canon », certains poussaient jusqu’au deuxième, à quelques mètres de l’entrée du port que franchissaient Le Ville d’Oran, Le Kairouan, Le Napoléon ou Le Ville de Tunis. Des pêcheurs à la ligne expérimentés les tançaient, car ils trouvaient ces jeux « idiots et dangereux », mais les enfants étaient heureux. Là, dans le port d’Ashdod on se jette à deux ou à trois en criant, imitant l’appel de Tarzan. Les journalistes prennent des photos pour le souvenir ou pour agrémenter leurs articles.
Dans l’espace « Mère-enfant » de la maternité de Baudelocque, à Port-Royal, règne une effervescence semblable à celle d’un marché de quartier populaire en pleine activité. Le personnel est surchargé de travail. Les infirmières, les gynécologues, les sages-femmes, les ASH, agents des services hospitaliers, s’affairent sans discontinuer. Ils vont, viennent, renseignent, questionnent, rassurent, sourient, ouvrent ou ferment des portes. Chez certains patients et leur famille on devine une inquiétude mal dissimulée, sur le visage d’autres on perçoit une discrète joie. Dans un des lits, Denise est allongée, les yeux fermés. Les cheveux noués, auburn sous le reflet de la lumière, laissent apparaître — il glissa légèrement — le pendentif berbère que lui avait offert Messaoud pour lui dire son attachement. En forme de cercle, le bijou représente en son centre la lettre Aza plantée sur ses quatre membres, fière comme l’Amazigh, l’homme libre, tout en argent. Denise est visiblement exténuée, mais sourit, les yeux mi-clos maintenant. Lui est assis à ses côtés, il observe songeur son bijou, frôle son bras, ne sachant ni quoi faire ni comment, silencieux, engoncé dans une blouse blanche, coiffé d’une charlotte sauvage, il a « l’air fin », inutile et heureux. Sur une table chauffante, leur bébé est pris de secousses, il braille, emmailloté dans une grenouillère bleue sur laquelle on lit « Happy Day ! », la tête recouverte d’un bonnet, bleu aussi, marionnette désarticulée. Denise tente de se redresser. Une sage-femme arrive pour lui prendre la température et la tension. L’enfant naquit ce matin. L’infirmière, elle doit avoir la quarantaine, peut-être est-elle martiniquaise ou guadeloupéenne, avait griffonné au stylo bleu sur la page datée « samedi 20 décembre 1980 » du classeur de la maternité, entre la ligne « 7 h » et la ligne « 8 h » : « Yanis El-Bethioui, à 7 h 15, RAS » et « 49 cm, 3kg100 ».
Denise parla à sa mère qui s’inquiétait « tu l’as appelé comment ? » Puis elle fit « ah ! » et après un silence elle ajouta « bon », comme un reproche, ou comme une boule de pétanque tombée de sa main. « Ah !… bon ». Le ton était inamical, sérieusement inamical. « Ah ! » en ouvrant certainement bien la bouche. On imagine son arrondi et celui de ses yeux, puis encore « ton père n’est pas bien… on te rappellera » avec entre les deux groupes de mots un suspens, un grand intervalle. On la devine ajouter « comme c’est mal… ça » avec le même suspens, le même intervalle dont certains usent pour un oui ou pour un non. Puis elle raccrocha. Les scènes que Ginette fait périodiquement à sa fille sont aussi nombreuses que futiles. Messaoud n’est pas vraiment le bienvenu dans la famille. Il le sait et s’en moque. Il a juste de la peine pour sa compagne. Depuis qu’ils apprirent que leur fille « s’est acoquinée à un Arabe », ses parents ne l’invitaient plus à la maison.
Six mois auparavant, en juillet, de nombreux collègues et amis du jeune couple assistèrent au mariage à Montfermeil. Ni Messaoud ni Denise ne furent surpris par l’absence de la famille France à la mairie. Hadj était là, digne représentant de la famille El-Bethioui. Kada appela son fils le soir même pour le féliciter. On l’entendait comme s’il était présent avec eux dans la pièce. Il aurait bien voulu assister au mariage de son aîné, mais la raison vainquit son cœur. Kada aurait pu venir en France plus facilement, car Chadli, le nouveau président, supprima l’ASTN l’autorisation de sortie du territoire national et maintint les trois cents dinars d’allocation touristique auxquels a droit tout Algérien partant à l’étranger — juste de quoi prendre un billet de train de banlieue — certes, mais il est encore marqué par le climat très tendu en France, par cette atmosphère qui plombe les humanités. L’indépendance de l’Algérie est toujours très mal vécue par les nostalgiques des colonies qui ne veulent pas ouvrir leur cœur. S’ils ouvrent leurs yeux et leur bouche, c’est pour faire payer cher aux « sales bicots » la perte du pays. Et la nouvelle loi Barre-Bonnet n’augure rien de bon. Kada fit donc, le cœur meurtri, le choix de ne pas se déplacer. Au téléphone, il resta pendu pendant plus de dix minutes. Denise voulait bien lui parler, mais Messaoud ne lui tendit pas le combiné de crainte qu’elle n’utilise des mots que son père ne peut entendre de sa bru. Plus tard elle apprendra que la pudeur dans la famille algérienne « c’est quelque chose je vous le dis ! »
Denise et Messaoud se fréquentent depuis novembre de l’année dernière, le mois des vingt et un ans de Denise et celui de sa titularisation chez Darty. Messaoud venait d’atteindre le quart de siècle, comme il aimait dire. Sa compagne avait quitté ses parents et le sud peu après la mort de sa grand-mère, la semaine de son anniversaire. Elle avait attendu longtemps ce jour qui allait l’extraire de son statut de mineure et la libérer de ses trop rigides parents. Le lundi 22 novembre, elle soufflait sur ses dix-huit bougies, et le mercredi Albertine mourut. Elle avait soixante-dix ans et demi. Le dernier jour du mois, Denise prit un train de Toulon à Marseille puis un autre de Marseille à Paris. Depuis des mois elle répétait à ses parents vouloir « découvrir le monde ». Les études ne l’intéressaient plus. Tout le mois de décembre, elle fut hébergée chez une ancienne camarade de classe dont la mère — qui réussit à fuir la chaleur du sud et ses gens trop jacasseurs à son goût — avait naturellement accepté de la recevoir. Denise travailla les derniers week-ends de l’année 1976 et les deux premiers de la nouvelle année dans une boutique de jeans et de vestes en cuir du marché Malik de Saint-Ouen, avant de se rendre à Amsterdam, le port de tous ses fantasmes. Elle pensait s’y installer quelques années, mais le Quartier rouge et Vondelpark ne lui réussirent pas. C’est dans cette ville qu’elle apprit le décès en janvier de son grand-père. La perte de son épouse devenait chaque jour qui passait encore plus insupportable à Robert. « Pépé est mort de chagrin », lui dirent ses parents. Le froid et le manque d’argent, ajouté au chagrin, précipitèrent son retour en France deux mois plus tard, au début de mars. Elle effectua plusieurs courtes missions d’intérim jusqu’à la fin juin — la dernière chez Darty —avant de retourner chez ses parents à Toulon qui étaient sur le point de déménager à Fréjus. Elle y resta les deux mois d’été, jusqu’au coup de fil du responsable du personnel de Darty qui lui proposait un CDD de deux mois qui sera renouvelé pour une période de douze mois, puis une autre, jusqu’à sa titularisation il y a un an.
Dès son premier mois de travail, Messaoud avait été troublé par Denise. Ses cheveux, une coupe au carré, étaient coiffés à la Sylvie Vartan, la plus belle pour aller danser, avec des franges ni blondes, ni brunes qui tombaient sur ses yeux verts. Ce sont ses yeux qui charmèrent le plus Messaoud, et sa gentillesse. Denise ne parlait pas beaucoup. Elle en était à son troisième mois de travail chez Darty, quatre avec le mois de juin. Messaoud pensait tantôt qu’elle était « la protégée », tantôt « la petite amie » — selon la fluctuation des bruits de couloirs — d’un certain Razi, un vendeur au rayon électroménager dont Messaoud avait la certitude qu’il le prenait de haut. Peu à peu, au fur et à mesure qu’ils se découvraient, qu’ils soupesaient leurs paroles, leurs gestes, leurs attitudes, Messaoud se rendait compte qu’il n’en était rien, c’est-à-dire que les relations entre Razi et Denise n’étaient que professionnelles et amicales, que Razi n’était ni méprisant ni condescendant, par contre c’était un homme plutôt réservé. Ils deviendront amis avant la fin de la nouvelle année. Razi — il tient à ce que l’on prononce correctement, prononcer le r non comme dans « ridicule » ou dans « riquiqui », mais rouler le r comme savent si bien rocailler les gens du Sud-ouest français ou comme en arabeou
— Razi donc, est un Oranais venu en France poursuivre ses études. Le matin il travaille chez Darty, l’après-midi il étudie à l’université de Vincennes où il s’était inscrit en novembre. Il avait quitté le bled au début du printemps de l’année précédente, en avril 1976, écœuré par les agissements de la Sécurité militaire qui surveille, enquête, punit les civils comme les militaires. Un jour, en réponse à Messaoud qui l’interrogeait sur les raisons qui lui firent quitter l’Algérie, Razi lui dit tout de go : « J’ai fui la bêtise et l’obscurité humaines, j’ai fui le silence et la crasse de la cellule du Palais de justice d’Oran où des agents enthousiastes et vicieux m’avaient jeté pour cause ‘‘d’outrage à magistrat dans ses fonctions’’, sans autre forme de procès. » Une réponse que Razi débita de telle façon que Messaoud comprit qu’il l’avait prononcée plus d’une fois. Le débit, les mots, la poésie qui s’en dégage avaient été éprouvés. Razi respirait à pleins poumons l’air de Paris, mais dans certains quartiers, certains bars ou avenues, il le trouvait pollué. Une Suédoise qu’il avait rencontrée dans une auberge de jeunesse du côté de la Porte de Clignancourt lui proposa de l’accompagner jusqu’à Norrköpping, chez elle, dans l’Östergötland en Suède. Cette invitation ne pouvait mieux tomber. À la fin du mois de juillet, Razi prit ainsi la route du nord en compagnie de Éva Lamm, c’est son nom, le pouce levé et la tristesse définitivement en berne, du moins l’espérait-il puisqu’il avait à ses yeux quitté la bêtise et l’obscurité. Razi se délectait de cette « douce légèreté de l’être » tant aspirée par les Tchèques. Chez Éva il savoura l’hospitalité douillette et amoureuse. Il admira les autres beautés nordiques, s’enthousiasma devant la majesté des îles, des lacs et des forêts, apprécia et partagea le respect et l’attachement que vouent les gens du nord à la nature. À la fois indulgente, harmonieuse et implacable nature. Mais au terme du huitième mois, Razi craqua. L’envers avait un revers. Les rigueurs de l’hiver nordique, la nostalgie du soleil et des ardeurs du Sud — quoique parfois superficielles — eurent raison de son fantasme, de son désir, vif pourtant, de résider définitivement en Suède, et même plus, y faire sa vie avec Éva qui tous les jours lui répétait ce chaleureux proverbe local « vi går snabbare… we move faster hand in hand ». Le jour de son départ, elle prit le train avec lui jusqu’à Helsingborg, quatre cents kilomètres au sud, au bord de l’Öresund, d’où ils contemplèrent ensemble le château de Hamlet, sur la rive danoise.
— Kronborg ! The time is out of joint. O cursed spite, lança Éva, très inspirée en faisant de grands cercles avec ses bras. Ce qui étonna Razi, les Suédois étant, jusqu’à la Midsommar, généralement plutôt apathiques. Il répliqua sans sourciller en souriant, mais, autant qu’Éva, il était défait.
— That ever I was born to set it right !
Ils se séparèrent sur ces paroles qu’ils avaient maintes fois lues dans la petite chambre d’Éva. Elle était infirmière et actrice intermittente, il était son souffleur. Le déchirement des adieux n’en était que plus douloureux. À la pensée d’Éva, qu’il appelle « l’âme du Nord », la gorge de Razi se noue, mais dans ses yeux une minuscule lumière scintille.
C’est Denise qui fut chargée de montrer à Messaoud comment numéroter les doubles de factures selon que le produit vendu relève du petit électroménager (Pelm) ou du gros (Gelm), de la Hi-fi, de la téléphonie… Sur la marge de gauche, à hauteur de chaque référence, on appose un tampon encreur qui imprime la date du jour et le numéro d’ordre du produit, quel que soit l’appareil vendu, sa marque, sa couleur, son prix. Sur une même facture on attribue autant de numéros qu’il y a de produits mentionnés : « N° 03-20230 », « N° 03-20231 », « N° 03-20232 » en précisant avec un stylo à bille rouge sur la marge de droite « Pelm », « Gelm » ou « Hi-fi »… Chaque employé de la section a son propre encreur. Denise avait le « N° 03 », le « N° 08 » pour Messaoud, le « N° 06 » pour tel autre… c’est ainsi que le chef de service pouvait et peut toujours facilement comptabiliser le nombre de factures traitées par chacun, au jour le jour. Et il ne se prive pas de distribuer des points et commentaires plaisants ou non, à voix haute pour que chacun sache. Denise elle-même référençait les ventes durant toute la journée. Rien de tout cela n’a changé. Son contrat à durée déterminée venait d’être prorogé d’un an. Messaoud était intérimaire. Au terme de sa dernière mission d’intérim, en mai, il était convoqué dans le bureau du chef du personnel. Il se demandait si cela avait un lien avec la qualité du travail ou les horaires ou alors avec les deux journées qu’il venait de prendre afin d’accompagner ses parents à Marseille. Il ne se doutait nullement que ce qu’allait lui proposer le responsable c’était un contrat d’une année entière, négocié sans l’intermédiation de Central-Intérim. Ce contrat conclu directement entre l’entreprise et Messaoud rendra la directrice de l’agence d’intérim verte de colère toute une semaine. Elle perdait un client, Darty, et le fit voir et entendre à Messaoud et au chef du personnel de l’entreprise. Messaoud lui avoua sa sincère désolation. À aucun instant il ne pensa que ce contrat allait chagriner Michèle Bauvoir et déclencher son courroux, car il l’aimait bien. À aucun moment il ne s’est douté que le contrat ainsi négocié porterait préjudice à son agence et probablement à son propre portefeuille.
À son terme, ce contrat fut renouvelé une autre fois pour un an. En avril 1980 le même responsable convoqua Messaoud dans son bureau pour l’informer de sa titularisation. Messaoud était si content lorsqu’il entendit ce mot tintiller de longues secondes que son esprit se confusionna. Il voyait le chef de service sourire, alors il fit un mouvement de tête, posa les mains sur les accoudoirs du siège et pencha le buste. Il allait se dresser, mais se ravisa, impressionné par le regard du responsable. L’intensité qui se dégageait des yeux du chef de service du personnel paralysa Messaoud qui était sur le point de l’embrasser. Le vendredi en huit — le deux mai l’entreprise préféra accorder la journée au personnel administratif — le vendredi neuf mai donc, à 17 h, Messaoud et Denise offrirent une collation à tous les collègues du service comptabilité. Au premier rang se trouvait le responsable du personnel. Depuis février, Denise et Messaoud occupent un studio à Montfermeil dans la rue Henri Barbusse. Denise avait libéré celui qu’elle partageait avec une étudiante dans le 14e, près du métro Mouton-Duvernet, et Messaoud abandonnait sa chambre du foyer pour jeunes travailleurs de Bondy, juste en face de Darty, une chambre de douze mètres carrés qu’il occupait depuis janvier 1979 contre un loyer mensuel de 400 francs nets qui ne varia jamais. Il traversait l’avenue Gallieni et il était chez lui. Son frère rendra l’appartement de Nanterre à la société des HLM peu de temps après pour s’installer à Bobigny où il travaille, dans un centre de formation continue depuis bientôt quatre ans.
Sur le ventre de sa mère, Yanis ne s’agite pas, et l’infirmière veille. Les employés vont et viennent, surchargés d’activités, de produits de pédiatrie et de rêves de vacances. Denise est toujours allongée. Messaoud s’extrait de son rêve, il se relève. Il ne sait que dire. Il ne dit rien, se contente de sourire. Il regarde la blouse blanche qu’il porte et en même temps tâte la charlotte, « j’ai l’ai fin » pense-t-il.
Comme dans toutes les villes et tous les villages du pays, hier dans la famille Pinto on a fêté Lag Ba’omer. Les enfants ont joué au tir à l’arc et allumé des feux de joie dans les terrains vagues, les derniers jeux et feux en Israël. La famille s’apprête en effet à quitter ce pays sans attendre la fin de l’année scolaire. Yvette commence à peine à saisir les mécanismes de base de la grammaire hébraïque, Yacoub finit lamentablement son année au collège, alors que Mimoun ne passera pas l’examen de fin de formation en photographie, prévu à la mi-juin. Toute la région est en ébullition. L’atmosphère lourde qui règne depuis plusieurs mois couve une guerre. En octobre dernier, la Syrie avait organisé de grandes manœuvres, « des manœuvres d’intimidation » répétait-on dans les journaux et la télévision : « Les Syriens voient des menaces partout », « l’objectif des Arabes est de nous jeter à la mer. » Toute la famille sait que Gaston ne supporte plus de vivre en Israël. Dihia et Habiba sont résignées, que peuvent-elles ? Voilà des mois qu’il se lamente. Il attendait qu’une bonne occasion se présente pour faire sa Yerida, sa descente, et cette possibilité se présente aujourd’hui. Il a hâte de retrouver la France, même si Mimoun ne veut pas vraiment abandonner ses amis, son nouveau pays qu’il commence à aimer. Il veut s’engager dans l’armée, mais il n’a pas l’âge légal d’incorporation. Hormis les premiers temps d’euphorie, Gaston ne se sentit jamais vraiment chez lui. Leur aliya est un échec cuisant. Il dit préférer supporter la vie en France, sa misère et son lot d’antisémitisme, plutôt que la souffrance que lui font subir en terre d’Abraham, dans le « pays de tous les juifs », ses coreligionnaires, ses frères. Il le répétait souvent ces derniers temps à ses enfants, à Dihia, à sa mère. À tous. Le pays, très soudé en apparence, est très fragmenté dans la réalité. Les Ashkenazes, généralement instruits et fortunés, méprisent les israélites d’Afrique du Nord plus humbles. Ils se proclament « les Occidentaux », un terme très valorisant dans la société, mis en avant comme un étendard alors que « les Marocains et les Algériens » sont à leurs yeux « les Orientaux ». Les arguments de Gaston sont solides, sauf que Mimoun n’eut jamais de problème avec Zeev ni avec les Friedman. Gaston économisa en utilisant toutes les combines, tous les moyens, travaillant parfois les jours fériés et le soir. Nuit et jour, il est tourmenté par cette injonction intime : descendre en France avant l’irréparable. « Et ce blocus de Tiran, c’est un pas de plus vers la guerre, c’est sûr. »
Il y a deux ou trois semaines, Yvette — elle va sur sa neuvième année — pressait son père de questions sur Israël, la France, l’Algérie, la guerre, les Arabes. Toutes ces interrogations qui sont le fruit des échanges qu’elle capta chez les adultes la contrariaient. Elle lui disait ne rien comprendre. Gaston saisit l’occasion que sa fille lui offrait pour lui renouveler l’opinion tranchée qu’il a sur la situation du pays et répondre à ses questions bien sûr — « la France c’est un beau pays tu verras avec tes nouveaux yeux, la France ce n’est pas que le camp, tu te souviens du camp ? » Yvette fit signe de la tête, elle était trop jeune —, mais surtout pour soulager sa conscience qui le malmène chaque fois qu’il pense au meurtre de son père en septembre 1941. Il tourna autour de la question, ne sachant comment l’aborder, comment dire à sa fille l’assassinat de son père, comment lui dire la vérité ? puis il plongea. Parla sans précaution, brutalement. « La vérité, lui dit-il, n’est pas celle de l’Écho d’Oran, mais celle de plusieurs personnes qui ont assisté au meurtre. C’est des racistes qui ont tué ton grand-père ma fille, des amis du maire d’Oran qu’on appelait l’abbé Lambert. » Gaston ne voulut pas insister. Le plus important était dit. Il lui répéta, « les tueurs de mon père étaient des amis de l’abbé » et il passa à autre chose, il revint sur les juifs d’Europe de l’Est, « on n’a rien à voir avec ces gens-là ma fille, les Russes, les Ukrainiens, les Polonais, oui, même les Polonais on n’a rien à voir avec eux, rien. On n’a rien à voir avec leur arrogance, leur hypocrisie, leur mentalité. On sera chez nous bientôt ma fille, et on y sera mieux, tu iras dans une belle école, tu auras beaucoup d’amies, beaucoup plus qu’ici tu verras. » Lorsqu’il dit « beaucoup plus qu’ici tu verras », sa voix s’enraya. Il l’embrassa longuement, il pleura peut-être lorsqu’il se trouva seul.
Quelques semaines auparavant, un soir d’avril, Dihia avait reçu par téléphone la nouvelle de la mort de sa grand-mère. « C’est arrivé brusquement. Elle a eu très mal au ventre mercredi, et jeudi c’était fini. Elle a très peu souffert, ‘‘nous venons de la poussière, nous retournerons à la poussière’’ » avait dit Zohar. Sadia Benhakim avait soixante-dix-sept ans. Elle mourut la bouche fermée, emportant dans sa tombe le secret de la filiation de sa fille. Oui, elle aussi, Dihia, voulait, plus que jamais, retrouver la France, son père, sa mère.
Dix jours auparavant la famille apprenait le décès de Daoud, fils unique de Yacob Benaroche. Il est mort à soixante-seize ans, un an de moins que la grand-mère Sadia. Daoud était le neveu de Ginette et avait dix-neuf ans de plus qu’elle. Cette partie de la famille vivait dans le sud-est de la France. Les uns et les autres ne se rencontraient guère. Ils se sont très peu vus depuis que dans les années trente Daoud décida de s’installer en France. Ils se sont complètement perdus de vue après la mort de Amar le grand-père de Denise lors du bombardement de la ville de Toulon. Ginette avait trente-trois ans et Dihia était encore adolescente.
Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle grille, les responsables de la programmation des émissions viennent de proposer à Charly d’intégrer Les Routiers sont sympas, l’équipe de Max, en aménageant ses horaires en fonction des cours de Capacité en droit qu’il s’apprête de suivre dès octobre à l’université d’Assas. Charly accepta avec une joie qu’il ne dissimula pas. Les auditeurs qui souhaitent se déplacer gratuitement d’une ville de France à une autre, plus ou moins confortablement installés dans la cabine d’un routier sympa téléphonent à la radio qui diffuse leur message. Les chauffeurs désireux d’accomplir une bonne action, de partager leur état d’âme, ou de faire de belles rencontres appellent le standard et le tour est joué. Charly débuta la semaine dernière. Il n’embauche pas avant 16 h. Son travail consiste à rédiger des fiches qu’il transmet à Max, à répondre hors antenne aux auditeurs, aux auto-stoppeurs ou aux camionneurs, et à préparer éventuellement leur passage à l’antenne. Pendant trois mois, jusqu’à septembre, il travaillera en binôme pour se former à l’esprit et au contenu de l’émission.
Charly est très content de son parcours depuis qu’ils revinrent d’Israël, voilà plus de sept ans maintenant. C’était en mai 1967. Son père, sa mère, Yacoub, Yvette, Habiba et lui s’installaient chez les grands-parents Zohar et Ginette, les uns et les autres heureux de se retrouver. Zohar résidait toujours à Port-Vendres, mais dans un appartement plus spacieux. Il ne travaillait plus depuis un an. Il avait été définitivement arrêté suite à un accident de travail. Ginette se morfondait plus encore depuis la disparition de Sadia. Ce mois d’avril là fut doublement douloureux pour la famille. Dix jours avant la mort de sa mère, Ginette apprenait le décès de Daoud, fils de Yacob Benaroche. L’accueil qu’elle réserva à sa fille et à la petite famille fut à la fois des plus joyeux et rempli de larmes. Le lendemain de leur arrivée, ils s’étaient tous rendus en autocar à Perpignan pour se recueillir sur la tombe de Sadia, dans le cimetière Hillel. Gaston se mit à la recherche d’un travail dès la première semaine. Il dictait des lettres de candidature spontanée à son fils qui les écrivait. Il répondait aux petites annonces lues dans les journaux ou sur la vitrine d’une boulangerie, d’une pharmacie. Il arrivait que Gaston se déplaçât jusqu’aux entreprises qu’il avait ciblées dans un courrier. D’autres fois il se présentait à la porte de telle ou telle société qui surgissait sur son chemin. Dans son CV il ne mit guère en avant son expérience de chauffeur acquise à Oran et à Ashdod. La conduite en France le déprimait, il n’était pas très sûr de lui, ne se sentait pas capable de slalomer comme les Parisiens ou même les banlieusards. Il ne voulait pas s’aventurer à prendre le volant de quelque engin que ce fût. Le soulagement lui parvint au milieu de l’été en la forme d’une lettre avec cet en-tête « Bazar de l’Hôtel de Ville de Paris ». Bien qu’ils participaient régulièrement à l’entretien de la maison, à l’achat des courses, qu’ils se faisaient discrets, Gaston et Dihia étaient bien contents de libérer Zohar et Ginette de leur charge. Le directeur du Bazar parisien stipulait dans la lettre qu’il proposait un poste de vendeur au rayon bricolage de son établissement. Gaston répondit au téléphone « la proposition m’intéresse, je suis d’accord… » Le responsable l’attendait dans son bureau « au plus tard jeudi si vous n’y voyez pas d’inconvénient ». Le lendemain Gaston prit l’autocar jusqu’à Toulouse et de là le train jusqu’à Paris gare de Lyon. Il se rendit directement au Bazar. Le soir il appela Zohar « L’affaire elle est conclue ! » Les prétentions salariales très modestes de Gaston firent la différence avec d’autres postulants. Dans la foulée il prit une chambre dans un hôtel meublé, le temps de trouver un appartement. Son chef de rayon lui apporta une aide décisive. En septembre Gaston et les siens emménageaient dans le 17e arrondissement, en haut du boulevard Malesherbes, entre la place Wagram et le vieux lycée Carnot, au 142 exactement. L’emploi dans le Bazar lui convenait parfaitement. La mère lessivait, rangeait, faisait à manger, entretenait les trois pièces de l’appartement à longueur de journée, aidée par Habiba lorsqu’elle n’était pas souffrante. Dihia sortait rarement. De cela elle était habituée. Les enfants reprirent le chemin de l’école avec plusieurs jours de retard. Yacoub et Yvette furent déclassés, Charly inscrit dans un lycée d’enseignement professionnel. Il peina durant deux années avant l’obtention du CAP-photo. Les enseignants ne furent pas trop sévères, notamment au début de la seconde année. La France conservatrice se remettait difficilement des blessures que lui infligèrent ses étudiants.
C’est à son père que Charly — qui ne répond plus au prénom Mimoun depuis leur retour d’Israël — doit l’idée de contacter Jacques Doinas, un des journalistes qui les avait interviewés à Ashdod. Doinas travaillait pour Radio Luxembourg. Gaston et Dihia écoutaient beaucoup la radio. Leur préférence allait précisément à RTL. Dihia ne ratait jamais La Case Trésor de Fabrice. Si elle s’était portée candidate au jeu, elle aurait sans doute gagné. Combien de fois ne trouva-t-elle pas, plongée dans sa cuisine, mais très attentive à la radio, le titre de telle ou telle chanson, et elle criait, avec le public « vive l’Empereur ! » comme il se devait, comme si elle y était. Plus tard, lorsque cette émission de jeu fut supprimée, Dihia se reporta sur Bingo le jeu de Patrick Topaloff. De son côté Gaston était captivé par les informations sportives. Il suivait les commentaires sur les matches de football, surtout lorsqu’ils concernaient son équipe favorite, le Red Star (avant l’équipe audonienne, Gaston n’avait pas d’équipe préférée si l’on excepte le CALO évidemment). Les informations générales l’intéressaient également. Les affrontements en Irlande du Nord entre catholiques et protestants le peinaient beaucoup, « un si beau pays, tu te rends compte ! » C’est justement en écoutant Jacques Doinas qu’il vint à l’esprit de Gaston l’idée de demander à son fils de le contacter. Charly lui adressa une longue lettre dans laquelle il lui rappela leur rencontre à Ashdod, avant de le saisir sur la situation familiale en accentuant certains angles et le supplia de lui venir en aide. Il n’oublia pas de le féliciter « ainsi que toute l’équipe de RTL notre radio préférée ». Doinas ne tarda pas à répondre à Charly. Il se souvenait parfaitement de lui, du match de foot qu’ils disputèrent à Ashdod, derrière l’immeuble où résidaient les Pinto. Il le rappela à Charly et accepta de le rencontrer avant la fin de l’année. Mais le rendez-vous fut ajourné à deux reprises. La première fois parce que l’agenda de Doinas ne le permettait pas, la seconde parce que le deuil avait frappé les Pinto. Leur chère Habiba s’éteignit au milieu du mois de février, à 62 ans, à la suite d’une grippe. Le même jour où à Val d’Isère, 39 personnes étaient emportées par une avalanche. À la radio on en a beaucoup parlé. Deux mois plus tard, en avril 1970 Jacques Doinas put se rendre chez les Pinto. Il mangea des matsot, des galettes au pain azyme préparées pour la Pessa’h et de la Mouna évidemment. Jacques Doinas se souvint que ce sont ces mêmes galettes et brioches qu’il avait appréciées à Ashdod. Jacques et Gaston avaient le même âge, la quarantaine à peine entamée. Ils n’avaient pas le même statut social, mais Gaston et Dihia confirmèrent aux yeux de Doinas qu’ils étaient d’honnêtes gens. Progressivement leurs familles se rapprochèrent, et les Pinto furent à leur tour invités chez le journaliste. Pierre un des enfants de Jacques Doinas et Charly avaient de nombreux atomes crochus, ce qui rendait leurs conversations longues et très agréables pour l’un et l’autre. Ils ne se ressemblent pas, Pierre est grand, une barbe fournie, le regard franc derrière les verres jaune ambre de ses Ray-Ban et porte plutôt bien son embonpoint alors que Charly est petit, mince, le regard sombre et le front dégarni, souvent chaussé de souliers à hauts talons sous un pantalon à pattes d’éléphant. Charly et Pierre deviendront de vrais amis. Pierre avait alors près de vingt ans comme Charly et poursuivait ses études à Dauphine. Il fera de Charly l’organisateur de l’enterrement de sa vie de garçon et le témoin de son mariage.
Au début de l’été, Jacques Doinas fit intégrer Charly à RTL comme stagiaire au sein du courrier : il classait les lettres selon qu’elles émanaient des auditeurs ou d’entreprises diverses, comme les agences de presse ou d’autres. Il les rangeait, les déposait dans les casiers des services et personnes auxquels elles étaient adressées. À vrai dire Charly était un factotum complet, et comblé. Jusqu’à septembre 1972. « Lorsqu’a eu lieu l’attaque terroriste contre des athlètes juifs à Munich, j’ai voulu tout bazarder et prendre les armes… Mon ami Zeev faisait partie de l’équipe israélienne. C’était un magnifique haltérophile. Il avait réussi toutes les étapes, il était reconnu et apprécié. Les Arabes n’ont pas hésité à le tuer » répétait Charly, très affecté. Sa colère était tellement grande qu’il se jura vengeance, « sur les tombes de ma mère et de Mimoun » son grand-père tué « par six Arabes à hauteur du boulevard Sébastopol ». Il y avait dans l’esprit de Charly une proximité évidente entre les identités ayant entraîné la mort de son grand-père et celles qui ont tué son ami Zeev. Peu lui importait les circonstances et les distances géographiques et temporelles.
Peu de temps après ce tragique événement, encore bouleversé, il se rendit au consulat d’Israël pour s’engager dans l’armée, mais son offre fut déclinée. Le fonctionnaire qui le reçut lui avança une raison biscornue pour justifier le refus, « tu as quitté Israël en mai 1967, tu n’avais pas encore 16 ans. On ne peut répondre favorablement à ta demande. » Charly se contenta difficilement de cette formule, mais il apprécia le long entretien qu’on lui accorda. Il répondit à toutes les questions avec un enthousiasme non dissimulé. Ce type d’entretien est rare, il n’est accordé par les services qu’à des personnes extrêmement motivées au discours tranché, proche du néosionisme. Charly répétait à ses parents, à ses amis « j’avais tellement envie d’en découdre, de venger mon ami, venger les pieds-noirs, venger mon grand-père Mimoun et tous les israélites assassinés ». « Tu as perdu la tête » lui reprochaient certains, mais lui n’en démordait pas. Il était prêt à tout abandonner, RTL, la France, la famille.
L’année suivante Charly faillit concrétiser son rêve. Une nouvelle guerre avait éclaté en octobre. Il lui fallait rejoindre le front par tous les moyens. Grâce à Jacques Doinas dont il était devenu le protégé, sa demande de mise en disponibilité fut acceptée, mais la bureaucratie était ce qu’elle était, il fallut des semaines avant qu’elle fût traitée. La direction était très compréhensive. « Reviens-nous entier » lui dit en souriant le chef du personnel en lui remettant l’attestation de mise en arrêt de travail. Charly douta de l’honnêteté de ses paroles et de son sourire qu’il jugea sardonique.
De l’autre côté de la Méditerranée, la guerre rêvée de Charly finissait. Il dut renoncer à son projet la rage au ventre, mais il eut toutes les peines du monde pour convaincre les responsables d’annuler la demande de mise en disponibilité, plus encore le responsable du personnel. Mais, grâce à Doinas on accéda à sa demande. Dans la foulée on lui offrit une opportunité qu’il saisit au vol, une opportunité en or : participer à la rubrique des courses hippiques. Tous les matins il se présentait à la station parmi les premiers, à l’aurore. Avec ses collègues il parcourait les journaux et les dépêches des agences de presse, puis ensemble ils préparaient l’émission qu’ils enregistraient au studio B. Charly n’était plus occasionnel. Pendant une année, il montrera à ses collègues, et plus encore à sa hiérarchie, combien il fallait compter avec lui. Son père était le plus heureux, car Charly n’hésitait pas à « lui filer de bons tuyaux » sur les chevaux ou les jockeys lorsqu’il en avait. Aujourd’hui grâce à la nouvelle grille 1974–1975 il fait partie de l’équipe Les Routiers sont sympas.
Du balcon de sa chambre, Charly jette un regard appuyé sur la Marina. Il y a peu de monde en ce dernier dimanche d’août. Un dimanche presque ordinaire si ce n’est que la poussière, dans cette ville suppliciée plus que dans toute autre, envahit tous les espaces. La chaleur est aussi écrasante qu’à Tel-Aviv. Air sec et immobilité. On entend des tirs, sporadiques. La zone est sécurisée par les milices chrétiennes. Charly sait qu’à quelques dizaines de mètres se trouve la ligne verte, il eut à le vérifier récemment. De temps à autre une sirène d’ambulance hurle. Il ouvre le store extérieur, s’installe dans un transat de canne sous la toile de protection et plonge dans un livre. Charly occupe cette chambre numéro 26, au deuxième étage de l’hôtel Phoenicia depuis lundi dernier.
Il lui fallut plus de sept heures pour parcourir les 270 kms qui séparent Tel-Aviv de la capitale libanaise. Du cœur du Gush Dan il prit un autocar jusqu’à Haïfa, puis un autre jusqu’à Nathariya. De là il monta dans un taxi jusqu’à Rosh Hanikra, à la frontière libanaise. Pour la traverser, bien qu’il ait mis en avant sa carte de presse, il dut affronter des rafales de questions des agents frontaliers des deux pays. Pour atteindre Nakoura, il leva le pouce et composa avec la patience. Ici on ne prend pas un inconnu comme on le ferait dans un pays en paix. La méfiance est répandue, plus encore dans les zones reculées. Un taxi clandestin accepta de le conduire jusqu’à Sour, à la condition de ne pas discuter le prix, « 6000 £, le prix n’est pas négociable ». Charly ne peut dire pourquoi toutes les dix à quinze minutes le chauffeur ouvrait la vitre de sa vieille Mercedes 280, et crachait en l’air en rouspétant, en français, contre « les chiens du sud ». De Sour il prit un autocar jusqu’à Beyrouth. À Saïda il y eut près d’une heure d’arrêt que Charly mit à profit pour découvrir la ville. Au détour d’une ruelle, il se retrouva au cœur de la cité médiévale, devant une savonnerie artisanale qu’il ne put visiter pour cause de « fermeture pour travaux ». Arrivé dans Beyrouth, à Bourj Hammoud, avant même de pousser la porte de l’hôtel, Charly prit soin d’appeler le contact libanais pour l’informer de son arrivée. L’homme au bout du fil questionna : « Zeev ? » et Charly répondit « Zeev 972 ». L’homme lui donna en retour les informations attendues concernant la réunion du 24.
Charly voyage seul, avec pour seul bagage un grand sac de sport Palladium en simili cuir noir qu’il ne jugea pas utile de faire enregistrer au comptoir d’El-Al à Orly. Dans une main il tenait le sac et dans l’autre le premier tome de Voyage en Orient de Gérard de Nerval. Dans son sac il avait un second ouvrage, Mesure de la France de Drieu La Rochelle dont il est étonnamment un fervent admirateur. C’est ce livre-ci qu’il parcourt, assis sur le balcon de la chambre d’hôtel. Il poursuit la lecture pendant un quart d’heure, puis se remet à l’article qu’il avait commencé à rédiger. Il biffe le titre qu’il lui avait donné, celui-là même qu’il avait trouvé plus attractif qu’un premier, le modifie par ce dernier, direct, et qu’il souligne de deux traits pour signifier à l’équipe rédactionnelle qu’il y tient : « Le massacre des chrétiens de Brih ». Le rédacteur en chef de L’Aurore, lui fait confiance et accepte l’anonymat de ses piges. Charly a son entrée dans le journal de Boussac. Il connaît depuis l’année dernière Jean-Michel Souen, un des responsables de l’information. Lorsqu’il y a quatorze mois les Israéliens opérèrent un raid sur l’aéroport d’Entebbe, Charly avait adressé une réaction « pour publication » au journal qu’il lisait régulièrement, mais dont il ne connaissait aucun journaliste ou autre salarié. L’Aurore ne publia pas son courrier, mais Jean-Michel Souen l’appela. Il le félicita pour la pertinence et l’engagement de sa lettre, « j’approuve totalement », tout en lui expliquant les raisons de sa non-publication. Des causes « purement matérielles ». Depuis, Jean-Michel Souen et Charly se rencontrent périodiquement pour boire un verre ou pour partager un repas et échanger leurs points de vue, ou plutôt pour les compléter, car entre la manière de l’un et celle de l’autre d’appréhender le monde il n’y a pas l’espace pour y glisser une feuille de papier à cigarette.
Aujourd’hui Charly répond a une commande ferme du journal, « un article sur la situation au Liban » qu’il est sur le point de communiquer. Demain, 29, il retournera à Tel-Aviv, mais il n’empruntera ni autocars ni taxis. Il y restera peut-être jusqu’à la fin de ses congés. Du balcon il voit des hommes ordinaires en armes qui arpentent l’avenue du front de mer jusqu’au-delà de l’université américaine. Certains portent un uniforme, d’autres non. « C’est donc ça », pense-t-il. Des ruines. Hormis quelques blocs de quartiers relativement épargnés, partout des immeubles éventrés et des nuages de poussière. Cette réalité ne surprend pas Charly et c’est machinalement, sans aucune raison ni aucun intérêt, qu’il pense « c’est donc ça ». Quatre jours plus tôt, le 24 août, une importante réunion secrète s’était tenue derrière le square Sodéco, à côté du cimetière juif. Étaient présents une dizaine de miliciens chrétiens, Zaki Bouznati le chef des phalanges, un militaire israélien de second ordre, ainsi que des personnes venues de France dont Charly (la plupart d’entre elles sont membres ou proches du Betar, du Crif, du CLESS, de Kach…) Ces personnes furent mandatées lors de la réunion qui s’était tenue rue Paradis à Paris au lendemain de l’assassinat de Kamel Joumblat. Charly et les autres Français ne voyagèrent pas ensemble, chacun se débrouilla par ses propres moyens, sachant qu’il fallait appeler un numéro de téléphone confidentiel dès l’arrivée à Beyrouth pour ne pas rater « la réunion du cimetière ». C’était la consigne numéro 2, la première étant de voyager seul. En plus du numéro de téléphone, on avait communiqué à chacun un code. Pour Charly ce fut « Zeev 972 ». Lors de la rencontre, il fut beaucoup question de l’élimination de l’OLP, l’organisation de Yasser Arafat. Les récents accords de paix de Chtaura entre les dirigeants libanais et l’OLP furent copieusement dénoncés par les milices chrétiennes qui pilonnent des villages dans le sud-est du pays comme celui de Nabatiyeh. Ces accords signés le 25 du mois dernier prévoient notamment le déploiement au Liban d’une force arabe de dissuasion. Lors de son intervention, Charly promit de tout faire pour « sensibiliser les Français contre les criminels palestiniens » et de revenir au Liban pour « venger les chrétiens, venger les morts de Brih de dimanche dernier et tous les autres. » À la fin de la réunion, Zaki Bouznati félicita Charly et tous les membres de la délégation française pour leur engagement. Le chef phalangiste impressionne par le regard noir qu’il pose sur chacun, comme une intimidation, une arme à feu sur la tempe. Sa rondeur est tout aussi provocante, son double-menton et bajoue, tout en lui est menace. Ce sont des conseillers de l’ambassade d’Israël à Paris qui avaient fortement suggéré aux uns et aux autres de se rapprocher de Bouznati.
Charly relit son article, à voix haute. Puis il s’empresse de rentrer dans la chambre, car les tirs reprennent. « Une balle perdue… » songe-t-il. Il lui faut joindre Paris. Avec son ami Jean-Michel Souen il échange des nouvelles avant de prendre le secrétaire de rédaction auquel il dicte son papier : « Dimanche dernier, le 21 août, des villages de la montagne du Chouf ont connu d’intenses combats. Des hommes du Mouvement national libanais appuyés par des milices palestiniennes ou pro-palestiniennes sont entrés dans le village de Mtayleh intimidant les villageois accusés de sympathie pour les Forces libanaises. À Brih ce sont vingt chrétiens qui ont été froidement assassinés par les mêmes groupes, parce que chrétiens… »
Charly est assis entre deux claustras ajourés à l’intérieur de la brasserie Le Select sur le boulevard du Montparnasse. Il avale une nouvelle gorgée de Mort subite. Ses camarades quittèrent les lieux et Erzebeth ne revint pas. Il a froid aux cuisses, mais les bruits dans son intestin se sont calmés. Son pantalon est humide et sale. Il essaya bien de le nettoyer avec du papier toilette, en vain. Des résidus de papier blanc s’y incrustèrent. Charly a beau frotter, mais il ne réussit pas à les faire disparaître. La table voisine, de l’autre côté du claustra, est occupée par une dizaine de jeunes hommes et de jeunes femmes, qui trinquent à la santé de leurs deux amis mariés l’après-midi dans la mairie du 17e arrondissement. On voit des parties de leur visage, de leur corps. On devine celles qui sont cachées. Charly les observe et dans son regard on soupçonne comme une hostilité froide, apaisée. « Un Arabe et une Blanche » remarque-t-il. Il a un pincement au cœur. Les amis lèvent leur verre. Quelques-uns sourient à Charly. Ils ne le connaissent pas.
Charly vient d’entamer sa deuxième année de licence. Il est assez content de lui. À RTL, les responsables l’ont muté au coeur de l’information dans l’équipe de Jacques Chupas. Finie l’émission des routiers que toutefois il appréciait et qui lui apprit beaucoup. Ces trois années lui apportèrent une réelle expérience de la radio. Les échanges avec les auditeurs, les routiers, les techniciens… Charly ne regrette rien, mais il lui faut aller de l’avant. C’est cet homme, Jacques Chupas, qui lui apprend les dessous du métier et plus encore, les combines, les sources sûres, le bidonnage, le conducteur… Charly aime cet homme à la corpulence du bombardier Cerdan. Son physique avait donné corps à cette voix qui captive l’auditeur, l’envoûte. Lui est tout son contraire dans la taille, dans la voix, dans le regard. Il est petit, le regard instable. « Paix à son âme » murmurera Charly chaque fois, lorsque, des années plus tard, le souvenir de son mentor lui reviendra. Jacques Chupas anime le journal de 18 h qu’il prépare avec toute l’équipe. Le soir, Charly est chargé des flashes et du journal de la nuit.
L’intérêt que Charly porte à l’université redouble grâce aux rassemblements politiques organisés dans les amphis très animés. Il participe à nombre d’entre eux et y prend systématiquement la parole dès lors que l’objet concerne « le conflit du Moyen-Orient ». Les discussions se poursuivent fréquemment le soir avec ses camarades dans une brasserie, souvent au Select comme aujourd’hui, chez l’un d’entre eux ou, lorsque les circonstances l’imposent, dans un local ad hoc du 10e arrondissement. La rencontre d’une jolie brune au nom, Erzebeth, aussi abrupt que le flanc du Grand Canyon de l’Arizona, le troublera longtemps. Certains l’appellent affectueusement « la Chintoc » parce que son visage est marqué par de grands yeux noirs obliques, une militante sioniste radicale. Elle est le fer-de-lance d’un mouvement français qui restera clandestin, mais dont la filiation s’ancre en Israël. Dans un petit carnet noir, Charly écrit la date du jour « sa. 15/10/77 » et deux étranges messages : « 6FE9-6FE9 m V96y8v 18mxxv : +N » et « Chin-Chin a encore frappé : + 2 ». Les deux notes contiennent le même nombre de caractères. À Beyrouth il avait noté en rouge et en lettres majuscules d’imprimerie « 6FGMS8M = V8MWEJSV8 ». Depuis qu’il participe aux débats politiques, Charly prit l’habitude de noter des appréciations, des sentiments ou commentaires divers qu’il juge importants, dans de petits cahiers ou des carnets qu’il numérote et date. Ces commentaires sont parfois codés. Le but assigné à Erzebeth par ses responsables consiste à engager pour la bonne cause des étudiants appartenant à la Communauté. Elle s’y prend très bien de telle sorte que bon nombre de ses cibles seront d’abord séduites, par elle, par ses yeux noirs qu’elle plisse à tel ou tel moment qu’elle seule juge opportun, par la gestuelle de ses doigts après que sa bouche en cul de poule eut expiré la fumée en volutes blanches finissant en cercles, par ses jambes qu’elle entrelace à deux doigts d’elles — ses victimes —, avant qu’elles ne tendent l’oreille, ne baissent la garde, de plus en plus, jusqu’à épouser ladite bonne cause. Erzebeth fume comme un pompier des cigarettes mentholées et accessoirement suit des études de droit elle aussi.
Charly vient d’adhérer au Comité de liaison des étudiants socialistes sionistes, qu’il fréquente depuis l’hiver 76. (« Une organisation timorée que j’ai fini par abandonner pour le Betar plus en phase avec mes idéaux, avec mon combat » répondra-t-il plus tard lorsqu’on le questionnera sur ses engagements et motivations politiques.) Erzebeth l’avait expertement motivé. Quand les responsables annoncent qu’une réunion se tiendra dans la rue Paradis, les militants traduisent qu’un membre important, un conseiller à l’information de l’ambassade d’Israël, un représentant du directoire du Betar ou de Tsahal, allait y intervenir. Parfois ils se retrouvent dans un gymnase à Sarcelles pour s’entraîner au Krav–maga une technique de combat utilisée par l’armée israélienne.
Charly se lève. Il se dirige vers la sortie en prenant soin d’éviter de croiser les regards de ses voisins qui chahutent. Il n’a pas de parapluie pour se protéger. La pluie dégoutte des branches, il presse le pas dans le noir. Erzebeth ne revint pas, et Charly ne se remet pas entièrement du coup de tête qu’il reçut d’un inconnu il y a moins d’une heure après que celui-ci tenta de voler le sac à main de sa camarade alors qu’il lui exposait dans le détail la réunion de Sodéco.
Près d’une année s’écoula depuis le dernier voyage de Charly à Beyrouth. Cela fait quelques semaines qu’il s’entraîne dans un groupe nommé Phalanges K., sous la responsabilité de Zaki Bouznati, un homme proche de Béchir Gemayel et du commandant Kaleb Azoulay du Mossad. Agile et habile comme un funambule Bouznati réussit de nouveau à se positionner sur l’échiquier politico-militaire national. Ce chef phalangiste vécut quelque temps à Lyon et à Paris au début de l’année pour se protéger contre des responsables chrétiens qui supportaient de moins en moins son influence montante, d’aucuns voulaient même le réduire au silence définitif. Lorsqu’une insinuation concernant l’affaire pointe, Bouznati l’évacue d’un geste vif de la main, contrastant avec la lourdeur de son corps, « cette histoire est derrière nous ». En recevant Charly il lui lança un « bienvenu chez vous » et pour lui signifier combien est grande la confiance qu’il lui accorde, dès la deuxième rencontre il lui offrit un MAT 49, « prenez-en soin ! »
À la fin de ce mois de juillet, Charly participe à un ratissage dans Beyrouth-Ouest à la lisière de la ligne de démarcation. L’année dernière il logeait à quelques centaines de mètres de la ligne verte. Pour des raisons qu’il n’avance pas et qu’aucun de ses proches ne lui demande, Charly décide de se faire appeler Klein, Charly Klein. En Israël c’est cette identité qu’il revendiquera. Pendant cette mission de nettoyage Charly rencontre Kaleb « Ah c’est vous le Français ! vos compatriotes sont bien sympathiques, ils déroulent très fraternellement le tapis vert au vieux barbu de Qom ! » Chez Kaleb la haine des musulmans et des Arabes — non chrétiens — est encore plus profonde que celle qu’éprouve à leur égard Zaki et ses phalanges qui, pour ces raisons, prônent le rapprochement avec Israël, « contre le péril arabo-musulman ». Le commandant a à cœur de rééditer l’expédition de Tell-El-Zaatar. « Il nous faut deux, trois, cinq Tell El-Zaatar », dit-il souvent en agitant son gros poing. Kaleb est âgé d’une quarantaine d’années. Son volume avoisine les limites autorisées dans les armées et services connexes. Des membres de son entourage qui ne l’apprécient guère le désignent entre eux à voix basse comme le Vieux khazyr bigleux. Qu’il soit en extérieur ou non, qu’il fasse beau ou pas il ne se départit jamais de la grosse paire de lunettes noires qui accentue sa laideur plutôt qu’elle ne la dissimule.
Malgré la colère et la haine qui l’enserrent, Charly est heureux au milieu de la foule. Il scande parmi plusieurs milliers de camarades sionistes « Bonnet, Giscard, Barre, complices des assassins » en tapant dans les mains au rythme des syllabes, deux fois deux coups, un autre coup, puis six. La veille, un attentat dévasta la synagogue de la rue Copernic causant la mort de trois personnes et faisant d’énormes dégâts. Charly est heureux, alors que le moment est à la gravité, au drame. Son corps semble désarticulé, il sautille en tapant des mains. Généralement cet état de fébrilité qui le saisit en ce moment apparaît à l’occasion d’un événement heureux, d’une naissance, d’une rencontre… Et là au milieu de toutes ces bonnes volontés au milieu de ce caillot de feu, Charly est traversé par une impulsion qui germe en lui depuis plusieurs mois, mais qui, le temps passant, commence à donner des signes, à se dévoiler, à prendre forme. C’est ce mouvement interne qui le rend heureux. Pierre Doinas, bien qu’horrifié par l’attentat, ne veut pas se joindre à ces « cortèges porteurs d’orages » dit-il à Charly. Pierre est souvent en désaccord avec lui. Leurs discussions à propos des groupuscules politiques que fréquente Charly sont tendues. Pierre est un libéral, plutôt giscardien, et tous ces groupements extrémistes le rendent malade. Sa rupture avec Charly sera consommée quelques semaines après son mariage, celui de Pierre, qui se déroula en mars 1981. Pendant des années leurs familles n’en sauront rien.
L’élection de François Mitterrand au Palais de l’Élysée déclenchera la décision que Charly mûrit depuis longuement surtout après cet attentat du Marais, une double décision : primo, abandonner ses études de Droit, la licence qu’il obtint l’année dernière — il avait dû redoubler la 3e année — suffit pense-t-il, pour lui ouvrir les portes d’une carrière professionnelle dans la magistrature ou sa périphérie. Secundo, retourner durablement au Proche-Orient. Son père, dépité, profondément déçu, ne lui parla pas pendant une semaine, mécontent non seulement que son fils renonce aux études si près du but, mais aussi, et peut-être surtout, qu’il retourne en Israël.
Depuis quelques années, quatre, la rose et le rouge dominent le spectre des fleurs et des couleurs politiques, mais les désillusions poussèrent sur l’humus amer de l’expérience. Elles s’expriment ouvertement. Messaoud n’est pas en reste pour critiquer le gouvernement. C’est que l’espoir était immense avec l’élection à la présidence d’un socialiste. Messaoud s’était senti pousser des ailes. Le soir même de la victoire, il s’était rendu à la place de la Bastille avec Razi et Denise qui portait Yanis sur son ventre dans un porte-bébé comme une mère kangourou. Il y avait tellement de monde qui cheminait vers la place qu’ils arrivèrent à plus de vingt-trois heures ! Messaoud et Razi s’appréciaient comme deux bons camarades de même quartier. La jalousie qui étranglait Messaoud il y a quelque temps relevait des souvenirs les moins brillants. Messaoud et Denise étaient doublement heureux, car ils étaient sur le point d’emménager dans un deux-pièces-cuisine, à quelques centaines de mètres du studio qu’ils occupaient jusque-là. Malgré les cordes qui se déversaient sur elles, les milliers de personnes présentes s’époumonaient « Mitterrand ! Mitterrand ! » Jeunes et vieux, hommes et femmes, ils avaient dans les yeux des étoiles qui scintillaient et autour du visage radieux un halo aux couleurs de la victoire. Le sol et leur corps étaient devenus si légers qu’ils semblaient flotter. L’Internationale avait fière allure et Messaoud accompagnait le chant révolutionnaire en brandissant haut le poing. « Les réacs avaient enfin perdu et avec eux la guillotine » disait-il en pensant à cet homme, Philippe Maurice, qui mourait de feu lent dans le couloir de la prison, avant que cette victoire ne défasse et brûle l’échafaud. Messaoud lisait Libération. Un journal qu’il découvrit au début de 1979 lorsqu’il avait publié un reportage sur la chute du Shah d’Iran. En une du journal s’étalait une photo de « l’imam de Neauphle-le-Château » enveloppé dans une longue cape noire, assis en tailleur sur un simple tapis sombre. Elle illustrait un article intitulé « Khomeiny se pose en chef d’État. » Le commentaire lui avait plu ainsi que d’autres articles comme ceux qui rappelaient les dessous de la « Grande marche verte des gueux » vers le Sahara abandonné par les Espagnols. Les contenus du journal — qui n’était pas régulier à l’époque — surtout ceux qui traitaient du social, de l’immigration… correspondaient parfaitement aux idéaux de Messaoud, à sa perception du monde. Depuis l’article sur la révolution iranienne, il achetait chaque numéro qui paraissait. Avec l’arrivée de la gauche au pouvoir en mai 1981, le journal était devenu « in », son audience s’était étoffée. Dans les bars chics — il lui arrivait de les fréquenter — Messaoud frimait avec Libé, tantôt sous le bras, tantôt l’exhibant, en veux-tu en voilà. Il lisait tout, des illustrations de Kiki Picasso aux incontournables commentaires des filles chargées de la mise en forme des articles et qu’on appelait affectueusement les « clavistes ». Ces notes entre crochets [ndlc] n’étaient pas nécessairement des précisions ou des compléments d’information pour clarifier ou aérer l’article, mais des sautes d’humeur, une exaspération ou un appui à l’article. Elles étaient souvent drôles et impertinentes… Lorsque durant les années socialistes il s’aperçut qu’il y en avait de moins en moins, Messaoud se demanda si cela n’était qu’une simple coïncidence. Il écrivait parfois à la rédaction qui ne répondait pas, appelait le standard pour protester. Une fois il se rendit au siège du journal, rue de Lorraine, au prétexte d’aider à l’enregistrement des Petites annonces. Dans la salle de rédaction, il provoqua un esclandre. Il criait « non, la publicité n’est pas un art ! » (sur le mur un slogan peint avait résisté « À bas les spécialistes de la pensée ! ») Messaoud exprima sa rage en hurlant devant ‘‘Serge July et sa clique’’ qui restèrent de marbre : Philippe Gavi, Marc Kravetz, Claude Maggiori, Zina Rouabah… Zina avait quitté le journal puis, manifestement, y était revenue. Le deuxième mercredi d’avril de l’année dernière, Messaoud s’étonna de la parution d’un extrait de la longue lettre de protestation qu’il avait adressée à son journal préféré malgré tout : « … je te lis aujourd’hui comme je prends mon p’tit beurré du matin. Seul ton courrier lavande ma chère (permets-moi de ne pas t’appeler Libé) respire encore… »
Tout cela fait sourire Razi, peu ou même pas du tout convaincu par cette « mouvance politique bonbon acidulé », comme il la désigne. Malgré ces quatre années, l’air qui flotte sur la France est encore léger, rose et rouge. Et les capitaux continuent d’emprunter des chemins de traverse jusqu’à Genève. « Tant pis, se dit Messaoud, nous, nous serons à la Concorde. »
Charly commande un autre « café italien » dans la brasserie Monot, derrière l’église du Saint-Sauveur. Il se sent définitivement heureux, car il vient d’apprendre qu’il est « officiellement affecté au groupe des Phalanges K. à compter du… » Il repense à la longue veillée fortement arrosée avec Kaleb et à sa promesse tenue, « je m’en charge » lui avait-il dit. Il ouvre son carnet pour y porter telles quelles les notes qu’il avait prises sur un bout de feuille cartonnée lors de la soirée, il était très tard : « L’ébriété se manifeste chez moi de deux façons, selon que j’ai bu en compagnie de tels gars ou de tels autres. Tantôt la soûlerie m’extrait de mon réel, m’éloigne de ma perception habituelle du monde, la rendant hideuse, tantôt au contraire, elle renforce mes attitudes et comportements. Celle qui m’arrache un temps de ma lucidité et par conséquent des ‘‘bas-fonds de la vulgarité dans lesquels me plonge la haine que j’ai de l’islam et des musulmans’’, comme ils disent ! (Oui je les déteste au-delà de la haine, et je l’exprime dès que je le peux en actionnant la détente de mon nouvel engin, le AK47), cette ivresse-là me fait rire sans retenue, enlacer des inconnus, les embrasser, moi l’obsédé de l’ordre, de la pureté et de la rigueur. C’est pourquoi, pour les maintenir intactes, voire renforcer mes convictions judéo-chrétiennes, je m’abstiendrais de boire avec les gris, les pas clairs. Cela n’est pas toujours aisé, on ne maîtrise pas toutes les situations. Kaleb est clair comme une eau de roche. »
En face de Charly, un homme portant une casquette et une écharpe noires, en coton, lit L’Orient-Le jour. L’assassinat de Sadat fait encore l’objet d’articles en une. Un autre papier traite de la récente rencontre à Bagdad entre Tarek Aziz et deux émissaires libanais, Élie Hobeika et Zahi Boustani.
Au début du mois, l’avion de la compagnie El-Al dans lequel se trouvait Charly atterrissait à Tel-Aviv. C’était le premier jour de novembre en début d’après-midi, le temps frisait la canicule avec un ciel par endroit couvert d’un voile laiteux, faussement limpide. Charly revenait en Israël le cœur léger. L’année sabbatique lui fut accordée. Il l’avait demandée au lendemain de l’élection présidentielle, « sur un coup de tête » ment-il. La décision de quitter la France, il y avait longuement réfléchi. Mais la victoire de Mitterrand, il n’y croyait pas. Il ne l’envisageait même pas. Le dimanche soir du deuxième tour de l’élection, au moment de la diffusion des résultats, il était assis dans le fauteuil du salon de l’appartement de ses parents, à côté d’eux. Comme eux, Mimoun avait voté pour Giscard d’Estaing au second tour, faute de candidat plus à même de mieux le représenter. Au premier il avait voté pour Jean-Marie Le Pen. Il le détestait, mais il disait pour se défendre « l’ennemi de mes ennemis est mon ami ». Tous les trois avaient, pendant les dix dernières minutes, gardé le silence, entièrement accrochés aux paroles des journalistes qui ne disaient rien d’important jusqu’à 20 heures précises. Yacoub et Yvette préférèrent s’éloigner de ces ambiances politiques, elle chez une amie dans le quartier, lui au Wepler qui projetait Mon oncle d’Amérique. Lorsqu’apparut le portrait électronique du vainqueur sur l’écran d’Antenne2 et lorsqu’il entendit Elkabbach déclarer, le visage blême et la gorge nouée, « François Miterrand est élu président de la République » et Mougeotte confirmer « François Mitterrand 51,7 % », Charly vacilla. Sa mère se couvrit le visage des deux mains. Son père se leva et quitta le salon. Le corps de Charly fut parcouru d’un long frisson. Une sensation fortement désagréable le secoua. On eut dit qu’on avait glissé dans son dos non pas un, mais plusieurs gros cubes de glaçons. Il demeura de longues secondes comme pétrifié. Il avait prévu de sortir, mais il se ravisa. Il changea de chaîne. Sur l’écran de TF1 s’affichaient les mêmes taux avancés par sa concurrente chaîne publique, se confirmaient. Dihia ne disait plus rien. Elle se leva et alla rejoindre sa chambre à coucher avec une petite radio à piles. Les semaines suivantes furent exécrables et chaque jour qui passait suppliciait Charly plus que le précédent. Il ne supportait ni les commentaires de ses collègues de travail ni ceux de la presse. Le mois de mai ne s’était pas entièrement déroulé lorsqu’il formula une demande de congé sabbatique d’une année, onze mois, « pour convenance personnelle » précisait-il aux collègues indiscrets. Elle lui fut accordée sans difficulté. Charly eut, au moment de la réception du document qui le libérait, une pensée pour Jacques Doinas.
Dans l’aéroport juif, la chaleur était accablante, la climatisation aléatoire. On s’essuyait, on s’éventait, on buvait ou on s’aspergeait d’eau. Aussitôt passées les formalités douanières et policières, Charly se retrouva dans la longue file d’attente d’un taxi. Il arriva à la Central bus station dans l’heure qui suivait. Il était convaincu que les assourdissants ronflements des moteurs et les polluants gaz d’échappement accroissaient la température. Dans le hall, des dizaines de personnes déambulaient, amorphes, parfois avec dans une main un mouchoir pour s’éponger le visage et dans l’autre un baluchon, une valise ou rien. Charly acheta un billet pour « la ville de son adolescence » puis monta dans l’autocar. Il dit toujours « Ashdod est la ville de mon adolescence », ce qui est faux. En réalité il n’y a passé que trois années et demie, mais Ashdod occupe une place particulière dans son cœur. Après ses derniers voyages en Israël, il s’en est voulu de l’avoir ignorée. Il s’installa à la première place, à droite du chauffeur qui faisait ronronner le moteur comme ses collègues. Il tendit la main et Charly lui montra le billet qu’il vérifia. Le Français avait programmé de rester une petite semaine dans Ashdod. Il demanda au chauffeur la permission de garder son sac Palladium avec lui, mais celui-ci, bien qu’habitué aux hautes températures, ne lui répondit pas. Peut-être voulait-il économiser ses forces, ou peut-être avait-il sommeil, car à l’instant où il hocha la tête, il ouvrit grand la bouche et demeura ainsi une longue minute, offrant au large rétroviseur intérieur, et par conséquent aux voyageurs fixant ledit rétroviseur, sa piteuse dentition. Charly glissa le bagage sous son siège après en avoir retiré le livre qu’il avait entamé dans l’avion. Il l’ouvrit à la page 23 qu’il parcourut :
« Et quand le 305 accourut sur le long rail de sa clameur/ Une étincelle se raviva sous le souffle/ Parmi mes stupeurs consumées, elle pétilla : / Je suis donc, je pense encore. / À cette seconde une explosion lyrique m’ouvrit à l’épanouissement du cratère,/ Toute ma vie je resterai l’inconnaissable initié à cette lueur indicible. / Je fus dans un tonnerre/ la pensée du monde/ Qui jouit d’être jusqu’au paroxysme de l’éclatement… »
Quarante minutes plus tard, les rues des premiers quartiers d’Ashdod absorbaient l’autocar. Charly eut une étrange sensation. Du bourg ensablé qu’il était dans son adolescence, le village se transforma en une grande ville relativement moderne. Charly eut comme un haut-le-cœur en réaction à la forte chaleur et à l’odeur d’œufs pourris ou de soufre qui remontait du port, transportée par un vent tout autant désagréable. Les champs rocailleux à la périphérie du village se métamorphosèrent en tours de standing. Le front de mer, jadis au plus près de la nature, est méconnaissable, s’étalant à l’infini, bordé de grandes avenues avec une marina pour familles aisées. Les dunes disparurent presque toutes. Ashdod figure désormais une pieuvre sournoise qui déploie, insatiable, ses tentacules à la recherche de nouveaux territoires adverses pour y appliquer ses ventouses déprédatrices. Dans la souricière formée par les avenues, places, buldings, Charly finit par repérer un hôtel convenable, précisément sur la Ha Tayelet. Les hôtels sont étrangement peu nombreux dans la ville. Il dut la parcourir en long et en large avant de se poser enfin. Celui qu’il trouva à l’est de l’agglomération ressemble à s’y méprendre à un lupanar. Après avoir renseigné le formulaire d’occupation de la chambre, posé son sac, pris une douche et repris ses esprits, il se rendit à pied dans le quartier nord, malgré le vent marin qui sifflait dans les oreilles. Il flâna tant qu’il put, sans grand enthousiasme. Il avait pensé glaner des nouvelles sur ses anciens camarades, espéré, pourquoi pas, en rencontrer. Redécouvrir pour les aimer encore plus les quartiers du port. Mais, maintenant qu’il était sur place, dans cette bourgade métamorphosée, Charly se rendit compte que sa vie et sa perception avaient changé avec le monde comme la ville elle-même avait changé sans l’attendre. Le cœur n’y était plus. Le sien bat beaucoup plus pour la capitale du cèdre au bord de l’implosion que pour cette ville trop tranquille, trop cauteleuse, trop ambitieuse. Charly ne s’étonna finalement pas du malaise qu’il y éprouvait. L’environnement dans lequel il baigna adolescent se transforma complètement. Cette ville, ses commodités et ses occupants ne lui inspirent plus que peu d’indulgence. Trois jours lui suffirent. Les sentiments peu chaleureux qu’il ressentait, et ce peu d’empressement qu’il avait de retrouver son passé et qui se manifestait chaque heure davantage en lui au fur et à mesure qu’il se réappropriait les artères de la ville métamorphosée, ont pour source son changement à elle certes, mais surtout sa hâte à lui de rejoindre le Liban pour en extirper « le cancer palestinien qui le ronge. » Le Palestinien est la justification première de sa présence dans la région en cette fin d’année. C’est pourquoi il atteignit Tel-Aviv, le cœur léger. Léger de progresser vers des perspectives prometteuses qui lui semblent venir elles-mêmes à sa rencontre, parées de leurs plus beaux atours. « Éradiquer le cancer » se répète-t-il sereinement, la fébrilité lui étant dans ces moments précis complètement étrangère.
Quelques semaines plus tard, Charly retrouvait Kaleb Azoulay à Zouq Mkayel, un village à vingt kilomètres au nord de Beyrouth. Kaleb se souvint vaguement de Charly, qui pourtant s’en était rapproché il y a un peu plus de trois ans. Ils avaient même échangé quelques mots à propos des « sympathiques Français », ce sont les termes qu’avait utilisés Kaleb. Il raillait ces « sympathiques Français » qui déroulaient le tapis vert aux opposants à Reza Pahlavi, le Shah d’Iran. C’était en août 1978 à Beyrouth lorsque le commandant du Mossad qui faisait la tournée des camps d’entraînement était venu faire un topo chez les Phalanges K.
À Zouq Mkayel, dans un pavillon non loin de l’église grecque Saint-Basile, se tint une importante réunion dirigée par Kaleb. Outre des responsables politico-militaires, étaient présents Zaki et un autre membre de son groupe, ainsi qu’un certain Brando, un homme redoutable aux dents longues, dit-on. Et bien sûr Charly. Ensemble ils mirent « un point final au plan d’extermination des terroristes de Beyrouth pour le siècle à venir ». Le plan sera exposé aux dirigeants israéliens pour approbation. Dès la réunion terminée, la plupart des membres quittèrent la ville, probablement pour se rapprocher de leurs familles en ces jours saints. Charly, Kaleb et trois Libanais se donnèrent rendez-vous pour le lendemain à Beyrouth dans le quartier Achrafieh, dans l’appartement de l’un des trois Libanais. C’est au bas de la rue Sassine et il y vit seul. En se rendant à cette rencontre, à hauteur de l’Hôtel-Dieu de France, Charly aperçut un homme avancer vers lui en claudiquant. Il portait un bandage qui lui comprimait la tête. Il marchait la tête basse, semblait plongé dans un marécage de problèmes insolubles. Aussitôt passé l’effet de surprise, Charly le reconnut. Il se crut un instant revenu entre le quai de la Loire et l’avenue Jean Jaurès à Paris, du côté de Félix Potin. Lorsque l’homme arriva à sa hauteur, Charly lui donna une tape sur le bras. Un coup plutôt inamical, voire agressif. L’homme, qui était profondément plongé dans ses réflexions, sursauta. « Ta petite maigre noiraude, ton Antigone à deux balles, c’est une salope mon cher connard ! » lui lança Charly avec sur les lèvres un sourire sardonique. Georges Chalandon connaît Charly de réputation. Il l’avait aperçu à Paris probablement (« c’était y a mille ans » pensa-t-il), mais là, il ne le reconnut pas. « Ce ton familier, cette désinvolture, quelle obscénité ! » se dit-il, mais il ne répondit pas. Il se contenta de faire un geste, comme pour dire « passe ton chemin » ou « ôte-toi de mon soleil ». Georges couvre les événements pour Libération, mais il est là également pour monter Antigone de Jean Anouilh. Le théâtre est sa grande passion. Georges aime ses comédiens. Il aime Hémon et Créon. Mais il a un faible pour Antigone, la Palestinienne qu’il entend répéter avec cet accent chantant et rocailleux qu’on ne rencontre qu’ici : « je suis noire et maigre. Ismène est rose et dorée comme un fruit. » Georges porte ce pansement à la suite d’une agression dont il a le plus grand mal à se remettre. Il fit un nouveau geste du bras et poursuivit sa route. Il pensa en son for intérieur que les propos de Charly ne relevaient que du crétinisme, c’est le terme qui lui vint à l’esprit : crétinisme. Il en était presque content, et le garda pour lui.
C’est là, dans cet appartement de la rue Sassine, autour de caisses de bière Almaza, de briques d’Arak, de sachets d’amuse-bouches et de petits plats chauds faits de pois chiches, de tahini, de samboussa, de pâte de sésame, d’épinards et de fromage que Charly et Kaleb — qui se dépouilla progressivement de son armure officielle de grand patron, mais pas de ses lunettes noires — apprirent qu’ils sont tous deux de même origine. Kaleb posa nombre de questions à Charly sur ses intérêts dans la région, sur sa famille. Puis il parla de lui-même. La famille Azoulay était parmi les plus anciennes d’Oran, comme la famille Pinto. Les parents habitaient à Saint-Eugène, deux rues derrière le square Garson. À longueur de journée son père, monsieur Yvars, travaillait le merrain, ajustait les douelles, cerclait les barriques chez Follana. Il lui en fallut des mois pour pratiquer des bondes en respectant les bonnes dimensions, des années pour devenir un bon tonnelier. Il y restera jusqu’à la grande catastrophe. Tous les membres de la famille quittèrent précipitamment l’Algérie, nus comme des vers de terre. En novembre 1962 ils se retrouvèrent en Israël, dans un kibboutz à Acre. Ils ne partirent plus de ce pays. Mais c’est sur Oran que s’appesantirent Charly et Kaleb : le cornet de frites du Théâtre de verdure, la calentica des marchands ambulants de La Calère, la pêcherie, les kermesses de Saint-Eugène, les auto-tamponneuses de la fête foraine de la place Fontanel à Gambetta, Santa Cruz, la Montagne des lions. Kaleb raconta son père, les bals et « la chasse à l’Arabe », Charly l’assassinat de son grand-père, le compte-rendu de L’Écho d’Oran — le quartier israélite. « Je connais, bien sûr, boulevard Joffre, la synagogue, oui je connais, je connais » fit Kaleb.
Avec les trois Libanais, ils n’échangèrent quasiment rien. Lorsqu’ils revinrent à leurs « moutons », c’est-à-dire à la question palestinienne, la question qui suinte en permanence des discussions dans ce pays, Charly fit part au Vieux khazyr bigleux de son souhait d’intégrer les Phalanges K. « Je les connais, je me suis entraîné avec eux, mais je souhaite en faire partie officiellement ! » Vers deux heures du matin, imbibés d’alcool et abandonnés à la cécité manœuvrée autant qu’eux par la colère et la haine — corps ineptes et entravés —, ils s’affalèrent sur les matelas posés à même le sol jonché de restes de nourriture, mouillé de bière et probablement d’urine.
Charly va maintenant commander une bière. Il ne pense plus qu’aux Phalanges. Il relit son carnet, « L’ébriété se manifeste chez moi de deux façons, selon que j’ai bu en compagnie de tels gars ou de tels autres. Tantôt la soûlerie m’extrait de mon réel, m’éloigne de ma perception habituelle du monde, la rendant hideuse, tantôt au contraire, elle renforce mes attitudes et comportements. Celle qui m’arrache un temps de ma lucidité et par conséquent des ‘‘bas-fonds de la vulgarité dans lesquels me plonge la haine que j’ai de l’islam et des musulmans’’ L’homme à la casquette noire et à la grande écharpe, qui était en face de lui, n’est plus là.
Les échos du mondial de football sont bien faibles dans ce petit village. Alain Giresse vient d’inscrire le 4e but français contre l’Irlande du Nord au second tour, mais à Zouq Mkayel cela n’émeut pas la population, préoccupée par sa survie. La nuit tomba sans entraîner avec elle la suffocante chaleur, étouffante. La maison qui abrite la réunion secrète entre des représentants libanais et israéliens appartient à Efef, alias Horse, un responsable des Forces libanaises. Dans le salon il n’y a qu’un seul ventilateur qu’on prit soin de poser sur une commode, au centre de la table en U, de sorte que Raphaël Sheytan le chef militaire israélien, le Rav halouf, bénéficie totalement de ses bienfaits. Trois autres israéliens, en tenue militaire eux aussi, sont assis, deux dont une femme sur la droite de Sheytan, le troisième sur sa gauche. Charly se trouve en face de la femme. Plusieurs fois, il porte discrètement son regard sur cette jolie jeune brune, avec des yeux olive en forme d’amandes. La première fois il est parcouru d’un long frisson. À aucun moment leurs yeux ne se croisent. Le reste de la grande table est occupé par douze personnes. Trois sont assises à la droite de Charly. Ce sont Horse, Elias El-Zely dit Boa le chef par intérim des FL, c’est un proche de Habika, le leader des Phalanges Jihaz appelé Le tueur. Et en bout de table un autre responsable des FL. Les neuf autres sont assises entre Charly et la femme : six membres des FL et trois autres miliciens de l’équipe de Boa, ceux-là mêmes qui se trouvaient dans l’appartement de la rue Sassine avec Charly et Kaleb. Aucun milicien ne porte l’uniforme. Boa s’exprime le premier. Il lance quelques phrases convenues et sans s’attarder passe à l’objet de la réunion puis donne la parole au Rav halouf. Le chef d’État-major félicite les Libanais pour l’action menée contre la faculté des sciences et les colonnes palestiniennes qui la contrôlaient. Puis il développe les grands axes de la stratégie qu’il arrêta pour la région. Avant de clôturer son intervention, il apprend aux représentants que le plan qui avait été proposé par les Libanais « au Roi Shamon », le grand patron, venait d’être approuvé. Enfin et pour conclure, le Rav Halouf donne d’autres informations, plus évasives. « Le moment venu, nous vous tiendrons au courant des modalités concrètes ». Il offre ensuite la parole à qui veut la prendre, mais personne n’en veut si ce n’est Horse qui remercie de nouveau « nos amis israéliens », appuyé en cela par Boa qui balbutie quelques mots enrobés, dans la même veine. Sheytan se lève imité immédiatement par tous les autres membres dans un bruit amplifié de chaises grattant le sol. Au garde-à-vous, la main en visière, ils entament Hatikva :
« Aussi longtemps qu’en nos cœurs…
כל עוד בלבב פנימה
נפש יהודי הומיה
Kol od balevav p’nimah
Nefseh Yehudi homiyah »
La jeune femme au garde-à-vous face à Charly fait surgir du plus profond de sa mémoire un souvenir qu’il pensait définitivement éteint, celui d’Erzebeth. Charly regarde la belle femme en treillis devant lui en se demandant si elle fume des Royale et si elle était à la réunion d’avril. Il l’aurait remarquée, mauvaise question pense-t-il. Cette autre importante réunion s’était tenue dans ce même village, Zouq Mkayel, non loin de l’héliport, dans une villa appartenant à un cadre des phalanges. Charly avait retrouvé le commandant Kaleb qui le présenta à plusieurs responsables dont Boa. Il se souvient qu’il lui avait tendu la main en lui disant : « bienvenue au club monsieur le journaliste. Nous avons besoin de gens comme vous » avec un sourire aux lèvres et un regard froid comme l’acier qui signifiaient qu’il avait recueilli assez d’informations sur lui. Les compagnons d’armes de Charly l’appellent Charly, parfois Charly Klein. Il sera aussi désormais depuis cette rencontre d’avril, « le journaliste ». Mais Charly ne se souvient pas avoir vu cette femme ni une autre. Sheytan clos la rencontre, portant haut la voix, le bras levé : « vive Israël, vive le Liban ! » La belle jeune femme au garde-à-vous, brune et menue, mais à la poitrine généreuse, raide dans son treillis militaire, n’a manifestement aucun autre souci que celui de sa charge professionnelle. Ses cheveux noirs sont coiffés comme elle, comme Erzebeth que Charly avait aimée. Cette fille, ici dans cette villa, sans sac ni parapluie, troubla son esprit du début à la fin de la rencontre. Elle ne lui prête ni plus ni moins d’attention qu’aux autres membres autour d’elle.
Il y a près de cinq ans Charly sortait de la brasserie Le Select accompagné de cette jolie Erzebeth (elle était étudiante comme il l’était). Ils aimaient s’y rencontrer en compagnons d’un même combat puis en amoureux (était-elle sincère ? il s’est maintes fois posé cette question). Parfois ils se retrouvaient en compagnie d’autres jeunes radicaux pour comploter après la fac et la radio. À l’époque Charly entamait sa deuxième année de licence et était sur le point de quitter l’émission Les Routiers sont sympas pour animer des chroniques avec Jacques Chupas. Ce soir-là ils avançaient dans la nuit, bras dessus, bras dessous, quand la pluie se mit à tomber. C’était la première fois que Charly retrouvait Erzebeth depuis son voyage en Israël et au Liban. Il en était à lui décrire Zaki Bouznati qui l’avait impressionné plus encore par son regard que par sa corpulence. Erzebeth venait d’ouvrir le parapluie, quand un homme s’approcha d’eux pour leur demander du feu. Encombrée, Erzebeth pria Charly de tenir le pépin. Elle commençait à ouvrir son sac à la recherche de son Zippo quand brusquement l’homme, un gringalet d’une trentaine d’années, cheveux noirs, à peine plus haut qu’un collégien moyen, un mètre soixante-cinq, souple comme un roseau, étira son corps au plus haut qu’il put et donna un violent coup de tête à Charly qui vacilla, puis il arracha le sac de la main d’Erzebeth médusée, courut à toutes enjambées sur le boulevard Montparnasse, mais il glissa sur le rebord du trottoir mouillé. Revenue de sa stupeur, l’étudiante rattrapa l’agresseur, se jeta sur lui et se mit à crier tout en lui assenant des coups sur le ventre, les jambes, le visage, tantôt avec son pied, tantôt avec le parapluie qu’elle venait d’arracher des mains de Charly qui agitait les bras, comme pris de spasmes. Son tube digestif lui joue des tours. Il entend des borborygmes. Il se penche en avant pour faciliter l’expulsion, sonore, des gaz encombrés dans son anus. Des badauds s’approchèrent. Ils ne s’aperçurent pas que Charly avait uriné dans son pantalon. Ne savaient pas que ce liquide tiède qui dégoulinait de son corps, sans que personne ne sache, lui faisait du bien, lui procurait un plaisir qu’il savourait les yeux clos, sans état d’âme. N’était la présence des passants, l’agresseur y aurait certainement laissé un bras ou un œil. Erzebeth marqua cette soirée d’une pierre sombre et ne répondit plus jamais aux attentes de Charly. Elle ne voulut plus en entendre parler, malgré ses obligations patriotiques. Ce souvenir se dissipe de l’esprit de Charly, emporté par les applaudissements. Il se ressaisit et claque des mains à son tour, ébranlé par cet épisode peu glorieux, marqué de lâcheté.
Le lendemain le halouf fera la tournée des zones stratégiques contrôlées par les forces amies d’Israël puis, la nuit venue, il reprendra le même l’hélicoptère à Zouq Mkayel pour retrouver Tel-Aviv.
Le soleil de Beyrouth dérive progressivement d’est en ouest, le ciel peu à peu se charge, et l’obscurité s’installe sur Chiayah, El-Horch, la Cité sportive défigurée, mais encore debout et sur le flanc est des camps palestiniens. Charly et son groupe sont postés derrière l’hôpital, à la lisière de Sabra, sur Tarik Jdideh. Des équipes de commandement israéliennes installées sur des terrasses d’immeubles depuis la veille, mercredi, surveillent tous les quartiers autour du stade. Les tanks de Tsahal encerclent les camps. Les Israéliens contrôlent toutes les routes, tous les carrefours des alentours. Charly se réjouit « les terroristes sont faits comme des melons ». Le plan Moah barzel, Cerveau de fer, fut mis en branle à la mi-septembre. Il s’accélère deux jours avant Rosh Hashana.
À la vue des deux drapeaux croisés peints sur la grande façade du mur de Dar Al Ajaza, l’un représentant Israël, l’autre les Kataëb, puissamment éclairés par les phares d’un engin militaire qui se dirige vers l’entrée du camp, Charly est parcouru d’une agréable sensation. Il a une pensée pour les siens et se promet de les appeler aussitôt qu’il le pourrait. Il se voit en soldat conquérant de la liberté, à Verdun peut-être ou à Canton. Deux phrases de Drieu qu’il avait relues la veille lui reviennent à l’esprit. Il se convainc qu’il lui faut les noter sur son calepin : « Enfant, à cause de la splendeur des images, j’ai préféré les pays exotiques à ma patrie. Son sol et son ciel étaient trop modestes. » Deux semaines auparavant, plus de quinze mille Palestiniens, avec à leur tête Yasser Arafat, étaient expulsés du Liban. Défaits. Charly et ses camarades n’ont aucune difficulté à éliminer les poches restantes. Chaque Palestinien sur la terre du Liban libre et ailleurs, doit payer l’assassinat du président Gemayel. Certains membres des Phalanges K. intègrent le groupe israélien Sayeret Mat’Kal que dirige Beni Elhem — un membre de la lignée des Hashomer réputés va-t-en-guerre. Charly en fait partie. L’incorporation se fit avec l’accord formel des responsables des Phalanges K. Charly et ses compères portent des vêtements civils et des sacs à dos, sans signe distinctif. D’autres groupes arborent les insignes des milices des Forces libanaises, ou des écussons avec l’emblème du Liban, le cèdre, comme les membres de l’armée libanaise dissidente de l’ALS de Saad Haddad contrôlée par Tsahal. D’autres portent des crêpes noirs.
Le ciel au-dessus des ruelles des camps palestiniens s’ambre totalement. L’obscurité qui s’installe progressivement tout autour de la Cité sportive et du cimetière absorbe, indifférente, l’effervescence du jour. Elle réduit à néant l’agitation ordinaire, celle des voitures, des foules, des marchés. Pas celle du ciel tourmenté ni celle du feu. Au milieu de la chaussée, de nombreuses voitures avec des impacts de balles sur les pare-brise, les portières grandes ouvertes, les capots, sont abandonnées. Cinq jeunes qui sortent du cinéma de quartier où ils mettaient en scène des poèmes de Mahmoud Darwich ont juste le temps de se faufiler hors du camp.
(Sa ya’ti barabara akharoun… Les tambours rouleront et d’autres barbares viendront. La femme de l’empereur sera enlevée chez lui / Et dans ses appartements, prendra naissance l’expédition pour ramener la favorite au lit de son maître. / En quoi cela nous concerne-t-il ? En quoi, cinquante mille tués seraient-ils concernés par cette noce hâtive ?)
Le cinéma est à moitié détruit. Les troupes pénètrent dans Sabra et Chatila par le sud, à 18 h, peu après la coupure programmée d’électricité. On ne voit guère que des ombres courbées aux dos proéminents. Elles avancent en file indienne. Un silence circonstanciel recouvre peu après toute la zone, le temps d’une longue respiration ou d’une interminable prière avant l’agonie. D’autres groupes, comme ceux du Jihaz de Habika, entrent par les portes ouest. Ils avancent dans les ruelles bordées de petites maisons d’un ou de deux étages, parfois inachevées ou détruites. Des masques d’une intense laideur sont dessinés sur leurs visages. C’est que ces ombres sophistiquées, surarmées, viendraient à bout des plus téméraires des humbles. Sur le toit de certaines maisons, des briques sont posées, comme abandonnées près de tiges de fer à béton déformées. Des fils électriques se balancent un peu partout. Certains finissent dans l’entrebâillement d’une porte, d’une fenêtre, d’autres tombent sur les toits. Les Israéliens occupent l’hôpital de Acca. Des balles traçantes se mettent à siffler, annonçant la fin attendue du silence comme on annoncerait le début de l’estocade dans une arène aux gradins archicombles suspendus à l’épée du torero, car tous savaient le silence provisoire. Des trombes d’eau tombées elles aussi du ciel se déversent sur les quartiers. On entend des tirs d’armes automatiques avant l’explosion générale. Des Bulldozers Aleph parcourent les zones d’ouest à nord. Des fusées que des unités israéliennes tirent à partir des terrasses d’immeubles avec les mortiers IDS de 81 millimètres éclairent les Sayeret Mat’Kal, appuyées par les milliers de torches au magnésium que répandent les avions. Il fait aussi clair qu’un matin de juin, un matin de tous les possibles, au bord du lac Moraine ou d’une bouche du Kilauea. Les instructions ne prêtent à aucune équivoque : « tirez sur tout ce qui bouge. S’il le faut, exécutez les fœtus dans les entrailles de leur mère ». Elles émanent de Raphaël Sheytan le Rav halouf, de ses proches et des subalternes. Elles ruissellent du sommet de la pyramide à sa base, du général — halouf — au halouf mishne, au sgan halouf, aux rav samal et samal, sergent, et jusqu’au milicien. Les enfants qui tambourinaient sur des jerrycans en criant, dégoulinant d’eau et de foi, « La Ilaha Illa Allah, la Kataeb wa la sahyoun » se volatilisèrent, ou furent exterminés. Un ordre est un ordre. Le groupe de Charly applique les consignes avec un zèle démesuré et dans la bonne humeur générale. Rares sont les âmes qui échappent à ses épouvantables armes. Un fou sort en courant des méandres de Chatila. Il s’immobilise au centre de la rue Khalil Haoui, nu comme un alexandrin et trempé jusqu’à la moelle. Dans la main il tient un couteau de boucherie. Il déclame,
Le voilà nez à nez avec un soldat israélien qui le met en joue, prêt à l’anéantir. L’homme brandit son couteau au ciel avant de le porter violemment contre son cœur, devançant les balles du soldat qui toutes s’écrasèrent contre un mur à moitié dévasté. L’homme tombe à la renverse, victorieux, le cœur offert au ciel. Le poète — c’est un poète ! — se fait hara-kiri aussi élégamment qu’un samouraï au plus haut de sa certitude, de l’apogée de son être libre, échappant aux balles de l’envahisseur, le terrassant par son geste. L’homme, au cœur de l’impasse, soustrait à son ennemi la décision de la mort, de sa propre mort. Et de tous les siens. Il meurt ainsi, libre, d’une mort debout, désormais plus vivant que jamais, faisant chanceler le ciel et le béton tout autour. Son regard encore tiède semble viser un balcon fleuri auquel il adresse un dernier vers comme une dernière supplique ou un dernier sourire d’homme sans entrave. Mort et libre dans l’éternité.
Un peu plus loin, dans Ghobeiry, une ruelle où guette une dizaine de soldats de Sayeret Mat’Kal, un marchand ambulant avance. Il a l’âge d’un collégien. Son regard donne à lire l’horreur que lui infligent les armes, là, devant lui. Il avance hagard, les bras tenus en l’air. Il abandonna sa carriole de fruits, pressant le pas de peur, trébuchant sur un cadavre à moitié recouvert de boue. Charly a le sentiment qu’un fluide gras, s’écoule dans toutes les parties de son corps, si violemment, si intensément qu’il s’évacue par ses pores. Sueur putréfiée, elle soulève son propre cœur. L’adolescent supplie Jésus fils de Dieu et de Bethléem et Marie de Nazareth Ennasira pour qu’ils prennent la forme d’une créature, de n’importe quoi, de n’importe qui, qu’ils intercèdent en sa faveur, que le soldat en avant, Charly, se fige brusquement, qu’il s’écroule puis disparaisse avec son arme dans le ventre de la terre, et les autres avec lui. Charly ne se fige pas, ne disparaît pas, mais il laisse passer le garçon « ayya, edheb ! » lui fait-il. Ses compères rient bruyamment. Le garçon accélère le pas, passe devant les soldats. Il fait quelques dizaines de pas avant de chanceler près d’un immeuble où sont disposées quatre lignes de sacs de sable superposées de sorte qu’elles forment un abri. Charly frissonne à l’idée qu’il va, dans les secondes qui s’annoncent, de nouveau savourer un spectacle incroyable dont il sera l’initiateur, le maître. Il n’est pas à son premier fait d’armes. Charly est aguerri, c’est un spécialiste. Son cœur se contracte, son rythme s’accélère un peu plus et dans le fond de ses iris sombres des filaments étincellent. Aucune âme ne vibre en lui. En son être ne sourdent ni le sentiment de fraternité, ni la mansuétude. L’effleurèrent-ils jamais ? C’est à ce moment précis, alors que l’enfant se signe en tombant contre un de ces sacs, que Charly décharge dans son dos les munitions de son AK47 — des balles calibre 7,62 qui disposent ‘‘d’une grande capacité de pénétration’’. Charly répond aux ordres avec une sorte d’allégresse. « Tirez sur tout ce qui bouge, s’il le faut exécutez les fœtus dans les entrailles de leur mère ». Sitôt le chargeur vidé, une envie folle le saisit qu’il ne peut réprimer, une envie folle d’uriner. Il pisse dans son pantalon sans aucune gêne, au contraire, et dans la foulée lâche un collier de pets. Il est parcouru d’un chaleureux sentiment de bien-être, de plaisir anal, génital et jusqu’à la plante des pieds. Charly éprouve une sensation jamais égalée sinon à la suite de situations similaires, une sensation plusieurs fois ressentie, mais dont il est pourtant incapable de décrire ou d’expliquer la jouissance qu’elle lui procure. Il entre dans une sorte de transe. De la bouche ouverte du jeune garçon coule un filet bordeaux visqueux, vite absorbé par le sable qui ruisselle d’un sac de protection percé par les projectiles. Désormais immobile l’enfant n’entendra plus, ne verra plus toutes ces ombres oppressantes qui assaillent son quartier. Des photographes horrifiés immortalisent ce temps de l’ignominie. Charly ne fait pas dans la dentelle, n’y va pas de main morte. Il se vante du plaisir qu’il éprouve, à la mort qu’il plante dans le dos de ses adversaires démunis. « Le chant de mon fusil d’assaut me procure une immense jubilation », dira-t-il à son chef direct Amoq Shahak, son mem-mem, et aux poètes de l’abjection. « L’AK 47 dont j’actionne la détente et la conséquence en face, la chute de la vermine palestinienne, qu’elle soit homme, femme, vieillard ou enfant, peu m’importe, me transmet en retour un fluide qui se niche au plus profond de mon être où il me procure une immense jouissance et engendre un ravissement qui transfigure mon visage, le ranime, le réconforte ». Charly reprend son avancée. Un moment il s’abrite dans un couloir d’immeuble, sort son carnet pour y écrire « 7-me-7yse. » Il ajoute la date et l’heure. Puis il revient sur la chaussée. Lui et ses camarades de Sayeret Mat’Kal mettent un point d’honneur à neutraliser les Palestiniens de Sabra et de Chatila. Des dormants du Mossad, résidant dans les camps, informent les assaillants. Aucun habitant ne doit être épargné, tels sont les ordres « tuez, tuez même les enfants, pour les empêcher de grandir, de devenir des terroristes », hurlait Amoq Shahak. Un groupe d’une vingtaine d’hommes et de femmes est neutralisé par les Phalanges K. Toutes ces personnes travaillent à l’hôpital Gaza. Ce sont des médecins, des infirmiers ou des auxiliaires de santé. Les trois médecins palestiniens et syriens sont abattus sur-le-champ. Les phalangistes demandent aux autres d’enlever leur tablier de travail et de leur remettre tout ce qu’elles ont sur elles : pièce d’identité, argent, montre… avant de les emmener à l’extérieur du camp, vers une destination que seuls connaissent les phalangistes. « Maltraités, injuriés, ils n’ont pas ouvert la bouche. Comme des agneaux conduits à l’abattoir, comme des brebis muettes devant les tondeurs. Ils n’ont pas ouvert la bouche ». Les Sayeret Mat’Kal crieront au monde qu’ils n’ont « rien vu, rien entendu », que les photos ne disaient rien, contrariant Saint Genet : « pendant les nuits de jeudi à vendredi et vendredi à samedi, on parla hébreu à Chatila… La photographie ne saisit pas les mouches ni l’odeur blanche et épaisse de la mort. Elle ne dit pas non plus les sauts qu’il faut faire quand on va d’un cadavre à l’autre. Si l’on regarde attentivement un mort, il se passe un phénomène curieux : l’absence de vie dans ce corps équivaut à une absence totale du corps ou plutôt à son recul ininterrompu. Même si on s’en approche, croit-on, on ne le touchera jamais. Cela si on le contemple. Mais un geste fait en sa direction, qu’on se baisse près de lui, qu’on déplace un bras, un doigt, il est soudain très présent et presque amical. »
Durant la nuit, de 23 h à 4 h, entre 169 et 189 millimètres d’eau par heure tombèrent sur la ville, ajoutant à la mort le désastre du ciel. « Il nous fallait détruire tous les nids des terroristes, et nous avons réussi » fanfaronnera Charly. Aux premières lueurs du 18, jour de shabbat et de Rosh Hashana, Charly et ses collègues s’ennuient comme des rats noirs ou gris après l’apocalypse. Ils prennent la pose devant les objectifs des journalistes, les pieds posés avec délicatesse sur des cadavres, les doigts en V et les bouches radieuses, hilares. Charly fête avec les Phalanges K et Sayeret Mat’Kal la victoire de la monstruosité. Une odeur épaisse se dégage des vêtements de Charly et de ses camarades, de leur corps dégoulinant de boue rouge. Elle n’est pas celle de corps ou d’habits neufs ou usés. Pas celle de martyrs. Une odeur âcre, une odeur de cendre, de cadavres, de charognes. Charly écrit : « À chaque fois que j’élimine un Palestinien — ou une Palestinienne —, qu’il soit terroriste ou non, adulte ou ado ; que j’élimine ou que j’apprends qu’un Palestinien ou un musulman a été abattu, j’éprouve, comme mon cher Vilbec, un profond sentiment de joie, et me dis qu’il y a un cafard de moins dans ce monde. »
La fête spontanée qui suit est à la mesure de la victoire. Sans concession ni miséricorde. À lui seul Charly vide une vingtaine d’Almaza Pilsner. La mission fut parfaitement accomplie. De crainte que sa joie ne s’estompe, passant outre les interdits religieux, il téléphone à sa mère dans un enthousiasme et une surexcitation jamais égalés, pour lui dire l’amour qu’il lui voue à elle, à Eretz Israël, à Yehweh, qu’il outrage en le prononçant יהוה. Son exaltation atteint le comble. Il est totalement ivre. Il lui crie : « nous avons vaincu les rats ! » Non loin, ses camarades prennent d’autres photos, les pieds soigneusement posés sur les martyrs glacés et les doigts en V devant une équipe de télévision danoise qui filme pour les archives du monde et la mémoire en devenir, pour les générations futures et l’heure de vérité. Ils se photographient devant d’autres journalistes internationaux, stupéfaits, trempés de la tête aux pieds. Parmi ces journalistes se trouvent les Français Alain Ménargues et Georges Chalandon, bouleversés. Ils fixent longuement Charly et ses camarades de boucherie. Georges Chalandon pense à Anouilh, à Antigone la petite maigre palestinienne, à Hémon et aux autres. La présentation est prévue pour le premier octobre, dans treize jours, non loin de la Maison jaune, l’immeuble Barakat. Georges frissonne. La séquence est immortalisée. Sur pellicule pour certains, sur papier pour d’autres.
Raphaël Sheytan félicite tous les combattants pour avoir rendu leur honneur aux Libanais et donne son accord pour que les camps soient rasés et que sur leur emplacement un grand jardin zoologique voie le jour. Lui aussi souhaite exaucer le vœu du président assassiné. « Il faut effacer les camps, nettoyer le pays des Palestiniens pour les cent prochaines années ». Les travaux commenceront le lendemain. En ce jour de Rosh Hashana, 5743 martyrs seront enfouis sans prière ni compassion par des bulldozers implacables dans des fosses communes.
La place de la Concorde est un immense champ fleuri. Des centaines de milliers de personnes répondirent à l’appel de SOS Racisme. « Viens prendre ton pied avec mon pote », proclamaient les affiches de la nouvelle association antiraciste. Denise, Messaoud et leurs deux enfants, Yanis et Sarah, serrés dans une poussette, s’installent en retrait, sur la pelouse de l’esplanade, entre l’avenue Gabriel et les Champs. Razi vint accompagné d’une belle jeune fille. « Elle s’appelle Katia », dit-il. C’est une jeune Marocaine, très jeune, qu’il rencontra à Marseille dans une rue du quartier de Belsunce. « Elle cherchait ‘‘el-marchi Souleil’’ » plaisante-t-il en l’enlaçant. Après son DEA de sociologie, il y a un peu plus d’un an et demi, Razi préféra tout arrêter. Il ne supportait plus le démantèlement et le transfert de la faculté de Vincennes. Les deux années passées dans les nouveaux locaux à Saint-Denis furent de trop. Et puis, il ne se le cache pas, toutes ces années d’études étaient trop laborieuses. Il lui arrivait parfois, entre deux misères ou deux déprimes, de rêver d’une vie de petit bourgeois né avec une cuiller en argent dans la bouche. Les trépidations parisiennes aussi il en avait assez. Il finit par abandonner le froid et la pluie pour un pays des merveilles où le soleil atténue les effets de la mélancolie et des manques et où, fredonnait-il la misère est moins pénible. Razi travaille à Marseille, dans le Centre Bourse. Il conseille les clients de la FNAC dans le rayon livres. Il revint à Paris pour le week-end, « désolé, pas un jour de plus ! » pour montrer à sa jeune fleur de jasmin que « Paris c’est quand même autre chose que le douar de Belsunce ». La soirée à la Concorde est une preuve magistrale. Tout autour on boit, on chante, on danse. La bière coule à flots et les marchands de merguez ont le sourire jusqu’aux lobes des oreilles. « Nous sommes trois cent mille ! » hurle au micro un des animateurs. Une pléiade d’artistes se déchaîneront jusqu’au petit matin pour l’amour et l’amitié entre les potes.
Messaoud et Denise sont fatigués, mais heureux. Cette soirée réconforte Messaoud. Les moments comme celui-ci lui rappellent que la fraternité n’est pas qu’un pan de devise vissé au fronton des édifices. Mais depuis quelque temps les réticences de Razi avaient déteint sur lui. Depuis qu’il y a deux ans et demi — à la suite des grandes mobilisations ouvrières des usines Citroën et Talbot — Gaston Defferre, ministre de la République, avait accusé les travailleurs immigrés de mener « des grèves saintes d’intégristes, de musulmans, de chiites ! » Messaoud perdit peu à peu confiance en ce gouvernement auquel longtemps il crut. Il avait reçu cette intervention de Defferre comme un coup de poing. Un mémorable coup de poing officiel, étatique, « les immigrés sont un problème ». Des journalistes scrupuleux mettaient en garde contre le risque d’un déferlement raciste… La haine envers les Maghrébins était assumée par de nombreux Français. Elle allait en s’amplifiant. Un nouveau cycle naissait. Pour la première fois de sa vie, à la mi-novembre de la même année, Messaoud eut honte d’être Français. Il tomba malade et fut arrêté une semaine entière. Le lundi 14 novembre, dans le train Bordeaux-Vintimille un jeune touriste oranais, écoutait des chansons dans son baladeur lorsqu’il fut pris à partie par trois apprentis légionnaires, parce que « sa couleur de peau ne nous plaisait pas » dira l’un des criminels. Habib Grimzi ne vivra pas au-delà de la première heure du jour suivant. Il fut défenestré du train d’enfer qui l’emmenait à Toulouse, alors même que des milliers de « Beurs » traversaient les villes de France pour réclamer l’égalité et dénoncer le racisme dont ils sont la cible depuis qu’ils sont nés. Cette année-là, Vingt et un Maghrébins furent assassinés. « L’atmosphère est irrespirable », répétait Messaoud. Son père lui avait alors suggéré de « venir en Algérie avec les enfants pour connaître la famille et changer les idées. » Messaoud était à deux doigts de tout plaquer.
Neuf mois plus tard, en août de l’année dernière, Denise, Messaoud et leurs deux enfants s’étaient retrouvés à Bethioua. En vacances. Les parents étaient fiers de les accueillir dans la grande maison. Depuis qu’ils étaient revenus de France — six ans déjà — Kada et Khadra n’eurent de cesse d’en améliorer le confort. Il fallut plusieurs heures à Denise pour rencontrer tous les membres de la famille. Ils vivent pourtant tous dans la même ferme. Retrouver les parents de Messaoud bien sûr, mais aussi rencontrer sa tante Khadija, veuve sans enfant, son oncle Abdallah et son épouse, leurs cinq enfants, son autre oncle, Mohammed, et sa femme Khamsa et leurs quatre enfants dont le plus jeune, El-Hadi, a huit ans de plus que Denise. Il est marié et a quatre enfants. Son dernier, Omar, né trois semaines avant leur arrivée a presque un an aujourd’hui. La famille El-Bethioui est chaleureuse et le cœur toujours sur la main. Les petits-enfants sont nombreux et Denise était incapable de retenir tous les noms.
Les premiers jours en Algérie ils les réservèrent à la famille et à la découverte des environs. Ahmed, le fils aîné d’oncle Abdallah, insista pour qu’ils utilisent sa R18 familiale « vous la prenez, j’en ai pas besoin tant que vous êtes ici ». Ils se rendirent à la plage de Port-aux-poules, rebaptisée depuis l’indépendance Mers El-Hadjadj, Port aux Pèlerins, son nom d’origine, mais bien après le très lointain Magnus le Romain. Le village se trouve à l’est de la zone industrielle, à une dizaine de kilomètres de Bethioua. « Mers El-djadj, wella Mers El-Hadjadj », s’amuse Ahmed, « Port-aux-poules, dit-il, ou Port aux Pèlerins ! » Ils admirèrent le phare d’Arzew, parcoururent les allées du marché de Gdyel, aperçurent les jardins potagers de Kristel, partirent jusqu’à la source chaude de Aïn Franin. À Oran-ville, ils se rendirent plusieurs fois. Ce fut le choc pour Denise qui ne s’attendait pas à voir une si grande et belle ville avec quantité de buildings. La cité, protégée par deux importantes montagnes aux yeux des Oranais, celle des lions à l’est et celle de Santa Cruz à l’opposé, ne se construisit pas en tournant le dos à la baie comme on le pérora, mais en lui faisant face et en la défiant. Après Oran ils se rendirent sur la côte ouest, noire de monde, de bout en bout, de Saint-Roch aux Andalouses, en traversant Bouisseville et Ain-el-Turk. Ils passèrent le premier week-end dans un bungalow du complexe touristique conçu par Fernand Pouillon au temps du socialisme soviétique spécifique. Yanis ne voulait plus sortir de l’eau. Sarah se satisfaisait d’un trou dans le sable que son frère remplissait d’eau. À l’aide d’un petit seau, il allait et venait sans fin. Yanis et sa sœur se ressemblent. Ils ont les mêmes yeux verts et nez fin de leur mère. Yanis a les cheveux châtains ondulés de Denise alors que Sarah a une longue chevelure noire et de fins sourcils en forme d’arc. À ce moment-là elle n’avait que cinq mois. Lorsque Sarah naquit, Ginette et Albert envoyèrent une lettre qui émut leur fille. Denise avait hâte de découvrir Sig où habitaient jadis ses grands-parents. En Algérie, les mentalités et les paysages sont bien différents « c’est pas comme ici en France » regrettait Françoise la grand-mère de Denise. Son mari, Amar Benaroche, Denise ne le connut pas. Il disparut longtemps avant sa naissance, pendant le bombardement de Toulon, là où il s’était installé avec son épouse. C’était peu après leur mariage à Saint-Denis-du-Sig. Ahmed avait travaillé comme ouvrier dans les huileries Crespo quelques années, jusqu’à l’indépendance. Il avait vingt ans. Tous les jours il parcourait le trajet de Bethioua à Sig et retour dans un autocar TRCFA. Cette fois, pour faire découvrir Sig à son cousin Messaoud, à Denise et à leurs deux enfants, il accepta de s’installer lui-même au volant de sa R18. Ils entrèrent dans la ville par la route nationale 4 qui relie Oran à Alger — via Oued-Tlélat anciennement Sainte-Barbe-du-Tlelat — et qui traverse la ville. C’est une grande avenue garnie de palmiers des deux côtés. « C’était ça l’avenue Lamoricière », dit Ahmed à Denise en faisant un arc de cercle avec son bras. Denise hocha la tête, appréciant les dimensions de l’avenue. Ahmed gara sa Renault devant l’ancienne « cave Cano » derrière la mairie. « Le monument aux morts français de la guerre de 40 a été amputé de ses sculptures en bronze, mais l’obélisque est intact », dit-il. Ils installèrent la petite dans la poussette et entreprirent leur visite sommaire de la ville. Dans l’un des deux carrés couverts de plantes du grand square au milieu de la pincipale avenue, ils firent une halte pour les enfants. « À l’époque on l’appelait le square Charras ! » dit Ahmed. Denise se demanda si dans la voix d’Ahmed ne pointait pas un soupçon de nostalgie, puis elle se ressaisit « tout de même » rectifia-t-elle en elle-même. Sarah pleurait « elle a chaud » dit sa mère. « Moi je pleure pas », dit Yanis. Lui était en forme, il ne pleurait pas, mais il fallait bien le tenir par la main pour qu’il ne fasse pas de bêtise. Ils ralentirent le pas devant le collège à gauche « ici c’était l’école Dalera, pour les filles. De l’autre côté, il y avait l’école Mira pour les garçons musulmans ». Messaoud dit quelques mots en arabe qui firent rire Ahmed. « Encore un effort » semblait-il signifier à son cousin. Denise était impressionnée par le nombre de personnes qui déambulaient dans les rues. Sa grand-mère lui avait parlé d’un village, mais ce que Denise découvrait ne correspondait pas vraiment à ce qu’elle lui avait dit. Ce n’était plus un village, mais une ville. Une ruche. Les gandouras étaient noyées dans des habits ordinaires comme en France, et la misère étalée sur toutes les cartes postales coloniales dès lors qu’un visage autochtone y apparaissait — cela l’avait frappé — n’était que très relative. Elle s’en étonna. « Non y a plus la misère comme avant, ah non ! » s’exclama Ahmed presque vexé, « mais y a encore des pauvres bien sûr. » Ahmed lui indiqua du doigt un bâtiment entièrement recouvert de chaux. Il se dit que peut-être cela répondait à son interrogation sur les raisons de l’affluence « c’est le marché couvert ». Le mur était blanc, parcouru par deux longues bandes bleues parallèles. Au-dessus de la porte d’entrée, une horloge indiquait une heure fantaisiste. Ils le contournèrent, passèrent devant un grand enclos. Sur le fronton de l’immense porte, Denise lut « Huiles Crespo ». Une petite plaque accrochée sur le portail gris indique « entrée » et en arabe doukhoul,. Derrière, tendue au-dessus de la large allée principale de l’usine qui traverse deux séries de bâtiments, une grande banderole avertit « DÉFENSE DE FUMER ». Ahmed agitait ses mains, montrait le haut d’un bâtiment, murmurait à son jeune cousin quelques-uns de ses exploits, professionnels certainement. Non loin, un jeune homme était assis sur un cageot, devant une carriole. Il vendait toutes sortes d’objets utilitaires, des chaussures, des casseroles, des couteaux, et même des jouets… La rue devant eux sur la droite constitue la partie nord de la rue Voltaire avec au fond l’ancienne mosquée. « Nous voici devant le cher numéro 16 ! » dit Ahmed en regardant Denise. Le numéro 16 est une petite bâtisse orange de deux étages. C’est là qu’habitaient les grands-parents de Denise. Elle ne se souvenait pas du niveau. « Merci Ahmed » fit-elle. Il hocha la tête et murmura « eh oui ! » Que pouvait-il dire d’autre ? Puis il se recula, fit deux pas de côté. Denise fixait le mur décrépi. Le bâtiment était dans son ensemble sérieusement dégradé. La couleur était plus proche de la coque rouillée d’un navire ou d’une algue morte que de la peau d’une orange de Barigou, Perregaux. Messaoud se tenait lui aussi un peu à l’écart avec les enfants, Sarah dormait dans la poussette. Denise eut une pensée pour son grand-père, le rémouleur et son oncle mort à six ans. Amar et son fils François venaient de chez le marchand de lait, lorsqu’ils furent projetés par la puissance d’un souffle de l’autre côté du trottoir. Plusieurs bombes allemandes pulvérisèrent la façade de l’immeuble devant lequel ils passaient. Les blocs de pierre et les éclats de verre qu’ils reçurent ne leur laissèrent aucune chance. Ahmed prit plusieurs photos de la famille devant le bâtiment, puis celui-ci seul. Un peu plus loin, sur un grand portail à côté d’une belle construction de deux étages toute blanche, on avait dessiné à la craie blanche, rouge et verte, une tête sans oreilles ni nez. Un demi-cercle représentait la bouche. Un tronc et deux grandes jambes approximatives complétaient la silhouette. Un jeune garçon jonglant avec un ballon sous le drapeau algérien. Ahmed dit à Denise et Messaoud « ici c’était le cinéma l’Empire ». « C’est le ballon ? » demanda Yanis. « Une partie a été transformée en club de judo, l’autre est délabrée, continua Ahmed. L’Empire et Le Century étaient les seuls cinémas de la ville. Le second a été complètement rasé. Il n’y a plus de cinéma à Sig. À l’époque j’avais vu Les travaux d’Hercule avec Steve Reeves et Les dix commandements avec Yul Brynner et Charlton Heston ! » se souvenait-il… Yanis avait gardé le bras tendu, vers le dessin et répéta « c’est le ballon ? » « Oui c’est un ballon » dit son père. Denise était dépaysée, mais à Sig comme à Oran elle reconnaissait les monuments et places que lui avait décrits sa mère, Ginette, et plus encore sa grand-mère Françoise Chevalier. En traversant la rue, en face de L’Empire ils longèrent le long mur de l’hospice, toujours en fonctionnement. La longue rue est agrémentée de part et d’autre d’arbres à petites boules comme il y en a partout, à Arzew, à Oran, à Mers-El-Kébir… « ah je me souviens bien des boulettes qu’on se lançait à la figure ! » s’exclama Ahmed. Les ficus saturaient les rues. Il ajouta : « et voilà ! » en arrivant devant la voiture. « Vous connaissez la clouterie ? je vais vous y emmener. » Ahmed tint à leur montrer cet autre « monument » de Sig avant de rejoindre Bethioua. Ils n’en virent que le mur dégradé par le temps et le laisser-aller. Messaoud lut à haute voix l’inscription encore lisible « Tréfilerie de Sig », mais s’épargna de lire le numéro de téléphone qui suivait, auquel manquait d’ailleurs des chiffres. L’usine semblait abandonnée. Le long du mur, une ribambelle de gamins courait, chahutait. Denise lova dans ses bras Sarah qui commençait à manifester son mécontentement.
Il est tard ou tôt le matin, le jour bascula du samedi au dimanche. Yanis et Sarah sont réveillés. Ils pleurent de fatigue ou de soif. Baschung, Guy Bedos, Téléphone, Lavilliers, Djurdjura, JJ Goldman, Indochine… se produisirent, d’autres viendront, mais la famille El-Bethioui est épuisée.
Le correspondant de France2, en direct du quartier général de Jacques Chirac, rapporte que « le candidat à l’élection présidentielle a exprimé son indignation et sa consternation devant un geste sauvage qui semble être de nature raciste ». Messaoud hausse les épaules. Ce matin, peu après que le cortège du Front national s’ébranla, trois hommes le quittèrent pour se diriger vers le quai de la Seine, à hauteur du pont du Carrousel. Les trois manifestants marchaient vite en criant et en gesticulant. Ils avaient le crâne rasé. Brusquement, dans un même élan, ils se jetèrent sur un homme en l’insultant, avant de le pousser dans les eaux du fleuve. Brahim Bouarram fut englouti par un tourbillon dans les minutes qui suivirent. Les hommes politiques parlent beaucoup, se dit Messaoud dont la pensée le renvoya à un autre crime celui d’un autre Maghrébin, Imad Bouhoud, jeté dans le port du havre par des Skinheads, treize jours plus tôt, dans la nuit du 18 au 19 avril. Le meurtre avait été lui aussi fermement condamné par les politiciens. Messaoud ne comprend pas cette haine contre les Arabes, incrustée dans le cœur de la société française. Il y a quelques mois, deux autres furent abattus, l’un à Cherbourg, l’autre à Bayonne. Un autre encore à Saint-Étienne par un homme « excédé par les Arabes ». Messaoud pense à tous ces basanés comme lui, tués parce que leur peau n’était pas blanche. Il pense à Mabrouck Merabet abattu à Arandon, par un patron de bistrot sympathisant du F.N. Il pense à Mohamed Bouchfany, à Senoussi Bouchiba tué par trois parachutistes, à Abdel Abenis tué pour une cigarette, à Abdel Benyahia. Il pense à Omar Messaoudi, tué à St-Ambroix et à Mohamed Boussoualem. La liste est longue, très longue. En décembre 1988, Abdelkader Aouane et Abdelkader Belgourari, pensaient trouver un havre de paix à Paris eux qui fuyaient l’Algérie submergée par un profond désordre. Là-bas le parti unique était détesté par toute la jeunesse. Son siège et tous ses bureaux régionaux furent incendiés, saccagés. Les deux Algériens furent « tirés comme des lapins » le lendemain de leur arrivée, dans la plus belle avenue de la plus belle ville du monde. Messaoud se souvient bien de ce drame. Trois mois auparavant, le premier week-end de juillet, lui et sa famille abandonnaient leur deux-pièces cuisine de Montfermeil pour emménager dans une HLM plus spacieuse à Clichy-sous-Bois, au 5 rue Hector Berlioz. « Tirés comme des lapins » pleurait une jeune femme devant les caméras, bouleversée. Messaoud s’en souvient bien.
Le logement de Montfermeil était trop exigu pour sa famille, désormais constituée de cinq membres avec la naissance de Omar l’année précédente. Leurs multiples relances aboutirent enfin. Messaoud se souvient également du samedi suivant leur déménagement, le 9 juillet. Lui, Denise et leurs enfants partageaient le couscous offert par Hadj à l’occasion de son mariage avec Évelyne, une fille de Sevran de mère alsacienne et de père Kabyle. Le père fut longtemps ouvrier chez Renault. Son teint nordique Évelyne ne le lui doit certainement pas. Le mariage se déroula derrière l’Église de Pantin, dans un restaurant kabyle que Akli Tigzirt, le père d’Évelyne, avait proposé, il connaît le patron. Tous les amis et collègues qui le pouvaient se retrouvèrent au Jugurtha. Les parents d’Évelyne étaient présents bien sûr. La famille El-Bethioui ne reçut jamais autant de coups de téléphone du bled comme ce soir-là, d’Oran, de Bethioua, de Bejaïa, d’Alger… On chanta et dansa sur Zwit rwit, Netsargou, Saga Africa, et aussi sur I will always love you… Messaoud est complètement absorbé par ses pensées. La télévision débite images et commentaires qu’il ne voit ni n’entend. Il en est loin. Rayan, l’ami d’enfance qui était en vacances à cette période, fut invité « naturellement » au mariage. Rayan occupe la fonction de cadre dans les ressources humaines à Sonatrach (comme Larbi, l’oncle maternel des El-Bethioui, mais pas dans le même département). Les Algériens disent « la grande mamelle » pour désigner Sonatrach, la plus importante entreprise du pays. Il y avait aussi Razi qui était revenu à Paris sans Katia qui le quitta pour un jeune homme de son âge. « C’est mieux comme ça » lui dit Messaoud qui toujours lui signifia son désaccord, même si ça ne le regardait pas. Dès qu’il en avait l’occasion, il lui renouvelait son reproche « la fille est trop jeune », ou « ça ne fait pas sérieux »… Le lendemain du mariage, tous les six, Hadj, Messaoud, leurs épouses, Rayan et Razi se retrouvaient au Pont tournant, chez Aïcha El-Djenia, sans les enfants, gardés par une voisine de palier. Le Pont tournant est un lieu que le Tout-Paris des Oranais affectionne. C’est un souk, une gare, un port. Un havre de rencontres, d’échanges de nouvelles, un monument. Pourtant le Pont tournant est un lieu ridicule dans son expression métrique. Il se trouve sur le quai de Jemmapes à Paris, à l’angle de la rue des Écluses. Sa surface est si réduite que dès qu’on atteint vingt-sept clients, généralement le samedi soir — quinze au rez-de-chaussée (six accoudés au comptoir et neuf en salle) et douze au premier (trois petites tables) —, il affiche complet, mais on se pousse toujours pour le dernier arrivé. Ce soir-là, il y avait peu de monde. Autant le samedi soir il est souvent bondé, autant le dimanche il est vide aux deux tiers. Le Pont tournant est réputé pour son couscous. C’est Aïcha El-Djenia elle-même qui le prépare. Un couscous fin à l’agneau. Plus on en prend, plus on en veut. Ce soir-là, ils s’offrirent « un couscous pour six » dans le réduit du premier étage. Quelques jours après, les mêmes se retrouvaient à Clichy-sous-Bois. C’est dans l’appartement de la rue Berlioz que naîtra deux années plus tard, le 13 juillet 1990, le quatrième enfant de Denise et Messaoud, Larbi-Carl. Deux prénoms pour deux familles. Le père avait choisi comme prénom à son fils, Larbi. Denise trouvait ce prénom, plus que ceux de ses autres enfants, trop marqué. Elle était réticente « mes parents, ma mère surtout » disait-elle… Elle insistait pour en choisir un autre, mais Messaoud tenait par-dessus tout à rendre hommage à Si-Larbi son oncle maternel de Sonatrach mort quelques mois plus tôt et auquel il était très attaché. Lorsque Denise proposa alors d’ajouter un second prénom à leur enfant, Messaoud n’y vit pas d’inconvénient. Ils en parlèrent néanmoins dès le mois de mai, elle était à son septième mois de grossesse. Les semaines passèrent. Larbi-Carl les séduisit l’un et l’autre. L’oncle Si-Larbi décéda le jour même de la disparition de Greta Garbo (il l’appelait « La Divine Karénine »). Elle était actrice à la renommée universelle et les journaux du monde entier lui rendirent un hommage appuyé. Si-Larbi était responsable, presque anonyme, parmi les mille deux cents salariés de GL1, l’usine de liquéfaction de gaz, à l’est d’Arzew. Il venait de lancer une feuille culturelle, « Carrefour 31 ». Le quotidien d’État El Moudjahid lui réserva quelques lignes le 4 avril sur le mode ironique : « un groupe de jeunes Oranais en mal de communication… » Quelques lignes que Si-Larbi n’avait pas appréciées « communication, tu parles ! » C’était la seule fois où l’on parla de Si-Larbi dans un journal. Depuis l’effervescence qui suivit octobre 88, il ne pensait qu’à une chose : créer sa propre revue. Si-Larbi mourut d’une crise cardiaque, à 45 ans, le dimanche 15 avril, deux semaines après avoir créé son périodique qui ne mentionnait même pas son nom.
Des cris de femmes sortirent Messaoud de ses pensées. C’est dans le journal télévisé. On les entend crier « roddoulna wledna ! » Une poignée de vieilles femmes voilées scandent « Rendez-nous nos enfants, Vérité et Justice ! » Le correspondant de France2 à Alger dit qu’il s’agit de mères de disparus forcés, des « folles d’Alger » qui manifestent autour de la place du 1er Mai, ignorées par le cortège officiel des marcheurs exhibant pancartes syndicales et portraits du président, heureux d’exprimer leur bonheur devant les nombreuses caméras tournées vers eux. Certaines mères portent des écriteaux sur lesquels on peut lire le nom, l’âge, parfois la fonction de leur proche enlevé ainsi que la date de son enlèvement ou le nombre de jours passés depuis sa disparition.
« Amine Zellag
né le 5/07/1981
enlevé le 17/10/1993
560 jours »
À la fin du journal, Messaoud appuie sur la télécommande pour regarder sur La Sept-Arte un documentaire consacré au monde ouvrier, et à sa suite le film Les temps modernes, pour oublier ce macabre premier mai.
Depuis son retour à Paris, Charly ne manque pas de se rendre de temps à autre au Select où il s’installe sur la terrasse. Cela lui rappelle les beaux moments qu’il y passa avec Erzebeth et d’autres camarades du CLESS et du Betar. Il ouvre Valeurs Actuelles et commande une Mort subite « mûrie en fûts de chêne ». Charly aime son goût aigre, presque désagréable. Dans l’air qu’il hume, il décèle — croit-il — un reste de fumée Royal Menthol auquel se mélangent des parfums qu’on lui dira venus de fleurs suspendues sur des balcons de la rue Peggy ou Vavin. Le journal titre en page intérieure : « Les examens génétiques pratiqués sur la dépouille d’Yves Montand sont négatifs, l’acteur n’est pas le père d’Aurore. » Les parents de Charly le reçurent comme il se doit. Sa mère ne changea pas trop. Son père ne travaille plus depuis quatre ans, alors il passe son temps au PMU à parier sur des chevaux qu’il connaît mieux que ses enfants : Varenne, Écho, Zoogin, Draga, Fleuron Perrine… sa sœur Yvette se maria alors qu’il baroudait la nuit et instruisait le jour en Colombie. Elle réside à Rambouillet avec son mari et leurs deux enfants. Charly ne les rencontra pas encore « Il faudrait quand même que j’aille les voir » se dit-il, lorsqu’il lui arrive de penser à eux. Son frère, Yacoub, émigra aux États-Unis depuis une dizaine d’années. Il se manifeste très peu. On sait seulement qu’il intégra le monde associatif, qu’il est marié à une journaliste afro-américaine et, comme elle, il est un ardent défenseur des droits humains. Il est l’ami des pauvres et des opprimés en général. Lorsque sa mère lui donna cette nouvelle, Charly se contenta de hausser les épaules et de dire « n’importe quoi ». Il sembla à sa mère qu’il ajouta entre ses dents « pff ! » et qu’il haussa de nouveau les épaules.
Le personnel du Select a changé, pas l’ambiance. Les grandes salles sont toujours agréables à voir, la colonne fleurie aussi. Et les grandes peintures. Les parfums qu’exhalent les pétunias blancs, chèvrefeuille, jasmins rouges… aux abords de la brasserie le remplissent d’une nostalgie qu’il ne retrouve qu’ici. Des groupes, habillés aux couleurs du drapeau de leur pays se croisent. Ils chantent et boivent. Des couples, supporters des « bleus et blancs » argentins, exécutent maladroitement des pas de danse, pas argentins du tout, entre les tables. Leur équipe écrasa la Jamaïque 5 buts à 0. Charly termina son article. Il l’enverra à Talpiot avant 20 h 30 — il sera une heure de plus en Israël. Il a un peu de marge. Ce travail de pigiste c’est son ancien chef militaire, Amoq Shahak qui deviendra plus tard son ami, qui le lui trouva lorsque le centre de formation de mercenaires de Gvulot fut fermé. Il lui avait demandé de choisir de travailler dans un journal ou bien dans une entreprise d’export. Car après l’hécatombe de Beyrouth, Charly ne revint pas à Paris. Il fit le choix de rester en Israël. La France, RTL, pensait-il alors, étaient loin, si loin qu’il ne daigna pas écrire à ses employeurs pour leur expliquer sa situation. Ses proches réprouvèrent son comportement, mais leurs arguments et la déception de Jacques Doinas comptaient si peu à ses yeux. Il travailla quelques années dans une filiale de Kidon, une société de sécurité et d’exportation d’armes qu’avait montée Yaïr Klec, un ancien parachutiste, en collaboration avec trois officiers de réserve. C’était déjà Amoq Shahak qui l’avait introduit auprès de Yaïr. Lorsqu’après des années de loyaux services, le patron lui proposa de le suivre en Colombie, Charly n’hésita pas une seconde. Il était persuadé que dans un pays où règnent le filoutage, la force et la combine, il y aurait plus de mouvement et il serait beaucoup mieux récompensé. Compte tenu du climat général, des activités passées et de celles à venir, Yaïr voulait que Charly change de nom. « C’est tout trouvé, répondit celui-ci du tac au tac : « Charly Klein, je garde cette identité ». Celle-là même qu’il s’était forgée dans cette région où personne ou presque personne ne connaissait Mimoun Pinto, hormis les camarades des années soixante qui habitaient à Ashdod. Charly n’était pas sûr qu’ils y vivaient encore. D’autres, très peu nombreux, l’appelaient « le journaliste », Yaïr ne révéla pas à Charly le contenu des missions qui l’attendaient en Colombie, se contentant de répéter « l’ombre sera ton domaine » par exemple, ou bien « ce sera cool tu verras. » Il fallait néanmoins, pour répondre à l’officiel cahier des charges, que les quinze personnes retenues suivent une formation. Elle se déroula pendant trois jours au David intercontinental de Tel-Aviv, la semaine du départ pour Bogota, entre salle de cours théoriques et salle de sport, rideaux, fenêtres et portes fermés.
Parmi les activités développées en Colombie, l’équipe de Yaïr Klec avait en charge l’apprentissage du maniement des explosifs, des armes de guerre et du matériel d’espionnage. La brochure de Kidon ne le précisait pas. Charly fit donc partie d’une équipe de mercenaires qui formait notamment des forces paramilitaires. Tous les membres savaient que les intérêts des différents groupes colombiens et autres se chevauchaient parfois. Ils savaient également que ces groupes ne faisaient et ne se faisaient ni révérence ni cadeau. Mais aux uns comme aux autres, ils leur montraient l’intérêt qu’ils avaient à se ménager. Le centre principal était stationné à Puerto Boyaca, à l’est de Medellín, dans un territoire contrôlé par le cartel de la drogue. Une autre équipe israélienne installée, disait-on, à Los Sonrisas, sur le Rio Magdalena, avait pour mission de fournir des pistolets mitrailleurs, des fusils d’assaut et des pistolets semi-automatiques, fabriqués par IMC–Israël military companies. Les différentes troupes, forcées de se tolérer pour l’apparence et le bon fonctionnement de la formation, agissaient beaucoup dans l’ombre, en relation avec des groupes externes dont certains travaillaient plus ou moins directement au profit du gouvernement colombien. Au fil des événements économico-politiques, et compte tenu des impératifs, des immixtions, des visées souvent opposées, et des rapports de forces fluctuants, la situation se dégrada. De plus en plus d’articles mettaient en cause les Israéliens, particulièrement Yaïr, dans de nombreuses affaires liées au trafic de drogue, à la corruption et aux assassinats ciblés. Sur la foi d’un rapport du DAS — département administratif de sécurité, le service colombien de renseignement — l’hebdomadaire Semana avait, dans une de ses éditions de septembre 1989, accusé Yaïr Klec d’être derrière l’assassinat de Luis Carlos Galan candidat à l’élection présidentielle. Pour Yaïr le point critique était atteint. Il ne pouvait plus rester en Colombie ni dans aucun autre pays d’Amérique. En moins d’une année, tout le personnel de Kidon et ses filiales enfourcha le pas au principal responsable dont on perdit la trace du jour au lendemain. Fuir était le mot que tous les Israéliens et leurs collaborateurs avaient le plus partagé, et celui dont ils avaient le plus mesuré les conséquences pendant la débandade, avec un autre terme de même importance : détruire. Ils allumèrent autant de feux de joie qu’ils purent avec tous les dossiers en cours ou archivés. La plupart des mercenaires se retrouvèrent de l’autre côté de l’océan, au cœur de la toile brune, en Israël. Avec l’aide d’anciens gradés de Tsahal à la retraite, Yaïr reconstitua un centre de formation de mercenaires. L’école fut montée dans le désert du Néguev, à Gvulot, à proximité de la station d’écoute 8200 de la base militaire Tze-elim, et discrètement en collaboration avec ses dirigeants. Comme la base militaire, l’école était entourée d’un mur orné aux angles de miradors, surmonté de barbelés et fendu tous les cinq mètres d’une meurtrière. D’impressionnantes antennes paraboliques, identiques à celles de la base, étaient fixées sur son toit. La majorité des paramilitaires Colombiens y parachevèrent leur formation notamment en suivant le fameux cours 666 sur les intérêts géostratégiques, sur la mondialisation des armes, sur les antagonismes civilisationnels… Ce cours était dispensé deux fois par semaine, deux autres séances étaient réservées aux armes tandis que les six autres plages horaires étaient destinées aux techniques de combat comme le CAC, combat au corps à corps ou le Krav–maga et même aux PPMON, pressions physiques modérées ou non. Les mercenaires n’étaient pas des enfants de chœur. Ils avaient quartier libre la journée du samedi, l’après-midi du mercredi et la matinée du dimanche. « J’ai appris beaucoup en Israël. Je dois beaucoup à ce pays » écrit dans son autobiographie Castano celui-là même qui fut tenu pour responsable de l’attentat contre un avion de la compagnie Avianca qui avait fait plus de cent morts. La bombe à l’origine de l’explosion de l’avion fut déclenchée par un altimètre, « la bomba fue activada por un altímetro ». Un exercice plusieurs fois simulé durant les formations que prodiguaient les Israéliens notamment à Puerto Boyoca. Charly continua quatre années avant d’être licencié. L’école du Néguev ne disposait plus suffisamment de finances, disait-on contre toute évidence. Ses effectifs furent alors, au titre de ce motif avancé, réduits de moitié.
Pendant toute cette période, Charly avait su consolider son réseau de connaissances éparpillées dans le pays. Il pensait pouvoir l’actionner sans difficulté le moment venu. Pour réintégrer le monde normal, il s’adressa de nouveau à son vieil ami Amoq qui lui proposa de choisir entre un emploi dans une entreprise d’export ou dans l’information. Charly mit en avant son expérience française et choisit le second. Journaliste. Depuis, il travaille dans un hebdomadaire francophone du quartier de Talpiot à Jérusalem.
Le responsable lui confia cinq à sept mille signes chaque semaine qu’il consacrait à un aspect de la ville, touristique, historique, archéologique… Au fil du temps il se constitua une impressionnante documentation. De mois en mois son intuition alimentait sa conviction, la renforçait : « Yerushaláyim est gravement menacée », c’est pourquoi il décida de lui dédier un essai. « Le cœur pur du monde, Yerushaláyim, ville de la paix terrestre, ville de la paix céleste mon joyau, est en proie à des hordes déferlant du sud et de l’est… Bénie soit la ville de Meir Kahane et de Baruch Goldstein. Préservée soit ma ville de l’impureté des Arabes et des Falashas. » Il en avait achevé le premier chapitre en moins d’un mois. Charly a un but dont il avait fixé les contours depuis longtemps, depuis bien avant Sabra, bien avant Chatila.
Sa Yerushaláyim est trapue. Sa couleur brune est celle d’une meute de hyènes inassouvies. Son plaidoyer Charly l’alimentait avec ces lignes de Gérard de Nerval : « À la tête du cortège, qui parcourait lentement les rues de Jérusalem, il y avait quarante-deux tympanons faisant entendre le roulement du tonnerre ; derrière eux venaient les musiciens vêtus de robes blanches et dirigés par Asaph et Idithme ; cinquante-six cymbaliers, vingt-huit flûtistes, autant de psaltérions, et des joueurs de cithare, sans oublier les trompettes, instrument que Gédéon avait mis jadis à la mode sous les remparts de Jéricho. Arrivaient ensuite, sur un triple rang, les thuriféraires, qui, marchant à reculons, balançaient dans les airs leurs encensoirs, où fumaient les parfums du Yémen. » Puis Charly se vit confier d’autres articles sur les relations internationales, notamment franco-israéliennes, sur la vie mondaine à Paris et le sport, particulièrement le football. Il les signe invariablement « C. Klein ». Le football est ce qui le détend le plus, pas en le pratiquant, mais comme supporter ou observateur. Le premier article qu’il écrivit sur le football portait sur le match de qualification à la coupe du monde qui opposait Israël à la Russie. C’était il y a deux ans à Tel-Aviv. Match nul : 1-1. L’année dernière il couvrit le match retour à Moscou où Israël fut défait 2-0. Israël finit troisième au classement et fut par conséquent éliminé. (L’IFA, la fédération israélienne de football tenta de déposer un recours pour cause de « buts injustement accordés aux adversaires », mais les juges internationaux furent unanimes et catégoriques « Le règlement s’applique à tous identiquement, aucune connivence ne peut être tolérée, quel que soit le pays. »)
Au Select le tohu-bohu des Argentins va crescendo entraînant les plus sceptiques des clients dans leur euphorie. Charly finit sa bière et son article. Le premier jet, axé sur les matches du jour, il le déchira et le glissa dans la poche de sa veste. Il préféra détailler l’ambiance qui règne dans les rues en fête de Paris. Maintenant il est temps pour lui de rentrer chez ses parents pour l’envoyer par l’Internet via Infonie. Sur le boulevard Montparnasse, le solstice d’été et des supporters des équipes d’Allemagne, de Yougoslavie et d’Argentine se donnèrent rendez-vous et le soleil peine à plonger de l’autre côté du monde. Charly se dirige vers le métro Montparnasse, poursuivi par un tintamarre de klaxons, de chants et toutes sortes d’instruments réunis, tablas, timbales et trombones. Il prendra la ligne d’Aubervilliers, puis la 3. Peut-être pense-t-il à modifier une dernière fois son article avant de l’envoyer à Jérusalem — qu’il ne prononce jamais, même devant des francophones, qu’en hébreu, Yerushaláyim. Cette ville le subjugue. Il la connaît moins que Paris cette « mère des villes », dit-il, mais il l’aime par devoir, comme nulle autre ville. Par quelque bout qu’il les prenne, les questions le renvoient à elle. Il lui arriva plus d’une fois de rentrer chez lui à pied en quittant le journal. Il remonte entièrement la rue d’Hébron, traverse la vieille ville jusqu’à la porte de Jaffa. Il lui suffit alors de traverser le Mamilla center pour accéder au 8 King David.
Valeurs Actuelles sous le bras, il traverse le boulevard du Montparnasse, passe La Coupole, les bruits s’estompent, il ne les entend plus. Le voilà sous la Porte de Sion, il longe les remparts à droite en direction du Mur des lamentations, évite là-bas la Mosquée Al Aqsa qu’il se défend de regarder. En chemin, dans le quartier juif il achète une kippa Chelsea « hand made ». Il arrive devant le Mur. Il bouscule un photographe qui prend sa petite amie en photo de l’autre côté de la barrière, côté femmes. Sur un écriteau accroché à une grille, un appareil photo noir est représenté, barré d’une oblique de même couleur. Dans l’interstice de deux blocs de pierre à la mémoire silencieuse, il glisse des vœux en psalmodiant. Une dame qui l’évite de justesse à l’angle de la rue du Montparnasse, lui lance « non, mais !… » La circulation redevient intense, assourdissante. Charly prend à gauche l’étroite rue. À la crêperie bretonne, il commande une galette de blé noir. Il poursuit sa promenade dans la vieille ville, passe devant des magasins de poterie et des vendeurs de tissus sur la via Dolorosa. Devant la mosquée Omar El-Khattab il accélère le pas, contourne le Saint Sépulcre, passe sous une voûte, dévale les 38 ou 52 marches jusqu’à la plateforme. Il se prosterne devant la statue de David dans une ruelle adjacente. Dans le souq Eddabbagha, avant de sortir par la Porte de Jaffa, il achète une baklawa qu’aussitôt goûtée il jette à terre. Il demande un jus de grenadine qu’il ne boit pas, trop amer le jus ou lui-même est-il malade. Étrange, pense-t-il. Il traverse le Mall Manilla pour se retrouver de l’autre côté, sur l’avenue King David. Il relève la tête, crache et prononce une injure devant ce qui fut l’entrée de l’immeuble où résida monsieur Sartre, au 29 de l’avenue Edgard Quinet. Il n’a plus qu’à traverser pour prendre le métro.
Kada se laisse tomber sur le canapé, « Allah ya rabbi ». Il donne quelques coups avec sa main contre le similicuir et dit « viens mon fils, viens. » Il est un peu excité. Il semble joyeux. Larbi aime beaucoup son grand-père, Jeddi. Il l’aime comme on aime un être qui remplit vos attentes et vos manques, un père Noël en quelque sorte comme on aimerait qu’il soit. Tout le monde ou presque l’appelle Jeddi, même Denise. C’est la première fois que Kada se retrouve en France depuis son départ définitif pour l’Algérie, il y a vingt-trois ans et demi. « Ya Rabcomme le temps passe ! » La famille de Clichy s’était rendue en force à l’aéroport le onze novembre pour l’accueillir. Lors des retrouvailles, nul ne pouvait dire qui de lui ou des enfants était le plus ému. On s’embrassait à n’en plus finir, comme là-bas. Kada était sidéré par les changements opérés ! Les routes décuplèrent, elles sont larges, les quartiers sont des fourmilières, les panneaux de publicité, posés jadis au hasard des poteaux, sont plus nombreux, plus grands et très agressifs, et les gens très pressés. Et ces innombrables voitures où vont-elles ? « ah, le froid c’est toujours pareil ! » Sans savoir pourquoi, cette température de saison, toute cette atmosphère de fin d’année, les guirlandes, le pas vif des jeunes femmes, leur allure décidée, leurs vêtements chatoyants, tous ces changements, cette modernité, le revigorent, le rendent heureux. Tous ces militaires armés et bien visibles le sécurisent. Kada approuve toutes les mesures prises pour se prémunir contre les attentats. « Il faut défendre le pays contre les pirates ». Kada et Larbi échangèrent souvent au téléphone, mais ils ne s’étaient pas rencontrés. Il ne s’agit pas pour eux de retrouvailles, mais de découverte. Kada découvre aussi le logement du Stamu situé au 2 allée Jules Massenet. La résidence se trouve juste derrière la supérette, à moins de 500 mètres de l’appartement de la rue Berlioz que Denise, Messaoud et leurs enfants occupèrent jusqu’en septembre 1997, avant d’emménager dans ce quatre pièces. Dans le trois pièces de la rue Berlioz, les enfants grandissant, la vie devenait difficile et les petits trop turbulents. Sarah ne supportait plus les braillements du petit Larbi ni Yanis ceux de Omar. Pour Yanis qui allait entrer en janvier 1998 dans le premier mois de ses 18 ans, l’urgence d’un logement plus grand s’imposait. Sarah quant à elle allait vers ses quatorze ans. Dans le nouvel appartement, les deux grands ont chacun leur chambre. « Viens mon garçon » dit Kada à Larbi « quel grand garçon, tu es presque aussi grand que moi ! » Lorsqu’il sourit, ses petits yeux rieurs et plus encore la petite moustache carrée, posée comme un sparadrap noir, le font ressembler au jeune Charlie Chaplin. Kada est un homme profondément bon, certainement pas un guignol, ni même un comédien. En guise de cadeau pour son quatre-vingtième anniversaire, le chef de service de la Caisse de retraite de Nanterre lui adressa un courrier dans lequel il lui réclame un certificat de vie « complété par l’autorité compétente de votre pays » afin de continuer à lui verser sa retraite en Algérie. Kada se dit qu’il n’y a pas meilleure preuve de vie que de se présenter en chair et en os à ce chef de service pointilleux. Et puis c’était une occasion de revoir ses enfants et petits-enfants. La caisse de retraite de Nanterre il compte s’y déplacer au début du mois de janvier. « Pourquoi tu n’ouvres pas un compte bancaire ici, c’est mieux pour toi » lui avait demandé Messaoud. Il y songera lui répondit-il, « après, après ». Larbi met sa PlayStation en mode pause, car il voit bien que son grand-père désire lui parler. Les parents n’allaient pas tarder à rentrer. Larbi devine des mots sur les lèvres de son grand-père même s’il ne les entend pas encore. « Merci Jeddi » lui dit-il en souriant. Larbi sourit souvent, sans qu’il y ait motif à sourire. Il n’est pas sot pour autant, simplement sa bonne humeur naturelle illumine son visage joufflu, et fait scintiller son iris. Sa gentillesse saute aux yeux sans qu’il fasse quelque effort que ce soit. La veille, à l’occasion de la fête de l’aïd, Kada lui offrit un billet de cent francs. Son jeu donnait des signes d’essoufflement. Larbi se disait qu’il avait bien fait de commander au père Noël une PlayStation 2 avec deux manettes. Larbi dit « père Noël » comme tout le monde, mais il n’y croit pas. « J’suis pas un bébé », mais il tient aux jeux. Il sait que père Noël c’est père Darty d’une certaine manière. Il entend Jeddi murmurer et le voit agiter ses bras. Kada répète « Yakhi ness, yakhi, mais quelles gens mon fils, quelles gens » en se tournant vers lui. Larbi abandonne sa console, car Kada répète plusieurs fois les mêmes mots. Il les répète jusqu’à ce que son petit-fils concède de lui prêter plus d’attention. Larbi appuie sur la poignée, éteint son jeu, parce que c’est son grand-père. Il n’agirait pas ainsi, ne lâcherait pas sa manette si à la place de Jeddi se tenaient ses frères, son père ou sa mère. Il se lève et va s’asseoir à côté de lui. « Écoute mon fils », crie Kada. À son âge il n’entend pas bien. C’est pourquoi il parle fort. C’est une habitude. Kada dit encore « Yakhi ness yakhi ». Depuis qu’il est chez ses enfants, Kada prit l’habitude de marcher dans la ville. Il fait souvent la même grande boucle, une heure de marche, vers 13 ou 14 h, avant la sieste, même si ramadan finit par laisser des traces. Marcher lui fait du bien. Là-bas au bled, il marche tout le temps, pour un oui ou pour un non, il s’invente des rendez-vous chez le cafetier, avec un ami, prend prétexte d’un achat quelconque, une baguette, une limonade. Ça le défoule et le rend de bonne humeur. Samedi c’était le dernier jour de jeûne. Le lendemain matin on s’embrassait à tour de bras. Jeddi décerna à Sarah le titre de Cordon bleu pour son savoir-faire et son dévouement, malgré l’examen de fin d’année. Sarah fut parfaite durant tout le mois sacré. Elle porte autour du cou un pendentif en argent assez semblable à celui que porte sa mère. Il représente une lune et une étoile à cinq branches. C’est Kada qui le lui apporta du pays. Dimanche on s’embrassait partout. À Clichy-sous-Bois nombreux sont les résidents qui pratiquent la religion avec pour nombre d’entre eux, les « 40-60 ans », des accommodements bien pratiques. Les jeunes sont plutôt intransigeants. Ambiance du bled. Jeddi était allé tôt faire la prière à la grande mosquée de Paris avec ses amis Da Mahmoud et Lakhdar. Da Mahmoud n’est pas un inconditionnel de la mosquée, Lakhdar n’en est pas un passionné lui non plus, mais le jour de l’aïd c’est un peu exceptionnel. Il y a des mosquées tout autour des cités, mais aucun des trois amis ne les fréquente ni les apprécie, bezzaf boulitique. La mosquée de Paris est plus tolérante, « c’est la mère de toutes les mosquées » aime à dire Jeddi. Kada connaît Da Mahmoud depuis de nombreuses années. Nanterre est un de leurs points cardinaux. Souvent dans leurs discussions ils y reviennent, à la ville et ses bidonvilles, à cette période de guerre et à la haine qu’elle charria. Ils en parleraient des heures sans discontinuer. Da Mahmoud y passa une partie de sa jeunesse avant de s’installer à Barbès. Da Mahmoud est originaire de Ivarvachen, un tout petit village kabyle au sud de Bejaïa, loin de Béni Yenni. Dans les années cinquante, lui aussi habitait dans un camp de Nanterre. Da Mahmoud est beaucoup plus jeune que Kada, pas plus grand de taille, mais plus jeune et plus bedonnant du ventre. La casquette collée à sa tête cache une calvitie et une intégrité morale totales. Lakhdar par contre est élancé. Il mesure plus de 1,80 m. On ne le voit jamais autrement qu’en costume-cravate. « Vous faites bien jeune », ou « vous ne faites pas votre âge », lui disent souvent les gens, les femmes surtout, même si personne ne sait en quelle année il naquit. On sait seulement qu’il est de Mostaganem, qu’il y grandit et fit ses études jusqu’au baccalauréat, mais nul ne s’aventurerait à donner son année de naissance et moins encore la date précise. Après la prière, ils prirent un thé au salon de l’Institut de la mosquée, avant de revenir dans le 93. Ils firent le tour des connaissances et des proches pour leur souhaiter la bonne fête « Koul âm ouan’toum bkheir »… Lakhdar est proche de Da Mahmoud. C’est lui, Da Mahmoud, qui le présenta à Kada. Tous les trois se rencontraient régulièrement à Barbès dans les années soixante-dix. Lakhdar venait d’arriver d’Oran. Les premières personnes dont il fit la connaissance, il les rencontra autour de la rue de la Charbonnière, de la rue de Chartres, dans le café Djurdjura où travaillait alors Da Mahmoud.
D’habitude, lors de ses promenades dans Clichy, Jeddi remonte l’allée Maurice Audin, puis l’avenue Salvador Allende. Systématiquement, lorsqu’il arrive sur l’allée Maurice Audin il s’immobilise une ou deux minutes devant la plaque indiquant le nom de l’allée « Maurice Audin 1932-1957. Mathématicien. Membre du Parti communiste algérien. Militant de la cause anticolonialiste. » Puis il continue sa marche. Il passe ensuite devant la mairie, longe l’étang du parc et revient par le Chemin des postes. Parfois, pour une raison ou une autre, ou même sans raison, guidé par ses pas, il modifie complètement son parcours. Ce lundi, son ami lui demanda de l’accompagner jusqu’à la sous-préfecture du Raincy pour requérir un certificat de non-gage. Ils s’y rendirent en empruntant le 601. Puis, après qu’ils eurent récupéré le document, Da Mahmoud et Jeddi suivirent à pied l’avenue de la Résistance jusqu’à la gare du Raincy. Le plan Vigipirate est renforcé depuis le lendemain des attentats de New York, il y a trois mois. Les patrouilles militaires vont et viennent le long des quais de gares et alentour, dans les grandes avenues, les musées… Les villes sont quadrillées comme en temps de guerre. Mais tout cela ne semble pas indisposer Kada, d’ailleurs « complètement dépassé », c’est ce que lui fit observer son ami.
« Écoute-moi bien, dit Jeddi à son petit-fils, on était au Tabac de la gare. Il y avait peu de monde. Dans les tabacs, il y a généralement beaucoup de clients, il me semble, là, non. Deux hommes se tenaient derrière le comptoir. L’un s’occupait du tabac et l’autre avait la charge du bar et de la salle. À part Da Mahmoud et moi qui étions attablés, il y avait un groupe de cinq ou six personnes au bout du comptoir qui discutaient bruyamment en rigolant et en buvant des pintes de bière. On aurait dit à leur voix qu’ils se disputaient, mais ils riaient Il était trois heures et demie ou quatre heures et ils donnaient l’impression d’avoir tant bu. Nous avons commandé deux cafés, puis nous avons commencé, tu sais, comme les vieux. On raconte mille choses, souvent les mêmes et souvent aux mêmes personnes. On parlait comme ça, mais des mots lancés par le groupe arrivaient jusqu’à nous. Des mots dits avec un peu plus de conviction, de solennité que d’autres. Comment te dire. Comme avec insistance, comme pour attirer notre attention. Au bout d’un moment il nous a semblé qu’ils parlaient de nous indirectement. Puis nous en avons été certains. Les gens riaient de plus en plus fort et les allusions aux Maghrébins de plus en plus évidentes. On entendait voler des morceaux de phrases à propos de Tempête du désert, d’Afghanistan, des tours de New York, de ramadan, et même du prophète, salla Allah alih wa sellem, que la paix soit sur lui. Ils nous les envoyaient comme des missiles. De temps en temps le patron, c’est celui qui tient la caisse devant l’espace-tabac, nous regardait par en bas, de biais, du coin de l’œil. Pas franchement. Et il souriait, même s’il faisait comme s’il était un peu gêné. Alors, bon, on a quand même tendu un peu plus l’oreille. Ils n’arrêtaient pas de raconter des blagues en nous regardant et en riant de plus en plus fort. Attends, j’ai pas fini. Écoute-moi. Des racistes mon fils. ‘‘Qu’est-ce qu’ils reçoivent à Noël les enfants d’Arabes ? Des vélos volés hihi !’’ dit l’un, ou encore ‘‘Abdel, Omar et Momo sont dans un camion. Qui conduit ? La police haha !’’ dit un deuxième. Ils riaient aux larmes. Un autre continuait ‘‘qui court plus vite qu’un Arabe avec une télévision entre les mains ? Son fils avec la PlayStation haha !’’ Et d’autres blagues encore beaucoup plus offensantes qui ne visaient que les Maghrébins. Si seulement… On ne pouvait rester indifférents quoi ! ». Larbi tente de temps à autre de glisser une remarque, une protestation, une réplique. Lorsqu’il entend « PlayStation ! », il sursaute, mais Kada est lancé. Emporté par son dégoût et sa tristesse encore vivaces plusieurs heures après, il ne soupçonne pas, ne voit pas dans le regard de son petit-fils, dans le battement de ses bras, l’impatience qui le déstabilise. « Ou on partait ou on réagissait. On a préféré la plus sage des solutions à notre âge, on a décidé de partir. Nous avions payé et étions sur le point de quitter le bar. Au même moment un des types arrivait vers nous pendant que de l’extérieur un homme poussait la porte d’entrée, une armoire à glace. Il a regardé à droite puis à gauche comme s’il cherchait quelqu’un. Il s’est tourné vers nous et son regard s’est posé sur Da Mahmoud. Il a dit, surpris, ‘‘ah, ammi Mahmoud !’’ Moi je tenais la porte ouverte. Le type m’a fait signe pour que je reste à l’intérieur, puis m’a tendu la main. ‘‘Alors tonton, comment vas-tu ?’’ il a dit cela à Da Mahmoud et il l’a embrassé, ‘‘bon aïd ammi’’. Le nouvel arrivant est un colosse, il doit avoir la quarantaine. Il a insisté pour nous offrir une boisson. On s’est mis au comptoir. Je n’oublie pas de te dire que dans le tabac un silence de nuit de désert a succédé à l’infernale effervescence qui s’alimentait de notre présence. Le type qui s’approchait de nous a entre-temps fait demi-tour pour regagner sa place. Je ne l’ai pas vu faire. Il était là et la minute qui a suivi, il s’est retrouvé là-bas. Da Mahmoud m’a présenté le gaillard. Il s’appelle Bachir, une de ses vieilles connaissances de l’époque où Da Mahmoud habitait Barbès. Bachir lui apportait chaque jour vers 4 h de l’après-midi ses beignets et son thé jusqu’à la chambre qu’il occupait dans un hôtel meublé de la rue de Chartres, avant de filer à l’entraînement. Bachir est un sportif. À l’époque il travaillait comme garçon de café, il avait un peu plus de quinze ans si j’ai bien entendu. Da Mahmoud ne portait ni casquette ni béret. L’évocation de ces souvenirs a bien fait rire les deux amis. C’était il y a vingt-cinq ans, et pourtant la mémoire de Da Mahmoud semblait plus alerte que celle de l’armoire à glace. Bachir a lancé au caissier ‘‘patron, un noir !’’ Les échanges étaient loin de l’aïd et de ramadan, mais ce n’était pas un problème. Puis Da Mahmoud évoqua les raisons de notre présence dans le coin, enfin il l’a mis au courant de ce qui commençait à prendre la forme d’une aventure, d’une bataille inégale entre une demie douzaine de poivrots remontés et deux vieux inoffensifs. Tout était dit dans un mélange d’arabe comme le mien et de kabyle. L’armoire l’appelle ‘‘mon oncle’’ par affection, Da Mahmoud n’est pas son oncle, tu comprends ça ! Son ami a posé lentement un bras sur le comptoir, le poing et les mâchoires serrés, puis il a posé l’autre bras et en a serré aussi le poing. Soudain il a crié en tambourinant des deux poings sur le zinc ‘‘il vient ce café ?’’ Tu penses bien que nous on était contents. Il s’est tourné vers nous « prenez quelque chose, ça me fera plaisir ! » Alors, fièrement Da Mahmoud a demandé deux autres cafés. Il a dit, la voix haute, « et deux autres cafés avec deux verres d’eau ! » Bachir a repris la commande en criant plus fort « trois noirs, trois ! » Et il a commencé lui aussi à lancer des blagues pas très intelligentes, il faut le reconnaître, mais les enfants du pêché l’ont bien cherché. ‘‘Pourquoi les racistes n’ont pas de cerveau, dites-moi ? a-t-il lancé en rigolant face à la cantonade bien silencieuse, pourquoi ? parce que leur cerveau a rejeté la greffe, cons !’’ Pardon Larbi, hacha weldi. Puis il s’est dirigé lentement vers les gars pour leur poser cette autre question ‘‘pourquoi faut-il enterrer les racailles comme Elmagribi sur le ventre, hein ?’’ »
— C’est qui Magribi ? » demande Larbi.
— Tu ne connais pas Elmagribi, Olivier Elmagribi ?
Larbi fait non de la tête. Son incisive supérieure, légèrement en avant, atténue l’éclat de son sourire.
— C’est qui ?
— Pourtant on jurerait qu’il habite dans la télé, répond Kada, vu le nombre d’émissions où il apparaît ! Elmagribi c’est un Juif berbère de chez nous, un Berbère perdu. Il squatte la télévision. Ses idées brunes comme la peste sont à la mode et infectieuses, alors toute la presse, avide de sensationnel et de coups tordus, l’invite ! Il a un complexe, Elmagribi, contrairement à ce qu’il affiche, en vérité il a la haine de soi et des siens. Au bled, quand je regarde la télévision, une émission de débat sur la société française — j’avoue que j’aime bien regarder les chaînes françaises — une fois sur deux je tombe sur des journalistes ou des commentateurs spécialisés, ils sont tous spécialisés, qui caressent dans le sens du poil leurs confrères, les gens de la finance et du pouvoir en général. Dans leur discours ils montrent clairement qu’ils soupçonnent les pauvres et les immigrés, les Roms, les Tchétchènes et nous. Ceux d’entre eux qui ne nous aiment pas se comptent sur les doigts de dix mains au minimum avec plus ou moins de véhémence. Ça n’a pas changé depuis les années de guerre. Je reviens à ce Elmagribi. Et bien, dès qu’il prend la parole à la télévision c’est pour tomber à bras raccourcis sur ses cousins musulmans et sur ses racines. Une sorte de harki quoi. Bref il a un sacré problème dans la tête. Mais revenons au bar. Bachir a continué encore plus dur : ‘‘il faut enterrer les racailles comme Olivier Elmagribi sur le ventre parce que si on les enterre sur le dos, on n’aura jamais assez de terre pour remplir leur grande gueule, cons !’’ hacha. Et de nouveau il s’est mis à rire, entraînant les autres, forcés. ‘‘Allez, une autre’’ leur fit-il, en invitant le patron et le serveur à nous rejoindre ‘‘venez je vous dis !’’… ‘‘Pourquoi les cercueils des racistes sont-ils troués, hein ? pour que les vers dégueulent, couillons que vous êtes !’’ Pardon mon petit, hein, hacha, mais c’est comme ça qu’il a dit. Pas un n’a bronché, à peine un murmure venu d’une table du fond de la salle. Leurs oreilles se sont certainement mises à siffler alors que Bachir roulait des épaules. Il y avait de quoi. Nous on se frottait les mains, on était aux anges et lui il levait sa tasse à la santé de tous. Les autres, plutôt lâches, ont aussi levé leur verre. ‘‘plus haut qu’ça, allez, cons !’’ hacha, exigeait Bachir. Les autres s’exécutèrent en silence. Comme on l’a félicité, Bachir nous a dit que toutes ces blagues étaient connues archiconnues. Tu les connais toi ces blagues ?
— Heu, non. Mais pourquoi tu dis hacha ?
— Hacha, c’est juste un mot pour dire pardon, pas exactement pardon, mais ça y ressemble. Lorsqu’on parle, il arrive qu’on dise un mot grossier, alors juste après l’avoir prononcé et pour s’excuser auprès de celui qui écoute, il faut dire hacha, ou hachak. On dit Hachakoum, si les personnes qui écoutent sont nombreuses. »
Jeddi est encore marqué par l’excitation. « Voilà, c’est tout ce que je voulais te dire, fait-il. Il répète Yakhi ness, yakhi, mais quelles gens mon fils, quelles gens ».
Le grand-père va plus avant, apprenant à Larbi que Bachir est connu dans tout l’arrondissement par le milieu. Tous le craignent. C’est un ancien boxeur qui eut quelques démêlés avec la justice. Au moment de sortir du bar, Da Mahmoud enleva la casquette et salua l’assemblée « bonne journée, messieurs ! » Bachir proposa de les raccompagner, mais Da Mahmoud et Kada qui préféraient marcher déclinèrent son offre et le remercièrent chaleureusement. « C’est bien de marcher », lui dit Da Mahmoud. Ils marchèrent quelques centaines de mètres puis ils rentrèrent par la même ligne de bus.
Larbi embrasse son grand-père. Il voit le clignement des paupières et se dit qu’il ne va pas tarder à s’assoupir. Puis il réarme la PlayStation pour un nouveau jeu. Il s’en va avec Blasto libérer les gentilles emprisonnées par des limaces géantes gluantes. Sa tête est confuse, pleine de sentiments mêlés de joie et de tendresse. Ses parents ne vont pas tarder à rentrer. Messaoud aussi souffre de racisme. Il subit l’ambiance exécrable qui règne au travail, mais il n’en dit rien à ses enfants. Il supporte les allusions faites aux Arabes, aux musulmans. Il encaisse les amalgames de toutes sortes répétés par certains collègues qui avaient décidé du jour au lendemain de le prendre ouvertement en grippe, non pour l’éventuelle mauvaise ou trop bonne qualité de son travail ou pour ses idées qu’ils ne partagent pas, non pour un geste qu’il aurait commis, d’avoir volé une poule, violé un enfant, tué son patron. Non, point de tout cela. Ils lui reprochent d’être né Messaoud, d’être né Arabe comme ils disent, musulman. Il lui arrive d’avoir honte pour eux, tant leur ignorance lui semble épaisse. Messaoud ne veut pas nuire à Denise qui, quoique travaillant dans les mêmes bâtiments, et bien que son intuition tente de l’alerter par de petits pincements au cœur, de lui adresser des messages, ignore à quel point son mari est la cible de discours frontalement haineux, plus encore depuis septembre, la cible de comportements abjects de collègues sournois, toujours souriant avec elle.
La maison des parents de Denise se trouve au bas du grand boulevard de la mer, à deux ou trois cents mètres du port et des plages de Fréjus. C’est une grande demeure qu’Albert hérita à la mort de son père, Robert, qu’on appelait affectueusement « le poilu ». Robert ne surmonta pas la disparition de son épouse, Albertine, deux mois plus tôt, en novembre 1976, à la veille de ses soixante-dix ans. Albert et Ginette préférèrent quitter l’appartement de Toulon et emménager dans la maison de Fréjus, plutôt que de la vendre. C’était durant l’été qui suivit le décès des parents. Denise venait de les retrouver pour passer avec eux une partie des vacances. Aujourd’hui toute la famille élargie s’y trouve réunie.
Lorsque Denise, Messaoud, les quatre enfants et Kada pénètrent dans le grand salon, c’est d’abord la table somptueusement garnie qui s’offre à eux. Près de la grande cheminée trône un imposant sapin décoré avec des boules et des étoiles brillantes, des guirlandes électriques et des cheveux d’ange. L’arbre sent bon la résine et son pied est pour peu de temps encore, nu. Des aiguilles fragilisées lors de la mise en place des ornements tombèrent de l’arbre. Elles tapissent un espace encore restreint à son pied.
Ginette leur demande de poser les valises et sacs dans les chambres, à l’étage, de se mettre à l’aise. Messaoud, Denise, les enfants et Jeddi prirent le train à la gare de Lyon l’avant-veille, en début d’après-midi dans une cohue indescriptible, chacun craignant pour sa place pourtant réservée. Pour des raisons que la SNCF ne jugea pas utile d’annoncer aux usagers, plusieurs trains avaient été supprimés vendredi et le lendemain matin, à quelques heures de leur départ. Tous durent jouer du bras et du coude pour ranger les bagages et atteindre leur place. « C’est toujours pareil, à chaque période de vacances de Noël on a droit à ce trafic » rouspétait une vieille dame digne auprès d’une autre qui acquiesçait en hochant la tête recouverte d’un grand chapeau cloche assorti à sa robe rouge, mais elle ne dit rien.
Denise et les siens arrivèrent chez les parents, exténués. À Avignon ils durent attendre quarante minutes avant le changement de train, et trente minutes à Saint-Raphaël pour les mêmes causes, le retard des trains régionaux. « Ah ! », s’exclama Albert en levant les bras lorsqu’il aperçut sa fille poser son pied sur le quai de la petite gare, « j’étais à deux doigts d’abandonner ! » « Je t’ai envoyé un mail ! » lui rétorqua-t-elle. Albert baissa les bras, tata les poches de son pantalon, devant, derrière, puis leva de nouveau les bras pour signifier qu’il avait oublié son téléphone. La pendule sur le quai n’indiquait pas la bonne heure. Il était 18 h 40. Albert eut un mot gentil pour chacun. Il interrogea Yanis « C’est quoi cette barbe, on dirait Gainsbourg dans ses mauvais jours ! » et encore « trois bises varoises ou deux parisiennes ? » Le père de Denise dut effectuer deux allers-retours avec la voiture, mais cela il l’avait prévu. Yanis et ses frères auraient pu parcourir le chemin à pied depuis la gare, mais aucun ne se souvenait avec exactitude de la direction à prendre, et puis Albert n’aurait pas accepté. Messaoud est content, car entre les parents de Denise et lui il n’y a plus de tension. Ginette et Albert avaient depuis longtemps fini par se rendre à l’évidence. Depuis la naissance de Sarah, ils acceptaient leur gendre. Ils s’en accommodèrent, puis l’acceptèrent. « Sarah, quel joli nom, divin ! » Ginette avait surtout constaté que c’était sérieux, que Messaoud était un mari très attentionné, « il est gentil comme tout ». C’est elle qui fit les premiers pas. Les mois avaient passé et les rancœurs s’étaient atténuées. Les parents furent obligés de les avaler au risque de perdre leur fille qui avait définitivement — elle le manifestait clairement — pris le parti de ses enfants et de son mari, non contre ses parents, mais contre la bêtise.
Depuis septembre dernier, Messaoud comme les « musulmans et apparentés » est perçu par nombre de ses concitoyens comme un suspect, un ennemi de l’intérieur, membre d’« une cinquième colonne ». C’est lui qui le dit ainsi. Sa situation professionnelle était devenue tellement intenable, leur couple en pâtit, qu’il ne trouva que deux réponses à opposer et il lui fallait choisir l’une ou l’autre : soit mettre le feu aux locaux de Darty et prendre le risque d’expédier par-delà la vie des collègues innocents, soit s’en aller. Il choisit la seconde. Au début du mois, il déposa discrètement sa démission en prétextant des problèmes familiaux en Algérie. Avec Denise ils en parlèrent alors beaucoup. Cette atmosphère délétère et la décision radicale de Messaoud contribuèrent toutefois à développer les dissensions au sein de leur couple. Bientôt il sera libéré de cette routine — cela fait plus de vingt ans qu’il travaille chez Darty — et mieux, de ses collègues « ignobles ». Messaoud ne se plaignit jamais de l’évolution de sa carrière, mais vingt ans ça pèse, et ces trois derniers mois. Autant que tout le reste. Il ne pensa jamais, n’osa jamais penser ne serait-ce qu’un instant, qu’on soupçonnerait, se méfierait de sa francité, qu’on douterait de sa fidélité à ce pays. Messaoud revendiqua toujours sa double et honnête citoyenneté, sa double culture sans complexe, sans jamais privilégier l’une par rapport à l’autre, « je ne peux choisir entre mon père et ma mère » aimait-il répondre à ceux qui se préoccupaient de la consistance du lien de fidélité qu’il entretenait avec l’Algérie et avec la France. Chez Darty, des collègues qu’il connaît depuis longtemps, qu’il estimait, lui ont de nombreuses fois et lâchement, fait ressentir son allogénéité supposée : « rentre chez toi », « dégage », « pas d’Arabe ici », autant de petits mots qu’il trouva griffonnés au feutre noir sur du papier à journal et posés dans le tiroir ou sous le calendrier de son bureau. Il en reçut aussi dans sa boîte mail, mais ne réussit pas à identifier les auteurs. Denise comme Messaoud s’entendirent pour ne pas en parler aux parents.
En ces jours de fêtes, les Fréjussiens sont nombreux dans les allées du marché de Noël. Hier, la famille se scinda en deux. Une partie flâna entre le port et les plages, les enfants jouèrent aux autotamponneuses, au bowling et firent des parties de billard, quant à Albert, Kada, Messaoud et Yanis, ils se déplacèrent sur des lieux de mémoire qui tiennent à cœur au turco que fut Kada. Ils rentrèrent dans Sainte-Maxime par la côte, se rendirent à Cogolin, sur la plage de La Foux que Kada trouva étrangement petite, « La Red beach ! » Tout avait tant changé. Il se souvenait de cet été de guerre, quand il débarquait du croiseur Duguay-Trouin avec des dizaines d’autres turcos pour prendre d’assaut la région et en finir avec l’occupant. « Wallah el bareh », c’était hier. La plage lui semblait infinie et les constructions éparses. Il se remémorait, par moments la voix tremblotante, des temps où la mort tourmentait chacun d’entre eux, et d’autres, plus légers. Albert emmena ensuite le petit groupe à travers la forêt des Maures. Ils firent une halte à Collobrières où ils prirent un café ou un jus, à La terrasse provençale. « C’est très joli ! » répétait Kada en pointant du doigt en direction des vallons de Pérache et de Marin. Puis ils continuèrent par le col de Babaou jusqu’à Bormes-les-Mimosas où Albert prit la grande route jusqu’à Toulon. Une ville que Kada voulait, comme les précédents lieux, tant revoir. Bien sûr elle s’est métamorphosée et Kada ne reconnaissait plus rien. Sur la grande place de la liberté, au-devant du jet d’eau, une plaque rend honneur aux soldats pour que nul n’oublie. Yanis lut à voix haute : « La ville de Toulon en hommage de reconnaissance envers les soldats de la première armée et les soldats sans uniformes des forces françaises de l’intérieur qui chassant l’envahisseur lors des combats héroïques du 22 au 25 août 1944 l’ont libérée de ses chaînes. Le 25 août 1945 le Conseil municipal. Jean Bartolini, Maire. » Les yeux de Kada s’embuèrent, mais il ne dit rien, alors que Yanis faisait la moue. Il relut à voix basse le texte en roulant la cigarette qu’il avait entre les doigts, mais plutôt que la porter à ses lèvres, il la jeta à terre et l’écrasa. Il eut ces mots secs, désabusé : « N’importe quoi, y a rien sur les anciens du bled, c’est tronqué ! »
Lundi n’en finit pas de s’étirer et l’excitation des plus jeunes est palpable jusqu’à la dernière minute, celle qui précède les beignets d’huîtres et les feuilletés de saumon, jusqu’au repas. L’imposant sapin chargé de lumière couve une multitude de paquets portant chacun un mot doux, un nom. L’odeur de résineux embaume discrètement l’espace. Les discussions sont engagées et le vin rouge a une longueur d’avance sur le champagne et la bière. Yanis et ses frères préfèrent les jus de pamplemousse, d’orange et d’abricot. Kada choisit un jus de banane. Il dit ne pas se souvenir avoir jamais goûté à l’alcool, « peut-être une fois pendant la guerre, ou deux fois » laisse-t-il échapper alors que ses yeux pétillent. La fréquentation des bistrots ne lui pose pas de problème, mais il ne se souvient pas avoir bu. « Moi non plus » blagua Ginette. « Oh pauvre ! » s’exclama aussitôt Albert en tapotant l’épaule de Messaoud, « Toi ce qu’il te faut c’est un sparadrap ! » La soirée se poursuit durant tout le repas avec des banalités, rien n’est omis : les journalistes et les émissions de la télévision, la nouvelle monnaie européenne, la corruption dans les rouages de l’État… Messaoud prend le risque de parler de ce Britannique dont le nom lui échappe et qui avait tenté l’avant-veille de faire sauter l’avion qui reliait Paris à Miami dans lequel il se trouvait, avec des explosifs dissimulés dans ses chaussures. Yanis, malicieux, l’interrompt avec délicatesse : « Délicieuse, vraiment la dinde ! » dit-il, craignant avec justesse que l’on glisse dans une zone de turbulence incontrôlable. « C’est gentil… merci », « oui, c’est très bon, ajoute Kada, vraiment bon ». « Merci beaucoup Jeddi. » À cause des risques de divergences plus ou moins aiguës et d’éventuels dérapages, on passe vite sur les guerres et les attentats de New York. Jeddi Kada évoque Tasfut taberkant, le printemps noir de Kabylie, mais, manifestement, c’est trop compliqué pour Ginette et Albert qui ne connaissent rien à l’actualité algérienne ni aux rouages du système politique algérien. L’arrivée du gâteau a plus de succès. « Ah ! » soupire Larbi, « la bûche ! » C’est Sarah qui se charge de la servir après que Yanis l’eut coupée en tranches. Les échanges partent de plus belle, mais aucun sujet qui puisse fâcher n’est abordé. Les plus jeunes s’impatientent. « Les cadeaux, les cadeaux ! » réclament Omar et Larbi. Le sourire en coin de Sarah ne dit pas autre chose. « Tu t’en chargeras Carl ? » fait Ginette. Elle précise « tout à l’heure hein ? » Larbi attend un quart d’heure, le laps de temps que son impatience supporte, « mamie, je peux ? » puis il se précipite sous le sapin. Il prend le premier paquet, le tourne, retourne, lit « papé ». Il regarde Albert, « c’est pour toi papé ! » et le tend à Sarah qui fait suivre sur sa droite à Omar, Omar à Messaoud, et lui à Albert. Ginette et son mari appellent Larbi par son second prénom, Carl. C’est une habitude depuis sa naissance. Parfois il les reprend sans toutefois trop les contrarier. Il dit « moi je préfère Larbi ». Il prend le deuxième paquet, lit « Jeddi », et d’un pas pressé se dirige vers lui. Passe derrière Yanis et Denise à gauche. « C’est pour toi Jeddi ». Kada l’embrasse. Larbi revient à l’arbre et continue « à faire son père Noël ». Il regarde d’un œil malicieux les étoiles qui brillent au sommet du sapin. Voudra-t-il les décrocher ? Yanis reçoit un coffret contenant trois livres intitulés « Histoire de la pensée », un roman noir « Pars vite et reviens tard » et plusieurs CD. Sarah a droit à un coffret « bien-être », un volumineux dictionnaire « Le Petit Larousse illustré, 2002 », un casque audio, « La grammaire est une chose douce », ainsi qu’un kit de la nouvelle monnaie, l’euro. Elle remplace désormais le franc et le faux écu. Omar et Larbi reçoivent plusieurs jeux et des bandes dessinées, en plus d’une casquette et d’une PlayStation2 chacun. Aussitôt les consoles, manettes, cassettes et autres cadeaux distribués et reçus, on fait le tour de la table pour remercier chacun. À Yanis et Ginette, nés tous deux en décembre, on renouvelle le souhait : « happy birthday to you ! », puis les plus jeunes rejoignent les chambres à l’étage. Sarah occupe le bureau, au rez-de-chaussée. Les enfants quittèrent la salle à manger, mais la télévision resta branchée, sur la même chaîne. Yanis a les traits tirés, son sourire est forcé. Il ne tarde pas à quitter à son tour la table.
Messaoud discute avec Albert assis sur sa droite, lui-même est à gauche de Ginette. Il y a bien des années que la mère de Denise pardonna à sa fille son mariage avec Messaoud. Si tension il y a c’est entre les époux, mais Ginette n’entend rien, ne voit rien hormis quelques signes qu’elle met sur le dos des chamailleries ordinaires que l’on rencontre chez tous les couples du monde. Messaoud veut parler des problèmes qu’il rencontra dans son travail, mais ne sait par quel bout commencer et craint en même temps de crisper l’atmosphère. Denise regarde d’un œil discret la télévision. Les pitreries d’un acteur de Malcom, la nouvelle série télévisée de M6, à propos des Pères maristes d’Océanie plongent sa mère dans son enfance et les années noires qui l’accompagnèrent. Ginette se souvient particulièrement du mitraillage de l’Externat Saint-Joseph et du feu qui avait suivi provoquant la destruction du cinéma L’Éden. Son frère et son père tombèrent un an avant cet incendie, sous le premier bombardement de la ville, le 24 novembre 1943, « un mercredi ». Ginette mémorisa cette funeste date à vie, mais n’a pour le reste que de vagues souvenirs. Denise interrompt le voyage dans le passé de sa mère, « maman, y a pas autre chose que ça ? » Ginette sursaute, elle s’adresse à son mari en le tirant par la manche « Albert ! va mettre un peu de musique s’il te plaît ! » Ginette n’avait que deux ans en 1943. François, son frère, en avait six et son père, Amar, vingt-huit. Tous deux revenaient de chez le marchand de lait. Au moment où ils s’apprêtaient à traverser la rue de Besagne, derrière l’immeuble où ils habitaient, ils reçurent quantité de blocs de pierre et d’éclats de verre. Les soins qu’on leur prodigua à l’hôpital maritime ne purent leur sauver la vie. Ce bombardement entraînera la mort de centaines de personnes, grandes et petites. En août de l’année suivante, la ville était libérée notamment par la troisième division d’infanterie algérienne à laquelle appartenait Kada, fier et scandant parmi des mille :
« C’est nous les Africains Qui arrivons de loin !
Nous v’nons des colonies Pour sauver la Patrie !
Nous avons tout quitté Parents, gourbis, foyers !
Et nous avons au Cœur Une invincible ardeur !… »
La mère de Ginette, Françoise, demeura seule avec sa fille jusqu’en 1951 lorsqu’un Italien immigré de fraîche date l’épousa. Ginette garda peu de souvenirs de cet intrus qui lui offrit deux demi-frères qui, dès qu’ils accédèrent à la majorité, rejoignirent des oncles en Amérique. Elle n’eut plus de nouvelles de son beau-père pendant une vingtaine d’années. Ginette est toujours restée dans la région. Elle s’y maria avec Albert France, lui-même originaire de Provence. De Puget-sur-Argens précisément. Leur fille naquit à Toulon, « hors mariage » comme on disait alors, ce qui souleva une tempête dans les familles et le voisinage. Et cela était d’autant moins inacceptable que le père d’Albert était un héros de la Grande Guerre. La tempête se transforma en agitation, puis régressa. Elle fut étouffée avec l’arrivée du Nouvel An, on s’embrassa et on tourna la page. Robert est un poilu décoré à titre posthume comme d’autres soldats par le président Giscard d’Estaing, invité à une cérémonie commémorative un jour de novembre 1978 à Puget-sur-Argens alors qu’il visitait l’arrière-pays varois. Robert était mort un peu moins de deux ans auparavant. Toute la famille France est originaire de la vallée de l’Argens, une petite dépression située entre le massif de l’Estérel et celui des Maures. Ce n’est pas le cas des Benaroche, la branche paternelle de Ginette, dont les origines sont espagnoles. Pourchassés pour cause d’impureté de sang, les Benaroche avaient le choix entre rester en Espagne reconquise et périr ou fuir. Ils se réfugièrent en Algérie où ils firent souche. Amar Benaroche et Françoise Chevalier s’installèrent dans le sud de la France, peu de temps après leur mariage, célébré discrètement à Saint-Denis-du-Sig en Algérie. Amar rejoignait ainsi son père venu deux ans auparavant, dans la même région. Daoud avait quarante-deux ans et voulait « refaire sa vie ». Amar et Françoise découvraient une France en ébullition. On manifestait beaucoup. Les ouvriers faisaient, disait-on, des grèves de la joie. En mai, des centaines de milliers de Français commémoraient la Commune de Paris. L’espoir grandissait avec les premiers congés payés votés en juin. En Algérie, la vie devenait de plus en plus difficile pour les petites gens, beaucoup plus qu’en métropole. C’est pourquoi Amar et Françoise décidèrent d’émigrer en quelque sorte. À Saint-Denis-du-Sig, Amar était rémouleur. Il possédait une petite charrette sur laquelle était fixée une meule. Chaque matin il s’installait devant le marché couvert à deux pas de chez lui et y demeurait jusqu’à la mi-journée. Il affûtait couteaux, ciseaux, poignards en faisant tourner la meule avec son pied nu. Mais les clients ne se bousculaient pas. Beaucoup préféraient les ustensiles en acier inoxydable, plus solides. Amar, qui avait auparavant changé plusieurs fois de métier, passant de vendeur de bonbons à galoufa — on désignait ainsi les chasseurs des chiens errants qu’ils conduisaient à la fourrière municipale où ils étaient éliminés —, de galoufa à rempailleur de chaises, de rempailleur à manœuvre dans les huileries Crespo, et de manœuvre à journalier, désespérait. Comme la métropole avait besoin de bras, alors les jeunes mariés se lancèrent dans l’aventure : traverser la Méditerranée et s’installer sur son autre rive. Une aventure difficile qui allait les plonger au cœur de la guerre.
Depuis le début de la soirée, Kada se contente d’écouter. Il parle peu, parfois il lance à tel ou telle « plus fort, plus fort ». Il tend l’oreille, mais si l’on n’élève pas la voix, il ne saisit pas tout. De temps à autre, il se redresse sur son siège, mais peu après il s’y enlise de nouveau. Ce n’est pas tant la chaise qui est inconfortable que les années qu’il porte ou qui le portent qui l’ébranlent. Elles lui pèsent de plus en plus. Ses longs silences se font plus fréquents. Lorsqu’il prend la parole c’est pour se réfugier dans sa jeunesse. Souvent Kada aime à répéter que, paradoxalement, pendant la guerre il vécut des moments parmi les plus beaux de sa vie. Denise, sur sa droite, pose la main sur la sienne. « Raconte-nous Jeddi », lui demande-t-elle. Elle sait elle aussi tout le bien que lui font les souvenirs du temps qu’il passa à Toulon et à Marseille durant ces années-là, malgré tout ce qu’il subit de ses « frères d’armes » comme il dit. En face d’eux les apartés de Messaoud diminuèrent. Albert se joint à sa fille « Racontez-nous votre bataille de Toulon, racontez ! » dit-il à Kada qui se limite à ces mots « ah la guerre, la guerre… » Il fait tourner la roue de sa vie dans le sens contraire des aiguilles d’une montre de sorte que ses souvenirs les plus récents s’effacent pour laisser place aux plus anciens qui abondent. Comme ressuscité, complètement sorti de sa léthargie, son visage s’éclaire. Sa bouche laisse poindre une sorte de rictus. Il se lève, un verre de jus de fruits à la main, bois une gorgée et pose le verre. Il se racle la gorge, respire profondément, puis il déclame :
« C’est nous les Africains Qui arrivons de loin !
Nous v’nons des colonies Pour sauver la patrie !… »
Il dit « ah la guerre, la guerre… » Il hoche la tête parce que beaucoup de souvenirs s’y embrouillent, s’y bousculent avant d’émerger à la lumière. Puis, presque figé, comme au garde-à-vous, il se met à citer les noms de ses camarades de combat tombés autour de lui dans Toulon durant les horribles jours d’août 1944, comme on égrène un chapelet : « Adallaoui Djilali Ben Ali, Aoufi-Slimane Ben Mohamed, Hamid Ben Merzouga, Atmane Ben Tahar, Attitallah Salah, Belghoul Maamar, Chebli Salah, Djemmah Hocine Ben Amara, Gouarir Moussa, Hamoudi Lahcène, Kafoui Layek ». Kada est trahi par sa gorge. Il dit : « à leur mémoire », murmure « Allah yerham echouhada » en portant le verre à ses lèvres. Il poursuit, submergé par l’émotion, « tous ils sont tombés devant moi. Pour la liberté. C’étaient mes amis, comme mes frères. » Et il se rassoit. Hamid Ben Merzouga qui était le plus proche de ses amis décéda, écrasé par un soldat français quelques jours après la libération. Kada s’agite sur sa chaise, pose la main droite sur le dossier de celle de Denise pour se relever. Sortir dans le jardin. Ginette profite de l’absence de son mari parti vers la salle de bains pour glisser à Messaoud, sans trop élever la voix, les mains en entonnoir autour de la bouche et en articulant de sorte qu’il ne lui demande pas de répéter « ti es pas comme les autres », les autres Arabes. Elle dit « je reconnais qu’il y en a qui sont gentils ». Elle ajoute « le problème c’est quand vous êtes en bandes ». Puis, aussitôt elle se reprend, en riant aux éclats, « excuse-moi, je veux dire quand ils sont en bandes hihi ! pas vous non, hihi ! »… en continuant de rire sans retenue. Denise proteste « maman ! » Albert revient, passe devant le sapin, s’approche de la tablée avec sur le visage un regard sévère qu’il porte à son épouse lui signifiant ainsi — peut-être à cause de l’alcool qu’elle boit sans modération, ou bien des mots qu’elle prononce sans discernement — qu’il n’en est pas du tout fier et que même il en a honte. Ginette n’est ni à son premier ni à son deuxième verre de Whisky. Au suivant elle se met à chanter Lina l’Oranaise en dandinant le haut de son corps comme un aspic,
« Ya ommi ya ommi ya ommi
Essmek deymen fi fommi
Men youm elli âyniya chafou eddouniya
Chafouk ya ommi-laâziza âaliya… »
Kada sourit. L’air marin infiltré dans le jardin lui fait du bien. « Il fait froid dans le jardin » dit-il, mais personne n’entend. Ginette reprend : Ya ommi ya ommi ya ommi… Kada tapote le bord de la table en balançant discrètement la tête. « N’était la présence des petits je m’abandonnerais » se dit-il. Ses lèvres frissonnent « Ya ommi ya ommi, je connais bien ! » « Lina c’est une Benaroche comme moi, elle est la fille, unique, de mon arrière-grand-oncle Shlomo, hein c’est vrai chéri ? » continue Ginette. Elle ajoute « dis-moi que c’est vrai ! » « C’est vrai ? ah, moi je l’aime beaucoup Lina » fait Kada, le corps penché vers elle, Ginette, les yeux grands ouverts, mais elle ne l’entend pas, elle poursuit « Mon arrière-grand-père paternel, Yacob Benaroche était le frère le plus âgé de Shlomo, Alla yerhem. D’ailleurs c’est en souvenir de Lina que mon père m’a appelée Ginette, parce que son vrai nom à Lina c’est Ginette, je ne sais pas si elle est encore en vie mesquina, je ne crois pas, ou alors elle est presque centenaire ». Ginette chante Lina, elle dit « mesquina » la pauvre, puis « Alla yerhem, que Dieu l’accepte dans son Paradis », elle qui n’avait plus prononcé un seul mot en derja depuis, peut-être, 1962. Elle se sert un autre Jack Daniel’s puis tend la bouteille à son mari qui la devança en posant la main sur son verre. Il n’en veut pas. Après un long silence, elle ajoute « on a perdu de vue une partie de la famille, après que mon père est venu s’installer en France. » Puis elle reprend : « Ya ommi ya ommi ya ommi-Essmek deymen fi fommi… » Si Messaoud a l’oreille discrète, Kada est à la fois admiratif, intimidé et gêné. N’était la présence de son fils et de ses petits-enfants qui l’entendraient, même s’ils sont occupés à l’étage, il chanterait. Kada apprécie beaucoup Lina l’Oranaise. Ses chansons, comme celles de M’hamed El Anka, Oum Keltoum, Ahmed Wahby, Cheikh Hamada, marquèrent sa jeunesse.
Depuis qu’il s’installa dans le Marais, au début de ce mois d’octobre, Charly passe le plus clair de son temps à noircir des pages chez Camille devant son cappuccino. Le soir avant de se coucher, il reprend ses notes sur son iMac. C’est ici dans ce quartier, chez Camille, mais aussi dans son logement et tout autour, dans les parcs, dans les rues, entre les quais, la place des Vosges, et le Centre Pompidou, que Charly échafaude son éloge de Jérusalem. Il s’y remit dès la première semaine de son emménagement. Chez Camille il aime aussi taquiner la serveuse et déguster des rognons à la graine de Meaux, le plat préféré du chef cuisinier. Au printemps dernier, Charly revenait à Paris, dix mois après la coupe du monde de football. Il passa les premières semaines de son retour en France à déambuler comme un homme prêt à se réinventer un futur dépouillé de la mémoire encombrante des errements de son passé. Mais Charly n’est pas homme à questionner son passé. Il revendique ses errements qu’il ne reconnaît pas comme tels d’ailleurs, il les assume comme le résultat d’un homme (lui) vigilant dans son nid de pie, la main en visière à guetter les barbares. « Je crois que c’est à ce moment que j’ai pris la décision de revenir m’installer à Paris », répond-il lorsqu’on lui demande pourquoi il est revenu. « À ce moment » c’est-à-dire durant la coupe du monde de football. Lorsqu’on insiste « oui, mais pourquoi ? », il précise qu’il est impossible à un être sensible — c’est le terme qu’il emploie, « sensible » — de résister à l’emprise de cette ville, à ses lumières. Il dit un être « sensible » en lovant sa propre personne dans ce mot, ouvertement, comme une évidence. Mais ce ne sont là que des mots dont il aime bien se gargariser lorsqu’il entend contourner une question ou un sujet dont il ne veut pas observer les nuances qu’il ne partage pas. À vrai dire c’est une autre raison, moins esthétique, qui l’avait fait revenir à Paris et abandonner Israël. Une raison qu’il ne peut partager sans risque. Yaïr Klec lui doit une somme considérable, liée à leur business en Colombie, mais Yaïr jamais ne voulut reconnaître cette dette, arguant que ce sont des circonstances externes, par conséquent indépendantes de sa volonté, qui créèrent le chaos de Kidon dans ce pays. Yaïr et Charly en étaient arrivés à un point d’hostilité tel que la vie de l’un ou de l’autre pouvait être mise en jeu. Sur insistance de son ami Amoq, dont il put d’ailleurs à cette occasion, mesurer les limites de ses possibilités donc de sa puissance, Charly abandonna la partie. « On ne sera jamais loin », lui avait-il promis. Charly s’éloigna d’Israël, de ses pièges et de ses dangers sur mesure pour s’installer à Paris. Il lui fallait désormais se réapprivoiser les espaces qui avaient tant changé. Son absence aura duré — si l’on excepte son bref séjour durant la coupe du monde — un peu plus de dix-sept ans. De novembre 1981 à mars 1999, cela fait bien dix-sept ans et quatre mois, entre Tel-Aviv, Jérusalem, Beyrouth, Bogota, Puerto Boyaca, Los Sonrisas… Pour mieux maîtriser sa nouvelle situation, il se devait de faire le point, s’interroger, analyser les pertes et les profits. Son livre sur Jérusalem il l’avait mis entre parenthèses. Il accepta l’offre d’hébergement de ses parents, le temps de trouver un logement indépendant. Gaston et Dihia apprécièrent ce retour comme un don du Ciel. Ils avaient tant insisté durant son passage l’été précédent lorsque le monde avait les yeux braqués sur la France, tant prié, pour qu’il revienne pour de bon. Les parents ne parlent pas beaucoup. Pendant la journée, Gaston passe le plus clair de son temps au PMU. À la maison, Dihia se retrouve seule à faire la lessive, le ménage ou à regarder des séries à la télévision, chaque activité occupant une plage horaire précise. Ils ont chacun leurs habitudes qu’ils ne partagent pas. Dihia n’aime pas les courses de chevaux et Gaston ne supporte ni X-Files, ni Urgences, ni aucun autre film américain. Alors, ce retour de Charly, ses parents prient pour qu’il se prolonge le plus longtemps possible. Charly aime beaucoup ses parents, mais il avait fini par avoir besoin de plus d’espace, de plus d’intimité. Il ne projetait pas de se mettre en couple, il n’y songea jamais sérieusement depuis Erzebeth. Il y pense encore moins maintenant, à 48 ans. Charly a ses habitudes d’homme seul, et il désire déployer leur pleine expression. Six mois après son retour, il abandonna ses parents pour emménager dans la rue des Francs-Bourgeois, au cœur du Marais. Gaston et Dihia reprirent alors leurs occupations favorites, chevaux et séries télévisées qu’ils pratiquaient avec plus ou moins d’entrain. Leur fils occupe un appartement de deux pièces assez modeste, mais confortable au 24, au-dessus du bistrot Chez Camille. Dans un coin du salon, près de son bureau aménagé dans une des deux pièces, il prit soin de fixer d’anciennes cartes postales de collection et de vieilles photos d’Oran dont une, en noir et blanc, de format 45X30, montre le fort et la chapelle de Santa Cruz ainsi que le port qu’ils surplombent. Aucune image de Colombie ou d’Israël, pas même de Jérusalem, n’a sa place dans la pièce. Pas une image de Jérusalem alors même qu’il reprit son panégyrique. Assis devant l’écran de l’ordinateur, son esprit vagabonde au-delà du rideau de la fenêtre, au-delà de la fenêtre elle-même, au-delà du tintamarre des voitures et des cris des clients du bar, des marchands et des passants. Il traîne dans le labyrinthe de la ville sainte. Charly est parfois préoccupé par des pensées obscures, voire étranges. Ainsi il se demande — et cela n’est pas la première fois —, « comment maîtriser cette journée cruciale qui peut faire basculer mon monde, qui peut me faire culbuter moi, dans un autre monde… » Passé le seuil de son appartement, il occupe le plus clair de son temps chez Camille, sous sa fenêtre, où il sirote son cappuccino en se questionnant, en noircissant ses pages et où il aime aussi déguster de bons plats soignés, autres que les rognons que lui choisit le chef cuisinier. C’est dans ce quartier que Charly espère finir son livre dont il arrêta le titre définitif, Yerushaláyim, ma terre promise perdue.
Dans la cour de leur grande maison, sous la tonnelle de vigne et de chèvrefeuille, Messaoud sirote un thé. Il se demande si ses enfants accepteront de venir à Bethioua cet été ? Et leur mère qu’en pensera-t-elle ? Yanis ne viendra sûrement pas, trop occupé qu’il sera à la préparation de la soutenance de son Master, prévue à l’automne. Messaoud s’interroge aussi sur ses projets commerciaux, sur la rénovation de la ferme familiale à laquelle il tient à participer. Il est content de se trouver là, même s’il est assailli par toutes sortes de questions. Sur la table basse rectangulaire, il pose un lot de feuilles de papier agrafées dont il vient de finir la lecture. Son grand-père, Hadj Omar, aidé par ses fils aînés Mohammed et Abdallah, avait mobilisé toutes les énergies disponibles pour améliorer la vie dans la ferme en ajoutant plusieurs pièces. Chacun de ses trois garçons devait à ses yeux bénéficier de son propre espace de vie intime. Ce temps est loin et les deux frères et le père de Kada sont depuis décédés. « Chhadou Mohamed rassoullah » prononce sincèrement, mais maladroitement Messaoud en guise de recueillement. Plus tard, en prévision des mariages, d’autres transformations eurent lieu. Certaines pièces furent modifiées en salon, et de nouvelles chambres construites. La grande cour — dont la superficie avait été réduite pour permettre la construction de la pièce des invités et des logements des fils de Abdallah et Mohammed — est commune à tous les membres de la famille, tout comme la cuisine et la pièce d’eau. De l’autre côté du mur se trouve le terrain agricole d’une surface de quatre hectares. C’est sous la partie ombragée de la cour que se trouve Messaoud, sous le chèvrefeuille dont les branches enlacent les sarments de la vigne. Il est attablé devant un verre de thé à la menthe. Il reprend entre les mains le contrat du local qu’il s’apprête à louer avec Rayan, son ami retrouvé malgré la brouille née de l’expérience d’Eaubonne. Ils ont rendez-vous cette après-midi chez le notaire. Depuis son arrivée au bled il y a deux mois, Messaoud occupe la partie ouest de la maison. Il s’installa dans la pièce réservée aux invités. Celle-là même que ses parents occupèrent après leur retour définitif de France, avant de s’installer dans le logement de feu cheikh Hadj Omar.
« Cette fois il lui faudra être plus sérieux sinon je me casse ». Après sa démission de chez Darty, Messaoud monta une affaire avec Rayan à Eaubonne, au nord de Paris. Ils avaient souvent émis l’idée d’ouvrir un commerce ensemble. Messaoud saisit l’opportunité qui s’offrait à lui. Ils louèrent un local et y hébergèrent une SARL dont l’activité principale consistait en l’abonnement à la télévision par satellite. Ils la baptisèrent pompeusement « M & R Sat-International » créée dans la foulée. Tout en travaillant à Sonatrach (près d’Oran), Rayan participait pendant son temps libre à la vente aux Oranais d’abonnements à CanalSat, TPS, ABSat. En Algérie, dans les entreprises d’État le temps libre qu’on s’octroyait malgré le millefeuille de lois et règlements ne manquait jamais pour s’adonner à des occupations plus rentables ou joyeuses. Et ceci tout en bénéficiant d’un salaire rondelet payé par cette même entreprise publique. Le temps libre il suffisait de le prendre. Rayan démarchait les clients potentiels à commencer par ses collègues de travail, il récoltait l’argent, puis téléphonait à Messaoud qui se chargeait de l’aspect administratif. Il abonnait les personnes en adressant aux fournisseurs d’accès à la télévision satellitaire des dossiers contenant le nom des bénéficiaires avec des adresses puisées au hasard dans les Pages blanches, l’annuaire téléphonique d’Île-de-France. Le plus fréquemment c’est l’adresse de M & R Sat-International qu’il indiquait, 66 rue Gabriel Péri. Cela n’avait aucune incidence, car les TPS, ABSat et Canal, libéraient les lignes aux clients dont l’abonnement était en règle (le paiement s’effectuant par le biais du compte bancaire de M & R Sat-International), sans se soucier du reste. Souvent, pour dynamiser les ventes, les fournisseurs d’accès aux chaînes satellitaires offraient des cadeaux aux abonnés (téléviseurs, antennes paraboliques, etc.) que Rayan et Messaoud, qui les réceptionnaient, revendaient bien évidemment puisque les formulaires d’abonnement ils les remplissaient sans piper mot aux clients. La combine fonctionna quelque temps, pas plus d’un an et demi, puis capota, non du fait d’un souci quelconque lié à la régularité de la boîte (hormis les fausses adresses), mais parce que l’ami Rayan omettait trois fois sur quatre de transférer les liquidités des abonnements sur le compte de M & R Sat-International qui, par la force des choses, périclita. Les malheureux clients qui s’étaient abonnés aux chaînes étrangères pour oublier l’inepte télévision locale se retrouvaient soudainement plongés dans l’écran noir de leur téléviseur. Ils rouspétaient alors auprès de Messaoud qui les renvoyait vers le blond, son indélicat associé. Le lancement de la SARL n’empêcha pas Messaoud d’émarger à l’ANPE qui ignorait tout de son affaire avec Rayan. Denise ne supportait plus « toutes ces magouilles » qui contribuèrent à plomber un peu plus leur relation. Leur appartement s’était transformé en enfer pour l’un et l’autre. La rupture devenait une nécessité pour elle comme pour lui. Pour les enfants la séparation des parents était un drame, alourdi par le départ de leur père en Algérie à la fin de l’année. Dans l’esprit de Messaoud, la responsabilité de la situation qu’il vit incombe aussi à Rayan. « Sans les magouilles du gros blond, je n’en serais peut-être pas là », pense-t-il devant son verre à moitié vide. Le plus important pour lui est de repartir sur de nouvelles bases avec son ami. Créer une entreprise à Oran, toujours dans le domaine de la réception satellitaire, dans la vente de têtes LNB, d’antennes, de récepteurs, de décodeurs… Avant de venir au bled, Messaoud prit soin de convaincre discrètement son aîné, Yanis, pour qu’il signe à sa place « tiens, imite ma signature » les documents mensuels d’émargement de l’ANPE. Messaoud tient aux indemnités de chômage, même s’il se trouve physiquement à l’étranger. Yanis accepta, mais son père dut insister. Son fils trouvait cela déplorable et condamnable. Il dénonçait toujours les pratiques de ce genre, mais là c’est son père alors bon…
Sous la tonnelle Messaoud boit les dernières gorgées du troisième thé et pose le verre sur la table basse. Il lui semble que cette matinée de février est aussi chaude que celle d’un été parisien, mais il se demande aussi si ce n’est pas le thé qui lui donne cette impression. Il appelle Rayan : « je me débrouille pour le transport, on se retrouve chez le notaire ». Il prendra un taxi collectif. Son ami fixe le rendez-vous à 15 heures 10. « Heure locale ? » plaisante Messaoud pour pointer cette étrange précision qui ne ressemble guère à son ami Rayan qui n’eut jamais ni de montre ni le souci de l’exactitude. L’étude notariale se trouve au cœur du centre-ville d’Oran, derrière le Grand hôtel et la Grande poste.
À travers les vitres de la fenêtre fermée du salon de son nouvel appartement, alors que les mêmes mots « On ne sera jamais loin » tournent et retournent dans son esprit, Charly semble sonder dans un même mouvement d’une part la distance qui sépare cette vitre contre laquelle son front dégarni est collé de la base du mur du jardin de la cour, et d’autre part l’espace qui sépare cette même base du mur du toit de l’autre immeuble, le A. Au centre de la cour, trône un grand sapin sur lequel clignotent de petites ampoules en forme de losanges et dansent des étoiles de Noël en cartons à six branches de plusieurs couleurs flashy. De chaque côté de l’arbre, deux anges gardiens statufiés, tenant chacun une lanterne, semblent veiller sur l’ensemble. Charly libéra la semaine dernière le petit T2 de la rue des Francs-Bourgeois pour s’installer dans ce vaste appartement qu’il acquit grâce à un nouveau coup de pouce des services officiels et officieux de Kuneman, le chef Tevel. « On ne sera jamais loin », lui avait dit son ami Amoq en lui tapotant l’épaule. Le logement — un trois-pièces cuisine de 110 m2 — se situe au quatrième étage, dans le bâtiment B au fond de la cour du 52 rue Blanche. Le 52 est un ensemble d’immeubles cossus, posés sur le flanc droit de la caserne des pompiers, en face du théâtre de Paris, dans le 9e arrondissement. Charly apprendra plus tard que le choix de cette adresse n’était pas dénué d’arrière-pensée. Son voisin du dernier étage, au-dessus du sien, n’est autre qu’un haut responsable trotskyste, radicalement opposé au sionisme et à la politique colonialiste de l’État d’Israël. Il sera demandé à Charly de surveiller les faits et gestes d’Alain Lerouge, « un dangereux haredi laïc » dira Kuneman.
Charly n’est pas un romantique, tant s’en faut. À travers les vitres de la fenêtre du salon, il admire le grand sapin, mais dans son esprit les mots et gestes de son ami Amoq qu’il entend et voit encore, sont bousculés par certains événements de cette année 2000 qui s’achève. Un jour de février dernier, alors qu’il était invité à RTL pour la promotion de son livre, Yerushaláyim, ma terre promise perdue, Charly en profita pour proposer ses services à la direction. La carrière qu’il avait envisagée dans la magistrature, il n’y a jamais pensé après la faculté. Il n’en a plus les moyens intellectuels « j’ai tout perdu ». Yerushaláyim, ma terre promise perdue, fut édité en Israël chez Kinneret Zmora-Bitan Dvir en deux versions, l’une en hébreu, l’autre en français. « Yerushaláyim, j’ai foulé ton sol et cherché ton âme. J’ai entendu ton peuple, ouvert tes livres et lu dans ton passé le langoureux chant des morts. N’abandonne jamais ton ciel, tes ronces et ta chair aux étrangers… » Les seules mémoires encore présentes dans la radio avaient pour visage deux ou trois agents de l’administration et deux membres de la direction. Ils se souvenaient tous du jeune sherpa des Routiers sympas. Charly répondait aux plus curieux d’entre eux qu’il avait fait un grand tour du monde, qu’il avait résidé en Amérique, au nord, au sud, en chargeant son discours d’aventures et de mésaventures les plus acceptables et attendues. À aucun il ne parla de la Colombie ni du Liban. Non parce qu’il se serait dévoilé, à cette éventualité il ne croit pas, mais parce que, compte tenu des missions secrètes engagées et de l’implication d’Israël, cela lui aurait coûté en précautions à mettre en place et en arguments de tout moment à préparer. Le simple fait de les envisager le fatiguait. Sans omettre les risques physiques qu’il aurait pris. Plus tard peut-être.
En juillet il était embauché pour coanimer une plage hebdomadaire d’une heure axée sur l’actualité. Les essais se déroulèrent à la fin du mois de juin dans le plus petit des studios, le C, à raison de quatre séances de trente minutes chacune. L’émission, qui avait lieu le vendredi en début de soirée, s’alimentait de toutes sortes de polémiques, d’aucuns disaient de ragots. Trois mois plus tard, en octobre, il comprit pourquoi il avait été repris si facilement à RTL. L’attaché culturel à l’ambassade d’Israël, Ziv Kuneman, avait téléphoné à Charly le 24 pour lui proposer l’assistance des services culturels de la représentation israélienne pour la promotion de son livre. Il lui donna rendez-vous dans son bureau, pour le lendemain mercredi dans l’après-midi à l’heure qui lui convenait, pour en discuter. « 14 h 30 » proposa Charly.
Lorsqu’il fut introduit dans le bureau du chef Tevel, Charly s’aperçut que celui-ci n’était pas seul. Le moment de surprise passé, Charly fit un mouvement de recul, car il reconnut l’homme qui, assis face à l’attaché culturel venait de se retourner. Il pensa « traquenard ». Le diplomate insista pour qu’il s’assoie, tandis que l’autre homme, maintenant ni assis ni debout, lui tendait la main. Kuneman avait été mis au courant dans le détail du conflit qui opposait les deux hommes. Il répéta en s’adressant à l’un et à l’autre « Nous avons chacun le devoir de surseoir à nos différends. Seuls comptent les intérêts supérieurs d’Israël. Il répéta, solennellement « nous avons besoin de chacun de vous ». Puis vers Charly « sachez cher ami que les hiérarques de la Division Lohamah, et par conséquent l’État, ont décidé d’apurer le dossier Kidon et de vous dédommager jusqu’au dernier agorah ». Il lui fit comprendre qu’il avait personnellement appuyé sa demande de réintégration à RTL, demande dont il eut vent on ne sait comment. L’attaché culturel apporta d’autres éléments qui dissipèrent la tension qui avait commencé à poindre, non du fait de l’homme sur le visage duquel un sourire franc s’affichait, et qui, manifestement, avait déjà reçu ces assurances officielles, mais de Charly. Il tira à lui le fauteuil libre et tendit la main à Yaïr Klec. Les deux heures qui suivirent portèrent quasi exclusivement sur les missions mises en place par la division Lohamah du Mossad, dans le cadre du Plan Moïse, précisément de la mission Séphora dont Yaïr a la responsabilité en France. Une place non négligeable fut réservée à Charly dans ce dispositif. Il posa toutes les questions qu’il jugea nécessaire de poser. L’attaché culturel, rassura Charly et lui promit : « rien ne se fera sans votre accord, mais on compte beaucoup sur vous pour faire monter la mayonnaise. » Charly savait que Kuneman avait été longtemps proche de Habika, Le tueur. Il le fut jusqu’au jour où il reçut l’ordre — comme tous les éléments de tous les services concernés — de « rompre immédiatement » toute relation avec lui. (Habika sera pulvérisé avec sa Jeep quelques mois plus tard par quatre kilos d’explosifs alors qu’il rejoignait son domicile à Beyrouth). À la fin de la rencontre, ils quittèrent le bâtiment de l’ambassade pour la brasserie Le Rabelais, dans la rue Jean Mermoz, où ils scellèrent, entre bulles brutes de la Veuve Clicquot, petits fours, amuse-gueules et tintement de flûtes, une sorte de nouvelle proximité professionnelle bien comprise. Kuneman dit à Charly regretter que certains critiques littéraires ne fissent pas un bon accueil à Yerushaláyim, ma terre promise perdue, particulièrement l’un d’eux, qui écrivit : « Monsieur Pinto prostitue la littérature à ses pulsions ou convictions idéologiques sulfureuses, comme une miss univers qu’on offrirait à un homme politique véreux, dont on souhaite adoucir les positions… » « Qu’il aille se faire foutre » répondit Charly en faisant un geste brusque du bras, puis en s’excusant aussitôt il ajouta en prenant un ton neutre « c’est le même abruti qui a vanté l’exposition du dégénéré Nolde ». « Ce type est connu pour ses accointances orientales » compléta le chef Tevel, « allez santé, lekhayim ! » et ils entrechoquèrent leurs verres.
Moins de quinze jours après cette rencontre, Charly était chargé d’animer, en sus de l’émission du vendredi soir, une chronique de cinq minutes, La chronique de Charly — deux fois par semaine, le mardi matin et le vendredi matin. Aussitôt entamée, elle devait faire face à une réprobation de plusieurs auditeurs. Il lui fallait persévérer. Les responsables de la station ne le soutiennent pas, mais ne font rien contre non plus. Les manifestations des gendarmes et policiers alimentent ses rubriques plus que celles des ouvriers de Cellatex au bout du rouleau et des priorités médiatiques.
Avec sa main droite, Charly balaie ses étroites épaules comme pour se débarrasser de la poussière déposée sur son pull-over canari — le rouge l’insupporte — depuis qu’il se fixa devant la fenêtre. Puis il la passe derrière la tête comme s’il voulait évacuer de son cerveau toute autre pensée. Les ampoules du grand sapin clignotent toujours. Charly regarde la montre et décide qu’il est l’heure de se rendre au Bistrot des deux théâtres, en bas de la rue, où il a rendez-vous. Sur son carnet il note : « Le Rouge = RAS. Il blablate dans la presse contre le PC. Selon Libération (du 16) Le Rouge ‘‘regarde les prochaines échéances municipales comme le surfeur la vague’’ ».
Lorsque les tours jumelles du World Trade Center avaient été désagrégées, Charly leur consacra une vingtaine d’émissions dans lesquelles il insérait systématiquement un commentaire en lien avec les banlieues françaises où il était question d’armes, d’Islam, de drogues, de vols. L’intitulé de chacune des chroniques était à lui seul révélateur… Au fil des semaines, il édifia sa niche. Son émission fait désormais partie des plus remarquées du paysage radiophonique. Au gré des mois et de son acharnement, elle devint incontournable. Charly désormais dispose suffisamment d’assurance pour « monter les enchères », conforté par un climat général de plus en plus délétère dont les outrages se reflètent aussi dans le contenu d’innombrables lettres d’auditeurs. Une atmosphère que Charly et les plus fanatiques d’entre eux ne sont pas seuls à entretenir et à développer. Régulièrement il lance de violentes attaques contre les étrangers, contre les Français issus de l’immigration africaine, musulmane : « Rejetées de toutes parts des populations entières affluent en France sans respect aucun. Elles viennent pour la plupart du sud, les gitans de l’Est. Certains m’ont reproché d’exagérer. Je persiste, comment notre culture, hier dominante, et notre vie même, allaient faire face à ce déferlement, car c’en est un. Il n’y a qu’à voir tous ces jeunes des banlieues, ces ennemis de la France, ne sont-ils pas, à la suite de leurs parents, la semence du déclin de notre civilisation, de notre race ? Nous voilà aujourd’hui en train de nous interroger sur notre propre identité ! Des champs entiers de notre France tombent en friche ! Mais dans quel pays vivons-nous avec tous ces métis dans nos métros, ces Arabes, ces Bamboulas, faut-il que notre pays vive les attentats de New York, que la Basilique du Sacré-Cœur soit désintégrée ? que Notre-Dame de Fourvière et notre Bonne-Mère soient anéanties pour se réveiller ? » Si Charly est soutenu par de nombreux auditeurs et personnalités médiatiques et politiques, des associations et des intellectuels s’émeuvent du caractère xénophobe, voire raciste, de ses émissions et le font savoir. Ils affirment que tous ces Charly, Elmagribi, Graminée, Vilbec et bien d’autres mandarins ou assimilés, animateurs et hommes politiques nostalgiques d’un ordre ancien chauvin et infâme, baignent dans la fange. Les instituts de sondages, IPSOS, BVA et d’autres estiment que les sympathisants de Le Pen et Mégret avoisinent les 17 %. De crainte de plus grands remous, le directeur de la radio, vivement critiqué, imposa à Charly quelques mois de repos sans perte de salaire à compter de la trêve des confiseurs. Il ne pourra par conséquent commenter l’élection présidentielle.
À chacune de ses chroniques Charly attribue un titre, comme « Réflexions sur l’islam-islamisme », « Les illusions perdues », « La guerre civile n’aura-t-elle pas lieu ? », « Notre défaite »… Celle de ce matin 13 juillet (7 h 12) il l’intitula « Le prix du silence ». Charly Pinto y vilipenda les jeunes des quartiers populaires : « Jeudi dernier à Chambon-sur-Lignon, Jacques Chirac déclarait ‘‘devant la montée des intolérances et de l’antisémitisme, je demande aux Français de se souvenir d’un passé encore proche. Les actes de haine odieux et méprisables salissent notre pays.’’ Le lendemain de la déclaration du président, une jeune femme qui venait de monter dans le RER D à la station Louvres avec un bébé dans les bras était agressée par six individus d’origine maghrébine armés de poignards et de sabres… » Charly regrettait en son for intérieur que ces six jeunes hommes ne fussent pas habillés en kamikaze, en tenue afghane ou en Ninja, couteaux aiguisés entre les dents, dégoulinant de sueur âcre, les yeux exorbitants. Fils de petites frappes et salopards eux-mêmes. Il regrettait que le wagon ne se vidât pas de ses voyageurs. Que la jeune mère ne fût pas seule avec son bébé. Que dans sa lâcheté l’un des Arabes ne soulevât pas le nourrisson qu’il ne le secouât pas avant de l’écraser dans son landau. Qu’un deuxième ne terrifiât pas la jeune Marie-Louise Lenoir avec son sabre couleur or pointé sur sa naïve poitrine. Qu’un autre ne l’attrapât pas par les cheveux, ne criât pas ‘‘file-moi ton pognon la feuj’’ et ne la scalpât pas sec.
« … Ils ont bousculé la jeune femme, l’ont frappée puis lui ont arraché son sac à dos en proférant des insultes antisémites. Avant de descendre à Sarcelle, ils ont lacéré ses vêtements et dessiné au feutre des croix gammées sur son corps et celui de l’enfant… » Une croix gammée, deux, cinq, dessinées au feutre jaune sur le ventre blanc de la pauvre mère et sur la joue de son bébé… une méthode de nazis… nous vivons dans un univers infect où le Monde (à son tour) s’abreuve aux caniveaux. « Un an auparavant, la jeune femme avait été agressée par six noirs africains sur un parking de Louvres où elle réside. Sa mémoire sera à jamais souillée par ces sinistres matins… Ces actes graves et odieux ne peuvent demeurer impunis… » Charly enveloppa d’un voile noir les doutes des Renseignements généraux exprimés pourtant dès le samedi 10 juillet, doutes quant à l’authenticité des faits tels que relatés par la jeune femme qui répète avoir subi une agression à caractère antisémite alors que plusieurs journalistes émirent des réserves, alors que l’AFP annonça le lundi soir, la veille de La chronique de Charly : « le secrétaire général du syndicat Synergie-Officiers déclare que le témoignage de la jeune femme agressée vendredi dans le RER D présente des ‘‘contradictions’’ ».
Messaoud avait insisté pour que ses enfants viennent passer quelques semaines à la ferme. Les plus jeunes n’étaient jamais venus en Algérie. Vingt ans plus tôt, les parents y séjournèrent avec Yanis et Sarah. Le garçon avait trois ans et demi, sa sœur quatre mois. Cette fois-ci Yanis ne put se joindre à ses frères et sœur. Il est occupé à la préparation de la soutenance de son Master, prévue en novembre. Denise montra d’abord quelques réticences à laisser ses enfants se rendre en Algérie au vu de ce qui s’était passé durant toutes ces années quatre-vingt-dix, puis elle se ravisa. De nombreux habitants de la cité qui s’y étaient rendus, sont revenus sains et saufs et louaient, avec exagération pensait-elle, la nouvelle vie des Algériens, la « réconciliation nationale ». Ils assuraient que l’air y est sain et que la réussite est accessible à quiconque apprend à maîtriser la débrouille, pomper de l’air et brasser en surface ou dans les profondeurs de la corruption. Mais c’est Kada qui la décida. Il l’avait appelée pour lui dire combien la situation s’était améliorée, qu’elle était elle-même la bienvenue comme toujours, que toute la famille l’appréciait, que pour elle rien n’avait changé. Kada savait très bien que sur ce plan-là les cartes étaient jouées. D’ailleurs lui-même n’était pas convaincu par sa propre invitation. Entre son fils et la Française, tout était bien fini, et cela l’attristait.
Finalement Sarah, Omar et Larbi arrivèrent il y a trois semaines. Presque tous les jours, ils se rendent avec leur père à la plage de Port-aux-poules. Ahmed, le fils du grand-oncle Abdallah, leur prêta deux grands parasols, des chaises, des serviettes et une glacière. « Mers El-djadj, mechi Mers El-Hadjadj », se souvient Messaoud. Il y a du monde sur la plage, beaucoup autour d’eux. Tous ces regards francs, massifs dirigés vers leur emplacement les mettent mal à l’aise. Les jeunes, il n’y a que des garçons, forment comme un essaim. Ils vont, viennent, regardent avec insistance « Ils vont m’avaler comme une proie j’te jure » chuchote Sarah à Omar. Elle envoie plusieurs textos à ses copines en France à ce sujet, « c’est dingue ! » Elle n’arrive pas à se concentrer. Lui est assez énervé aussi à cause de tous ces va-et-vient incessants, tous ces yeux intrusifs, envieux ou inquiets, perdus. Si ça ne tenait qu’à lui, il foncerait dans le tas comme dans du fumier. Avec sa casquette grise des San Francisco Giants et son air renfrogné — à ce moment —, on le prendrait pour un baroudeur, ce qu’il n’est pas. Larbi lui joue un peu plus loin. Il est absorbé par un mini-football de plage. Avec d’autres jeunes, il tape dans le ballon, drible, passe, marque ou rate son tir sans se soucier de l’affluence autour d’eux. Sarah poursuit sa lecture perturbée de Pas d’orchidées pour Miss Blandish. Elle n’ouvrit pas et ne pense pas ouvrir pendant les heures de plage les polycopiés des deux modules (les soins et la santé publique) qu’elle pensait réviser pour son entrée en deuxième année de formation en soins infirmiers. Messaoud est au téléphone avec Rayan. Leur société est lancée depuis six mois, mais il pense qu’il leur faut patienter au moins jusqu’à la fin de l’année pour se prononcer sur sa viabilité. Rayan est enthousiaste lui, et sûr de leur affaire. Leur commerce se trouve dans Oran-ville, au 7 rue Beauchamp, à l’angle de l’avenue Nobel et Alexandre Dumas, une des principales artères du quartier Gambetta, à quelques mètres de Hadj Taghit esfengi, le spécialiste des beignets. Si les rues portent depuis l’indépendance de nouveaux noms : Bengoua, Ibn Tofeli et Boukherouba, les habitants — grands-parents, enfants et petits-enfants — disent toujours « rue Beauchamp », « rue Nobel », « Rue Dumas »… Le commerce de Messaoud et de Rayan occupe la villa qu’avait fait construire Hachemi Chambaz un ancien speaker célèbre. Ses commentaires des matches de football étaient débités à une vitesse inouïe, parfois plus élevée que celle d’un ballon tiré par un avant-centre frénétique d’un point de penalty, et ne correspondaient pas toujours à la réalité du jeu sur le terrain. C’est chez lui, chez Hadj Taghit esfengi, que souvent Rayan et Messaoud achètent le thé à la menthe et les sfenges chauds copieusement saupoudrés de sucre, qu’ils dégustent dans leur local commercial.
La déclaration du ministre de l’Intérieur à la suite de la mort d’un enfant de onze ans provoqua des remous au sein de la classe politique, y compris dans son propre camp, ainsi son collègue Begag qui jusqu’à récemment, se contentait de protester entre ses dents lorsque ses amis dérapaient, sortit de ses gonds. Le premier déclara lundi à La Courneuve vouloir « nettoyer la Cité des quatre mille au Kärcher ». Aux informations, Pujadas annonce que « trois hommes d’une vingtaine d’années ont été arrêtés sans résistance. Parmi eux figure l’auteur des coups de feu qui ont tué il y a quatre jours le jeune Sidi Ahmed ». Mais ce qui intéresse Jean-Marie Godinot dans le journal télévisé c’est plutôt cette voiture du futur qui fait des créneaux toute seule, c’est aussi l’assassinat de cette étudiante de l’IUT d’Orléans par un camarade de classe, amoureux éconduit. Jean-Marie est un homme sans histoires. Cheveux grisonnant, bientôt sexagénaire, un homme débonnaire à l’allure plutôt sympathique. On devine à son physique disgracieux qu’il déteste le sport. C’est avec lui que Denise vit depuis bientôt quatre mois. Jean-Marie vend des disques vinyles aux Puces de Saint-Ouen où ils se rencontrèrent. Les matins des trois jours de travail (samedi, dimanche, lundi), lui et son épouse, Francine, étaient souvent parmi les premiers à déballer la marchandise de leur camion à l’angle des rues Lecuyer et Jean-Henri Fabre, juste en face de chez Fernand le cafetier basque, sous le périphérique, jusqu’à cet accident qui coûta la vie à sa compagne. C’était un samedi d’octobre, cinq ans auparavant. Ils avaient quitté Saint-Ouen après le travail et rentraient chez eux à Coulommiers. Leur J5 fut percuté de plein fouet par la voiture d’un chauffard, très probablement enivré, car il avait pris l’autoroute de l’Est en sens inverse. Leur camion se retrouva derrière la rambarde de l’autoroute peu avant la sortie, à hauteur du Grand Morin. Plusieurs caisses de 45 et 33 tours s’étaient éparpillées sur la chaussée. Des centaines de disques étaient morcelés. Le mois précédent, Francine avait fêté son quarante-huitième anniversaire. Lui ne fut même pas égratigné, tout au moins physiquement, son moral souffrira durant des années. Il lui fallut repartir de rien. Denise et Jean-Marie se rencontrèrent chez Fernand peu après qu’elle et Messaoud se séparèrent. Jean-Marie vivait encore dans la perte de Francine, quoique la grande douleur se fût quelque peu atténuée. De temps à autre, Denise s’éloigne de Clichy-sous-Bois pour passer quelques jours chez lui, il vivait seul. Francine et Jean-Marie n’eurent pas d’enfant. Peu de temps après la disparition de son épouse, Jean-Marie abandonna sa maison de Seine-et-Marne pour se rapprocher de Paris. Parfois, le dimanche, Denise l’aide dans la tenue du stand. Un jour elle vint avec un lot de 45 tours de Lina l’Oranaise que sa mère lui avait offerts à l’occasion de son quinzième ou de son seizième anniversaire, elle ne savait plus. Denise déposa le paquet sur les tréteaux, entre deux bacs à disques « Rock et folk : W à Z » et « chanson française : À à D ». « C’est pour toi », dit-elle simplement en plaquant la main sur le paquet. Jean-Marie fut surpris et touché par le geste de Denise, mais il lui avoua qu’il ne connaissait pas cette chanteuse. Plus tard, elle lui racontera tout ce qu’elle sait de cette arrière-grande-cousine.
À la maison, Sarah prit la relève de sa mère malgré elle, par obligation d’une certaine manière. C’est elle, Sarah, qui prépare le repas pour ses frères, qui lave leurs vêtements, qui les repasse. Cette charge créée par la situation familiale, aggravée par l’intrusion de Jean-Marie dans leur famille, ou plus exactement par les absences de plus en plus répétées de leur mère, lui complique sa fragile vie d’étudiante. Elle a beaucoup de difficulté pour se concentrer à l’Institut de formation. Elle est souvent fatiguée, parfois découragée. Tout cela la contrarie, mais elle est plus malheureuse encore lorsque Omar et Larbi se chamaillent pour un rien, lorsqu’ils s’accrochent pour un verre de jus de fruits, un biscuit au beurre. De son côté Larbi se sent délaissé. Sans Sarah, ses frères et ses cousins, il serait plus déprimé. Il confie à sa sœur qu’il n’aime pas Jean-Marie, car il lui fait des remarques devant sa mère qui ne réagit pas, se contentant de sourire. « Son vieux ne me porte pas dans son cœur, moi je lui rends bien la monnaie de sa pièce. Quand il a eu fini de parler, je lui ai dit ses quatre vérités. » De temps à autre, Larbi préfère partir chez Yanis à Montfermeil — il habite dans la cité de la rue Picasso —, ou chez son oncle à Bobigny retrouver ses cousins jumeaux avec lesquels il s’entend bien. Éliès et Adel ont un an de moins que lui. Son grand frère ne peut grand-chose pour lui, préoccupé qu’il est par la recherche d’un travail à la hauteur de son Master2 de Sociologie. Il semble pourtant à Larbi qu’il s’éloigne de lui.
Hadj rabat brutalement le clapet de son téléphone. « Évelyne, on part ! » fait-il, le visage fermé. « Les enfants ! appelle les enfants ! » Ils sont obligés de quitter en urgence le manoir. Hadj ne prend pas le temps de s’excuser auprès de la mariée, n’y pense pas. Il fait un nouveau signe à sa femme « on fout l’camp »… Elle l’interroge « qu’est-ce qu’il y a ? » « On fout l’camp… les enfants, où sont les enfants ? » elle répète « mais qu’est-ce qui se passe, dis-moi ! » Ils quittent précipitamment la table. Retrouvent les enfants qui dînent à quelques mètres avec d’autres adolescents. « Vite, on part, venez ! » Quelques invités se retournent, leurs visages sont fermés. Certains montrent leur mécontentement. D’autres observent en silence. C’est l’incompréhension. « Mais enfin, tu peux me dire ce qu’il y a ? » « Prends le volant ! »
La journée de Hadj, Évelyne, Éliès et Adel, s’annonçait chargée ce premier samedi de juillet. Ils étaient invités au mariage de Clara, une collègue de Hadj dont Évelyne, et lui-même, apprécient beaucoup la gentillesse, la disponibilité. L’appréciation est réciproque. Clara les aime beaucoup ainsi que leurs enfants. Jusqu’à ces derniers jours, Clara vivait en concubinage avec Idir, un poète franco-algérien, originaire de la prolifique ville de Azzefoun qui donna naissance à El-Anka, Issiakhem, Iguerbouchène et tant d’autres talents. Les deux couples se rendent souvent de petits services, dès lors qu’ils le peuvent. L’invitation au mariage incluait l’occupation de deux chambres, l’une pour Éliès et Adel, l’autre pour les parents, à Saint-Lambert, dans le manoir de Sauvegrain. Il était prévu qu’ils y demeurent jusqu’au lendemain dimanche. Pour le samedi suivant, Hadj et Évelyne avaient envisagé de se rendre en Italie. Revoir Venise et Vérone en amoureux, sans les enfants, à l’occasion de leur propre anniversaire de mariage, le dix-septième. Ils vont devoir y renoncer. Ce n’est plus possible, « c’est terrible, bordel de merde ! » dit Hadj, la voix étranglée, « Allez, allez ! »
Hadj connut Clara au centre de formation en alternance de Bobigny où il est employé depuis près de trois décennies. Elle avait été recrutée quelques mois avant lui. Évelyne, il la rencontra des années plus tard. Durant vingt ans, Hadj enseigna dans ce centre le français, l’histoire et la géographie au bénéfice de publics de différents niveaux et horizons. Certains cours étaient destinés à des illettrés, d’autres à un public étranger primo-arrivant peu alphabétisé, d’autres s’adressaient à des apprenants visant une qualification et un diplôme de niveau V et IV. Depuis 1997 Hadj ne donne plus de cours. Il occupe le poste de responsable pédagogique. Il planifie, organise et agence l’ensemble des formations, anime différentes réunions périodiques, dont la plus importante, la réunion de coordination dont les formateurs disent qu’elle est un moment de respiration, un lieu d’expression de toutes les frustrations, de toutes les satisfactions, de toutes les routines.
Un silence étrange flotte dans le funérarium des Batignolles, entrecoupé de temps à autre par une aspiration bruyante vite étouffée et, lorsqu’ils traversent les lieux, par les bruissements des chaussures ou des costumes des employés qui vont et viennent, ne manifestant aucune empathie. Aucune affection de circonstance dans leurs gestes, dans leurs échanges murmurés, peut-être même sont-ils impassibles. Ils sont tous là ou presque. Sarah, Omar et Larbi, sont assis côte à côte sur des chaises marron rembourrées. Une quinzaine de sièges rangés en demi-cercle. Ils regardent leurs pieds. Yanis, une Camel éteinte coincée entre les doigts, se tient debout contre le mur. Il sortira bientôt dans le parking pour la fumer. Le regard qu’il porte au loin semble vouloir traverser le couvercle du cercueil qui lui fait face. Il se tourne vers sa mère, assise à la gauche de Sarah. Elle fixe le catafalque, les mains croisées sur ses genoux. Le silence est à son comble. Deux employés sont postés comme deux épouvantails noirs. Immobiles. L’un à l’entrée de la salle, près du cercueil, l’autre au fond, entre Yanis et la seconde porte d’entrée, les bras croisés à hauteur de la ceinture, les jambes légèrement écartées. Sarah réprime un sanglot. Sa mère la prend par l’épaule, pose ses lèvres sur sa tête. Omar renifle, peut-être est-ce Larbi. Hadj, Évelyne et leurs enfants sont également présents. Assis à l’autre bout, sur les chaises de droite. Messaoud arriva d’Oran, seul, par le vol de 14 heures. C’est lui qui se chargera de faire venir l’imam. Il ne restera que quelques jours, le temps qu’il faudra pour procéder à toutes les formalités nécessaires à la toilette mortuaire et au rapatriement du corps de son père, transféré ce matin dans le funérarium. Yanis sort de nouveau dans le parking pour fumer une cigarette.
Messaoud accompagnera la dépouille de son père d’Orly à Oran. Il sera inhumé dans le cimetière de Caïda H’lima à Aïn-Beïda. Les employés du funérarium s’affairent comme dans une PME. Ils vont, viennent, réclament des informations, s’interpellent, ne chuchotent plus… Le dimanche est un jour ordinaire. Embellir un corps et porter le cercueil, enterrer tous les jours que Dieu fait est leur travail. La tristesse du monde effleure à peine leurs habits. Depuis la venue de son grand-père, il y a trois semaines, Larbi passait plus de temps chez ses cousins où Jeddi Kada était hébergé, qu’à Clichy-sous-Bois ou Montfermeil. Kada était venu en France, toujours à cause de ce certificat de vie que l’administration des retraites lui réclamait. Et comme il y a cinq ans, Kada préféra se déplacer pour lui prouver physiquement qu’il était bien vivant, même s’il traînait le pied et qu’il était obligé parfois de mettre sa main en entonnoir autour de l’oreille pour mieux entendre ce qu’on lui disait. À quatre-vingt-cinq ans, il se portait cependant relativement bien. Il espérait seulement que la chaleur étouffante du début du mois de juillet disparaîtrait la semaine suivante, lorsqu’il se rendrait à Nanterre au service des retraites.
Samedi, Hadj, Évelyne et leurs enfants ne tardèrent pas à quitter l’appartement pour se rendre à Saint-Lambert, assister au mariage de Clara, la collègue de Hadj. Ils prirent la route après qu’Évelyne revint du marché. « On aurait bien voulu venir avec vous », dit Hadj El-Khamis à son père. « Tant pis, maalich, ce sera pour une autre fois ». La veille, Kada avait proposé à Larbi de se rendre ensemble au Centre culturel algérien qui organisait une journée spéciale avec chants et danses, exposition et conférence. Une affiche conséquente avait été préparée. On peut encore la voir dans les consulats, dans les boucheries halal et d’autres enseignes dans les quartiers à forte population maghrébine. « Dans le cadre de la célébration du quarante-troisième anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, le Centre culturel algérien (CCA) organise une journée culturelle le samedi 2 juillet avec la participation de Hasna Becharia, Nadia Benyoucef, Cheikh Sidi Bémol, Selim Fergani, Kamel Harachi, Karim Ziad… Projection du film de Roger Hanin ‘‘Train d’Enfer’’ à 17 heures… ‘‘Avoir vingt ans dans les Aurès’’ de René Vautier à 20 heures. Venez nombreux… »
Kada et son petit-fils prirent le métro de Pablo Picasso jusqu’à la Gare de l’est où ils s’engagèrent dans les longs et exténuants couloirs. Kada était de bonne humeur. Il fredonnait la belle chanson de Lina, presque aussi vieille que lui, et il se souvint de cette soirée de Noël à Fréjus, de Ginette qui avait abusé d’alcool et de leur tournée à Cogolin, la forêt des Maures et Collobrières…
Cela fit rire Larbi ce qui eut pour effet presque instantané de faire taire son grand-père, gêné. « C’était un beau week-end à Fréjus, tu te souviens Larbi ? » Il était peut-être à l’étage Larbi, il répondit qu’il ne se souvenait pas. Hadj, Évelyne et leurs enfants avaient pris la route. Pour Saint-Lambert. Jeddi Kada, forcé par la tyrannie de son grand âge et la chaleur suffocante, s’arrêtait de temps à autre pour reprendre son souffle et s’éponger le front et le cou avec un mouchoir en papier. Ils prirent ensuite la ligne 4 jusqu’à Montparnasse. Le trafic était remarquable, mais pas insupportable en cette après-midi de début juillet. À 15 h 30, les plus importants mouvements de voyageurs étaient passés. Comme à la Gare de l’Est, ils descendirent de la rame de métro pour effectuer un changement. Ils prirent la ligne 12 en direction de la Mairie d’Issy. À la cinquième station, ils sortirent. Convention est la plus proche station de métro du Centre culturel algérien. Comme ils voyagèrent debout (Kada ne s’offusqua pas que dans la rame de métro personne ne lui eut proposé son siège. Il connaissait bien Paris, ses transports et le peu de considération qu’on accorde aux personnes âgées), Kada demanda à s’asseoir quelques minutes sur un banc du quai avant de continuer. En montant l’escalier mécanique, il calculait le temps que cela leur avait pris : près d’une heure et trente minutes. Il faisait ce calcul mental, car il pensait au retour. Quitter suffisamment tôt la commémoration de l’anniversaire de l’indépendance du pays, pour ne pas avoir à rentrer trop tard. Tant pis ! ils ne verraient pas le film de René Vautier. Son esprit étant préoccupé par cette question, Kada ne voyait pas, n’entendait même pas le groupe de jeunes qui arrivaient dans leur direction, surgis d’on ne sait où en criant à l’unisson « bleu, blanc, rouge, la France aux Français, Sieg heil ! » La plupart des jeunes montaient deux par deux les marches du large escalier en ciment, alors que deux prirent l’escalator à toutes jambes. Lorsqu’il arriva à la hauteur de Larbi et de son grand-père, l’un d’eux demanda à Kada « t’es blanc monsieur ? » Surpris par la question ou n’en ayant pas saisi le sens, Jeddi ne répondit pas. Il tourna la tête vers les jeunes gens puis vers Larbi, en souriant. Un deuxième, de ceux qui prirent les marches, fit un geste du bras à son intention, un de ces gestes interdits par la loi et que Kada croyait — par son engagement passé, il y a plus d’un demi-siècle — avoir contribué à son éradication. « Sieg heil ! » répéta le jeune. Le même qui se trouvait derrière lui sur l’escalator, celui qui lui demanda s’il était blanc, glissa deux doigts dans la poche arrière du pantalon de Kada pour lui subtiliser le portefeuille qui dépassait. Puis il tira fortement vers le bas. Kada protesta en traitant le jeune homme de voleur, de voyou. Tout en haut de l’escalier mécanique, que Kada s’apprêtait à quitter, le jeune lui assena de violents coups sur la tête et au ventre. Déséquilibré, Kada trébucha puis tomba à la renverse du côté du grand escalier en ciment, juste à côté. Puis il en dégringola les marches jusqu’à la dernière. On eut dit une répétition d’une scène de film noir. Les gens qui montaient ou descendaient se figèrent. Deux jeunes filles se précipitèrent sur lui « monsieur, monsieur ? » Kada avait la tête en bas, le souffle court. Il gémissait, ne pouvait plus se relever. Larbi criait « Jeddi, Jeddi ! » Il n’entendait pas les filles le questionner. Les voyait-il ? Des douleurs atroces parcouraient le crâne du grand-père, ses bras, tout son corps, son être, de plus en plus sourdes, insupportables. Il s’efforça de bouger, mais il ne put. Sa tête cogna plusieurs fois contre le rebord des marches. On entendait un moment les agresseurs hurler :
« On nous demande pourquoi la violence
On répond que c’est pour protéger notre domaine
Oui nous sommes la Zyklon army
L’armée des skinheads NS
Sieg, sieg, sieg !
Heil, heil, heil ! »
Puis ils disparurent. Kada leva péniblement son bras droit, l’index pointé au plafond comme s’il accompagnait une supplique. Larbi se pencha sur lui en hurlant « Jeddi, Jeddi ! » De nombreux passants s’arrêtèrent. Quelques-uns composaient des numéros de téléphone pendant que les deux jeunes filles continuaient de consoler Larbi autant qu’elles pouvaient. D’autres personnes, parce que leur marche était ralentie, passaient en maugréant. Dans le quart d’heure qui suivit, Kada était allongé dans une ambulance qui le transportait à l’hôpital Vaugirard qui se trouve à quelques centaines de mètres. Les médecins du SAMU firent asseoir Larbi entre eux. Les employés demandèrent au garçon le numéro de téléphone ou l’adresse de ses parents après s’être informés sur son lien de parenté avec Kada, ce qu’avaient déjà tenté les urgentistes. Mais Larbi, hagard, choqué, n’était pas en état de répondre à leur sollicitation. Quelque chose se tramait dans sa tête. Quelque chose de violent contre ces hommes, ceux qui les agressèrent il y a quelques heures et leurs semblables, contre tous ces hommes qui portent en eux les germes de la malédiction et de l’aversion. « On ne leur a rien fait », se répétait-il alors qu’un sentiment étrange montait en lui, de moins en moins opaque et dont il se souvenait l’avoir ressenti par le passé, mais jamais à ce niveau-là. Quelque chose qui le remue au plus profond. « C’est peut-être ça la haine absolue, se demanda-t-il, cette chose qu’éprouvent les soldats dans la guerre ? » Il se souvint de cette après-midi, peu avant Noël, quand son grand-père lui racontait sa mésaventure dans un café du Raincy. Larbi ne pouvait articuler ne serait-ce qu’un mot.
Alertés, Hadj, Évelyne et leurs enfants arrivèrent tard dans la soirée sans pouvoir accéder à la morgue de l’hôpital. Hadj n’était pas en état de conduire. C’est Évelyne qui prit le volant depuis Saint-Lambert. Ils ne mirent qu’une heure pour arriver, mais ils trouvèrent les portes fermées. La vie avait abandonné le vieil homme dans une des salles d’opération de l’hôpital où l’avaient installé les médecins.
Ce matin, la famille se rendit au funérarium de Batignolles bien avant le transfert du cercueil. Ils durent attendre plusieurs heures, jusqu’au creux de l’après-midi. Il y a maintenant Yanis, Sarah, Omar, Larbi et leur mère. Hadj, Évelyne et leurs enfants sont également présents. Messaoud arriva d’Oran par le vol de 14 heures. Il ne restera que quelques jours, le temps qu’il faudra pour procéder à toutes les formalités nécessaires au rapatriement du corps de son père. Il lui faut en priorité faire venir l’imam. Kada sera inhumé dans le grand cimetière de Caïda H’lima, à Aïn-Beïda.
Dix adolescents jouent au football dans le stade numéro 3 du Parc des sports Alfred-Marcel Vincent de Livry-Gargan. Le stade numéro 3 est celui qui donne sur la rue Fürstenfeldbruck. En fin de journée, les corps frisent l’épuisement. Les joueurs sont en sueur, exténués, comme chaque fois qu’ils se retrouvent pour disputer une ou plusieurs parties sans fin durant lesquelles la montre n’a aucune utilité. Sauf en cette période particulière. « J’arrête ! » lance Samir alors que la belle journée décline. Les garçons tapent dans le ballon depuis tellement longtemps qu’aucun ne saura donner l’heure approximative du coup d’envoi si on le lui demande. Dans ce type de rencontres — pas toujours amicales —, il n’y a ni maître ni chronomètre. Le groupe est seul juge et arbitre. Le téléphone de Samir indique 17 h 12. C’est l’heure pour nombre d’entre eux de rentrer prendre le repas. La majorité des jeunes ne burent ni ne mangèrent de toute la journée. Depuis samedi dernier — premier des douze jours de « vacances de la Toussaint » —, ils viennent presque tous les jours dans ce stade nu, peu convoité par les grands, pour taper dans le ballon, « passer le ramadan » pour la plupart d’entre eux. Ce jeudi est le dernier d’octobre. L’école reprendra le 3 novembre, mais ce jour-là presque tous resteront chez eux. On ne va pas en classe un jour de fête et l’aïd en est une très importante. Les jeunes ramassent leurs effets, s’essuient le visage et quittent le stade. Quelques-uns se chamaillent à propos de la responsabilité d’un corner inabouti. Ils traversent la rue Fürstenfeldbruck et le chantier qui se trouve à quelques mètres du Funérarium. L’employé de garde — pensant qu’il s’agit de malfaiteurs — appelle le standard de la police qui alerte une brigade anti criminalité qui patrouille dans les parages : « Il y aurait des voleurs dans le chantier. » Dans les minutes qui suivent, une voiture de police pile à hauteur du funérarium. Surpris par le véhicule qui stoppe net devant lui, David s’immobilise. Il est aussitôt interpellé. Ses neuf camarades prennent spontanément la fuite. Aucun n’a de pièce d’identité sur lui. Leur arrestation aurait pour effet un passage obligé par le poste de police pour vérification d’identité précisément, et par conséquent, pour la plupart, rater le moment de la rupture familiale du jeûne. Durant le mois de ramadan, on est tous ensemble au moment de la rupture du jeûne. Tout retard peut donner lieu dans la famille à des interrogations, souvent exagérées, alarmées. Les parents ne comprenant pas comment, après une dure journée sans rien dans le ventre, on puisse encore traîner au-delà de l’heure, de la minute même annonçant la rupture du jeûne. Les adolescents courent autant qu’ils peuvent, poursuivis par le véhicule de la BAC. De temps à autre l’un d’eux se retourne pour mesurer l’efficacité de leur course et la distance qui les sépare de leurs poursuivants. Dans leur traversée de la Résidence du parc Vincent Auriol ils ne ménagent ni plantes, ni gazon, ni conteneurs de poubelles. Arnaud, Marcel et Bernard sont arrêtés alors qu’ils s’apprêtaient à couper par le Chemin des postes, rattrapés par la voiture de police qui contourna par la rue Jean Zay et l’allée Robert de Wey, derrière l’IUFM. Les autres, Mahiddin, Yasin, Samir, Zyed, Hassana, et Bouna, se dirigent vers le cimetière de Clichy-sous-Bois. D’autres véhicules de la BAC arrivent. On entend plusieurs chiens aboyer, en même temps que hurlent des sirènes de voitures de police. Un des brigadiers lance dans la radio : « On vient d’avoir l’information comme quoi il y aurait des jeunes qui courent au niveau du cimetière. Nous on est sur place. Envoyez du monde. » Il est 17 h 31. Trois policiers abandonnent leur véhicule pour entrer dans le périmètre du cimetière. Yasin se tapit dans les bois quelques minutes avant de s’enfuir sur la gauche en direction du Conservatoire de musique. Hassana et Samir continuent droit devant. Ils pénètrent dans le cimetière, prennent la première allée, bifurquent vers les cyprès à gauche, avancent de quelques mètres encore. Derrière un talus semé de plantes sauvages, ils se laissent tomber à terre. Un nouvel appel radio est lancé : « Deux individus sont en train d’escalader un mur pour s’introduire dans les installations d’EDF. Il faut du monde pour cerner la zone. Ils vont bien ressortir. S’ils entrent dans le site EDF, je ne donne pas cher de leur peau. » Il y a à ce moment dans la zone du cimetière et autour du site d’EDF quatorze brigadiers de police. Les jeunes qui escaladent le mur d’enceinte sont Mahiddin, Bouna et Zyed. UPP 866, le policier de proximité qui demanda qu’on « envoie du monde », et ses deux collègues Suzy Ka et Pierre Gé se dissimulèrent eux aussi quelque temps derrière des tombes. Les trois brigadiers longent ensuite le mur d’enceinte de la zone à la poursuite des jeunes qui l’escaladèrent. À quelques mètres de la rue des Prés, l’un des deux hommes se hisse sur une grande poubelle du pavillon qui jouxte la zone. Il ne voit rien, n’entend rien, sinon le grésillement de son Talkie-walkie et Suzy Ka qui s’impatiente. « Y a rien », lui répond-il. Les policiers rebroussent chemin jusqu’au cimetière où ils appréhendent Hassana et Samir blottis derrière le talus, tremblant de peur. UPP 866 annonce dans son récepteur-émetteur : « Interpellation de deux individus au niveau du cimetière : le premier, type africain, habillé en bleu : Hôtel, Alpha, Sierra, Sierra, Alpha November, Alpha. Le deuxième, type nord-af : Sierra, Alpha… »
Les trois autres jeunes Bouna, Zyed et Mahiddin passent de l’autre côté du grillage contre lequel est accroché un grand triangle. En son centre, un logo alerte sur la dangerosité des lieux et les risques encourus. Sous le triangle, en appui, ces trois mots : « Danger de mort » et une mise en garde « Défense absolue de pénétrer. » Dans leur fuite-panique, les trois jeunes ne voient ni les panneaux ni les imposants tags noirs « Stop, ne risque pas ta vie », « Stop ! l’électricité c’est plus fort que toi ! » Ils se réfugient dans le « local de réactance » où circule un courant de vingt mille volts. À 18 h 11’ 03’’ un arc électrique foudroie Zyed et Bouna. Mahiddin, grièvement blessé, réussit à se traîner jusqu’à la barre d’immeuble où il habite pour alerter les proches. Plusieurs communes sont privées d’électricité, une partie de la soirée. À 20 h, un important attroupement se forme devant le commissariat de police, et simultanément des échauffourées sont engagées.
Charly est attablé à l’intérieur de la brasserie L’Avenue. Il est en avance sur son rendez-vous. En attendant l’homme qui bientôt lui remettra d’importantes informations, plus que cela, d’importantes orientations concernant Séphora, Charly parcourt un article sur le Colombien Gerardo Antonio Bermúdez alias Francisco Galan. Le plan détaillé des opérations de la phase deux de la mission Séphora (Séphora F.) tomba ce mercredi 26 octobre au matin, à la suite de la sortie du ministre français de l’Intérieur la veille à Argenteuil, lorsqu’il qualifia les jeunes de « bandes de racailles ». Une première intervention du même ministre avait mis en alerte les équipes de Séphora. C’était à La Courneuve en juin, lorsqu’il se dit prêt à « nettoyer les cités au Kärcher ». L’ordre de passer à la phase supérieure de la mission Séphora F. fut donné dans une brasserie. La mission Séphora F. consiste à susciter des tensions ou à les maintenir, au sein de plusieurs départements de France à forte population maghrébine africaine et musulmane afin de les rendre ingérables. Favoriser les conditions du chaos. Les interventions médiatiques de Charly font partie de la phase une. Il s’agit à présent de compléter le dispositif en déclenchant la phase deux. Ordre fut donné à Charly d’activer ses agents dormants. Séphora F. est une structure légère, composée essentiellement de citoyens franco-israéliens. Elle est en charge d’actions très précises. Charly en est un membre important, mais il lui est conseillé de se faire discret sur le terrain. La mission Séphora F. — F pour France, comme il existe une structure ad hoc pour la Belgique, Séphora B., une autre pour le Maghreb Séphora TAM., etc. — s’inscrit dans le cadre d’un plan directeur nommé Moïse, pensé par les services secrets israéliens à la suite de la destruction des tours jumelles du World Trade Center. Elle fut améliorée pour sa partie française après l’élection présidentielle en France de 2002. Son socle fut complété sur la base des interventions au colloque organisé par l’Alliance israélite universelle en novembre 2004 en son siège, rue La Bruyère à Paris. Le schéma directeur reprenait de nombreux passages de la communication du philosophe André Glups, membre du PNAC (Projet pour un nouveau siècle américain, un think tank néo-cons) et du chercheur Jacques Taréno, également membre du Conseil représentatif des institutions juives de France. La mission Séphora F. a pour objectif de réaliser des opérations ayant pour finalité de fomenter des troubles en France de sorte que l’image des « Arabes des banlieues » et des musulmans en général se dégrade le plus possible auprès des Français. Selon ces services, les « Arabes des banlieues » françaises sont à la source de la résurgence de l’antisémitisme et de la représentation négative d’Israël en France. « Séphora, notre fer de lance, introduira le venin qui éradiquera ces Arabes des banlieues », déclarait un des leaders des Services israéliens. La mission Séphora fut pensée et mise en place par la division Lohamah, une des nombreuses divisions du Mossad, dans le cadre du plan Moïse. La responsabilité de l’exécution de la mission en France incombe à Yaïr Klec. L’hexagone est découpé en cinq zones : Nord-Ouest, Nord-Est, Sud-Ouest et Sud-Est et la zone Centre. À la tête de chaque zone se trouve un chef avec grade de Lieutenant colonel : Sgan halouf. Charly est le halouf de la zone Centre, c’est-à-dire l’Île-de-France, Paris et les sept départements qui l’entourent.
Charly se trouve dans la brasserie L’Avenue depuis une dizaine de minutes, bien en avance sur l’heure du rendez-vous, et bien au chaud. Lorsque le timbre de la sonnerie de son téléphone retentit, il se redresse. Cette petite musique particulière — Ode à la joie de Beethoven — indique que l’appel émane d’un élément de l’ambassade d’Israël. La personne au téléphone lui demande s’il se trouve bien sur le lieu prévu. Charly vient de commencer la lecture du quotidien Le Monde qu’il acheta à un kiosque sur les Champs Élysées. Il avale une nouvelle gorgée de son expresso et reprend sa lecture, interrompue par la sonnerie de son Smartphone. Il s’attarde, un brin nostalgique, sur un article de la page 12 : « Francisco Galan, la paix ou la prison ». Le journal relate les tentatives du guérillero colombien pour convaincre ses pairs de l’Ejército de liberación nacional, de s’asseoir à la table des négociations avec le gouvernement. Galan avait été libéré par le président Alvaro Uribe pour atteindre cet objectif. Sa lecture de l’article finie, Charly plie le journal et s’abandonne au repos. Quelques minutes plus tard, alors qu’il est toujours plongé dans ses pensées, il sursaute, fait un mouvement brusque. Il vient de ressentir une présence. L’homme qui se tient debout devant lui lui fait signe de rester assis. C’est cet homme qui bientôt lui donnera dans le détail les éléments de la phase deux de la mission Séphora F. Aussitôt Charly éteint le regard dur qu’il a presque spontanément, « un regard inquisiteur et sombre d’aigle noir » le qualifiait Yaïr Klec. Un regard qui accentue la sévérité naturelle que dégage son visage.
Aussitôt après la rencontre de l’avenue Montaigne, Charly téléphone à Victor O., Raphaël E. et Eli C. pour leur fixer un rendez-vous pour le lendemain à midi chez lui, rue Blanche. Ces trois hommes constituent la première des deux équipes de la zone Centre sous l’autorité de Charly. Cette équipe A est en charge du « cœur de l’île » c’est-à-dire des départements 92 à 95 ainsi que de Paris. L’autre équipe, B, est responsable des « départements périphériques » 77, 78, 91. Ces hommes, Victor, Raphaël, Eli et Charly, se connaissent depuis longtemps. Ils exécutèrent plusieurs opérations ensemble — la dernière étant leur intervention musclée (en appui au groupe B) pendant la manifestation du 8 mai organisée à la place de la République par Les Indigènes de la République —, mais le pacte scellé exige qu’on n’approfondisse pas les liens, qu’on évite de se rencontrer en dehors des missions. C’est une règle parmi d’autres et tous les partenaires n’ont aucun autre choix que de l’appliquer. Une condition sine qua non. « On ne pose pas de question, on exécute les ordres. » Les collaborateurs de Charly le connaissent comme un sioniste convaincu. Ils le connaissent également par son métier. Mais ils ne savent quasiment rien à ce jour de la relation qu’il entretient avec les services israéliens et leurs correspondants à l’ambassade d’Israël à Paris. Charly ne fait pas mystère de son lien indéfectible, « éternel » aime-t-il répéter, avec Israël, mais il n’évoque jamais qu’en termes banals telle ou telle rencontre avec des employés de l’ambassade de cet État. Victor et les autres savent eux-mêmes les limites — considérant leur contrat — qu’ils se doivent de s’imposer. Charly ne parle jamais de son passé auprès des phalanges libanaises ni de sa virée colombienne. Ils le respectent, et l’appellent parfois « tonton Charly ». Victor, Raphaël et Eli sont commerçants. Leur âge est proche de la trentaine. Trente-trois pour Eli le plus âgé. Celui-ci tient une supérette à Ivry-sur-Seine, sur la Villa d’Ivry, accolée à sa maison, derrière le métro Pierre et Marie Curie. Raphaël est cordonnier à Sarcelles, sur le boulevard de la gare. Victor tient une enseigne dans le centre commercial Bobigny2. L’activité principale de First Copy, sa boutique, consiste à reproduire toutes sortes de documents. Ils ont tous les quatre cette originalité physique qui les fait ressembler à un quelconque quidam venant du sud de l’Europe ou du pourtour méditerranéen, de Porto-Vecchio, de Byblos, de Héraklion ou de Tataouine.
Autour du buffet froid, les quatre compères devisent à propos de la mobilisation des étudiants de l’université de Rouen, du Contrat nouvelles embauches, des centaines d’Africains abandonnés dans le désert par les autorités marocaines… « Passons aux choses sérieuses ». Charly livre l’exposé qu’il prépara hier soir dès qu’il rentra chez lui. Après quoi ils procèdent à un récapitulatif détaillé. Les questions sont posées, les réponses apportées et les ordres distribués. Il lui faut conclure. Dans son ventre, il entend des gargouillements, « mauvais signe » pense-t-il. Il libère ses collaborateurs en leur donnant rendez-vous dimanche autour de 14 h à la porte de Pantin, à La Brasserie de l’horloge. Charly est satisfait et impatient. « N’oubliez pas deux choses à faire dit-il, la première est de retarder vos montres d’une heure samedi soir, la seconde est de regarder l’émission d’Ardisson le même soir, vous ne serez pas déçus. » À Eli il dit en clignant de l’œil « nous deux on se voit samedi ». Charly lève le bras droit en guise de salut, et lance « Par la tromperie, la guerre tu mèneras ! » et les trois autres de reprendre « Par la tromperie, la guerre tu mèneras ! » Aussitôt la porte claquée il se précipite aux toilettes. Sa main glisse sur la poignée. Il se reprend à deux fois pour ouvrir la porte. Il appuie sur l’interrupteur, la braguette est coincée, il desserre sa ceinture, brutalement, trop tard. Une grosse tache brune molle écœurante déborde de ses fesses, coule le long des jambes de son pantalon.
Charly se rend chez Eli à Ivry l’après-midi de shabbat, alors que l’affluence du marché des fruits et légumes de l’avenue Henri Barbusse céda la place à un calme relatif, les commerces ne s’animeront de nouveau qu’en fin de journée. La veille il rencontra Marek, son adjoint de la seconde équipe. Il lui livra les éléments en sa possession et le chargea de les communiquer aux deux autres membres de l’équipe, « faut se tenir prêt à l’action ». Le temps est maussade. Le ciel menacera bientôt toute la banlieue sud, est et nord. Charly tint à être présent pour la préparation des armes. Eli n’aurait pas compris que la tâche lui incombât à lui tout seul. Dans son garage, ils vident dans des seaux le contenu des bouteilles de bière qu’Eli avait entreposées sous le panneau d’outillage. Ils les essuient en y enfonçant un chiffon, puis les remplissent d’essence. Eli met de côté les deux seaux remplis de bière. Celui qui contient la Mort subite est pour sa consommation personnelle, le contenu de l’autre — il déteste la Duvel — qu’il n’ose pas proposer à Charly, et puis comment l’emportera-t-il ? il l’offrira ou le jettera « c’est moins risqué ». Charly et Eli confectionnent une quarantaine de cocktails Molotov qu’ils rangent dans le coffre de la Renault 25 d’Eli, dans quatre boîtes en carton ondulé. Les bananes qui étaient contenues dans les boîtes sont déposées dans le rayon fruits et légumes de son magasin mitoyen fermé ce jour, c’est samedi. Le travail fini, Eli plonge une casserole dans le seau de la Mort subite. C’est leur récompense immédiate. Les deux compères boivent à tour de rôle et Charly profite du moment de détente pour rappeler à Eli l’importance de la mission qui les attend dimanche. « Ah, j’oubliai ! » le coupe Eli. Il ajoute « attends, j’arrive ». Il disparaît quelques minutes par la petite porte qui donne sur son magasin. Lorsqu’il revient, il tend une barquette de briquets électroniques jetables. « Évidemment ! » lance Charly en secouant la tête. Eli jette le lot de briquets dans le coffre de la voiture. Après avoir vidé la casserole de la bière, ils quittent le local. La discussion continue jusqu’à la bouche de métro où ils se séparent. Eli revient dans son garage alors que Charly s’engouffre dans le métro pour rejoindre Pont du Garigliano où se trouvent les studios de télévision. Exceptionnellement l’émission d’Ardisson à laquelle il est convié sera présentée en direct.
Depuis jeudi, et plus encore depuis la manifestation qui suivit le lendemain, durant laquelle des centaines de personnes marchèrent en silence à la mémoire de Bouna et de Zyed, des rumeurs les plus extravagantes et jusqu’aux plus invraisemblables se propagent à travers les tours et les rues de la ville. L’une d’elles concerne Mahiddin qu’on prétend décédé des suites de ses blessures. Son oncle pourtant démentit dans la journée la mort de son neveu. Celle de Bouna et Zyed bouleverse toute la ville et au-delà. En ces derniers jours de ramadan, Clichy-sous-Bois retient son souffle. Que se passera-t-il les jours suivants ? La version que répètent les officiels « la police ne poursuivait pas les jeunes », personne n’y croit, hormis des agents de l’État. Si les jeunes n’étaient pas poursuivis par la police qu’avaient-ils à s’engouffrer dans un transformateur électrique ? Étaient-ils devenus fous ? Pourquoi quatre équipages de policiers ? Et puis la transcription radio des policiers divulguée par un journaliste est édifiante. « On nous prend pour des imbéciles », s’insurgent nombre d’habitants.
Ce samedi soir, dans l’appartement de Yanis — il se trouve dans la cité de la rue Picasso à Montfermeil —, autour de la table de la salle à manger, il y a les trois frères. Yanis est absorbé par la lecture du journal Metro, Omar et Larbi regardent la télévision. Il y a aussi Sarah qui s’éreinte dans la cuisine. C’est elle qui fait à manger pendant le ramadan. À cause de l’importante augmentation des tâches ménagères durant ce mois sacré, elle ne s’aperçoit pas du temps qui passe. Lorsqu’elle s’exclame « c’est l’heure ! » ou bien « on mange dans deux minutes ! » aussitôt ses frères se précipitent pour mettre la table. Ça, ils savent faire. Quand tout est prêt, le citron coupé, les dattes distribuées, le lait fermenté, lben, versé dans les verres, Sarah dispose son petit tapis dans un coin du salon pour prier, salat el maghreb, la prière du couchant, et une autre, spécifique à cette nuit du Destin qui s’annonce : La fatiha, une soura, inclinaison, double prosternation, le tout deux autres fois et le Salam alikoum, à droite d’abord puis à gauche. Au menu du repas : hrira comme tous les soirs, chorba au poulet, salade… sans oublier les incontournables, zlabiya et chamia. Après le repas, c’est Sarah qui prépare le thé, et encore elle qui lave, rince et range la vaisselle. Elle sait qu’aucun de ses frères ne glissera la main dans l’évier, ne trempera le petit doigt dans l’eau. S’ils consentent à mettre la table, ils rechignent à faire la plonge. Sarah aurait aimé suivre les émissions de télé du bled, des émissions spéciales diffusées durant tout le mois de jeûne, mais Yanis, contrairement à l’oncle Hadj, n’installa pas d’antenne parabolique. Si tout se déroule comme prévu, si elle ne redouble pas sa troisième année comme ce fut le cas pour la deuxième, Sarah obtiendra le diplôme d’infirmière, dans un peu plus d’un an et demi. Omar veut travailler ou suivre une formation rémunérée, le lycée ne l’intéresse plus. Quant à Larbi, il commence à lâcher prise malgré les remontrances et encouragements mêlés de son grand frère, ou à cause d’eux. La disparition de Kada l’affecta plus qu’aucun autre membre de la famille. Rien ne semble plus l’intéresser. Il passe des journées entières avec ses amis de la cité, assis à même le trottoir, ou debout le pied posé contre un mur. Lorsqu’on lui demande ce qu’il fait, comme on demanderait quelle est son occupation, il répond « je tiens le mur », parfois il dit « muriste » en souriant. Larbi sourit toujours. Mais s’il souhaite éviter tout bavardage, il dit « rien » ou bien il hausse les épaules en étirant ses pommettes ou alors il tapote avec son doigt l’oreillette de son téléphone pour faire comprendre que ce n’est pas le moment de le déranger, en arborant une légère grimace. Lorsque dans les discussions on évoque la famille, Larbi parle souvent de son grand-père. Il dit combien il s’en veut de n’avoir su le protéger. Et son visage se ferme. « Ils étaient nombreux les fachos. » Yanis est le seul à avoir achevé ses études. En novembre dernier, il soutint un mémoire de Master2 de sociologie à Saint-Denis, « Identité (s) et lecture de la presse : les Français issus de l’immigration algérienne. » Mais, depuis, il ne trouve pas de travail à la hauteur de son diplôme. Il se contente d’emplois alimentaires. Cela fait un an qu’il vit de petits boulots. Il participe à des enquêtes comme son père en son temps et presque au même âge, vingt-huit ans auparavant. « Enquête d’opinion auprès du public ». Se déplacer dans une ville précise, dans telles et telles avenues, rues, impasses. Du porte-à-porte. Viser telle zone pavillonnaire, tels groupes d’immeubles, telles catégories d’habitants, telles tranches d’âge, toquer à la porte du pavillon ou sonner à l’interphone de l’immeuble, convaincre, monter les marches, frapper à la porte, montrer son « attestation d’enquêteur » de la Sofres, accepter avec le sourire les nombreux refus. Aux enthousiastes poser toutes les questions exactement comme elles sont écrites sur les dix feuillets à l’intérieur de l’appartement, pas au seuil, pas dans les couloirs, faire signer, remercier, descendre. Tous les jours. Périodiquement Yanis reçoit une ou plusieurs notes signées par le service du personnel de la Sofres : « Nous vous informons que votre virement s’élève à 48,12 € », ou « 198,21 » ou « 8,60 »… selon le nombre de questionnaires validés par les contrôleurs du bel immeuble de la rue Barbès à Montrouge. Parfois juste de quoi remplir de quelques litres le réservoir de sa R25 GTX sans âge, très gourmande. Depuis la fin de ses études, Yanis ne trouva que des emplois précaires, très mal rémunérés. L’annonce à laquelle il avait répondu stipulait : « Sofres recherche enquêteurs H/F : 1– Pour enquêtes en porte à porte. Résider à Paris ou Banlieue proche. 2– véhicule nécessaire. 3– Pouvoir travailler l’après-midi, le soir et le samedi. Tél. au 05.12.20.05. XX. »
Après que le thé eut été bu et la vaisselle mise à égoutter, Omar et Sarah se préparent pour descendre au Stamu. « Dites à maman que je reste là » leur crie Larbi. « Elle est pas là ! » Larbi hausse les épaules sans se retourner. Il est saisi par les provocations de l’invité principal de l’émission « Tout le monde en parle » consacrée ce samedi à la question identitaire. C’est un type que connaît bien Yanis. « Il ressemble drôlement à papa ! » dit Larbi. On croirait qu’il sourit. Dans ses yeux on devine une secousse, une zone grise, un trouble. Le grand frère pointe l’écran de la télévision, offusqué lui aussi par les propos tenus. Au-dessus de ses doigts, la fumée de la Camel ondule, disparaît un temps, puis revient pour aussitôt se dissiper. Il dit, « ce clown ? ah non alors, tu ne le connais pas ». « Ben regarde ! » « Ouais, bon, il lui ressemble un peu physiquement, mais c’est tout, heureusement. Ce type, il passerait devant un miroir que son reflet glisserait en dehors du cadre ! Ce Pinto est un démon ! » À la gauche de l’invité principal, il y a un jeune rappeur, à la gauche de celui-ci Fog, un journaliste qui écrit pour un célèbre hebdomadaire. Il est invité partout, car, dit-on, il sait tout sur tout, de l’histoire des Gonds Koitur et du Gondwana, des poupées indiennes et de la vie de toutes les Cléopâtre et même de Dieu. Mimoun Pinto, n’y va pas avec le dos de la cuillère : « Je suis un Français de souche. Je suis judéocathodique… » On entend des rires. Pinto reprend : « judéocatholique… » Des invités sourient, pas lui. Il remue, tend le bras vers le rappeur, fixe l’œil de la caméra qui glisse devant lui, continue : « le soir le quartier des Halles est un cauchemar effroyable… Tous ces Bamboulas, ces Arabes, sont étrangers à notre identité nationale… Je ne suis plus en France, plus en Occident. Je suis en Afrique. » Et encore : « Le ministre a raison de parler de racailles, les violences dans les cités, comme hier à Clichy-sous-Bois, sont le fait de voyous fils d’immigrés musulmans, majoritairement d’origine maghrébine ou d’Afrique noire que le politiquement correct nous impose de taire. Il a raison le Abdel Outil, il est pourtant des leurs, qu’a-t-il dit ? ‘‘Ces Barbares des cités, il n’y a plus à tergiverser, il faut leur rentrer dedans, taper fort, les vaincre, reprendre le contrôle des territoires qui leur ont été abandonnés. Et vite !’’ Il a raison, la République judéo-chrétienne se doit de récupérer les espaces qu’elle a concédés à ses ennemis, contrôler les quartiers où ne s’applique plus sa loi, mais la leur. Si leur religion et leur culture sont un frein à leur intégration alors il ne leur reste qu’à aller voir ailleurs. Ce sont là les conséquences d’une immigration massive, continue et incontrôlée, venant du tiers-monde islamique pour l’essentiel… » « Wallah, je ne comprends pas cette haine que ce type nous inflige régulièrement à la télé et à la radio, ‘‘nous sommes fatigués de la haine’’… » Yanis est scandalisé, « si par malheur il arrivait au pouvoir, il nous obligerait à broder sur nos vêtements un croissant jaune je te jure ! La décolonisation algérienne lui est restée au travers de la gorge à ce revanchard ». Le rappeur se tourne vers Mimoun en pointant sur lui ses deux pouces dans un mouvement d’essuie-glace : « vous vous présentez comme ‘‘Français de souche’’. Je suis désolé, mais vous n’êtes pas ‘‘Français de souche’’, vous êtes une pièce rapportée par la grâce d’Adolphe Crémieux. Vous ne dites pas que ces ‘‘Barbares’’ comme vous les désignez, ont été marginalisés depuis des lustres. De temps à autre, avec ses doigts il figure des guillemets. Vous et vos semblables avez construit contre nous des plafonds de verre que nous ne pourrons jamais briser. Vous approuvez la provocation du ministre de l’Intérieur à Argenteuil pour qui nous sommes de la racaille et vous ne dites pas le mensonge du même au lendemain de la mort de nos deux amis Bouna et Zyed, grillés par un arc électrique alors qu’ils étaient poursuivis par la police, vous ne dites pas les bombes lacrymo… Ces jeunes manquent d’espoir et de respect. Ils sont rejetés par la République au-delà des cercles de l’égalité, de la liberté, de la fraternité, au-delà de leur plus lointaine périphérie. Ils sont humiliés, niés, les discours comme les vôtres incitent à une haine symétrique à votre propre haine monsieur. La haine de ces jeunes, vous la souhaitez. Vos propos contribuent au nihilisme, au suicide social. Et c’est ce que font ces jeunes en brûlant les crèches et les voitures de leurs proches. Ces enfants d’ailleurs sont d’ici, ils sont mes voisins, mes frères. Ah, qu’elle est insignifiante et criminelle votre haine, si vous saviez. Une nouvelle belle haine que vous ‘‘purifiez par l’amour de la Patrie’’, à l’image de votre ancêtre Drumont. De nouveau il forme des guillemets avec ses doigts. ‘‘Les mauvaises tentations vous manipulent, tout le monde peut atteindre ses rêves’’ monsieur ! » Charly reprit la parole avec, dirait Yanis, l’aplomb dont usent les bien-pensants, les biens installés médiatiques, sûrs de leur affaire : « Cette guérilla urbaine, cette révolte ethnicoreligieuse, je dirais même cette Intifada est inacceptable. Les parents sont responsables au même titre que leur progéniture. Ils doivent être sanctionnés pour manquement à leurs obligations. Il est de la première urgence que l’État s’occupe des Français et supprime les allocations familiales qu’il distribue à ces gens. Nous les avons accueillis les bras ouverts. Aujourd’hui, avec leurs enfants et petits-enfants ils forment un peuple dans notre peuple. Cela ne peut plus durer. Ces voyous, ces racailles qui vivent de trafic de drogue et imposent la loi de la jungle, leur loi, doivent être lourdement sanctionnés, et je dirais même renvoyés en Afrique du Nord. Les Français en ont assez de vivre au milieu d’ordures que personne ne retient de force chez nous ! » Mimoun est interrompu et même chahuté par le chanteur « nous n’avons rien à intégrer monsieur, nous sommes d’ici autant sinon plus que vous, arrêtez de déverser votre haine, vous vous trompez d’époque, nous ne sommes pas dans les années trente ! » Larbi répète « ce type ressemble bizarrement à papa », ce qui agace de nouveau le grand frère. « Arrête ! il est raciste, tellement raciste qu’il doit inconsciemment, mais profondément, détester sa propre personne ». Larbi ajoute « c’est un chien, pire qu’un chien, un rat d’égout. Si je tombe dessus je le démolis, j’te jure que je le bousille. » Yanis relève chez son jeune frère des paroles véhémentes marquées par la rancœur et ce n’est pas nouveau. Il constate qu’il adopte des comportements qu’il ne lui connaissait pas. Il ne sait pas que dans le cœur de son jeune frère monte ce même sentiment qu’il avait éprouvé contre les crânes rasés qui les avaient agressés Jeddi et lui au sortir de la station de métro Convention, et qui se proclamaient de l’armée des skinheads NS, qui criaient « Sieg, sieg, sieg ! Heil, heil, heil ! » Yanis ne le sait pas ou oublia. Larbi s’irrite plus facilement, il cherche à en découdre. Il se métamorphose. « Le bousiller ? » Yanis espère que ces mots outrepassent la pensée de son jeune frère. Pourtant en son for intérieur, lui-même bout certainement autant que lui. Il prend un moment, caresse sa barbe de trois jours, ne sachant comment traduire ses pensées, puis finit par lâcher, « ce type a tellement honte de ses racines, des siens, de soi qu’il s’est complètement ‘‘peaulissé’’. Et il veut que tous les Sang-mêlé, tous les Arabes, tous les Noirs fassent comme lui, se blanchissent la peau avec du Blanc. Larbi ne lâche pas prise : « Jeddi disait ‘‘un chien reste un chien, même s’il se déguise en lion’’ ». Cela les fait bien rire. « Allah Irhmeh » dit Yanis. Larbi répète « que Dieu le bénisse » en portant son index droit sur ses lèvres, puis sur son front et son cœur. Yanis songe aux efforts qu’il entreprend depuis longtemps auprès de Larbi pour lui inculquer la tolérance, la citoyenneté, le vivre ensemble, mais son entreprise n’est pas aisée. Il redoute qu’il tombe définitivement dans le piège des haineux, qu’il utilise comme eux la méchanceté, la bêtise… Il constate de nouveau que les conseils concernant l’argumentaire qu’il lui prodigue de temps à autre demeurent sans grand effet. « Fais attention Larbi ne tombe pas dans le piège que ces racistes tendent, car c’en est un, ‘‘si tu combats les monstres tu dois veiller à ne pas devenir un monstre toi-même, et si tu regardes longuement l’abîme, l’abîme regarde en toi’’ dit le philosophe. » L’incompréhension de Larbi se traduit dans la forme que prennent ses yeux, deux grosses billes noires. Il fixe son grand frère, mais il ne peut articuler un seul mot. « Il faut savoir gérer sa colère frérot dit Yanis, mais je le sais, ce n’est pas toujours facile de garder son sang froid devant de tels poisons. »
Le dimanche à l’heure convenue, Charly, Eli, Victor et Raphaël se retrouvent dans La Brasserie de l’horloge. Après avoir fini leurs consommations et considéré dans le détail leurs rôles respectifs à jouer dans les heures à venir, les quatre missionnaires prennent place dans la voiture d’Eli. Durant le trajet ils détaillent de nouveau leurs observations, remarques et toutes choses importantes liées à leur mission. Charly reçoit mille et un compliments pour son énergique prestation télévisée. La conversation est parfois ponctuée de longs silences que Charly — par devoir ou par la position qu’il occupe dans le groupe — rompt par un jeu de mots, une contrepèterie, une question ou une pirouette quelconque. Les villes défilent, Bobigny, Bondy, Livry-Gargan, Clichy-sous-Bois. Lorsqu’ils s’apprêtent à stationner au cœur des pavillons de la cité en effervescence, juste en face du lycée Nobel, Charly donne à ses jeunes collègues une dernière recommandation : « Je vous rappelle que vous ne devez en aucun cas utiliser votre téléphone durant la mission, mettez-le en mode vibreur. Rendez-vous ici même devant le lycée entre 16 h 30 et 16 h 45. » Ils remontent ensemble l’allée de Gagny jusqu’au Carrefour des Libertés, puis chacun s’engage dans une direction attribuée. Charly regrette son parapluie. « Ça va tomber », songe-t-il. Il traverse la cité du Chêne pointu puis descend vers la mairie et le collège Doisneau. De l’intérieur de la voiture, il téléphone à Marek, « mardi 14 h à Blanche, informe les collègues. » Raphaël se dirige vers le complexe sportif. Quant à Victor, il bifurque à droite après le rond-point des Libertés, passe devant l’école primaire puis s’engouffre dans la forêt de bâtiments surchargée de parcs automobiles bondés, de poubelles débordantes, de tags démesurés. Eli ne s’éloigne pas du lycée ni de la cité du Chêne pointu. Durant une heure chacun jaugera la tension sur le terrain, veillera sur les commentaires, repérera les leaders, jusqu’à l’heure du rendez-vous. Le dernier du groupe à retourner au point de rencontre est Victor. Il revient à 17 heures, complètement trempé. Un silence étrange se répandit dans les quartiers, aussi rapide et pesant que le silence d’une procession en marche vers le cimetière et les morts, alors que s’abat sur elle des trombes d’eau qui dispersent les vivants. Victor s’excuse du retard qu’il attribue à une conversation entre une vingtaine de jeunes devant la cité de la Forestière, un échange animé auquel il fut particulièrement attentif. « Il faut absolument nous concentrer autour du périmètre du complexe sportif », propose-t-il aux trois autres. « Je confirme, dit Raphaël, cette zone a été mentionnée plusieurs fois. » « Les derniers jeunes, reprend Victor, ont interrompu la discussion il y a dix minutes et se sont donné rendez-vous après la rupture du jeûne, autour du carrefour des Libertés avant de se ruer vers les entrées des bâtiments. » Chacun détaille ce qu’il observa durant les deux heures passées dans son secteur. « Rupture de quoi ? » interroge Eli. « C’est ramadan, ça fait presque un mois qu’ils bouffent pas ces cons » s’exclame Victor. « C’est à quelle heure cette rupture ? » Aucun n’a la réponse, mais ils conviennent que la situation est idéalement mûre. Ils approuvent la proposition de Victor. Par mesure de sécurité et avant d’entrer en action, Charly suggère de quitter provisoirement les lieux. Ils ont une bonne heure devant eux. C’est lui qui conduit la Renault d’Eli. Ils empruntent l’allée de Gagny puis la rue du 19 mars 1962, arrivent à la gare du Raincy par le boulevard du Midi. Pendant le trajet Eli, Victor et Raphaël prennent chacun une demi-douzaine de bouteilles prêtes à l’emploi qu’ils dissimulent dans leurs parkas ou doudounes. Les rues sont anormalement peu chargées dans cette ville huppée. Ils y avancent au hasard. Peu de voitures, peu de piétons, peu de vie. « Une atmosphère propice » pense Charly. Habituellement le dimanche on est plutôt enfermé chez soi, chez les grands-parents, au cinéma, ou même dans un stade… Sur la route du retour à Clichy-sous-Bois, la pluie diminue, puis cesse complètement lorsqu’ils atteignent la forêt de la fosse Maussoin. Charly dépose Victor sur l’Allée de Gagny, à hauteur du collège Romain Rolland, Eli et Raphaël deux cents mètres plus haut, sur la même allée, derrière le complexe sportif. Au-delà du complexe se trouve une zone pavillonnaire. C’est là que Charly gare le véhicule. Les espaces publics se remplissent peu à peu alors que la nuit maintenant tomba. Des bruits sourds se propagent en se transformant. Le tumulte gagne les quartiers les uns après les autres. On entend des sirènes de pompiers et de police. Dans les zones autour de La Forestière des jeunes invectivent les forces de l’ordre, de plus en plus menaçantes à leur tour. En quelques heures on passa étrangement d’une cité assoupie à une ville anormalement agitée. Des échauffourées émaillent le début de la soirée. Des poubelles brûlent. Les affrontements s’amplifient. Au journal de 20 h, le ministre de l’Intérieur promet une « Tolérance zéro pour les voyous ». Des femmes passent en courant les bras tendus vers le ciel ou vers une personne qu’elles croient reconnaître. Elles portent leur tenue d’intérieur et des tongs. Elles crient le nom de leurs enfants, parfois elles ajoutent « tu n’as pas vu mon fils ? » ou « il était pas avec toi mon fils ? » Nombreux sont les petits groupes qui se forment un peu partout autour de la cité. Charly repéra ses collaborateurs sur le boulevard Émile Zola, fondus dans la masse des jeunes. Victor se trouve à hauteur de l’école Henri Barbusse, Eli et Raphaël devant La Forestière, face à l’hôtel. Des rumeurs incontrôlables s’amplifient selon lesquelles « les flics ont brûlé la mosquée » ou « le garage de la police municipale a été entièrement détruit ». Monsieur Claude Dilain, le maire de Clichy-sous-Bois accourut avec des adjoints. Il implore les résidents « s’il vous plaît rentrez chez vous, rentrez chez vous ! » Un vieil Africain derrière lui, reprend « rentrez chez vous ! »
Un camion de pompiers est caillassé. Un vent de panique agrège tous les habitants de la zone comme un ban de poisson affolé, on s’agite dans tous les sens. Les attroupements se transforment en manifestations. « Venez, venez ! » s’époumone un jeune alors qu’un autre hurle des propos incompréhensibles, « la mosquée, leur race, la mosquée ! » Deux groupes se font face, le premier est constitué de trois ou quatre douzaines de jeunes prêts à tout certainement, le second de brigadiers casqués, protégés par des boucliers et armés de matraques. Monsieur Claude Dilain est en conversation animée avec le chef de la brigade. Deux minutes s’écoulent lorsqu’une autre brigade s’immobilise derrière la précédente. On lit au dos des uniformes 4B, 1B, 2A, 3C… Les groupes de policiers avancent vers les manifestants qui reculent, s’affolent. Eli et Raphaël se dirigent vers le garage-salle de prières, derrière la Mission locale. Le garage se vida de ses fidèles, forcés d’interrompre les tarawih, les prières surérogatoires du ramadan. Ils se précipitèrent à l’extérieur, car l’air dans le local devenait irrespirable. Certains suffoquent. « Ils ont jeté une grenade dans le Jamaâ les bâtards ! » Plusieurs jeunes ne souhaitent qu’en découdre avec les policiers qui avancent en rangs serrés. Ils crient « Assassins ! » Des hommes d’un âge mûr, portant grand boubou ou abaya, tentent de s’interposer « retirez-vous » disent-ils aux uns « on s’en occupe » lancent-ils aux autres en agitant les bras, sans succès. L’un d’eux se retrouva au sol, il se plaint, mais personne ne lui prête attention. Il finit par se relever péniblement en criant paniqué « c’est quoi ça, c’est quoi ça ? » Sur le trottoir d’en face, les flammes que rejettent les poubelles lèchent la vitrine et le caducée d’une pharmacie. Profitant de cette atmosphère insurrectionnelle Eli et Raphaël, en longues discussions avec les plus agressifs des adolescents, leur tendent des cocktails Molotov. Eux-mêmes en allument quelques-uns qu’ils lancent contre les forces de l’ordre. Raphaël crie « les flics, tous des feujs ! » Ils ont tous le visage dissimulé dans des keffiehs ou des foulards. Charly rejoint Victor devant l’école. Ensemble ils contournent le pâté de maisons pour se rapprocher de Eli et Raphaël. Ils se retrouvent tous les quatre sur l’allée Anatole France au milieu d’un groupe de jeunes qui jettent dans les poubelles tout ce qui leur tombe entre les mains pour propager le feu. L’un d’eux est Larbi. Il reprend les injures des plus grands à l’encontre des agents de l’ordre. Deux véhicules de la police municipale passent à proximité. Les gamins leur lancent toutes sortes de projectiles. Victor ne porte pas de keffieh, mais une cagoule noire sur laquelle il fixa un insigne : une croix de Savoie rouge et blanche, et un aigle noir aux ailes déployées. Il extrait un cocktail Molotov de son manteau, l’allume et le lance. Il en tend un autre à un jeune qui s’avance. De temps à autre Charly active son Olympus semi-professionnel qu’il tient discrètement en main comme un téléphone pour enregistrer ce qui se déroule autour d’eux. Il discute avec un groupe de jeunes, leur pose des questions naïves, quelques mots pour les hameçonner. Il se lamente comme un citoyen d’un quartier proche, dépassé. Raphaël et Eli s’approchent, alors que la tension est à son summum. Bachir, un des jeunes qui se trouvent près de Charly, semble intrigué. Il s’approche un peu plus de lui. Il voit de ses yeux une lumière vive se dégager. Il s’avance encore en le fixant avec intensité, si bien que le trouble qui saisit Charly empourpre ses oreilles. « Sioniste fout le camp ! » crie Bachir. Il ajoute « c’est un feuj, c’est un feuj, hé les mecs walla c’est un feuj ! » « Rssel femmek » lui rétorque Charly en le bousculant. Mais Bachir répète en hurlant du fond de ses entrailles « sioniste ! » Larbi reprend « Hé, c’est l’enculé de la télé, le halouf qui était chez Ardisson ! » Eli, Victor et Raphaël, ombres furtives, comprennent sur-le-champ que le feu peut à tout moment les emporter. Ils se volatilisent aussitôt, abandonnant Charly dans la tourmente. Une bagarre s’en suit. Un croc-en-jambe et celui-ci s’étale face contre terre. Malgré la douleur qui l’étreint, il ne lâche pas l’appareil enregistreur qu’il comprime dans sa main droite. Une dizaine de gamins sont sur lui. Les uns donnent des coups de pied, d’autres des coups de poing et de pied à la fois. « Quand lui le professeur il a eu cogné avec les mots, nous en bas on le nique avec nos pieds ! » s’amuse Larbi, déçu finalement par le physique de Charly qu’il voyait si grand à la télé en imposer par son élocution et dont il constate la petitesse là devant lui. Il est pris d’un fou-rire lorsqu’il aperçoit les bottines qu’il porte dont les talons sont ridiculement hauts. Il rit et il cogne et il cogne. De la poche de la veste où il glissa la main, il se saisit d’un petit carnet et d’un portefeuille. Alertée par les collaborateurs de Charly cachés derrière un camion de l’autre côté de l’allée, une brigade entière se précipite jusqu’au groupe qu’elle encercle. Plusieurs jeunes sont maîtrisés, puis embarqués sans ménagement dans des voitures de police banalisées et dans un fourgon. Charly dissimule l’Olympus dans une poche de son pantalon. Provocations et altercations se poursuivent jusque tard dans la soirée.
Larbi joue une partie de football avec ses amis à La Forestière, derrière le stade, entre le parking et la cité. Ils jouent en attendant l’appel du muezzin qui donne le signal pour la rupture du jeûne. L’appel d’el-addènn’est que théorique. Il n’y a pas d’appel, ou s’il y en a un, il est lancé — plus ou moins discrètement selon le degré d’implication idéologique du muezzin — de l’intérieur des mosquées. Chez soi, si on est branché sur une radio communautaire comme Beur FM, Radio Soleil ou Radio Orient, ou encore sur une chaîne de télévision maghrébine ou orientale, on l’entend le muezzin. Mais on ne peut s’y fier, c’est plus compliqué. On ne peut se fier à l’appel à la prière d’un muezzin installée à Médine ou à Tunis, car le soleil ne se couche pas au même moment à Pékin, à Paris, à Neuilly, à Bondy, à Rabat, à Djerba… Après tout chacun fait ce qu’il veut faire qu’il s’appelle Mohamed ou William. Par conséquent l’heure de la rupture du jeûne et avec elle l’appel du muezzin diffèrent selon les zones géographiques. Ainsi lorsque la télévision d’Arabie saoudite appelle à la rupture du jeûne, en France le soleil est encore haut. Au bled tout le monde l’entend el-addèn. Dans certains quartiers il y a trois voire cinq mosquées et donc autant de muezzins, et chacun y va de sa voix particulière, parfois agréable, parfois à faire brailler les nourrissons ou à perturber l’autre appelant. Chacun sait que ce dimanche « à Paris et ses environs » comme on dit sur Canal Algérie — cette chaîne algérienne qui n’oublie pas ‘‘notre communauté à l’étranger’’ mentionne en bas d’écran, au fur et à mesure, les heures précises de rupture dans les principales villes françaises — on rompt le jeûne à 17 h 34, heure d’hiver depuis la nuit dernière. Ce jour est le 27e de ramadan. La dernière semaine est la plus difficile, le jeûne pèse sérieusement tant au niveau physique que mental. Larbi n’est pas un fanatique. Il trouve que c’est dur et le dit. « Ce n’est pas comme au bled, là-bas, pendant le mois de ramadan, après qu’on a eu dormi toute la journée, on vit toute la nuit, alors bien sûr c’est plus cool. » C’est ce qu’il croit. Avec quelques-uns de ses camarades, il joue au foot en attendant l’approche de ladite heure. D’autres jeunes assistent au match ou chahutent. Ils se forcent de vivre normalement, mais la douleur pèse sur eux. Comment se résoudre à la perte d’amis ? Le climat s’alourdit dans Clichy chaque jour davantage depuis la mort jeudi de Bouna et Zyed. Le lendemain, ils étaient des centaines à manifester dans le silence. C’était la première fois que Larbi marchait avec autant de gens. Étranges vacances scolaires. Les agents de l’ordre avaient pris position un peu partout dans les cités, les carrefours et même dans les parcs. « Il nous traite de racailles, la racaille. Et le soir il a remis ça à la télé ‘‘tolérance zéro pour les voyous’’ » s’indigne Larbi. Vers 17 h, les jeunes joueurs se séparent. Quelques-uns restent dans les halls d’immeubles, mais la plupart rentrent à la maison. À peine quittent-ils La Forestière que des messages se mettent à tourner en boucles. Larbi en reçoit un sur son Nokia bleu fluo : « Slt. Urgent. Rejo1–9 h Carref. libertés. Envoie ce msg à ts t. potes. g-la-n @+ ». Aussitôt il transfère le texto à ses contacts qui habitent dans les environs. Larbi rentre manger chez Yanis. Il avale un bol de hrira et un autre de chorba frik, un verre de lben et claque la porte. Sarah crie « ton gâteau, la chamia, la chamia ! », mais Larbi est déjà à l’extérieur. Il se dirige vers le lieu de rencontre. Les précédents week-ends, Larbi rompit le jeûne à Bobigny chez son oncle Hadj, mais cette fois-ci il choisit de rester à Clichy et à Montfermeil. Les jours de semaine, il préfère aller chez le grand frère. Quand il commença à faire ramadan, Larbi avait sept ans et demi. Il s’en souvient très bien, c’était l’année de la coupe du monde de football en France. L’année de la fraternité. Depuis longtemps, Messaoud et Denise avaient acheté des formules foot « Pass 98 ». Chaque Pass donnait la possibilité d’assister à cinq matches (dont un huitième de finale) pour un montant de 700 francs. Un « Pass 98 » pour Yanis, un autre pour Omar et un troisième pour Larbi. Messaoud aurait bien aimé accompagner ses garçons, mais la note eut été « trop salée » c’est ce qu’il avait dit. Le plus beau des matches auxquels assistèrent les trois frères opposait la France à l’Arabie saoudite, parce que gagné 4 à 0 par la France. Mais ni Yanis, ni Omar, ni Larbi n’apprécièrent que leur héros, Zidane, écrase ses crampons sur un joueur adverse, à terre. Le carton rouge et l’exclusion du match il les avait bien mérités. Cinq mois plus tôt, en janvier 1998, Larbi avait commencé à jeûner par demi-journées ou bien un jour sur trois ou sur sept. Les ramadans passèrent et Larbi s’aguerrit. Depuis qu’il commença à pratiquer le jeûne, c’est le deuxième qu’il ne passe pas avec ses parents. C’est important le ramadan. Il réunit les membres de la famille tous les soirs à la même heure. Ce n’est plus le cas pour sa famille regrette-t-il, enfin ce n’est partiellement plus le cas.
Lorsqu’il arrive au Carrefour des libertés il y a foule. Il n’y a pas que des jeunes. On échange certainement plus de rumeurs que d’informations. « Le feu s’est propagé à Montfermeil, paraît qu’il a pris aussi aux Beaudottes à Sevran, aux Quatre mille », « à La Courneuve aussi, à Livry-Gargan, à Aulnay… » « C’est le bordel ! » se réjouissent des jeunes qui lancent des pierres en direction du McDonald’s. Depuis jeudi, ils sont nombreux les médias à roder dans Clichy. Ils sont partout, à l’affût du moindre mouvement, du moindre clash. « Des vautours » râlent certains adultes expérimentés. « Nous on sait pas parler comme les bourges, nous c’est comme ça qu’on parle, en mettant le feu » criait Bachir à un journaliste. Bachir Chakour et Roman Brauman sont les meilleurs amis de Larbi. Bachir habite à La Forestière, Roman au 4 allée Jules Massenet, dans la même barre chez une famille d’accueil. C’est un enfant de la DDASS. Larbi les connaît depuis tout petit, grâce au foot. Bachir étudie au lycée Nobel. Roman et Larbi sont en 3e, dans la même classe, à Louise Michel. Ils sont tous trois très liés, mais Larbi se sent plus proche de Roman que de Bachir, sans pouvoir se l’expliquer, peut-être parce que Bachir « il est un peu trop mytho » ou bien parce que Roman est orphelin, ou bien encore parce qu’il excelle au foot, ou peut-être qu’en plus de cela, qu’en plus de ses statut et qualité, il ne mange pas de porc lui non plus, c’est interdit chez eux aussi. Parfois ils se chamaillent, se traitent de tous les gros mots, mais cela ne dure pas, les mots s’inclinent toujours devant l’amitié. Roman est parti en vacances depuis une semaine. Il aimerait pour sûr se trouver avec ses copains. Le rond-point est noir de monde. Les policiers revinrent. Ils se positionnèrent derrière, vers Émile Zola. On entend des cris et la sirène des pompiers de plus en plus puissante.
De l’autre côté du carrefour, devant le Mac-Do, certains s’excitent. Ils crient « poulets racistes ! », « flics assassins ! » D’autres agitent les bras, montrent la direction d’un bâtiment, vers lequel ils courent « des poubelles et des voitures ont pris feu devant la Mission locale, venez ! » Un camion de pompiers qui essayait de traverser le carrefour reçut des projectiles sur le pare-brise, sur lequel désormais sont dessinées des lézardes aux formes de toiles d’araignées. Un groupe arrive en criant « ils ont brûlé la mosquée ! ils ont brûlé la mosquée ! » Plusieurs carrés d’habitants se forment instantanément. On s’émeut. Larbi a l’impression que c’est une force surhumaine qui soulève les manifestants et les pousse vers le boulevard Émile Zola. Les policiers sont armés comme s’ils se préparaient à atteindre un front de bataille armée. Le maire est arrivé avec deux collaborateurs. Il demande aux uns et aux autres de se calmer. Des vieux crient « rentrez, rentrez chez vous, doukhlou ! » Larbi dit que ces chibanis ne comprennent rien. Avec Bachir et d’autres amis, ils contournent le pâté de maisons par l’allée Romain Rolland. À l’angle d’Anatole France, la devanture de la pharmacie brûle. On court dans tous les sens. Une voiture de la police municipale s’aventure vers le groupe. Larbi et ses amis lui lancent des barres de fer et de grosses pierres, tout ce qui se présente. « Ils en ont pour leur grade ! » Des inconnus leur fournissent des bouteilles prêtes à être lancées, trois ou quatre hommes qui portent des foulards noirs et blancs masquant leur visage. Larbi se saisit de deux bouteilles. Il sait qu’elles contiennent de l’essence. Un des hommes tend un briquet BIC près du goulet de la bouteille, et, avec son pouce, il actionne la molette. En un éclair, le chiffon qui dépasse de la bouteille — l’affichette indique « Duvel » — prend feu. D’un geste vif Larbi la lance aussi loin qu’il peut. Il tremble. Il recommence avec une deuxième bouteille — l’affichette indique « Mort subite ». Bachir en jette au moins trois. L’homme lui offre son briquet. Il crie « les flics, tous des feujs ! » Bachir se prépare à allumer une nouvelle bouteille lorsqu’il se fige. Brusquement. On jurerait qu’il vit Satan. Il s’arrête net, puis il se met à hurler contre un homme comme si celui-ci était sur le point de l’agresser, comme s’il avait insulté toute sa famille ou comme s’il lui avait annoncé la fin du monde : « sioniste, salaud ! » crie Bachir, « chien de ta race ! », et il se met à lui donner des coups de pieds, de poings, suivi aussitôt par d’autres jeunes. Charly tente de se défendre, mais il est pris de court. Bachir hurle de nouveau « c’est le Kleb de la télé, regardez ! » On entend « Qu’est-ce qu’il fout là ? » Certains ne comprennent pas, se contentant de crier « qui c’est, qui c’est ? » en abreuvant l’inconnu de coups pour ne pas demeurer en reste. Larbi, lui, reconnaît formellement l’homme qui est passé la veille chez Ardisson. « Kelb, raciste, poison ! » dit un autre. Une ribambelle d’autres jeunes arrivent en courant. Larbi s’engouffre dans le tas, il se faufile en usant du coude, et comme tout le monde il expédie une série de coups de pieds au bas du dos et aux jambes de l’homme à terre. Il réussit même à lui substituer son épais portefeuille. Le type hurle en algérien « habsou, arrêtez ! » Les coups sont violents, mais le sont-ils autant que ses diatribes à la télévision contre les jeunes des quartiers ? Larbi se pose ces questions et les regrette aussitôt, peut-être considère-t-il qu’un mot n’est pas un coup. Puis il se reprend « lui il sait parler même en arabe, nous on ne sait pas, on n’a que nos pieds et nos bras pour nous venger, on n’a pas les mots des bourges. Lui, il a les grands mots et la radio et la télé et les livres. Il a tout pour lui le salopard. Il ne nous aime pas. Il a la haine contre nous. Pourquoi il nous déteste ? »
Larbi parle comme Bachir, comme tous ses amis. Les mêmes mots, la même haine. Larbi a tellement la rage qu’il ne se rend pas compte de ce qui se passe autour de lui. Brusquement la situation se retourne. Il y a maintenant de plus en plus de policiers, presque autant que de manifestants. Larbi est immobilisé en un clin d’œil par plusieurs agents des forces de l’ordre, les mains dans le dos et la tête dans les Rangers d’un agent. Lui et une dizaine d’autres jeunes, mais la majorité s’évapora. Eux sont roués de coups de matraque et jetés dans un fourgon grillagé, avant d’être conduits au commissariat. « Après qu’ils m’ont été tombés dessus comme sur Ben-Laden, ils m’ont donné des coups avec leurs godasses » dira plus tard Larbi au juge. Dans le Van, les policiers lui prirent son portable, mais pas le portefeuille qu’il avait glissé dans son caleçon. À l’intérieur il y a plusieurs cartes de visite, des cartes à puces, quelques billets de banque. Il y a aussi un petit carnet noir Rhodia sur les pages duquel sont écrits des chiffres et des lettres, et des mots obscurs. Le premier mot, écrit en caractères d’imprimerie, en majuscule est « MOISE », seul sur une page. Sur une autre, ceci : « ne pas perdre de vue que ce qui est en jeu c’est faire Étoile avec Stalingrad et Nation », puis « 1-1me8v ay9gv8 19 » et « 2- wvrmby8ehv8 ms amp eamtv wvh m8mlih », l’ensemble encadré avec un gros Stabilo jaune. Ce galimatias est suivi des mots « en douceur », « se charger de la goye » et d’un autre terme illisible. Puis encore des noms de stations de métro surlignés de différentes couleurs. Une vingtaine de pages plus loin ceci : « Le Rouge de la Blanche a fait du boucan ». Au poste de police on confisque tout à Larbi et on lui pose des questions dont nombre lui paraissent d’une grande futilité. Il passe la nuit enfermé dans une cellule, sans ses chaussures, sans sa ceinture. Le ventre noué par la peur.
La salle d’audience du Parquet de Bobigny est bondée. Il y a quelques heures, Larbi y fut déféré avec une vingtaine d’autres jeunes. Yanis et sa mère assis dans une des premières rangées sont silencieux. Yanis est irrité, cela fait trois quarts d’heure qu’il triture une cigarette entre ses doigts. Sur le visage de Denise, on lit de l’angoisse et de la nervosité. Bachir est assis deux rangées derrière eux. Il échappa de justesse au coup de filet. À la barre, Larbi ne regarde pas le juge. La tête est baissée et les bras croisés. Le juge pour enfants lui pose les mêmes questions que les policiers, et d’autres. Il insiste beaucoup sur l’agression d’un « journaliste qui faisait son métier », il lui reproche de ne pas reconnaître les faits, mais Larbi pense que le juge lui en veut particulièrement, « il me pousse à bout » pense-t-il. Les tentatives de contrôle de l’avocat qui l’assiste ne servent à rien. « Qu’as-tu à nous dire » insiste le juge, avec dans la voix l’expression d’un réel besoin de savoir, et rien que cela. Larbi se laisse aller, se lance dans un discours de près de cinq minutes avec à l’esprit le désir d’impressionner, de montrer qu’il est à la hauteur : « Ce type est raciste. J’aime pas les racistes. Il dit toujours ‘‘je suis un Français de souche moi, je suis catholique moi.’’ En parlant comme ça, il augmente ma haine. Lui et ses semblables nous rongent de l’intérieur. Ils ont infesté nos corps comme le cancer, comme le poison. » Deux jeunes qui applaudissent en lançant « ouais c’est vrai ! » et « c’est vrai ça ! » sont aussitôt expulsés de la salle par deux policiers alertes. Le juge demande à Larbi de continuer. « Il dit qu’il y a ‘‘trop de Noirs, trop d’Arabes, c’est un cauchemar effroyable.’’ Il dit que nous sommes étrangers à la France parce que nos parents sont Arabes. Ces gens-là ils m’acceptent qu’à la banlieue de leur monde, de leur sang. Quand il a eu répété à la radio et à la télé que ‘‘les Noirs et les Arabes qui inondent la France sont étrangers à l’identité française’’, il a multiplié par dix ma haine. Partout ce type nous provoque, nous exclut. Un jour il lui arrivera ce qui lui arrivera. Et ce sera pire qu’hier… » Un murmure approbateur parcourt la salle. Le président exige de nouveau le silence du public en tapant avec son marteau et en rappelant les règles du tribunal, puis il demande à Larbi de poursuivre, mais lui n’a pas arrêté de parler, « … qu’est-ce que je suis moi, je suis Arabe, demi-Arabe, noir, étranger ? L’autre il veut la France blanche comme ses maîtres. Parce que lui il est même pas blanc. Regardez-le, qu’est-ce qu’il a de plus que nous ? il est même pas blanc. Il est marron comme son père, comme son grand-père, comme mon père, comme moi ! Mais il a honte de sa tête, c’est pour ça qu’il parle comme ça, il a honte de son histoire. Il dit que nous sommes son cauchemar. Il répète ‘‘la France c’est plus la France, c’est l’Afrique.’’ Pourquoi ces gens-là ils nous humilient, pourquoi ils nous assassinent ? Ces gens-là ils nous poussent à détester nos parents, à renier nos arrières-grands-parents et nos racines. Ces gens-là ils nous renvoient dans des zones qu’on connaît même pas ! » Larbi ne se contrôle plus. Le juge lui demande de se calmer, puis de se taire. L’avocat aussi. Larbi apprit ce qu’il fallait auprès de son frère. Il ne comprend pas certains des termes qu’il emploie, mais il pense qu’ils ont plus de poids, il pense aussi qu’il fait bien d’utiliser les mots de son frère plutôt que les siens, plus directs et moins savants. Le juge lui pose d’autres questions encore, mais Larbi se rend bien compte qu’il n’a plus le contrôle, qu’il sortit de ses gonds comme il sortit du temps de la justice et lorsqu’on sort de ses gonds plus rien n’a de l’importance, tout est nivelé à la périphérie de la raison. Il sait tout cela, mais il continue ainsi plusieurs minutes avant de se calmer. Son avocat lui prend la main, il le gronde certainement. Larbi préfère baisser la tête et ne plus rien ajouter. Il sent les flammes consumer ses joues. Avant de trancher, le juge insiste sur deux ou trois autres questions, mais il n’obtient que silence et haussement d’épaules. Larbi-Carl est condamné pour agression contre des agents des forces de l’ordre et un journaliste dans l’exercice de ses fonctions. Il lui dit qu’il le libérerait s’il consent à écrire une lettre d’excuses à l’homme qu’il agressa et vola, à Charly. Puis il lui pose la question « acceptez-vous… » Larbi hoche la tête, balbutie quelques mots que personne n’entend. Son avocat lui signifie en tapotant son oreille avec son index qu’il n’entend pas ce qu’il dit. Alors Larbi se reprend et répond par l’affirmative, « oui, j’accepte de faire une lettre… »
Yanis et sa mère sortent sans tarder de la salle, ébranlés. Larbi les retrouve en utilisant une porte dérobée. Denise plonge ses bras autour de lui, l’embrasse chaleureusement. Elle pleure en silence. Yanis écrase sa deuxième cigarette. Tous les trois rentrent ensemble à Clichy-sous-Bois dans la GTX verte du grand frère. Durant le trajet Larbi n’est pas loquace. Il vida ce qui lui tenait à cœur dans la salle, devant le public. En voiture il parle peu, lui non plus n’est pas tout à fait remis de l’épreuve. Il demande « il est où mon portable ? » puis l’heure qu’il est. Il dit qu’il veut boire, puis qu’il a besoin d’un mouchoir. Lorsqu’ils arrivent devant leur immeuble, Denise embrasse de nouveau Larbi et Yanis. Lui il continue en direction du centre Leclerc. Dans sa chambre, même si elle prend soin de choisir ses mots, elle réprimande son fils sans trop le bousculer, le prie d’écouter son grand frère « il a raison Yanis, bien sûr qu’il a raison ». Jean-Marie appuie sur le bouton « mute » de la télécommande. Il entend tout ce qui s’échange, mais se garde d’intervenir, sinon pour dire à Larbi de prendre garde à ses fréquentations. Larbi ne lui répond pas, dit à sa mère qu’il monte chez Yanis. Jean-Marie vint passer quelques jours chez Denise, trois ou quatre, pas plus.
En rentrant chez lui Yanis retrouve Larbi assis devant l’entrée du bâtiment. Le grand frère accepte qu’il lui porte un sac de commissions. « Prends celui-ci. Tu manges ici ? » Larbi lui rapporte que sa mère lui cria dessus. « Je lui ai crié pareil. Mais l’autre, le gros, ça ne le regarde pas. Il n’a pas à me faire de réflexion. Je l’ai envoyé chier. » Denise n’éleva pas la voix sur son fils et Jean-Marie ne lui fit aucune remarque désobligeante, « tu devrais faire attention à tes fréquentations », c’est ce qu’il lui dit, mais aucune observation blessante ou désagréable.
Plus tard, Yanis apprend au téléphone que monsieur Dilain fut pris à partie en fin de journée, devant la mairie. Une dizaine de motards cagoulés voulaient en découdre. Ils criaient leur haine « des cocos, des socialos et des musulmans ». Ils arboraient des étendards avec une flamme tricolore. L’un d’eux descendit de sa moto, courut vers le maire et le bouscula. Aussitôt, un cordon de protection regroupant une vingtaine d’hommes et de femmes se forma autour du maire en criant « les fachos ne passeront pas ! » Le docteur Claude Dilain est un homme qui se bat sans relâche depuis des dizaines d’années pour que les citoyens de Clichy-sous-Bois vivent dignes, dans la liberté, dans l’égalité et dans la fraternité. « Cette agression n’est pas la première », dit Yanis à son interlocuteur au téléphone. Tous deux sont d’accord pour se joindre au comité de soutien à monsieur le maire, en cours de constitution.
Le lundi 31, les sayanim se retrouvent chez Charly où ils déroulent le fil des événements de la veille… Sont également présents les membres de l’équipe des « départements périphériques ». Charly ne manque pas de tancer vertement Raphaël, pour avoir utilisé son téléphone, « un risque impardonnable » dit-il. Sur son visage, deux morceaux de sparadrap longs de plus de quatre centimètres barrent, l’un le front, au-dessus de l’œil gauche, l’autre le bas du visage, à la base du nez. Après leur départ, Charly finalise un compte-rendu qu’il déposera sous pli en fin de journée à l’ambassade d’Israël « à l’attention de Yaïr K. »
« Six mois » décida le juge contre Larbi. Six mois pour vol avec violence… L’agression se déroula le samedi 24 février en fin de journée. Le buraliste était sur le point de baisser le rideau. À l’extérieur du magasin, Larbi faisait le guet tout en bloquant discrètement la porte d’entrée, le visage à découvert, une casquette noire vissée sur la tête. Ses deux complices avaient dissimulé leur visage dans leur capuche, sur le seuil de la boutique. Le premier commanda « trois Marlboro s’il vous plaît ! » « Vous êtes les derniers, nous allons fermer » répondit le marchand en se retournant vers ses rayonnages pour extraire les paquets. À ce moment précis, le deuxième voyou sortit une arme dont le débitant ne décèlera pas la facticité et la pointa en sa direction en hurlant « la caisse, la caisse ou je te bute ! » Le premier — il tenait une batte de baseball — se jeta sur lui en criant à son tour « la caisse, la caisse fils de pute ! » L’homme tenta de résister, mais c’était peine perdue. Il reçut une avalanche de coups de poings, de pieds et de batte, si bien qu’il se retrouva à terre, plié de douleur, ensanglanté. Il ne les vit pas ouvrir la caisse ni ne les entendit. Les trois compères déboulèrent sur la chaussée, deux portaient chacun un gros carton. Ils coururent jusqu’à la 309 de l’un d’eux, garée dans le parking d’une supérette, quelques dizaines de mètres plus haut. Le conducteur démarra à toute vitesse. Aucun ne possède le permis de conduire, pas même le chauffeur qui est aussi le propriétaire du véhicule. C’est lui qui utilisa le pistolet en plastique. Ils venaient de dérober tout le contenu de la caisse, 2700 €, et deux cartons de cigarettes. Ce vol, ils le préparèrent durant près d’un mois. Moins de soixante-douze heures après leur forfait, le jour même où le buraliste sortait du coma, les trois camarades étaient appréhendés. Larbi ne put ou ne voulut expliquer comment il se trouva mêlé à cette histoire. Ni à ses proches, ni aux policiers, ni au juge. Pourtant, bien que cette agression fut assez grave, qu’elle attira la presse, elle n’était pas leur première affaire. Larbi et ses mêmes camarades avaient commis plusieurs vols sur des marchés, à Sevran, Villepinte, Le Raincy, et dans des centres commerciaux. Depuis Quiberon, et malgré sa volonté exprimée à Yanis en présence de Omar, mais aussi aux conseillers de la Mission locale, Larbi « filait un mauvais coton » disait leur voisine de palier. Alors que ses compagnons écopèrent de prison ferme, lui, compte tenu de son âge, fut condamné à un placement de six mois dans un centre éducatif fermé, à Savigny-sur-Orge.
En même temps qu’il intègre le centre éducatif, Larbi est définitivement exclu de la formation de peintre en carrosserie qu’il suivait. « Le petit il file un mauvais coton » répétait la vieille voisine des El-Bethioui à la mère ou à Yanis, une fois même à Sarah qui haussa les épaules. Mais lorsqu’elle apprit qu’il avait intégré une formation, elle s’exclama « ça, c’est une vraie bonne nouvelle ! » Depuis un an, Larbi semble désorienté. Cela avait commencé avec la nouvelle année scolaire. Il s’absentait régulièrement des cours depuis la reprise d’hiver. Il était en 3e et ses performances devenaient rares. Il continuait de fréquenter les nombreux jeunes dont il fit la connaissance durant les révoltes d’octobre. Il traînait souvent dans le centre commercial du haut de l’allée Maurice Audin. Parfois il disparaissait toute une journée. Lorsque ses frères s’inquiétaient, le sermonnaient, parfois sans ménagement, Larbi répondait « j’ai fait une descente à Paris avec avec mes potes, y a rien d’mal ! » Il faisait partie d’une bande dont les membres habitaient à Clichy-sous-Bois ou à Montfermeil. Périodiquement ils prenaient le bus jusqu’à la station Église de Pantin, ou jusqu’à Pablo Picasso, où ils s’engouffraient dans le métro. L’heure suivante ils se retrouvaient tous sur les Champs-Élysées ou autour du Forum des Halles. Importuner les filles ou bousculer d’autres jeunes faisait partie de leurs jeux préférés. Un jour de juin Larbi et sa bande s’étaient retrouvés piégés, enfermés dans le poste de police du Forum qui se trouve en face de l’entrée Lescot, et la raison à cela tient en une expression que Larbi découvrait dans la bouche du juge pour enfant : « violence en réunion ». Pour sa défense il nia les faits qu’on lui reprochait. « C’est eux qui nous ont attaqués les premiers ». Pourquoi ? Il ne put rien dire. Parmi les jeunes que Larbi et ses copains avaient agressés — le tribunal retint que c’était bien « le groupe de Clichy-Montfermeil » qui déclencha la rixe et non l’autre —, il s’en trouvait un dont les coups qu’il avait reçus entraînèrent une fracture de cheville et une incapacité temporaire totale de sept jours. Une mesure de réparation pénale fut prononcée contre Larbi : travailler dans une association caritative tous les jours ouvrés de 9 h à midi pendant deux semaines. Des sanctions similaires ou plus lourdes furent infligées à ses camarades de la bande. C’est ainsi qu’il se retrouva à glisser tous les matins des enveloppes « don » dans les boîtes aux lettres au profit du Secours catholique de Clichy-sous-Bois. À la fin de son travail d’intérêt général, l’association offrit à Larbi un coffret de chocolats et 50 €. À l’intérieur de la boîte de chocolats que Larbi ouvrit aussitôt reçue pour en avaler deux, il y avait une invitation au 12e Salon du chocolat qui se tient au Parc des expositions de la Porte de Versailles.
La dernière semaine de juillet, Larbi et Omar la passèrent dans un camping à Quiberon presque totalement aux frais du grand frère. Yanis accepta, une seule fois, qu’ils participent au plein de carburant de sa Renault. Yanis vit chichement, mais cela ne l’empêche pas de bien s’occuper de ses frères et sœur autant qu’il peut. C’est pendant cette semaine de vacances qu’il réussit à faire accepter à Larbi qu’il s’inscrive à la Mission locale, puisqu’il ne voulait plus entendre parler du collège. Il avait désormais plus de seize ans, la scolarité ne lui était par conséquent plus obligatoire. Yanis prit comme modèle Omar qui venait d’obtenir son Brevet en carrosserie, même s’il n’a pas l’intention de poursuivre en Bac pro. En septembre Larbi se rapprocha de la Mission locale. Le mois suivant il intégrait le même centre de formation en alternance que celui fréquenté par Omar. Le centre se trouve aux Quatre chemins, à Pantin. Larbi préparait un CAP de « peinture en carrosserie ». La formation s’étendait sur une année scolaire. Ce qui lui plaisait c’était les heures qu’il passait dans le garage, non loin de chez lui, plus que les cours théoriques aux portes de Paris, une semaine en entreprise, la suivante en classe. Il était fier de la rémunération qu’il percevait. 310 € par mois ce n’était pas peu pour lui et il en était très satisfait comme de soi. Larbi n’avait jamais reçu régulièrement autant d’argent. Les sorties avec ses camarades il en faisait plus, surtout les vendredis et les samedis soirs. Jusqu’à cette fatale journée de février. À 6 h 30 du matin, des agents de police martelaient contre la porte de l’appartement. En moins de cinq minutes, Larbi, en pyjama et les yeux pas tout à fait dans leur globe pour saisir ce qui lui arrivait, fut emmené manu militari. Son âge ayant été mis entre parenthèses par les officiers de l’État. Il avait beau se débattre, il fut soulevé et traîné jusqu’au véhicule des policiers en stationnement sur le parking près du Stamu II. Larbi n’avait pas clôturé son septième mois de formation. Au poste de police, on le secoua rudement. « Ce sont tes propres potes qui t’ont balancé » lui dit, goguenard, l’un des agents de police, « arrête de faire le mariole ». Larbi finit par reconnaître tout en pleurs avoir participé avec des amis de Montfermeil — dont il livra les nom, prénom, adresse, et le numéro de téléphone de deux d’entre eux — au vol d’un buraliste, près de la gare du Raincy. Il écopa pour cela de six mois en centre fermé.
Larbi et son ami sont sur le point de se séparer. Tarik arrive au terme de son placement au centre. Le samedi arriva plus vite qu’ils ne le pensaient. Ils échangent des amabilités et des promesses. « Tu me trouveras ici », dit Tarik à Larbi en lui remettant un bout de papier. Larbi pousse sur la pointe des pieds et tend la joue comme il le ferait avec ses parents, ses amis, mais Tarik l’entoure de ses bras. Tarik a le même âge que lui, mais il le dépasse d’une bonne tête. Il l’enlace fortement en lui tapotant le dos. « Il neige, dit Larbi, fais gaffe à ne pas glisser ! » Tarik purgea la totalité de sa peine, mais pas Larbi. Il lui reste deux mois, à moins d’un imprévu, une autre bagarre ou une quelconque bévue qu’il provoquerait. « Bonne année ! » dit Larbi à son ami. Tarik grimace « non pas ça, pas ça ! » Il tend le bras droit, l’index pointé vers le ciel laiteux.
Le premier jour de son arrivée au centre éducatif fermé de Savigny-sur-Orge — le 10 mars 2007 — Larbi était reçu dans le bureau du directeur. Yanis était présent ainsi qu’un éducateur, le même qui les accueillit deux heures auparavant et qui leur détailla les droits et obligations des résidents du centre. « Assayez-vous ». Le premier responsable expliqua les objectifs du placement, ainsi que le fonctionnement du centre, puis il remit à Yanis des documents à signer. Le grand frère confirma au directeur qui le réclamait que Larbi ne possédait plus de téléphone portable depuis son arrestation musclée. « Je l’ai désactivé et rangé en lieu sûr. » Larbi marqua sa désapprobation en donnant un léger coup d’épaule, très discret, à son frère. « Vous avez bien fait, les téléphones portables sont prohibés dans notre établissement. » Puis le responsable fit signer à Larbi le règlement intérieur et le livret d’accueil. Après que Yanis eut pris congé, l’éducateur entreprit de faire visiter tout le centre à Larbi, en lui expliquant les fonctions de chaque pavillon, chaque aile, chaque section. Dans la chambre qui lui fut attribuée, il y a un petit appareil radio qui fait aussi réveil-matin. Durant les deux premières semaines, il lui était très difficile de communiquer, il ne sortait quasiment pas plus de trois phrases, quel que fût l’effort de l’éducateur. Graduellement, il élaborait son projet éducatif aidé par le professeur technique et des éducateurs. Peu à peu, grâce à Moussa le formateur technique, Larbi abandonnait sa coquille. Depuis le début, ce qui lui plaît le plus dans le centre ce sont les moments qu’il passe dans l’atelier mécanique vélo de l’unité d’activités de jour. Il s’y rend deux fois par semaine. Larbi ne savait presque rien de précis sur les différents composants du vélo, ni comment les aborder, les monter, les remettre en état de fonctionner. Si peu. Avec Moussa, il apprit à réparer les crevaisons, démonter et monter les dérailleurs, installer les plateaux, changer la pédale, le guidon, régler les freins, ajuster la selle… Contrairement à d’autres formateurs ou aux éducateurs, Moussa est très avenant avec lui, en empathie, comme avec tous les jeunes. Grâce à lui le rapport d’accueil adressé au juge fut très élogieux. Ils ne sont pas plus d’une douzaine de jeunes dans le centre, mais certains sont réputés comme étant de « fortes-têtes » ou de « sales types », ou encore des « têtes de Turc » comme disent certains employés. Il arrive à Moussa d’élever la voix, de prendre des sanctions, par exemple faire une recherche sur la question du vivre en groupe. Une fois il exigea d’un pensionnaire qu’il avait surpris en train de fumer dans les toilettes, qu’il rédige trois pages sur les conséquences sanitaires du cannabis. L’enseignant de français reprit le texte du résident, le fit travailler sur l’accord du participe passé avec l’auxiliaire avoir, sur le participe passé des verbes pronominaux, sur des règles et notions élémentaires qu’il avait oubliées, et sur des questions qu’il ne s’était jamais posées. Mais il est rare que Moussa agisse ainsi, même à l’égard des plus turbulents. La plupart des jeunes fument plus ou moins ouvertement, peut-être par provocation.
Un peu plus de quatre mois après son arrivée, le 20 juillet exactement, un vendredi, Larbi faisait la connaissance d’un nouvel arrivant condamné à la même peine que lui, six mois. Il fut retenu contre Tarik la participation en bande organisée à une agression contre un groupe d’une « cité ennemie » dans la galerie d’un centre commercial. La bagarre se termina par une casse gigantesque et trois hospitalisations. Tarik jura à Larbi sur le Coran, en s’excusant aussitôt, car on ne jure pas sur le Coran dit-il, staghfirou Allah, pardon à Dieu. Il dit que les policiers et le juge avaient exagéré, qu’il ne méritait pas d’être enfermé. Tarik ne fume pas, ne boit pas non plus. Il avait dix-sept ans à son arrivée. C’est un grand garçon, ses traits sont fins comme le collier de barbe qu’il porte comme on porte une médaille ou un signe extérieur d’appartenance. Un collier exposé comme une signature. Dans l’atelier vélo il ne rechignait jamais à réaliser le travail demandé. Lui aussi aime bien bricoler. Le formateur leur donnait des consignes, puis les laissait faire. Plus tard, vers la fin du mois d’août, lorsqu’ils devinrent familiers l’un à l’autre, Tarik et Larbi parlaient de leur famille, de leur vie quotidienne avant leur enfermement dans le centre. Tarik appréciait encore plus Larbi depuis qu’il lui raconta avec franchise les raisons de son emprisonnement, sa participation à une agression contre un buraliste et les descentes à Paris avec ses camarades de la cité. Ils parlèrent beaucoup des révoltes des banlieues. Tarik avait lui aussi participé aux soulèvements d’il y a deux ans, dans sa ville, Ivry. Tarik habite à deux pas de la Promenade des Petits Bois, chez ses parents. Mais c’est en septembre que Larbi et Tarik se rapprochèrent réellement l’un de l’autre lorsque le mois de ramadan arriva en même temps que Larbi commençait son deuxième projet éducatif. Tarik et Larbi étaient les seuls dans le centre à jeûner. Ils désiraient demander à Moussa s’il observait lui aussi le ramadan, mais ils n’osèrent pas, lui-même n’en parlant presque pas tout en étant bienveillant à leur égard. Le personnel était indulgent avec eux, compréhensif. L’éducateur de veille prenait soin de les réveiller tôt le matin, avant le lever du jour, pour prendre le repas du Sobh. Ils avaient un réveil-matin, mais l’éducateur de veille toquait quand même à leur porte. Larbi se contentait d’un jus de fruits et d’un croissant ou d’un pain au chocolat. En moins de dix minutes, il était recouché. Tarik réchauffait les restes du plat de la veille, prenait un verre de lait, puis étalait son tapis de prière. Bien que l’un et l’autre se furent engagés par écrit à accepter un régime alimentaire non spécifique, la direction du centre autorisait exceptionnellement leur famille à apporter le couffin durant le ramadan, une fois par semaine : chorba maison ou en sachets, dattes, lben… Pendant le mois sacré, Yanis et Sarah se présentaient ensemble à chaque visite : le mercredi 12 septembre, veille du premier jour de jeûne, puis les 18 et 25, et les deux premiers mardis d’octobre. Le samedi 13, jour de l’aïd, ils vinrent avec leur mère. Larbi entamait donc son deuxième projet éducatif. Les résultats du premier ayant été réévalués alors qu’il préparait la troisième et dernière phase. C’est ce qui ressort du bilan de son premier parcours. Lors d’une bagarre — c’était à la fin du mois d’août —, Larbi avait lancé une chaise sur un pensionnaire qui n’arrêtait pas de dénigrer l’Islam et les Arabes. Larbi fut privé de toute activité pendant deux semaines. On le priva aussi de ce à quoi il tenait le plus, la PlayStation. Jusque-là on avait toléré qu’il joue avec la console que lui avait offerte Yanis. Désormais cela n’était plus possible. Évidemment la gratification lui fut supprimée. Il n’avait plus d’argent de poche. Le règlement à son égard fut appliqué de manière rigoureuse. Une première fois, alors qu’il fêtait ses 17 ans, Larbi avait bousculé et injurié un éducateur. C’était quelques jours avant l’arrivée de Tarik. La fête fut interrompue et l’utilisation de l’ordinateur lui fut interdite durant deux semaines entières. D’autres résidents que Larbi provoquent des tensions dans le CEF. Plusieurs d’entre eux s’étaient enfuis, des téléphones portables de l’établissement avaient été volés, des bagarres éclataient régulièrement, des éducateurs étaient molestés… cela conduit nombre de salariés à se mettre en disponibilité ou à demander un congé sabbatique.
« Je suis fier de toi », disait Tarik à Larbi. Il trouvait que la réaction de son ami face au jeune qui médisait de l’Islam et des musulmans était saine. Il lui répétait « je suis fier de toi ». Tarik priait assidûment, faisant en sorte que cela se sache, se voie, et même s’entende. Larbi n’avait jamais prié. Son père est croyant, mais il ne lui apprit jamais à prier, ni Kada son grand-père. Larbi ne les vit jamais faire les ablutions ou prier. Savaient-ils ? Tarik trouvait facilement un lieu pour évoquer la nécessité de la Salat : le banc du jardin sous lequel roucoulent des pigeons attirés par des miettes de pain que leur lancent des locataires attentionnés ou oisifs, l’espace musculation ou judo de la salle de sport, le réfectoire… et même la bibliothèque. Il savait aussi choisir le bon moment. Tantôt il arrivait après les activités, généralement le soir, lorsque les esprits, libérés un temps et partiellement des contraintes du centre, étaient plus enclins à la rêverie ou à la discussion libre, tantôt il apparaissait pendant les animations. Mais quel que fût son choix, il utilisait son intuition à la perfection. Un jour que Larbi se trouvait dans la bibliothèque absorbé par la lecture d’un livre qu’il avait entamé une semaine auparavant, un livre « oublié par un éducateur », Tarik vint discrètement vers lui. Le livre était ouvert à la page 566 (il va sans dire que Larbi n’avait pu lire autant de pages en si peu de jours, il papillonnait plus qu’il ne lisait, c’est pourquoi il en était à cette page-là) : « De caractère ardent et enthousiaste, comme tous les chiots, qui jappent de plaisir en voyant leur maître et lui sautent au visage pour le lécher, Koultiapka ne dissimulait pas ses autres sentiments… Où que je fus, au seul appel de : ‘‘Koultiapka !’’ il sortait brusquement d’un coin quelconque, de dessous terre, et accourait vers moi, dans son enthousiasme tapageur, en roulant comme une boule et faisant la culbute. J’aimais beaucoup ce petit monstre : il semblait que la destinée ne lui eut réservé que contentement et joie dans ce bas monde, mais un beau jour le forçat Neoustroïef, qui fabriquait des chaussures de femmes et préparait des peaux, le remarqua : quelque chose l’avait évidemment frappé, car il appela Koultiapka, tâta son poil et le renversa amicalement à terre. Le chien, qui ne se doutait de rien, aboyait de plaisir, mais le lendemain il avait disparu… » Lorsque Tarik posa sa main sur son épaule, Larbi sursauta puis se tourna comme en un seul mouvement. Tarik avait déjà posé l’autre main sur le livre qu’il referma. L’instant d’après il lui tendait un objet en souriant : « pour ton bien, tu devrais faire un meilleur choix de lecture au lieu de ça ». Et il lui offrit un petit livre, vert, qu’il tenait dans la main — celle-là même qu’il avait posée sur Dostoïevski pour le refermer —, le Saint Coran dans les deux langues, traduction de Muhammad Hamidullah. « Garde-le, mais sois discret. Tu devrais te rapprocher plus de Dieu, apprendre la Sira des khalifes, les paroles du Prophète que le Salut soit sur lui… c’est beaucoup plus important ». Tarik parlait de ces temps anciens de l’Islam, des Sohabas. L’ignorance de Larbi le faisait sourire, mais il ne le rudoyait pas. En lui répétant ce qu’il lui avait déjà dit, en lui parlant comme à un jeune frère, sans le brusquer, sans l’intimider, sans le contraindre, en posant son bras sur ses épaules, Tarik savait qu’il empruntait la meilleure voie, celle qui fera de Larbi un ami d’El-Nasr. « Viens, on va dans la cour ». Larbi glissa Souvenirs de la maison des morts sur l’étagère « Aa–Bz », à l’angle. Volontairement, et comme il le faisait chaque fois qu’il finissait d’en lire quelques pages, parfois une seule, il ne rangea pas le livre à l’emplacement qui est le sien, pour que personne ne l’emprunte. Ce n’était pas la première fois que Tarik lui apportait la connaissance de sa propre religion. C’est lui qui lui apprit à pratiquer correctement, à respecter scrupuleusement les rites. Tarik commença par lui apprendre la profession de foi, lui en donner le sens profond. « C’est le plus important », disait-il. Puis à faire les ablutions, les grandes et les petites : « on se nettoie les parties intimes avec la main gauche et le reste du corps avec l’une ou l’autre main. Mais c’est la main droite qui puise l’eau. Et l’on commence toujours par laver la partie droite du corps. » Plus tard — il prenait son temps, répétait, corrigeait — Tarik lui apprit deux ou trois ayates, des versets, puis la salat, la prière, le sujud, comment se prosterner, comment faire une raqaa, une inclinaison… ce qu’il faut réciter, jusqu’aux salutations, fléchir la tête d’abord à droite et saluer son voisin « essalamou alaykoum wa rahmatou Allah », puis à gauche, et répéter la salutation. Tarik connaît tout cela sur le bout des doigts, il maîtrise tout cela comme une respiration. « Un jour je t’offrirai les recommandations de Sa Bienveillance le cheikh Abdul-Aziz-Ibn Abdullah Ibn Bâz, et celles de cheikh Saleh Ibn Fawzan Ibn Abdillah Al Fawzan, tu verras, c’est formidable ». Larbi eut envie de rire à l’écoute de ces noms sans fin, ces noms d’un autre monde, un monde lointain qu’on ne voit qu’à la télévision, en la forme de tuniques soyeuses brodées d’argent, ou de turbans dorés, portés avec élégance par des émirs ou des princes orientaux courtisés par les hommes politiques et les businessmen du Grand monde, frères d’affaires. Des noms d’un monde inconnu, mais Larbi se retint de rire. Dans son cœur il se nichait, plutôt qu’une banale amitié, une sorte d’admiration océane.
Il y a près d’un mois, le 22 décembre, des éducateurs et éducatrices étaient venus avec leur compagne ou compagnon et leurs enfants pour célébrer Noël avec les résidents et leurs parents. Le samedi suivant par contre, il n’y avait aucun étranger au centre. Tarik était resté cloîtré dans sa chambre ces deux samedis-là. C’est ainsi que Larbi s’apercevait au fil des semaines que le comportement de son ami Tarik se modifiait ou peut-être qu’il découvrait des facettes qu’il lui avait jusque-là cachées et qu’il lui dévoilait peu à peu. Larbi mit cela sur le compte de son tempérament. Peut-être, pensa-t-il, que le caractère de Tarik ne le prédisposait pas à tout lui dire en quelques semaines. Mais on était à plus que quelques semaines, cela faisait cinq mois que Tarik et Larbi se connaissaient. Il lui semblait plus rigide, fallait-il lui en parler, mais comment lui dire ? Larbi respecte beaucoup son ami, il a une profonde admiration pour lui, mais il ne comprend pas pourquoi on n’est pas de bons musulmans parce qu’on participe à la préparation des fêtes de Noël, « quel mal à fêter la naissance de Jésus, notre prophète ! » pensait-il. Jeddi le lui avait bien dit, Jésus notre maître, Sidna Issa, est un parmi les prophètes des musulmans. Lui-même, Tarik, le lui avait dit. Pourquoi on n’est pas de bons musulmans parce qu’on parcourt Souvenirs de la maison des morts ou parce qu’on célèbre la nouvelle année — ce sont les reproches que lui fit Tarik — « tu es musulman, tu ne dois pas fêter Noël ni le réveillon du Nouvel An, c’est haram. » Larbi comprend d’autant moins ces paroles que ses parents lui offrirent toujours un cadeau à Noël, qu’il y eut toujours chez eux une ambiance de fête le dernier jour de l’an, sauf en 2003 bien sûr, mais Larbi se gardait d’évoquer certains problèmes familiaux devant son ami. Il ne comprend pas ces paroles de Tarik alors que tous ses camarades de cité participaient aux réjouissances de fin d’année, un peu moins ces dernières années il est vrai. Larbi se posait ces questions, sans savoir comment lui-même se comporterait dans un mois, un an. Tarik et lui restèrent en froid plus d’une semaine. Larbi espérait que cela ne dure pas et il eut raison d’espérer. Tarik fit le premier pas vers la réconciliation quelques jours avant sa sortie.
L’enfermement de Tarik arrive donc à son terme. Il sera dans quelques heures de nouveau libre. « Tu me trouveras ici », dit-il à son ami en lui tendant un bout de papier sur lequel il écrivit un numéro de téléphone, une adresse électronique et l’adresse postale d’une mosquée. « Tu me trouveras ici », lui répète-t-il en tapotant la feuille de papier avec l’index sous l’adresse de la mosquée. Larbi glisse la feuille dans sa poche et tend la joue, mais Tarik l’entoure de ses bras comme un frère, lui donne de petites tapes sur le dos. On ne s’embrasse pas. Dans les rues de Savigny, la température avoisine les trois degrés au-dessous de zéro ce 19 janvier. Une température de février qui s’invite au cœur de janvier.
La journée fut longue. Larbi est très fatigué, allongé sur son lit, les bras croisés sous la tête. Ses yeux grands ouverts fixent au plafond la peinture blanche, elle tire sur le beige, qui se craquelle. Ses idées se brouillent. À l’angle, une affiche déchirée de Zidane dont il avait oublié le large sourire et le regard perçant qu’il lui adresse chaque fois que ses yeux se portent sur lui. Il ne sait comment l’image de son héros chemina dans son esprit au point de se transformer, comment elle le mena vers son ami Tarik, peut-être le sourire, pense-t-il. Larbi ne trouve pas le sommeil et il est tard. Cette journée du 10 mars 2008 restera, pour sûr, longtemps gravée dans sa mémoire. Il la marquera d’une pierre blanche. Il s’interroge : « marquer d’une pierre blanche, d’où vient cette expression ? n’est-elle pas haram ? » En ce moment, l’esprit de Larbi est assailli de questionnements et de nombreuses images, récentes pour la plupart. Il se souvient qu’il eut un frisson le matin devant le portail du CEF. Une brise soufflait et sa joie de se retrouver définitivement libre fut décuplée lorsqu’il aperçut Yanis et Sarah qui l’attendaient dans la GTX verte du frère. Au moment où il pensa « définitivement », il tressaillit. Une même sensation de joie, un même frémissement parcourt son dos, alors qu’il est dans son lit à s’en souvenir. Ce lundi matin, au terme d’une année pleine, Larbi quittait le CEF de Savigny. Une belle journée de fin d’hiver, chaude et belle comme celle d’un printemps du sud, s’annonçait, prometteuse d’autres beaux jours aussi chauds et beaux. Dans le sac qu’il serrait dans la main, un sac de sport que lui offrit Moussa au nom de toute l’équipe éducative, Larbi avait glissé au milieu de ses effets vestimentaires le livre sur les forçats d’un bagne de Sibérie et son chapelet de trente-trois perles.
Larbi était plutôt satisfait des dernières semaines de son parcours. Dans le cadre du projet de sortie, il avait conclu un contrat avec un garagiste de Belleville, connu par les responsables du CEF pour avoir embauché plusieurs jeunes du centre éducatif. Chaque matin Larbi prenait le RER C jusqu’à Notre-Dame puis les lignes 4 et 11 du métro jusqu’à Ménilmontant. Puis il remontait la rue du même nom jusqu’à la rue des Pyrénées qu’il longeait à gauche sur deux cents mètres. Il arrivait que le formateur technique l’accompagnât. Prendre les transports seul, sans éducateur, était encouragé et le critère confiance était un élément très important dans la réussite du projet. Lorsqu’il prenait seul les transports, Larbi aimait parcourir Souvenirs de la maison des morts dont il avait lu des pages entières à la bibliothèque du centre. Pas lorsque Moussa l’accompagnait. Dans le centre Larbi cachait le livre. Il ne voulait pas qu’on le surprenne avec, car il l’avait dérobé à la bibliothèque.
La première fois que Larbi revit Tarik, il ne le reconnut pas. C’était à la sortie du garage, il allait prendre son kébab. Un gaillard s’approchait de lui en souriant, les bras en l’air, sur le point de l’enlacer. Il eut un mouvement de recul, puis se reprit aussitôt lorsque le jeune homme lui lança « wech Larbi tu ne me reconnais pas ? » Tarik prononça ce mot « wech » en même temps qu’il fit un autre geste de la main suspendue pour qu’il fût mieux saisi par Larbi, mieux entendu en quelque sorte, et ce geste-là Larbi le connaissait bien, mais il lui fallut quelques longues secondes pour l’associer à son compagnon d’enfermement. Oui, c’était bien son ami Tarik qui se tenait là devant lui. Il avait une barbe aussi fournie et longue que celle de Louis le Soumis le prédicateur, et des cheveux noirs qui lui tombaient sur les épaules, couvrant toute la nuque. « En si peu de temps ? ça ne peut être qu’une perruque » avait pensé Larbi, mais il n’osa pas parler de cela à son ami, ce n’était pas le moment. Larbi était persuadé qu’il avait pris dix centimètres. Il n’osa pas non plus lui poser la question. Il avait embelli. Il ne l’aurait pas reconnu si Tarik n’était venu à lui. Il était midi trente. Les deux amis déjeunèrent dans une gargote tunisienne, Le Djerba, que fréquente Tarik, « le patron est un frère ». Ils prirent chacun un thé à la menthe et un maqroud à la suite du plat de loubia, échangèrent des nouvelles sur le CEF, sur la famille, les frères, la prière. En sortant du restaurant, Tarik fit un signe au frère. Il paiera plus tard. À la fin de la journée de stage pratique, Larbi retourna à Savigny. Dans sa poche, il avait mis le chapelet en bois que lui avait offert son ami. « Tu loueras les quatre-vingt-dix-neuf noms d’Allah, apprends-les ». Les jours suivants, Larbi retrouvait son ami au même endroit et leur discussion portait invariablement sur le CEF, la famille, les frères, la prière. Tarik réglait chaque fois l’addition. Pas question pour lui de laisser Larbi mettre une pièce. Ce fut ainsi chaque fois que Larbi se rendit au garage jusqu’à cette dernière semaine, celle du bilan.
Mais là, il est tard, Larbi est fatigué et déjà il s’impatiente de le retrouver à des jours, à des heures qu’on ne lui imposera pas, complètement libre. Il lui faut également renouer avec la famille, les amis, le quartier. Dans son esprit éprouvé, toutes ses pensées s’imbriquent, elles le fatiguent un peu plus. Larbi est heureux.
Les années passèrent sur les villes comme sur les hommes. Clichy se désespère plus encore qu’hier. Pour Charly elle ne fut qu’une étape. Il y en aura d’autres, mais il ne sait lesquelles. Si Charly déteste Clichy-sous-Bois, la voue aux gémonies, il adule Jérusalem. Son livre se vendit relativement bien… « Yerushaláyim, ville de la paix terrestre, ville de la paix céleste mon joyau, est en proie aux populations allogènes, ces hordes déferlant du sud et de l’est ». Il anima plusieurs rencontres dans des librairies, à Paris, à Bruxelles, à Jérusalem, pour la promotion de son essai. Et jusqu’au Salon du livre de Paris dernièrement, au stand des éditions Babel (auxquelles sont associées les éditions israéliennes Kinneret Z-B). Un Salon à l’honneur d’Israël qui fête le soixantième anniversaire de sa création. L’esprit de Charly est encore rempli d’images de la visite qu’effectua le président Shimon Pérès au Salon. Certaines s’estompèrent, d’autres sont très vives. Il s’émut à la pensée de la soirée organisée par le CRIF au Palais des Congrès, de la prière du président, près duquel il se retrouva — à moins de dix mètres — « si je t’oublie, Yerushaláyim, que ma main droite se dessèche. »
Ce mardi à 7 h 12 le jingle de La chronique de Charly cinglera comme un coup de fouet. Charly n’y est pas encore. En ce moment il est assis devant la grande vitre qui le sépare du technicien et attend le signal. Il apporte une dernière retouche, modifie quelques termes de son intervention en dégustant son café-mousse. Dans quelques minutes ce sera à lui. Il parlera. Il frappera fort. Très fort. Ce sera juste après la pub lorsque le technicien pointera un doigt en sa direction. Dans deux ou trois minutes. Les débats sur l’identité nationale qui secouent la France depuis quelque temps ne le satisfont pas du tout. Il les trouve timorés, comme verrouillés. Il est convaincu que la parole est encore bridée. « On fait encore beaucoup dans le politiquement correct, dit-il souvent, dans l’autocensure ». La nuit écoulée fut quelque peu agitée. Il s’était redressé sur son lit — c’était la seconde fois —, tâta la table de chevet à la recherche de l’interrupteur pour allumer la lampe à poser. Il tendit la main pour prendre la feuille sur laquelle il avait couché son intervention. Il parcourut le passage qui lui apparut imprécis, qui ne lui convenait pas tout à fait. Il en corrigea quelques phrases telles qu’elles lui furent suggérées dans son rêve, puis il se rendormit. Maintenant — alors qu’il est sur le point d’intervenir en direct sur les ondes —, il lui semble que le rêve qui l’enveloppa cette nuit d’une certaine manière l’encouragea. Il était venu lui tendre la main. Lui dire combien il a raison. C’est pourquoi il biffa plusieurs segments de phrases pour les remplacer par d’autres, plus directs, plus forts, suggérés par l’obscurité de sa nuit. Il lui fallait traduire au plus juste sa pensée. Ne pas prendre des chemins de traverse. Dire ce qui l’habite au plus profond. Le jingle va retentir dans une minute. « De toutes les façons les auditeurs connaissent mes positions », se rassure-t-il. Ce sont probablement les mêmes qui le regardent à la télévision où il est assez fréquemment invité par des présentateurs amis, comme en échange de bons procédés, car lui aussi invite des animateurs à son émission du vendredi soir qui à leur tour le sollicitent. Ils s’invitent les uns les autres, ils vont d’un studio à un autre, radio et télé confondues (mais aussi d’un restaurant à un autre, d’une soirée à une autre) : Charly fut invité chez Ruquier, puis chez Arthur, chez Ardisson… des Enfants de la télé à Tout le monde en parle, et à On va s’gêner… Charly est présenté comme étant aussi « un spécialiste du monde arabe et du Moyen-Orient ». Lui à son tour, de nouveau, leur offre les micros de son émission et leur attribue des titres ronflants. Et ils portent presque tous, mais cela n’est point surprenant, les mêmes lunettes, les mêmes vestes, affichent les mêmes tics physiques et manies langagières. Ils se congratulent les uns les autres, pourquoi se gêner en effet. Et les félicitations tournent en boucle comme un film de série B qu’on s’arrache, parce que pas cher et facilement accessible, c’est-à-dire superficiel. Et c’est ce qui emporte une large adhésion. « Quoi qu’il en soit les auditeurs me soutiennent ». Charly reçoit régulièrement des corbeilles entières pleines, des kilos, de lettres d’encouragement. Il se perçoit lui-même comme un boxeur sur un ring adulé par les trois quarts de l’assistance et cela suffit à le rendre très optimiste. Il est même heureux et quelque peu surpris de constater que la mayonnaise prend si facilement. Le jingle va retentir. Il prend les deux ou trois dernières notes, porte de nouveau la tasse de cappuccino à ses lèvres, regarde à travers la vitre du studio le doigt qui est pointé vers lui. Avec sa main gauche, il balaie de haut en bas sa chemise jaune cintrée, quelque souillure trop visible. Charly grimace, car à la seconde même où il s’apprête à entamer son texte, des images de Beyrouth en feu assiègent son esprit. Il avait trente et un ans et le courage aveugle et sans concession de ses armes à soustraire, liquider, effacer. Il sort un kleenex pour s’éponger le front, le cou, ajuste ses talons sur le repose-pieds de son siège assis debout, cale son fessier, gargouille sous le menton juste avant l’ouverture du micro, le visage cramoisi jusqu’aux oreilles. De rage ou de peur. Pas de honte, non. De rares reproches d’auditeurs mentionnèrent qu’il l’avait depuis longtemps bue. Il se racle la gorge alors qu’il reçoit une directive dans l’oreillette, que le jingle s’évanouit. Une lumière rouge au-dessus de la vitre du studio clignote et la main du technicien se tend vers lui :
« Bonjour à tous. Aujourd’hui ‘‘Le Grand remplacement’’. Depuis une trentaine d’années, notre pays est entré en décadence. Notre grand roman national est déconstruit, mis à terre. Nous sommes inondés par une sous-culture généralisée. La France se défrancise. La belle langue française, langue de civilisation, langue des Lumières est dégradée, paupérisée, violentée, abâtardie, créolisée, décomposée. » La voix de Charly est posée, plate, presque uniforme. Il continue « écoutez comment les jeunes des cités la méprisent, palabrant dans un langage impur, un charabia maghrébin–africain, enfermés dans des tours d’ivoire communautaristes… » L’instant d’un battement de cils Charly revoit son père Gaston agiter la main, ‘‘n’oublie jamais mon fils, zakhor, zakhor…’’ lui répète-t-il en lui tendant L’Écho d’Oran, ‘‘ils étaient six Arabes, regarde c’est écrit là, Mokhamed Lakrim, Khamed Amrani, Ali…’’ les noms défilent. Gaston et Mimoun son père, qui l’accompagnait au collège, ‘‘ont été agressés par six Arabes à hauteur du boulevard Sébastopol non loin de la Grande synagogue.’’ Charly se souvient encore des six noms qu’il avait soigneusement recopiés sur une feuille de cahier qu’il scotcha au bas de l’article du journal. ‘‘Six Arabes…’’ Un battement de cils. Derrière la vitre du studio, un doigt est pointé sur lui et cette lumière rouge qui clignote : « Il faut déchoir de la nationalité tous ces banlieusards, toute cette racaille tous ces délinquants qui n’ont pas été et ne sont toujours pas loyaux vis-à-vis de notre passé, de notre pays qui les accueille. Il faut dire et répéter l’échec de l’intégration. Les Mohamed, les Fatimatou, quelque chose, ne peuvent pas être français. Continuer à s’appeler Mohamed ou Fatimatou à la troisième ou quatrième génération c’est refuser nos valeurs, c’est refuser l’assimilation à l’essence française. Dès lors qu’on est Français, nos ancêtres sont les Gaulois, Vercingétorix, Pépin le Bref, pas Mahomet, pas Saladin ! » Maintenant le débit de Charly est plus rapide et le ton de sa voix monta de plusieurs crans. « Nos ancêtres sont le socle de notre récit national. Ces gens-là, tous ces Mohamed, toutes ces Fatimatou sont infidèles à la France historique. Ils lui tournent le dos, veulent imposer leur Charia, nous soumettre. Il nous faut changer les lois. C’est une question de survie. La religion mahométane n’a pas sa place dans notre cher pays. La France n’est pas une terre d’islam. Les musulmans n’ont d’autre choix que de renoncer à leurs coutumes anachroniques ou bien quitter la France et aller vers le pays d’origine de leurs parents. Telle est la grande solution à laquelle nous sommes nombreux à croire. Il nous faut abroger le droit du sol. Il faut mettre un terme au Grand remplacement du peuple français par d’autres peuples venus d’Afrique du Nord, du Sud et d’Asie. Ce Grand remplacement commencé il y a quarante ans entraîne petit à petit la perte de notre identité, de notre culture au profit de l’islam. Ce Grand remplacement de notre population est un crime qui se commet au grand jour contre notre France, contre notre Europe bien comprise. Il faut y mettre un terme par tous les moyens. Écoutez s’il vous plaît le XXe chant de l’Apocalypse, j’ouvre les guillemets, écoutez : ‘‘Le temps des mille ans s’achève. Voilà que sortent les nations qui sont aux quatre coins de la terre et qui égalent en nombre le sable de la mer. Elles partiront en expédition sur la surface de la Terre, elles investiront le camp des Saints et la Ville bien-aimée.’’ Fin de citation. Chers auditeurs, notre longue histoire judéo-chrétienne est remise en cause. Notre identité séculaire est attaquée. » Un nouveau battement de cils extrait Charly de son texte. Il tousse. Il se revoit avec ses camarades de guerre poser, le sourire large, devant les objectifs, les pieds minutieusement appliqués sur les cadavres et les doigts en V. Il sourit à sa mémoire. Quelques heures auparavant ils pénétraient dans les camps. Un silence de mort recouvrait Sabra et Chatila peu après la coupure d’électricité. À 18 h les troupes anti-palestiniennes pénétraient dans les camps, par le sud. Ils entendirent des tirs d’armes automatiques avant l’explosion générale. Des Bulldozers Aleph parcouraient les zones d’ouest à nord. Des fusées éclairaient les Sayeret Mat’Kal israéliennes. Puis un long silence au bout duquel la victoire attendue. Charly se reprend, ne sourit plus : « Pardon — il se racle la gorge bruyamment —, pardon. Ces gens-là, il y a quelques années, ils menèrent une guerre contre la France à partir des banlieues. On nous dit, le petit doigt sur la couture du pantalon, ‘‘la discrimination positive est la solution’’, mais elle est scandaleuse cette discrimination, c’est du racisme anti-blanc. La France aujourd’hui n’est plus que l’ombre de sa grandeur passée, à cause de l’immigration massive. Le Japon est un grand pays, une grande nation homogène parce qu’il ne connaît pas de violence, parce qu’il a toujours refusé l’immigration de masse. La France aujourd’hui n’est plus que l’ombre de sa grandeur du 19e et même d’une partie du 20e siècle. Elle a été transformée en une sorte d’auditorium droit-de-l’hommesque. À Gare du nord le soir, c’est le cauchemar absolu, tous ces Noirs, ces Arabes, mais dans quel pays sommes-nous ? Mais quelle douleur, mais quelle douleur ! On nous dit ‘‘vous êtes islamophobes’’, mais l’islamophobie c’est de la résistance !… Les Français de souche sont invectivés, stigmatisés par les hérauts du politiquement correct et de l’antiracisme qui évitent les questions que se posent légitimement des millions de Français. La majorité des Français est contre le multiculturalisme, contre l’islam, cette névrose de l’humanité ». Charly s’éponge le front, il perd pied. Tousse. À mal au ventre. Il retire le pied du repose-pieds de son siège pour le poser sur le sol. Maintenant qu’il est debout, il se libère des gaz qui l’encombraient et aspire à pleins poumons. Il va mieux, mais son esprit demeure à Beyrouth. Le ciel au-dessus des ruelles des camps palestiniens s’illumine. Des avions lancent des torches au magnésium. La parole est aux armes, toutes les armes, légères et lourdes, appuyées par toutes sortes d’engins terrestres et aériens. Raphaël Sheytan félicite les troupes pour avoir rendu leur honneur aux Libanais. Charly reprend, le ton est au plus haut, la voix s’étrangle, la respiration est perturbée. L’auditeur le devine s’agiter sur son siège, agiter les bras, remuer le postérieur : « Il est de notre droit, mais aussi de notre devoir de contribuer à préserver notre identité, notre culture occidentale en endiguant l’islamisation en cours, en éradiquant leurs fossoyeurs. (Dans son ventre le gargouillement des intestins reprend). Et lorsque notre cher collègue et ami Olivier Elmagribi s’insurge, lorsqu’il lance un SOS en ces termes, écoutez bien ! Lorsqu’il alerte ‘‘dans les villes, mais aussi dans les campagnes, notre territoire renoue avec les grandes razzias, pillages d’autrefois. Les grandes invasions d’après la chute de Rome sont désormais remplacées par les bandes de Tchétchènes, de Roms, de Kosovars, de Maghrébins, d’Africains qui dévalisent, violentent ou dépouillent’’ je suis entièrement d’accord avec lui ! Ceux qui veulent nous interdire de penser l’ennemi, de le présenter, de le haïr, ceux-là officient contre notre Eret… » Charly dit « Eret… » et aussitôt étouffe dans l’œuf le mot qu’il était sur le point de prononcer, le mot Eretz, et un autre qui suivait celui-ci tout naturellement. Il se reprend, il dit « ceux-là qui officient contre notre France éternelle » en appuyant avec excès sur les derniers termes, à se mordre la langue. « Ceux-là et les politiques qui nous gouvernent je les renvoie au regretté Carl Schmitt qui disait : ‘‘la grandeur de la politique tient à cette possibilité permanente de situations exceptionnelles où il faut décider, et précisait-il, la discrimination ami/ennemi est la distinction spécifique du politique.’’ » Charly fait signe au technicien, arrache son oreillette. Il se raidit, descend du siège en brandissant sa feuille de papier. Il se recule et crie dans le vide « connards, fumiers ! » Puis il lâche la feuille qui tourbillonne avant de glisser sur la moquette. Charly n’a pas le temps de la ramasser. Il fait quelques mètres les cuisses serrées, retient la respiration en gémissant. Un filet d’urine coule le long des jambes de son pantalon, souille le tapis. Des collègues s’esclaffent. Lui, éclate en sanglots. Le technicien, pris au dépourvu, il n’était pas prêt, appuie sur le bouton des spots publicitaires, « ‘Nerf’ ! La guerre des ‘Nerf’ continue avec le Raider CS 35 conçu pour tout dégommer, il est doté d’un chargeur 35 cartouches pour une puissance de tir extrême ! ‘Nerf’ pure action, pur délire ! nerf.fr »
Larbi rencontra pour la première fois Louis le Soumis dans la mosquée El-Nour à Belleville, un jour de mai, peu après sa libération du CEF. C’est lui qui dirigeait la khotba, le sermon. Larbi n’en savait presque rien. C’est Tarik qui le mit au courant. Il était mieux introduit et savait beaucoup de choses sur tout le monde, sur les frères, et notamment Louis le Soumis. C’est un « Français de souche » converti à l’Islam trois ans auparavant. Il naquit Louis Saint-Christophe en 1970 à Paris. Larbi le retrouvera plusieurs fois, parfois dans la mosquée à l’occasion de la prière du vendredi, parfois lors des rencontres hebdomadaires, le dimanche, rencontres qu’organise El-Nasr. C’est une association qui est hébergée par la mosquée El-Nour. Il lui arrive de le croiser dans le quartier lors des distributions de repas aux nécessiteux, aux sans domicile fixe. Le Soumis a toujours un mot pour chacun. Il aime changer de lieu pour rencontrer le maximum de gens. C’est pourquoi il n’est pas toujours à Belleville. On le voyait souvent dans la mosquée de la rue de Tanger. Mais depuis sa démolition, on le rencontre tantôt à Sartrouville, tantôt à Montfermeil ou à Montreuil. On dit qu’en certaines occasions il porte un masque.
Dans la mosquée, les dimanches, à la suite de la dernière prière du jour, la prière d’el-îcha, on récite le Coran, on parle de Charia et autres pratiques religieuses, de la belle époque des Sohaba, mais aussi des guerres Iran–Irak, de l’Afghanistan, des attentats de 2001, des révoltes de 2005… Et de l’actualité aussi, du coup d’État en Mauritanie, bref de l’état du monde tel qu’il est et tel qu’il devrait être. Le prédicateur du dimanche soir est toujours le même : Walado El-Mimoun. C’est un homme dans la force de l’âge, petit, frêle. Il semble fragile, mais c’est un fougueux et déterminé. Il porte en lui une force qu’on dirait innée. Il vit dit-on de la générosité de ses fidèles et il en a dans toutes les associations El-Nasr du pays qu’il parcourt à longueur d’année. Dans chacune d’elles, il est reçu avec le même accueil enthousiaste. Larbi imagine son père avec une grosse barbe et une chevelure fournie et ondoyante, comme celle de cet homme devant lui. « Il lui ressemblerait drôlement ». Cette pensée le fait sourire. Les origines du prédicateur se situent au Moyen-Orient, mais personne ne sait exactement dans quel pays. Lui-même entretient le doute. L’on sait seulement qu’il passa de nombreuses années à Londres et qu’il eut maille à partir avec la justice du pays. Disposant d’un passeport européen, il se déplace de pays en pays au gré des exigences militantes et de l’importance de la porosité des frontières, car plusieurs pays l’ont à l’œil, et parfois même déclaré PNG, persona non grata. Dans ses conférences il fait fréquemment référence à des hommes comme Cheikh Abdul-Aziz-Ibn Abdullah Ibn Bâz dont il recommande la lecture de son livre, particulièrement aux débutants : « Les leçons importantes pour toute la Communauté ». Il cite abondamment Abu Muhammed Al Maqdisi et son « Taâmoulat Fi Husn El Dhin bi Allah » ainsi que « This is our Aqidah ». Récemment il évoqua le « Hukm el Islam fi eddimogratiya » de Abd el Moun’im Moustapha Halima. Il arrive qu’on visionne des vidéos, comme celles de Anouar Al-Awlaki dans lesquelles on appelle au djihad contre les impies. Mais un autre ouvrage d’un groupe nommé El-Mouwahhidoûn circule parmi les fidèles, « Déviances et incohérences chez les prêcheurs de la décadence ». C’est celui-ci que recommande Tarik à Larbi. Il le lui tend. « Lis ! » Larbi ouvre le livre, parcourt une page prise au hasard : « Le Jihâd occupe une place prépondérante en Islam, au point que plus d’un tiers du Coran traite de cette question, sans parler de la Tradition du Sceau des Messagers ‘alayhim salat wa salam… Que la majorité des musulmans se soit laissée terroriser par la propagande des koffars des hypocrites et apostats, au point de ne plus oser, ne serait-ce qu’en parler, n’y changera rien : le Djihad demeurera sans interruption et jusqu’à la Fin des Temps un pilier essentiel de l’Islam, un devoir, et le Chemin vers l’Agrément d’Allah ‘azza wa jalla… Allah dit : Inna Allaha chtara mina el-mouminina enfoussahoum wa amwalahoum bi-anna lahoum el-jennata youqatilouna fi sabili Allahi… Ainsi Allah a-t-Il acheté des croyants leur âme et leurs biens en échange du Paradis : ils combattent dans le sentier d’Allah, puis ils tuent, aussi bien qu’ils sont eux-mêmes tués. Promesse vraie qui, dans la Thora et l’Évangile et le Coran Lui incombe. Et qui, plus qu’Allah, s’acquitte de son contrat ? — Réjouissez-vous du troc que vous avez troqué. Voilà l’énorme succès !… Ceux qui croient en Allah et au Jour dernier ne te demandent pas l’autorisation quand il s’agit de lutter de biens et de corps… » Le document insiste sur le rôle néfaste que joue Tariq Ramadan en Europe, « ses hérésies ont atteint une ampleur jamais égalée », mais il n’est pas le seul intellectuel musulman à être ainsi renié. La plupart sont des koffars aux yeux de El-Mouwahhidoûn, des ennemis de Dieu.
En sus du dimanche, d’autres réunions ont lieu sous l’autorité de Louis le Soumis. Des réunions spéciales, très cloisonnées. On y vilipende les intellectuels néfastes, les hommes politiques, les journalistes… de France, d’Europe et d’autres contrées, sans distinction de croyance. On y donne toutes sortes de recommandations, toujours justifiées, validées par des exemples puisés dans les premiers temps de l’Islam, l’Islam authentique. Des réunions fermées auxquelles Larbi sera intégré plus tard, lorsqu’il aura réussi tous les contrôles, récité tous les engagements, manifesté une assiduité sans faille, accepté certaines conditions, dont des « services à rendre à l’Islam », et après qu’il sera clairement mis en garde, « si jamais il y a une fuite… » Larbi sera admis dans le très restreint Comité des frères. On lui signifiera qu’il est un combattant de l’ombre, « tu es désormais un soldat de l’ombre au service de la Oumma. » Une Communauté pour laquelle, il en fera le serment sur le livre saint, Larbi est prêt à aller jusqu’au sacrifice suprême, l’estichhad.
Les invités sont confortablement installés sur l’imposant canapé d’angle en cuir, au design moderne. Sur son agréable, mais instable fauteuil en croûte de cuir, Charly leur fait face. Personne ne prête attention aux bavardages de la télévision. Sur le siège sont assis de droite à gauche Marek et ses deux comparses de l’équipe de la sous-zone « départements périphériques », Eli C., Élisa Lewinski, on l’appelle Lény, parfois Lisa, et Bernard Goszczynski-Lafange. Lui on l’appelle tantôt Bernard, tantôt Pinky. Pinky pour son aspect vestimentaire, car il porte toujours du rose, un bracelet rose, des lunettes roses, une cravate rose ou, comme ce jour, une ceinture rose. Les plus farouches de ses adversaires (ils ne sont pas quantité négligeable) l’appellent Lafange. Goszczynski-Lafange est né en Algérie comme Charly, à Béni-Saf une petite ville côtière qui se trouve à quatre-vingts kilomètres à l’ouest d’Oran. Les deux nouveaux connaissent l’appartement de Charly. Ils y furent formés d’une certaine manière. Eux aussi sont désormais des sayanim. Élisa et Pinky remplacent Raphaël E. et Victor O., mais leur rôle est différent. Raphaël E. purge une peine de trois décennies dans la prison de Kerobokan à Bali pour constitution d’un réseau de pédophilie et de trafic de drogue. Quant à Victor O., il fut abattu lors d’un soulèvement populaire à Ramallah cinq ans auparavant. Avec cinq de ses collègues de l’unité israélienne Douvdevan, Victor avait tenté d’infiltrer un nouveau groupe de manifestants palestiniens. Il avait quitté la France pour Israël moins d’un an après les révoltes des banlieues. La charge des soldats israéliens était d’une violence inouïe. Victor, contrairement aux expériences antérieures, fut cette fois-là démasqué, car il n’avait pu donner le code qu’un jeune résistant palestinien lui demandait. Un code (différent selon les quartiers de Ramallah) qu’avaient décidé de partager les manifestants palestiniens avant le soulèvement, et que les chefs de Victor — il activait sous les ordres indirects de Avi Sivan — ignoraient. Victor n’eut pas le temps d’utiliser le pistolet automatique qu’il venait d’extraire de la poche de son jean. Le Palestinien lui sauta dessus et lui assena plusieurs coups de couteau, dans le ventre, dans le cœur, dans le visage, dans les bras.
Lény et Pinky sont deux intellectuels franco-israéliens, au caractère trempé dans des convictions elles-mêmes chevillées au corps et à l’esprit de l’État d’Israël qui les imbibent. Ils furent recrutés, à la brasserie Le Rabelais par Charly et un collaborateur du nouvel attaché culturel et chef Tevel à l’ambassade d’Israël, monsieur Ziv Nevo qui remplaça Ziv Kuneman. Tous deux, Élisa et Pinky, avaient leurs entrées dans de nombreux médias français et un ascendant sur nombre de leurs responsables. Et c’est bien pour cette raison qu’ils furent sélectionnés par le chef Tevel. « Notre pays est en train de perdre la bataille de l’information, les Français n’en font pas assez, dépassés par les réseaux sociaux ! », leur avait dit l’agent israélien. Après avoir pris soin de fermer les fenêtres, Charly alluma lustre et lampadaires, et augmenta le son de la télévision, on ne sait jamais. La chaîne rediffuse la Finale de la dernière coupe du monde de football opposant l’Argentine et l’Allemagne. Charly rejoint sa place. Il reprend la parole qu’il avait cédée à Lény et Bernard, non pour qu’ils se présentent, mais pour qu’ils donnent leur point de vue sur l’exacerbation des conflits, « quels qu’ils soient » en Europe ou en France. Charly commence par attirer l’attention sur la gravité de la situation aux portes de l’Europe : dans certains pays arabes, africains… et moyen-orientaux. « Cette fois ces préoccupations alarmantes doivent nécessiter notre totale, notre absolue mobilisation… Le risque de déstabilisation de nos pays à cause des bouleversements en cours au Moyen-Orient et sur la rive sud de la Méditerranée est élevé. Nous devons participer à l’instauration d’un ordre nouveau selon nos intérêts bien compris… Des hordes de nègres et de musulmans accostent sur les côtes italiennes et grecques sans que cela inquiète nos dirigeants. » Charly poursuit en dénonçant la démission de l’Europe. Il alerte quant à ces « Arabes soi-disant Français qui portent haut les armes contre notre civilisation judéo-chrétienne. Rappelez-vous des émeutes de 2005. Il est de notre devoir de ne pas rater le rendez-vous avec l’histoire. Il est de notre devoir, nous, fers de lance, de stopper l’avancée de l’islam qui nous a déjà montré toutes ces années combien il est destructeur de notre identité juive, de l’identité judéo-chrétienne de la France. Alors, écoutez-moi bien. ‘‘Par la tromperie, la guerre tu mèneras !’’ Voici ce dont il s’agit… »
« La Cour d’appel de Rennes a confirmé ce jeudi la relaxe des deux policiers poursuivis pour non-assistance à personnes en danger, dans le cadre de l’enquête sur la mort des adolescents Zyed et Bouna en 2005, à Clichy-sous-Bois. » (AFP)
Sur les énormes tapis tressés en plastique qui recouvrent le sol de la salle attenante à la mosquée El-Nour, juste derrière le minbar, une quinzaine d’hommes patientent en bavardant. Ils viennent d’achever la prière d’el-îcha. Leur visage est fermé. Lorsque Walado El-Mimoun se présente, il lance à l’assemblée « essalaamou alaïkoum ». Tarik et Larbi sont présents, assis côte à côte. « Wa âlaykoumou essalaamou wa rahmatou Allahi wa barakaatouhou ! », que la paix, la miséricorde et la bénédiction d’Allah soient sur vous également, répondent-ils comme un seul homme en se redressant dans un doux et long murmure de reconnaissance.
Larbi ne maîtrise pas totalement l’arabe, mais durant toutes ces dernières années, il réalisa d’importants progrès et les frères ne s’y sont pas trompés qui le félicitèrent à souhait. Il sait désormais lire sans difficulté notable un court texte, et comprend l’essentiel d’un discours élémentaire. Lors des rencontres que lui-même anime, Larbi utilise certes la langue maternelle, mais nombre de citations qu’il emploie sont en arabe. Sa foi se raffermit autant que sa haine envers les koffars en général et plus encore ceux que El-Mimoun et Le Soumis notamment citent régulièrement dans leurs prêches. Le visage d’El-Mimoun est grave lui aussi. Contrairement à son habitude, il commence par une très longue tirade dans laquelle il rappelle les noms illustres des premiers temps de l’Islam, les Sohabas, les khalifes et le Prophète Mohammed « Salla Allahou alayhi wa sellama…, que la bénédiction et le salut d’Allah soient sur lui. Ô, Allah, ouvre-nous les portes de Ta miséricorde… » Puis, dans une langue arabe châtiée, il se lance dans un long discours pour condamner le monde occidental, premier grand responsable de la grave situation dans laquelle patauge le monde arabe et musulman : « la Oumma islamique est attaquée, de toutes parts nous assistons à des tentatives et plus encore que des tentatives, à des ingérences occidentales dans les affaires de nos peuples, dans nos affaires pour nous imposer des systèmes contraires à nos valeurs, contraires à nos traditions, contraires à nos croyances… Ils ont détruit la Libye, ils ont massacré les Irakiens, les Syriens, le Monde arabe, et s’offusquent d’être la cible des soldats de Dieu. Ce sont les mêmes qui s’insurgent et crient ‘‘Daech, Daech !’’ pour mieux nous aveugler. » El-Mimoun cite des leaders politiques, des intellectuels et philosophes américains, anglais et français « qui s’érigent en guides, en protecteurs, mais en réalité ils agissent dans le seul intérêt de leurs Communautés et des Juifs. Certains d’entre eux s’en sont récemment vanté au dîner du CRIF. » Parmi les noms cités, Larbi entend celui de Charly. « Plusieurs journaux ont rapporté les paroles de Pinto — il dit « Bintou » —, je vous livre des extraits du Figaro et que Dieu me pardonne ». Et El-Mimoun retire de la poche de son âbaya blanche étriquée une page du journal, pliée en huit, qu’il lit, quelque peu hésitant, en roulant les r et en confondant les voyelles. « ‘‘Je porte en étendard ma fidélité à mon nom et ma fidélité au sionisme et à Israël… C’est en tant que juif que je participe à cette aventure politique, directement en France ou avec le soutien d’amis dans les pays arabes’’ Il dit laânatou Allahi âlayhim ajmaïn, que la malédiction de Dieu soit sur eux, et il poursuit la lecture, ‘‘c’est en tant que tel que je contribue à définir des fronts militants, que je concours à élaborer pour nos deux pays, la France et Israël, une stratégie et des tactiques…’’ Voilà ce qu’ils osent, reprend le cheikh en arabe. Par moment Larbi voyait son père. « El-Mimoun ressemble drôlement à papa », pensa-t-il en se demandant pourquoi il ne lui avait pas inculqué les rudiments sur l’état du monde et du monde arabo-musulman. Un frisson lui parcourut l’échine lorsqu’il se demanda ce que penserait son frère Yanis — qui lui recommande souvent d’être un homme droit et bon avec les autres — s’il savait qu’il fréquente cette mosquée depuis des années. Personne dans la famille ne le sait, ni même ses amis. D’ailleurs, il ne voit presque plus ses anciens amis de la cité. Larbi ne put ou ne voulut pas rétablir les ponts. Des amis, il en trouva d’autres, plus intéressants, et pieux comme lui. Le juge des enfants et Charly lui apparaissent un instant. Il voit Charly à Clichy-sous-Bois, puis à la télévision exprimant avec violence sa haine inouïe des Arabes et des musulmans. Larbi se demande ce qu’il continue de dire à la télévision. Depuis sa libération du centre de Savigny-sur-Orge, il ne la regarde plus, l’évite autant qu’il peut, haram. « Sept ans déjà ! » pense-t-il en redressant la poitrine. Il dit staghfirou Allah, pardon à Dieu. Il revient à l’imam. « Tous ces khoubatha malveillants sont responsables du marasme du monde et, par leur soutien direct ou indirect au taghout El-Alaoui, aux centaines de milliers de morts en Syrie, laânetou Allahi âlayhim el koul ». Amen, répond l’assemblée. « Pour toutes ces raisons mes chers frères nous avons l’obligation devant Dieu le miséricordieux d’envisager de nouvelles ripostes à la hauteur du défi qui nous est posé, encore plus fortes, encore plus terribles. » Puis de nouveau en français « des ripostes dignes de notre foi en Allah sobhanou. » L’allusion aux attentats qui ensanglantèrent Paris est rapide, El-Mimoun ne s’y attarde pas, « la riposte aux Koffars doit être toujours plus forte, toujours plus terrible ». Larbi exerce une forte pression sur ses doigts croisés jusqu’à faire accélérer l’afflux sanguin. Louis le Soumis est présent dans la salle. Il ne dit rien jusque-là. Maintenant il se lève et d’un pas lent, assuré, s’approche du minbar. Reste debout. Il prend la parole à son tour à la suite de deux autres membres de l’association. Le Soumis s’étend sur les commentateurs médiatiques les plus violents en appelant les musulmans sincères à ne pas se laisser intimider. À la fin de son intervention il lit deux versets coraniques : « Wa len tardha ânka elyahoudou wa la ennassara hatta tettabiâ millatahoum… » qu’il traduit en français « Et les juifs ne seront jamais contents de toi, les chrétiens non plus, jusqu’à ce que tu suives leur religion… Ô, les croyants ! Ne prenez pas pour amis les juifs et les chrétiens : ils sont amis les uns des autres. Et celui d’entre vous qui les prend pour amis, eh bien oui, il est des leurs. Non, Dieu ne guide pas le peuple prévaricateur ». Les dernières phrases de son discours, le Soumis les prononce en arabe « Wa qatilou fi sabili Allahi… Combattez dans le sentier d’Allah ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Vraiment, Allah n’aime pas les transgresseurs !… Et tuez ceux-là, où que vous les rencontriez… Puis, lorsque les mois sacrés expirent, alors tuez ces faiseurs de dieux, où que vous les trouviez ; et capturez-les, et assiégez-les et tenez-vous tapis pour eux dans tout guet-apens… » Contrairement aux précédentes dont le débit était trop rapide, Larbi assimila parfaitement l’intervention de Louis le Soumis. Mais Tarik répondra à toutes les questions que son ami se pose, il reprendra pour lui l’essentiel des harangues. Peut-être précisera-t-il des expressions, des tournures, probablement ajoutera-t-il ses propres commentaires et d’autres.
La nuit s’éclipse sous le regard indifférent des rares passants. Dans cette partie du quartier des Champs-Élysées, comme sur toute la ville, une pluie fine, continue, tombe sur la chaussée. Charly vient de finir sa chronique à RTL. Il est 7 h 45. Ce matin il traita de football, fait rarissime chez lui. Dans deux jours les joueurs du PSG affronteront au Parc des princes leurs grands rivaux de la cité phocéenne. Charly émit de sérieuses réserves sur « les Africains Kimpembe et Ben Arfa, trop indisciplinés et n’en faisant qu’à leur tête ». Puis il loua longuement « l’élégant petit Kevin Trapp qui peut faire un travail exceptionnel contre les Marseillais, certainement mieux que Areola ! » Après sa chronique, Charly quitta les studios du sous-sol sans traîner. Il est encore tout en sueur. Il porte sous le bras un fin classeur et plusieurs journaux. Il se trouve à l’extrémité de la rue Bayard et s’apprête à prendre l’avenue Montaigne. Sa démarche sur ses hauts talons est aussi raide que la veste du costume croisé gris foncé qu’il porte sur une chemise noire coupée par les trois couleurs bleu blanc rouge d’une imposante cravate. Il avance sous son ample parapluie droit noir qu’il tient comme un capitaine vainqueur de coupe tient son trophée, mais de sa seule main libre. Il traverse l’avenue à hauteur de la boutique Chanel. Sa démarche n’est plus alerte, mal assurée. Tout cela n’est pas nouveau, ses tempes sont grises et l’outrage du temps n’épargne personne, fut-elle reine de Saba ou de Chine. En face, il ralentit le pas, passe devant la Melli Bank qu’il ignore. Vendredi dernier il s’y était arrêté pour retirer quelques billets du distributeur, pas ce matin. Il fait d’autres pas, arrive à hauteur du numéro 41, devant la brasserie L’Avenue. D’un geste brusque, il secoue la poignée en bois de son parapluie noir Arabica et pousse la porte vitrée. Il le dépose dans le porte-parapluie, à l’angle près de la porte. À la vue d’un employé, il brandit la main pour le saluer. Puis il pose ses documents sur sa table fétiche et s’assoit. Mimoun choisit toujours la même table lorsqu’elle est libre — c’est souvent le cas à cette heure-ci — dans la partie qui donne sur l’entrée, à hauteur de la banque. « Café afuch monsieur Pinto ? » lui lance le serveur à moitié courbé. « Comme toujours » répond Charly sans le regarder. À la une du premier journal qu’il extrait du classeur, Le Figaro, il lit ce titre : « Hillary Clinton a-t-elle déjà gagné ?… La candidate démocrate devance largement Donald Trump et ferait mieux que Barack Obama en 2008 et 2012 ». Libération montre sur toute la une un soldat kurde, lourdement armé, sous ce titre : « Reportage en Irak. Au cœur des combats… notre envoyé spécial a suivi les progrès des combattants kurdes qui desserrent l’étau de l’État islamique autour de Mossoul. » La photo en une du Point montre François Hollande et le roi Salmane d’Arabie très proches l’un de l’autre. Le titre semble vouloir traduire l’image« Liaisons dangereuses ». Le titre exact est : « Liaisons dangereuses… le livre-enquête de Chesnot et Malbrunot. »
Larbi est assis sur le banc de l’abribus, lisant ou faisant mine de lire, à la lumière du réverbère Souvenirs de la maison des morts — il le prit plus pour faire diversion que pour lire — la capuche de son blouson de cuir est relevée. En réalité l’œil de Larbi ne cesse de fixer le 41. Il regarde vers L’Avenue et plus loin vers le rond-point. Puis sur sa droite, de l’autre côté, vers le bas de l’avenue Montaigne en direction de la lointaine Flamme de la liberté. De nouveau il plonge son regard vers la brasserie. Il tient le livre presque plaqué contre son visage. Regarde la page, ne lit pas. Son esprit le lui interdit. Il est seul sur le banc. Un bus arrive, il se lève, s’extrait de l’abribus. Le bus ne s’arrête pas. Larbi revient au banc, regarde sur sa droite, en direction de la Seine. Se lève de nouveau. Il fait quelques pas puis retourne sous l’abribus. Il est fébrile. Il glisse la main dans la poche de son pantalon, se saisit du chapelet, répète sobhanna Allah, Allahou akbar en l’égrenant.
Le mois dernier, Larbi avait assisté à deux reprises à l’émission de Mimoun. La seconde était d’une violence inouïe contre les musulmans. Celle de vendredi dernier « L’islamisme c’est l’islam en mouvement » il paraît qu’elle était « monstrueuse ». C’est ce mot qu’utilisa son ami Tarik lors de son intervention à la réunion du dimanche à la mosquée. Il dit « Wahchiya ». Que ce soit à la première comme à la deuxième émission auxquelles Larbi assista, toutes les chaises — capitonnées — de la salle du sous-sol étaient occupées. La chaleur y était étouffante. Larbi bouillonnait sur son siège. Il sentait monter en lui la nausée. Au-dessus de lui le plafond tournoyait. De son front, de ses bras, la sueur coulait. À l’entrée le vigile l’avait méticuleusement fouillé. Pour l’avoir suivi de nombreuses fois après ses chroniques (notant tous ses faits et gestes), Larbi connaît dans le détail le chemin — toujours le même — très court, qu’emprunte à pied le journaliste à chaque fin d’émission pour se rendre à L’Avenue.
Lorsqu’il voit Charly sortir de la brasserie et secouer son parapluie, il enlève la main de la poche du pantalon, cesse de louanger Dieu à l’aide des perles de bois. Il se lève, range son livre dans la grande poche extérieure de son blouson noir. Bientôt il emboîtera le pas à Charly qui revient sur son chemin pour récupérer sa voiture stationnée dans le parking souterrain du 22 rue Bayard. Larbi le sait. À cette heure matinale, la circulation dans le quartier est encore fluide et les piétons sont peu nombreux. Le ciel est chargé tout comme ces derniers jours. C’est au niveau de la boutique Versace, alors que Charly s’apprête à traverser l’avenue Montaigne, que Larbi arrive à sa hauteur. Il avance un peu plus, le frôle, jette un regard appuyé sur les chaussures de Charly puis d’un geste vif il plaque sa main droite sur ses fesses. Charly se retourne brusquement en balayant son postérieur de son bras. Puis il dresse le parapluie devant Larbi. « Salope de tarlouze ! » lance Larbi en crachant au sol. Il lit dans le regard de Charly cet air assuré qu’on a lorsqu’on considère que son statut est hautement supérieur à celui de son vis-à-vis, le visage empreint de gravité et l’allure générale condescendante, méprisante. Larbi en est convaincu. Il ne le quitte pas de l’œil. « Salope » répète-t-il, avec, à l’instant même où il l’injurie, autant de pitié et de férocité dans son regard que dans sa voix. Leurs cœurs sont encordés aux plus profondes des haines. Larbi tourne la tête à gauche et aussitôt à droite. Puis en un éclair il plonge la main dans son blouson de cuir pour extirper son Zwilling, et, comme s’il avait fait cela toute sa vie, dans un geste théâtral faisant onduler son corps sans quitter des yeux Charly, le plante dans sa poitrine en hurlant « Allahou Akbar ! » Une fois, deux fois, trois fois. Autant de coups que de cris de guerre. Mimoun s’écroule en poussant un hurlement farouche. Le parapluie, le classeur et les journaux lui tombent des mains et s’éparpillent sur la chaussée. Larbi glisse et tombe sur Mimoun. À côté gisent Souvenirs de la maison des morts et un petit carnet noir, ouverts tous les deux. Des passants pris de panique se mettent à crier. On hurle, on court, un camion freine brusquement, s’immobilise. Il est embouti par une voiture qui le suivait. Larbi se relève, court, entraîné par l’énergie d’un assassin qui n’a plus rien à perdre sinon la vie, le couteau dégoulinant de sang encore dans la main, en direction de la plus belle avenue du monde, toujours illuminée, engourdie par tant de frasques, d’extravagances ou de tragédies exécutées cette nuit en son sein. « Me cago en la puta madre que te parió. Chien de ta race » lâche Mimoun, à peine audible, en se contorsionnant. Le sang gicle à travers la chemise noire. Son agresseur disparut. Il entend des cris. Des hurlements d’hommes. Il lui semble entendre un claquement sec, puis d’autres. Des deux mains, la droite posée sur la gauche, il appuie à n’en plus pouvoir contre l’abdomen tailladé, à hauteur du rein gauche. Des étoiles voltigèrent quelques instants dans le ciel secoué avant de s’écraser sur son corps. Il entend les cris qui fusent des passants affolés. Des cris ou des chants ? Il s’interroge. En tombant, il buta contre le rebord du trottoir mouillé qui lui embrase le visage. La cravate tricolore souillée lui ceint le cou. Elle est pliée de telle sorte qu’elle forme comme un fer à cheval approximatif. Mimoun tremble de tout son être. Ne sait pas s’il a froid ou chaud. Il est bientôt submergé par son histoire et celle des siens. Des pans entiers de sa vie défilent à présent devant ses yeux mi-clos avec une netteté qui le surprend. Des hommes et des femmes, des événements, des lieux, des idées, comme dans un rêve. Jusqu’aux obsèques de ses parents auxquelles il n’assista pas. Tout ce qui le constitua, qui l’enrichit peut-être, mais aussi tout ce qui l’avilit, corps et âme. Un lot d’images d’une histoire qu’il ne connut pas, qu’il apprit par cœur, pour, comme lui répétait son père, ne pas oublier. Un lot d’images donc qui se figent. Il voit ce grand-père qu’il ne connut pas. Le corps de Yacoub allongé sur un trottoir d’Oran. Il allait sur ses trente-cinq ans. Il accompagnait son fils à l’école Bénichou comme il le faisait souvent. Cette vision d’horreur Mimoun l’avait créée, l’avait imaginée. Reconstituée d’une certaine façon. Jamais il ne vit son grand-père, jamais il ne vit donc son corps allongé sur le trottoir, à quelques mètres de l’école que fréquentait son père Gaston. C’est lui, son père, qui lui répéta souvent cette agression pour qu’il n’oublie pas. « N’oublie jamais mon fils, zakhor, zakhor… » comme l’apprentissage de la Guemara. C’est ce tableau rouge qui se présente à lui alors même que son propre corps est allongé sur la chaussée froide et humide du boulevard Montaigne à quelques pas de la rue Bayard. Il voit le Maghrébin. Il voit les Maghrébins, « les Arabes » « los Moros ». Il crie. Crie-t-il ou s’entend-il crier ? « Nous nous dirigeons vers le chaos ! Les musulmans ne sont que des ‘‘gardeurs de moutons et de chameaux !’’ Ils vivent chez nous, mais ne veulent pas vivre à la française ! » Ses lèvres tremblent, mais Mimoun ne parle pas, ne murmure pas. Ces mots qui ne sont pas des mots sont en lui, ils lui font mal, dans la bouche de sa mémoire désormais en proie à la déréliction. « Cette situation nous conduira à la guerre civile ! Il faut les déporter comme ils nous ont déportés ! » Les phrases qui ne sont pas des phrases sont noires, lourdes, hachurées, et inutiles à la fois. Elles tremblent autant que son corps, dans son corps. Elles se bousculent pour s’en extraire, en vain, et sa douleur est grande. « Kol od balevav pénimah/Néfesh Yehoudi homiyah… » Il tente une fois encore de se relever. Il redresse la tête à quelques centimètres du sol. Ses efforts sont surhumains. Il dit, non il ne peut pas dire, sa bouche frémit, c’est en lui, au plus profond de son être : « J’ai tué des hommes et des femmes, des vieillards, mais aussi des enfants et je ne regrette rien. » Ces phrases ne sont pas. Elles sont un mélange de pensées et de visions qu’il faut ainsi comprendre, une représentation mentale. Il récite, c’est en lui : « Mes plaies sont infectes et purulentes, par l’effet de ma folie. Je suis dans la crainte à cause de mon péché. Et mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. Ceux qui me haïssent sans cause sont nombreux. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils sont mes adversaires, parce que je recherche le bien. Ne m’abandonne pas, Éternel ! ne t’éloigne pas de moi ! Viens en hâte à mon secours, Seigneur, mon salut ! Je file mon suaire ! » Mimoun Pinto n’avait jamais pensé que la mort pouvait se présenter à lui ainsi, alors qu’il a la tête et le cerveau dans le caniveau. Il soulève la main droite pour la porter contre son arrière-train. Ce n’est plus une main, c’est un fardeau, un poids, le plus lourd qu’il n’ait jamais porté. Son geste misérable et inutile ne peut empêcher l’écoulement, sous le pantalon, de sa matière molle et il a soudain, vaguement honte de son corps, de son âme, des siens, de ses ennemis, du monde. Et de ses dérisoires bottines noires à hauts talons. Sous son visage, maintenant immobile contre la rigole, l’eau de pluie est souillée, sa teinte désespère le jour.
Larbi se lance dans une course éperdue en direction du métro Franklin Roosevelt. Il abandonna le couteau dans une poubelle, au bout de l’avenue. Il tend l’oreille au bruit sec qui claque. Qui vient d’en face, du rond-point. Aussitôt il fait demi-tour. Revient sur le côté impair de l’avenue Montaigne. Il entend encore plusieurs coups de feu. Il chancelle. Tombe à la renverse. Se relève avec difficulté. Parcourt quelques mètres. S’écroule de nouveau. Atteint par plusieurs projectiles, il s’effondre sur le corps de Mimoun. Trois, peut-être cinq, autres coups secs, brefs, suivent. Ses mains labourent le sol, caressent la toile du parapluie. Les voilà maintenant, Charly et Larbi, l’un sous l’autre, tête-bêche. Deux frères ou deux cousins, deux ombres mêlées, confondues, encore animées. Larbi grimace, sa bouche se tord, il veut prononcer quelques mots, mais il ne peut les articuler, ces mots au cœur de son corps « ils nous détestent, ils ne nous ont jamais aimés… » Il émet des sons inaudibles, le visage enserré dans la capuche de son veston. Le voilà, lui aussi, submergé par son histoire, plus courte. Des périodes plus ou moins heureuses, plus ou moins exécrables remontent à sa mémoire. Il revoit sa sœur Sarah en infirmière, les yeux verts de sa mère, son sourire. Il voit son grand-père Kada ramassé en chien de fusil sur le skaï, « il était heureux. » Larbi l’entend fredonner, ses lèvres frémissent,
À ses côtés, le livre qu’il prit pour dissimuler son visage, passer inaperçu, le livre qu’il lisait dans le centre éducatif. Souvenirs de la maison des morts glissa hors de la poche du blouson. La page 105 s’offre aux curieux, aux hommes de bonne volonté : « un homme vit tranquille et paisible ; son sort est dur — il souffre… Il sent tout à coup quelque chose se déchirer en lui : il n’y tient plus et plante son couteau dans la poitrine de son oppresseur ou de son ennemi. Alors sa conduite devient étrange, cet homme outrepasse toute mesure : il a tué son oppresseur, son ennemi : c’est un crime, mais qui s’explique ; il y avait là une raison ; plus tard il n’assassine plus ses ennemis seuls, mais n’importe qui, le premier venu ; il tue pour le plaisir de tuer, pour un mot déplaisant, pour un regard, pour faire un nombre pair ou tout simplement : ‘‘Gare ! ôtez-vous de mon chemin ! ’’ Il agit comme un homme ivre, dans un délire. Une fois qu’il a franchi la ligne fatale, il est lui-même ébahi de ce que rien de sacré n’existe plus pour lui ; il bondit par-dessus toute légalité, toute puissance, et jouit de la liberté sans bornes, débordante, qu’il s’est créée, il jouit du tremblement de son cœur, de l’effroi qu’il ressent. Il sait du reste qu’un châtiment effroyable l’attend. Ses sensations sont peut-être celles d’un homme qui se penche du haut d’une tour sur l’abîme béant à ses pieds, et qui serait heureux de s’y jeter la tête la première, pour en finir plus vite. Et cela arrive avec les individus les plus paisibles, les plus ordinaires. » Larbi agressa-t-il Charly parce qu’il y avait une cause ou parce qu’il avait sa raison ?
Le policier qui tira, s’approche des deux hommes ensevelis sous l’étendue de leur solitude, l’arme toujours au poing. Des collègues arrivent en courant. Une dame montre Charly,
— Le monsieur il passait et le jeune il l’a poignardé en criant A la wakbar.
— ouais, le monsieur marchait tranquillement et l’autre lui a sauté dessus, dit son voisin.
— Ils sont morts ?
— …
Le policier se penche sur les corps pour, de sa main libre, se saisir d’un carnet noir et d’un journal. Puis, après avoir rengainé son arme, il enlève l’élastique qui fermait le carnet et prend la feuille qui se trouve à l’intérieur, une feuille ordinaire 21X29 pliée en huit. Mimoun et Larbi font comme deux ombres défaites. Rien ne semble bouger, aucun souffle. Le fluide de la vie paraît s’être définitivement asséché. Les deux ombres sont abandonnées à leur sort. Elles atteignirent, dans deux élans symétriques, l’horizon de leur propre limite, de leur propre obscurité dans une identique humanité, dans une identique proximité, traversées par une même mélodie intime tragiquement humaine :
« Ya ommi ya ommi ya ommi
Essmek deymen fi fommi
Men youm elli âyniya chafou eddouniya
Chafouk ya ommi-laâziza âaliya… »
Autour des deux hommes, sur la chaussée mouillée, de nombreuses petites perles de bois éparpillées font comme autant d’étoiles dans le ciel noir. Plus loin, à une vingtaine de mètres, les roues d’un scooter renversé tournent encore. À proximité, un adolescent est allongé, immobile. Une expression étrange se dégage de ses grands yeux noirs ouverts. On dirait qu’ils interrogent le groupe de personnes qui se constitua spontanément autour de lui. Un filet de sang s’écoule de la nuque du motocycliste. « Il passait », balbutie une dame qui attendait le bus.
Le policier qui fit feu tient dans la main gauche le carnet noir et la feuille qu’il récupéra près des corps. La pluie épargna le contenu de la feuille et l’essentiel du carnet, pas sa couverture. « Qu’est-ce que c’est ? » demande un collègue. Le carnet est noirci — il porte le nombre 107 en sa première page, probablement son numéro d’ordre —, il est noirci de noms bibliques et de numéros de téléphone, de mots et d’incompréhensibles lettres et chiffres. Le policier put ainsi lire : « hm9h y8ev9gmgey9 bvh tm8h gyalv9g » et d’autres messages codés. Puis encore « la septième branche du chandelier brillera de nouveau ». Quant à la feuille, dépliée, elle porte en en-tête ces mots : « RTL– 1re radio de France. 22 rue Bayard. 75008 Paris. Charly PINTO journaliste. Email : charly.pinto@rtl.fr Tél. : 06.20.73. XX. XX ». À droite, une date est portée au stylo à bille à encre noire : « ve. 14/10 ». Le reste est un long texte rédigé à l’ordinateur sur le recto et le verso de la feuille. Le policier lit :
« Bonjour à tous. Aujourd’hui ‘‘L’islamisme c’est l’islam en mouvement’’. Notre pays, ses valeurs et son histoire, que l’on veut réécrire avec une autre hache, sont menacés. Une guerre nous a été déclarée. Cette guerre nous devons la gagner. La France n’est pas une terre d’islam. La grande majorité des Français est contre la religion de l’immigrationnisme. La religion mahométane, ce fascisme vert qui déteste nos valeurs, notre mode de vie, notre humus est incompatible avec notre République. L’islam n’est pas une religion, c’est un dispositif de guerre. Je répète que cette religion et ses adeptes nous ont déclaré la guerre. Ces gens-là sont infidèles à la France éternelle. Ils lui tournent le dos, ils veulent nous imposer à nous, chez nous, leurs pratiques moyenâgeuses, leur CHARIA ! Mon cher ami Pinky a mille fois raison de dénoncer les accoutrements étrangers à notre civilisation que nous sommes sommés d’accepter, comme le foulard et le burkini islamiques. Il est insupportable à la majorité des Français de constater que dans les cafés de certaines cités on ne trouve plus de femmes, que dans certains quartiers on ne trouve plus de Blancs. Nous ne sommes plus en France, mais en Algérie ou en Arabie, c’est à se tirer une balle dans la tête ! La France aujourd’hui n’est plus que l’ombre de sa grandeur passée. Aujourd’hui, plus encore qu’hier, nous sommes dépossédés, nous sommes spoliés par ces ‘‘MINABLES DU SAHARA’’, nous ne sommes plus chez nous, et demain nous serons étrangers sur nos propres terres, soumis si nous ne réagissons pas. Les musulmans, dans leurs pratiques quotidiennes, violent nos lois. Les vêtements comme les burnous, djellaba, chéchia et burkini sont à bannir de notre espace national. LA MAIN DE FATMA n’est pas la main de la France. Chers auditeurs, je revendique moi aussi le droit de HAÏR L’ISLAM et tous ces ‘‘revendicateurs, caïds sournois, bornés, fanatiques, maléfiques.’’ Nous sommes aujourd’hui sommés de plaider pour une banlieue universelle où toutes les racailles porteront leur casquette à l’envers en charabiatant entre hommes dans les bars. Les racailles, ces hordes qui ont mené, il y a une dizaine d’années, une guerre contre la France et les Français à partir des banlieues, ces hordes sont prêtes à récidiver. Une mèche et tout s’embrase de nouveau. On nous gorge de « diversité, de discrimination positive, de multiculturalisme » ! mais ce ne sont là que des concepts abjects qui participent de la destruction de notre socle civilisationnel ! La discrimination positive c’est du RACISME ANTI-BLANCS qui ne dit pas son nom. L’idéologie antinationale de bien des élites françaises a largement contribué à cette situation. Monsieur Pinky a mille fois raison lorsqu’il s’insurge contre l’antiracisme, cette hideuse fausse idéologie, cette source de violence du 21e siècle.
Mais alors que faire ?
Le patriotisme, le courage et l’urgence exigent qu’en cette nouvelle législature, nos gouvernants entament un processus de désislamisation de notre société. Le Coran devrait être interdit. ZÉRO MOSQUÉE en France ! Notre armée nationale devrait reconquérir les territoires perdus de notre chère République, de notre France, abandonnés aux musulmans. Notre armée devrait détruire les casbahs érigées dans notre République, plutôt que de se maintenir dans des tâches ridicules dans les gares, devant les mosquées et ailleurs, comme c’est le cas aujourd’hui. L’urgence sera aussi d’interdire à toutes ces myriades d’individus, d’associations, d’amicales, de sites Internet, de radios communautaires, de continuer de propager le venin de l’islam dans notre société. Il est de la première nécessité de contenir cette invasion migratoire musulmane qui nous submerge depuis des décennies et qui a réussi à changer l’image de nos belles villes par l’aveuglement, voire la complicité de nos gouvernants. Il faut déchoir de la nationalité tous ces musulmans qui, force est de le constater, récusent notre Grand roman national. Ils ne sont pas loyaux vis-à-vis de notre pays qui les accueille et leur offre toutes sortes d’allocations au détriment des vrais Français. Les musulmans n’ont d’autre choix que de renoncer à leurs coutumes et croyances anachroniques ou bien quitter la France et rentrer chez eux, retrouver le pays d’origine de leurs parents ou grands-parents. Il faut mettre un terme au GRAND REMPLACEMENT du peuple français. Ce GRAND REMPLACEMENT est un crime contre notre humanité, contre notre Europe judéo-chrétienne. Chers auditeurs, chers compatriotes, j’attire votre attention sur cet extrait que je fais mien de mon cher et regretté ami Klein Benyamin : ‘‘un grand danger menace la France. Ce grand danger, c’est LE MUSULMAN. Dans toutes les régions où les musulmans se sont installés, ils ont affaibli la moralité et fait baisser le niveau de l’honnêteté, ils se sont isolés, ont rejeté toutes les tentatives faites pour les intégrer et se sont moqués des valeurs de notre religion judéo-chrétienne, sur laquelle se fonde notre nation. D’ici cent ans, s’ils ne sont pas expulsés de France par la Constitution, ils seront si nombreux à grouiller dans ce pays qu’ils nous gouverneront, nous détruiront et modifieront la forme de gouvernement pour laquelle nous, Français, avons versé notre sang et sacrifié nos vies, nos biens et notre liberté individuelle. Nos enfants travailleront dans les champs pour les nourrir tandis qu’eux se frotteront les mains de satisfaction.’’ VIVE LA FRANCE ! »
Alors que les roues du scooter renversé s’arrêtent de tourner, une lumière embrase brusquement les façades des derniers blocs de la bourgeoise avenue. Sous le ciel obscurci, la pluie continue de tomber et la foudre de tonner sa mise en garde.
* * *
+++++++++++++++++
CLIQUER ICI POUR LIRE LE ROMAN DANS SON INTÉGRALITÉ
fichier PDF
.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3 réflexions sur « LE CHOC DES OMBRES »