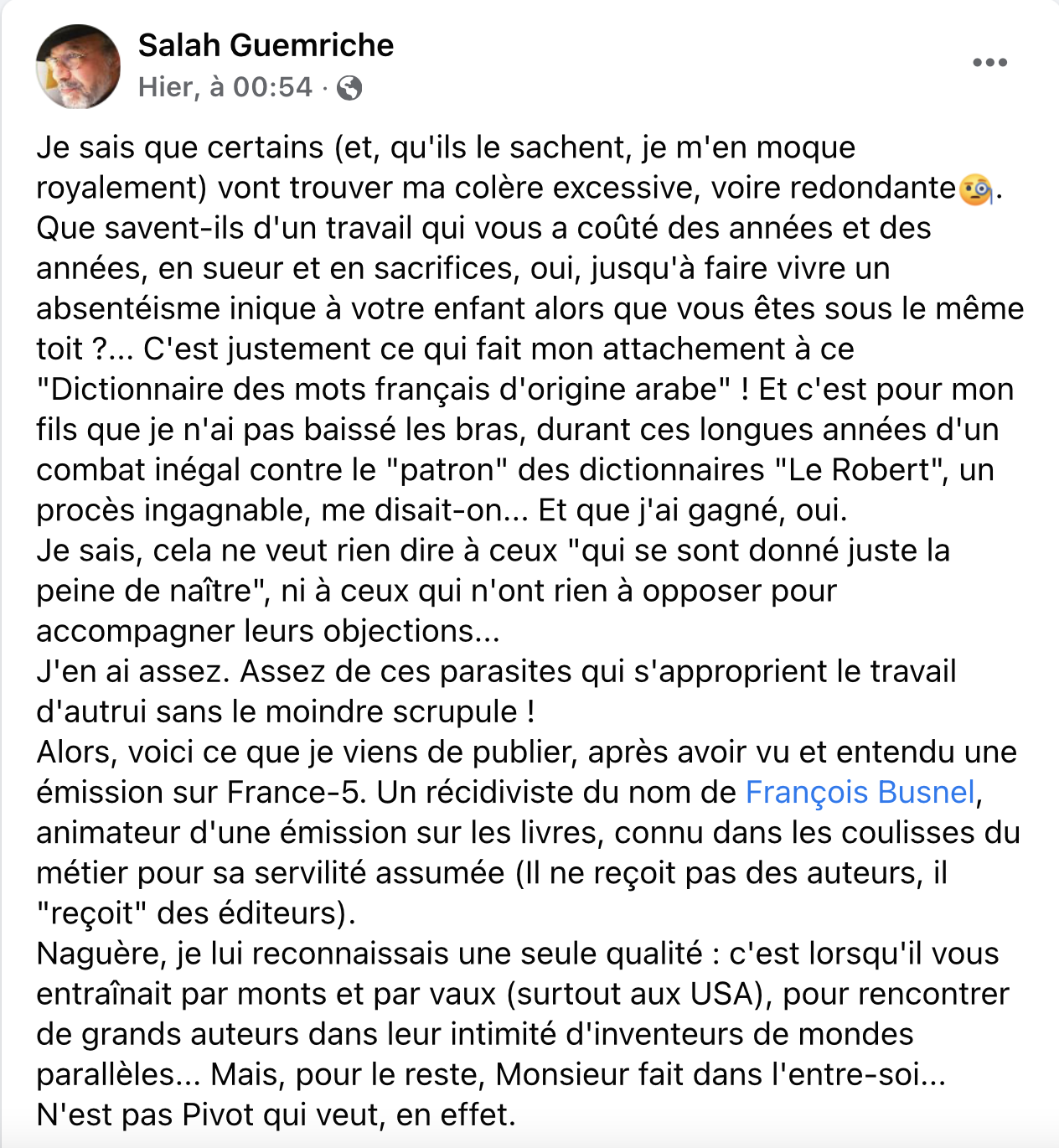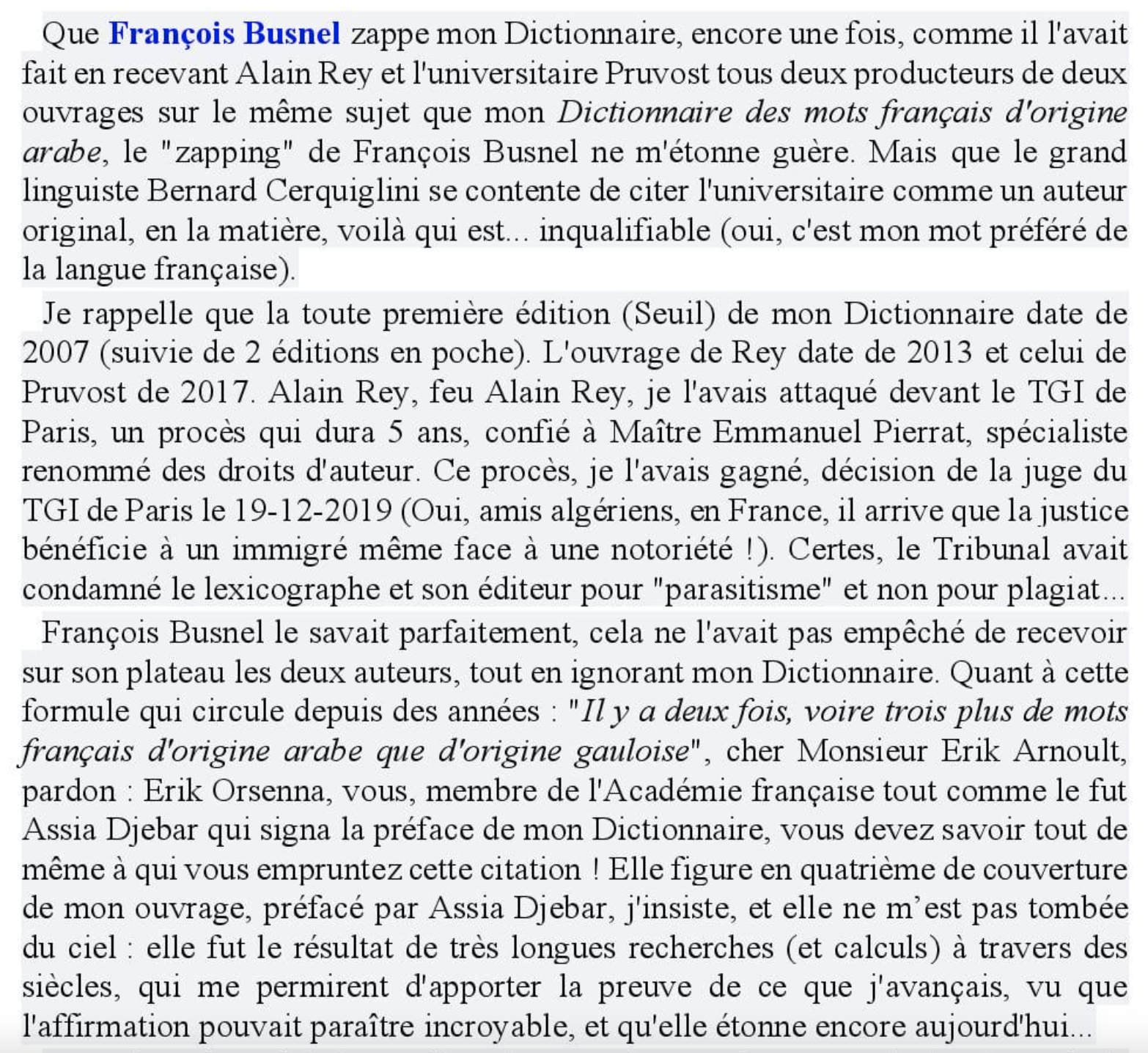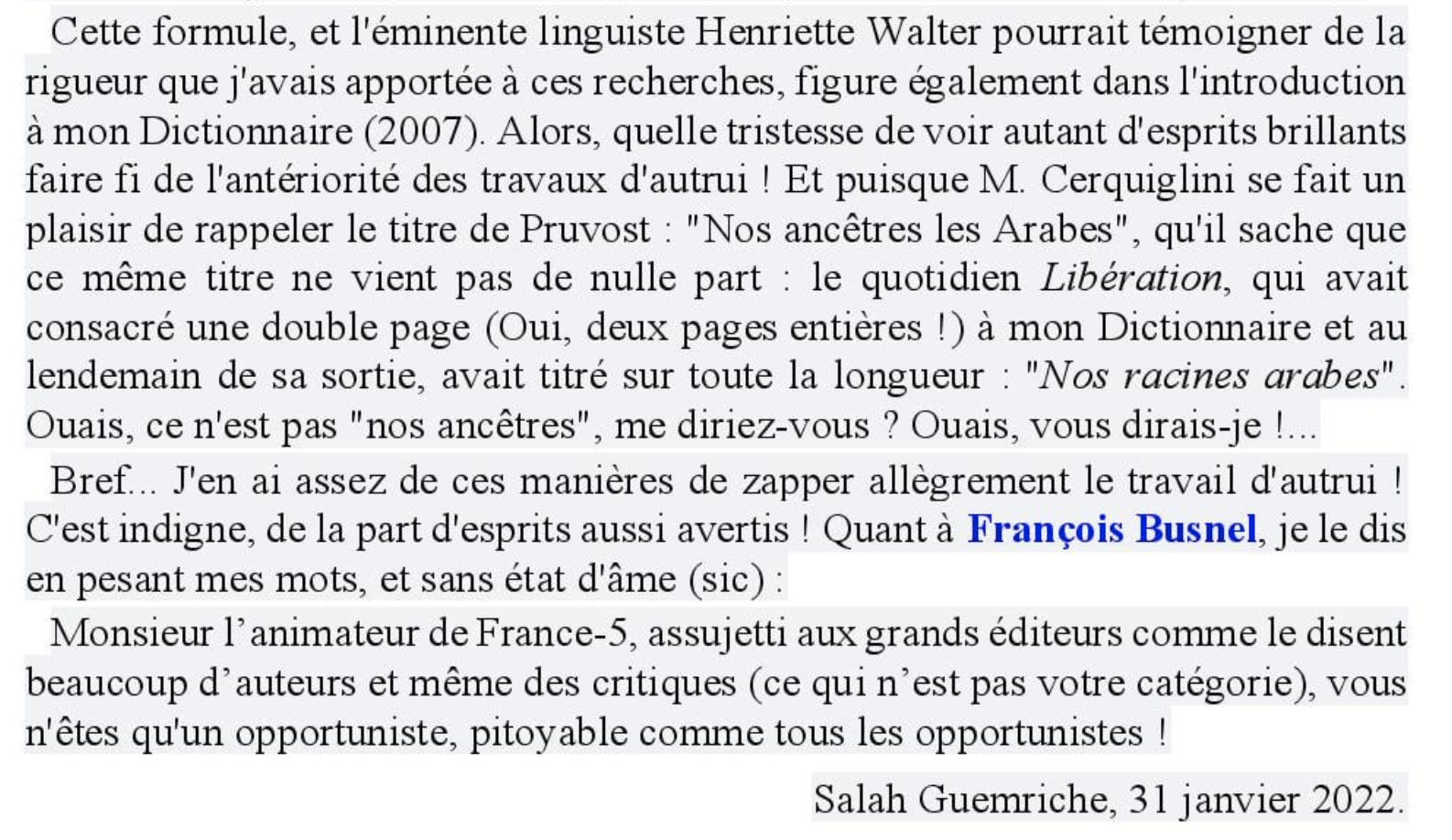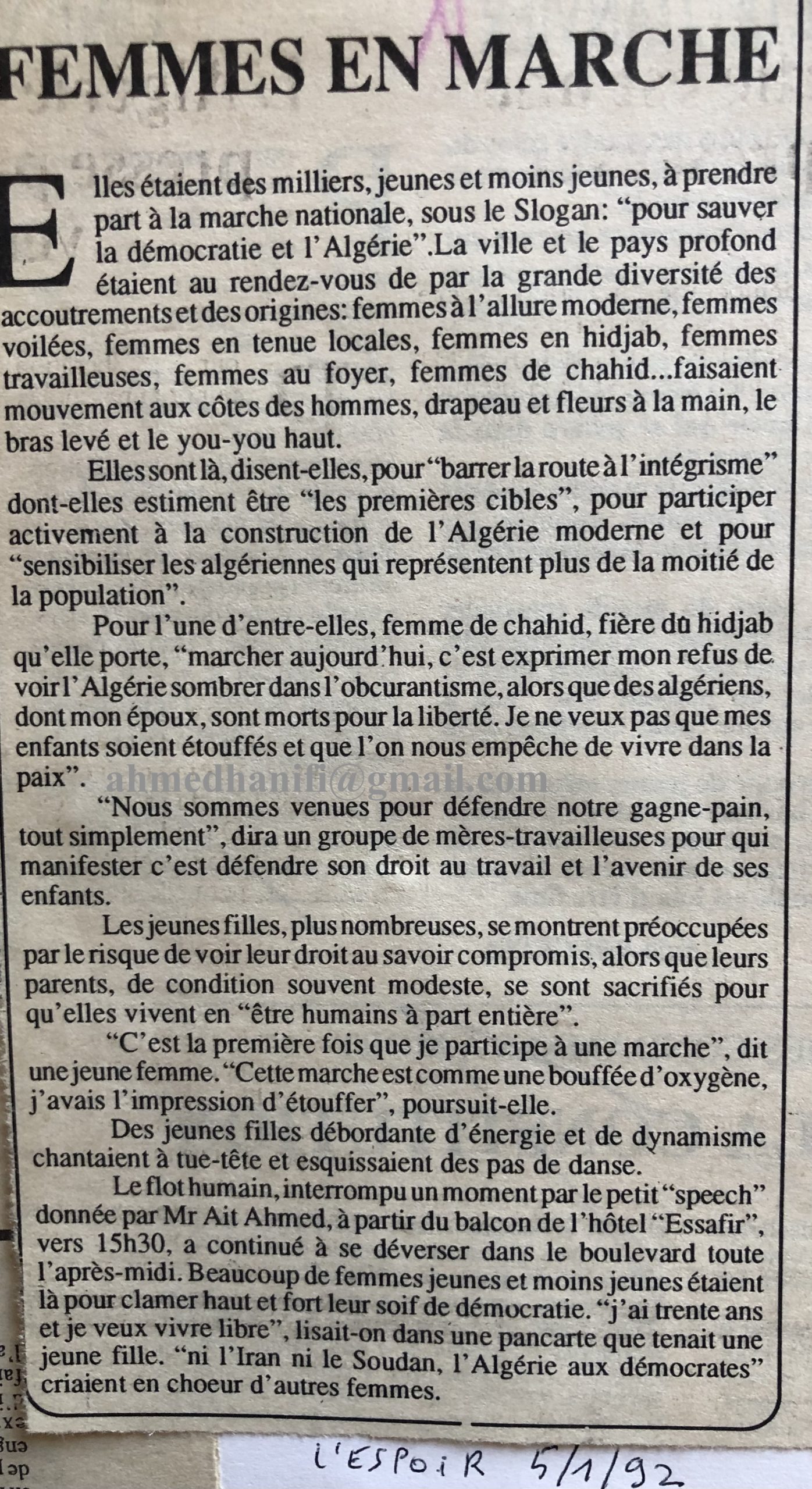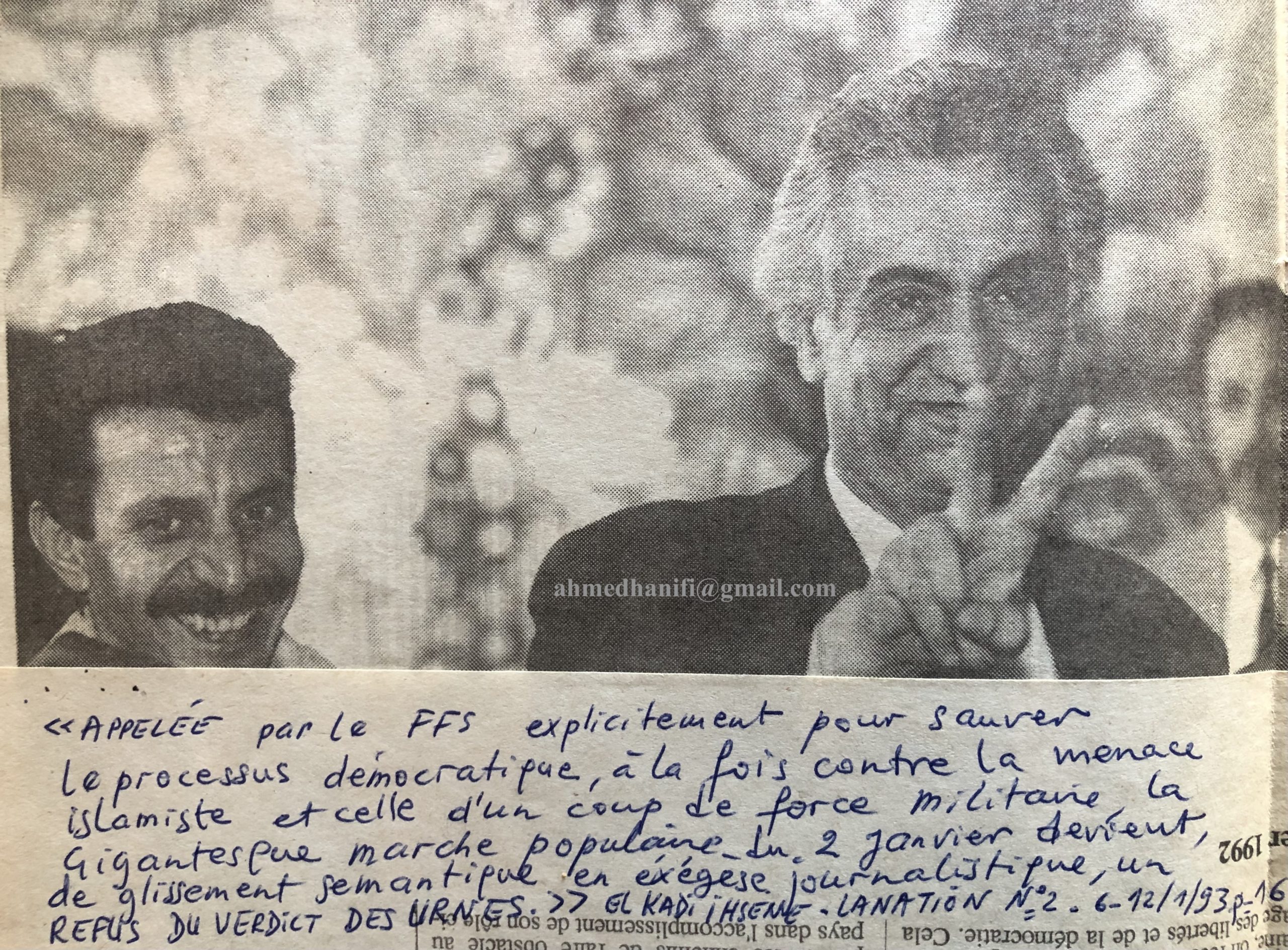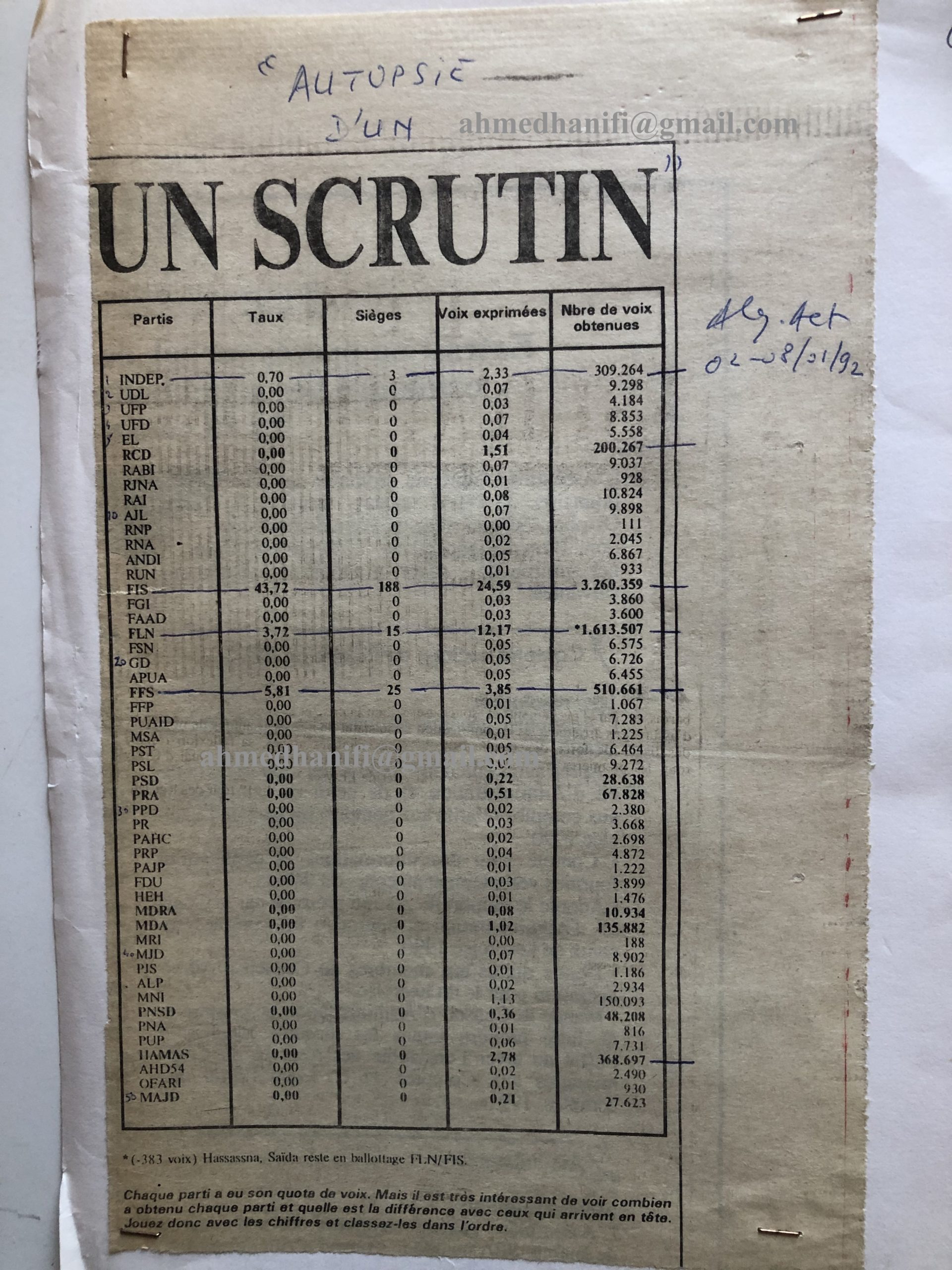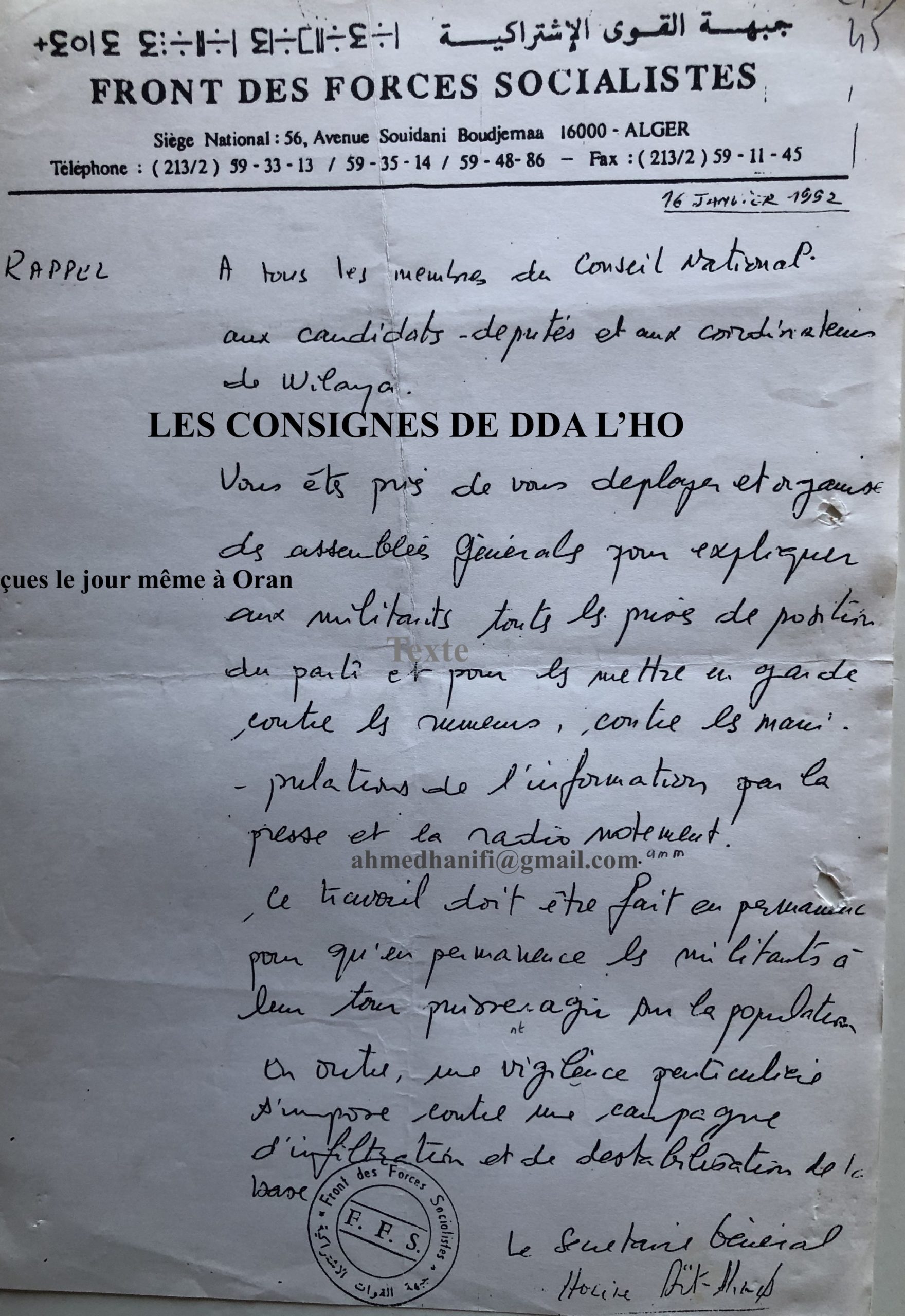______________________________________________________
CLIQUER SUR CE LIEN POUR LIRE LE ROMAN « La plus secrète… » en PDF
______________________________________________________
Ce qui suit est un entretien que Mohammed Mbougar Sarr a accordé à Jeune Afrique
_______________
JEUNE AFRIQUE
CULTURE
30 décembre 2021
Par Clarisse Juompan-Yakam
Mohamed Mbougar Sarr : « La colonisation est une épine plantée dans la chair de l’ancien colonisé »
Sénégal, relations Afrique-France, homosexualité, et surtout littérature… Le Prix Goncourt 2021 a tenu Jeune Afrique en haleine avec une verve réjouissante.
Plus d’une cinquantaine d’interviews avec des médias internationaux tels la Deutsche Welle, le Financial Times ou encore le Guardian ; entre 2500 et 3000 exemplaires de son livre événement dédicacés dans une vingtaine de librairies à travers la France… Mohamed Mbougar Sarr tient ses comptes depuis le 3 novembre, jour de son couronnement par l’Académie Goncourt pour La Plus secrète mémoire des hommes, une enquête étourdissante entre le Sénégal, la France et l’Argentine, sur les traces d’un écrivain disparu des radars, qui questionne le pouvoir de la littérature et le face-à-face entre l’Afrique et l’Occident.
Considéré malgré lui comme un sacré phénomène, l’enfant de Diourbel a pourtant encore de la ressource : mots soupesés – et pas un seul de travers –, propos structuré, il nous tient en haleine durant deux bonnes heures, délivrant son discours sans flottement, avec une douceur et une autorité intimidante. Comme lors de ce savoureux échange de plus d’une heure sur le rôle de la littérature en politique avec christiane Taubira, ex-ministre française de la Justice, argument contre argument, citation contre citation. Un régal.
Fêlures et angoisse
Jeune homme bien dans son époque, mais profondément habité par la littérature, ce fils de médecin a déjà commencé, par petites touches, à constituer « une œuvre honnête », celle, dit-il, dont il n’aura pas à avoir honte. Remarqué dès 2014 après la publication de sa première nouvelle, La Cale, pour laquelle il reçoit le prix Stéphane-Hessel de la jeune écriture francophone, il est révélé en 2015 par Terre ceinte, son premier roman, qui lui vaut le prix Ahmadou-Kourouma puis le Grand Prix du roman métis.
Pourtant, Mohamed Mbougar Sarr confesse quelques fêlures, ainsi que son angoisse, obsessionnelle, de ne pouvoir un jour exprimer ce qu’il veut, de céder à la médiocrité ou de se prendre pour ce qu’il n’est pas. Et ce qu’il n’est pas, Mohamed Mbougar Sarr entend aussi le dire sur le continent, où il envisage d’effectuer une tournée. Une façon de se connecter à sa poésie pour être au plus près de l’esprit humain.
Jeune Afrique : Des polémiques sont apparues après votre couronnement par l’Académie Goncourt. Par exemple, l’un de vos textes, publié en 2013 – vous aviez 23 ans – et décrivant une foule sénégalaise se rendant à un concert de Youssou N’Dour, a été dénoncé comme étant raciste.
Mohamed Mbougar Sarr : J’étais en effet très jeune, mais ce n’est pas une excuse. Je savais déjà ce que j’écrivais. Exhumer de vieux écrits pour confondre leurs auteurs est un procédé classique. Je réalise que la moindre visibilité vous soumet au regard inquisiteur des autres : on fouille dans votre passé à la recherche d’une sorte de vertu ou de pureté absolue. C’est vain. Le texte en question est un exercice de satire et d’autodérision. Je m’inclus dans ceux que je moque. Je suis allé à ce concert que je raille. Lire ce texte au premier degré, c’est manquer son humour et sa distance ironique. Mais je comprends que la négrophobie qui, historiquement, passait aussi par le recours aux stéréotypes, à la caricature et à la satire, a tellement fait souffrir les Noirs que, aujourd’hui encore, diriger une satire – fusse-t-elle littéraire – contre eux est toujours mal perçu. Davantage encore quand l’auteur de la satire est lui-même un Noir. C’était un texte peut-être maladroit, mais, en tant qu’écrivain, je refuse de me cantonner à certains thèmes et genres littéraires parce que je serais noir.
JE DÉFENDS L’IDÉE D’UNE LITTÉRATURE OUVERTE, OÙ TOUS LES IMAGINAIRES TROUVENT LEUR PLACE
Justement, on vous reproche d’écrire pour les Blancs…
Je ne suis pas toujours certain de comprendre ce procès, qui relève plus de l’idéologie et de l’identité que du poétique et du littéraire. J’y sens presque, parfois, un fond de mépris pour les Africains, qu’on peut finir par infantiliser à force de vouloir les particulariser, comme s’ils n’étaient pas en mesure d’être de vrais lecteurs. Que signifierait écrire pour les Africains ? Écrire sur des thèmes africains (à supposer qu’on sache ce que seraient ces thèmes) ? Écrire dans des langues africaines (étant entendu qu’il ne suffirait pas d’écrire dans ces langues pour être lu des Africains) ? Je défends l’idée d’une littérature ouverte, où tous les imaginaires trouvent leur place. Je suis africain, sénégalais, sérère. Mon imaginaire l’est tout autant et, qu’on le veuille ou non, cela ressurgit dans mes textes.
Votre roman De purs hommes, qui traite de l’homosexualité et de l’homophobie au Sénégal, a reçu de l’association Verte Fontaine et des éditions du Frigo, le « Prix du Roman gay », ce qui vous a valu les foudres de certains sur les réseaux sociaux et sur le continent, où ces sujets dérangent. C’est un cadeau empoisonné ?
Je trouve étrange qu’il arrive maintenant, pour un roman paru il y a trois ans. J’ai été surpris mais cela m’a aussi fait sourire: le prix Goncourt produit de pareils effets : beaucoup en veulent un morceau.
Vous ne le reniez pas ?
Au fond, ce prix m’indiffère, mais je me serais bien passé de la polémique qu’il a générée, qui me prête des intentions invraisemblables et m’éloigne de la littérature. [Il a été accusé d’être sous l’influence des lobbys LGBTQIA+, ndlr]. Désormais, quelle que soit la position que j’adopte, elle pourrait m’être reprochée par quelques-uns. C’est la rançon de la surexposition médiatique. Je dois accepter de vivre avec, c’est-à-dire, ne pas répondre à toutes les polémiques, refuser de comparaître devant tous les tribunaux institués pour clarifier des positions. Mon tribunal, c’est ma conscience. Mes juges, ce sont mes livres. Je voudrais demeurer un écrivain, quelqu’un assume ces moments de tensions créés par le langage littéraire, lequel est subtil, ambigu, fait de malentendus. Cette ambiguïté, dérangeante pour certains, moi m’intéresse.
Avez-vous été blessé par ces attaques ?
Certaines, violentes, étaient dirigées contre ma famille. Elles me touchent, mais ne m’ébranlent pas. J’essaie de comprendre les logiques profondes de ces réactions, mêmes les plus abjectes d’entre elles. Écrire, c’est prendre le risque d’être jugé et incompris. Je ne suis pas le premier écrivain dans cette situation. Je ne serai pas le dernier. Je remercie en tout cas toutes les personnes qui ont défendu la liberté de créer et de s’emparer de tous les sujets dans une perspective romanesque. Il ne s’agissait pas seulement d’un lynchage : il y a aussi eu débat, et il dépassait ma personne pour toucher à des principes.
N’y-a-t-il pas un décalage entre la réalité et les tabous que sont pour la société sénégalaise la sexualité, l’homosexualité, l’avortement ?
Comme la plupart des sociétés africaines, la société sénégalaise a été brutalement projetée dans la mondialisation. Les grandes questions sociétales se posent désormais à elle dans des termes qui lui sont étrangers. Par exemple, lors de la parution de De purs hommes, certains m’ont soutenu que « l’homosexualité [venait] de l’extérieur. » Or les études scientifiques prouvent qu’elle a toujours été présente sur le continent. Mais comment étaient-elles présentes ? Sous quel mode ? Là est la question. En réalité, les sociétés africaines ont toujours su intégrer toutes les minorités. Elles ont toujours eu des structures et stratagèmes d’intelligence sociale, que les colonisations ont précisément détruites. Aujourd’hui, parce qu’il y a ce contact avec l’extérieur, européen ou arabo-musulman, l’homosexualité devient paradoxalement un tabou, là où, à une époque, elle était digérée par un génie social, culturel et traditionnel africain. Aujourd’hui, suivant des logiques occidentales, et de façon brutale, on soulève la question de sa dépénalisation. Cela provoque des crispations au sein des populations, persuadées qu’on veut leur imposer un modèle de société. On en arrive ainsi à des violences homophobes.
N’est-ce pas assez hypocrite ?
Les choses se savent, se vivent, mais ne doivent surtout ni se dire ni s’écrire. C’est la définition la plus exacte de l’hypocrisie : savoir et ne pas vouloir se l’entendre dire.
Dans La plus secrète mémoire des hommes, vous racontez l’histoire d’un écrivain qui se lance à la poursuite d’un auteur disparu, dont l’unique roman a marqué l’histoire de la littérature africaine et française. Qu’est-ce que ce récit dit de la relation entre l’Afrique et la France ?
Il rappelle un mouvement de civilisation et un moment historique, où le racisme était présent partout, y compris dans la littérature. Racisme et préjugés pesaient alors beaucoup dans l’accueil réservé aux auteurs africains en France. Et Paris seule décidait de la valeur de ces écrivains, les encensant parfois avant de précipiter leur chute. Au-delà de l’histoire de cet écrivain fantôme, je tente de disséquer cette relation complexe entre deux espaces. Le premier, qui a été – s’est crû ou se croit encore – central, s’est arrogé le droit de dominer et coloniser l’autre. Fort de sa position, l’un dénie parfois à l’autre le droit de s’exprimer sur leurs relations, sur lui-même et sur l’ancien colonisateur. J’essaie de montrer comment la colonisation a pu, à travers un personnage d’écrivain, être un espace de domination, d’ambiguïté et d’exclusion, mais aussi d’amour et de relations puissantes. Le récit interroge non seulement les structures de l’échange littéraire africain, mais aussi le face-à-face entre l’Afrique et l’Europe, qui seraient vouées à se regarder en chiens de faïence.
Les deux parties semblent désormais d’accord sur un point : il faut en finir avec ce face-à-face.
Comme je le dis dans le livre, la colonisation est une épine plantée dans la chair du colonisé, et toute la question est de savoir comment continuer à vivre avec cette épine sans plus être obnubilé par elle et en lui ôtant le privilège de nous faire souffrir et d’emprisonner notre mental. Beaucoup s’imaginent qu’il n’y a qu’une seule manière de le faire.
Et quelle serait-elle ?
La rupture, définitive, radicale. Ceux qui la prônent voudraient cesser toute relation avec la France, ce qui est inenvisageable pour la simple raison que le monde est interconnecté. De plus, l’histoire tragique que l’Afrique entretient avec le continent européen a aussi fait naître des histoires individuelles et familiales entre ces deux espaces. Rompre avec l’Europe voudrait alors dire introduire des cassures, des désordres dans les trajectoires des familles, qui sont d’ici et de là-bas. Quelle relation aurait-on alors avec la diaspora ? Il ne faut pas voir les choses de manière abstraite et idéologique. Lutter contre l’impérialisme et le néocolonialisme est une cause noble a priori. Reste à gérer les complexités historiques de la mise en œuvre de ce combat. Il faut aussi admettre qu’il existe d’autres voies, plus apaisées, qui tentent, en établissant le dialogue, de poser des questions qui sont tout aussi radicales dans la mesure où elles touchent au fond des choses. Et ça passe aussi par un déplacement géographique. Tournons-nous, par exemple, davantage vers le continent sud-américain. Identifions ce que nous pourrions avoir d’intéressant à construire ensemble, afin de sortir de la relation exclusive avec l’Europe, qui devient toxique.
LE PANAFRICANISME EST UNE BELLE UTOPIE DIFFICILE À METTRE EN ŒUVRE
Le panafricanisme peut-il être l’une de ces voies ? A-t-il encore un sens ?
Je crois en l’idée. Elle me séduit dans ses expressions individuelles et locales, mais son échec, à l’échelle des grands ensembles, est patent. Même les grandes organisations continentales ne travaillent pas à le faire vivre, et donc échouent à se faire entendre sur des sujets essentiels comme la présence des armées étrangères en Afrique ou le franc CFA. Ces sujets sont portés par des activistes, parfois par des intellectuels, jamais par de grandes institutions politiques. Ce caractère inaudible me conforte dans l’idée que le panafricanisme est une belle utopie difficile à mettre en œuvre. La seule difficulté à voyager librement à l’intérieur même du continent africain pousse au désenchantement.
Beaucoup veulent pourtant que la relation Afrique-Europe évolue.
Tout le monde le veut. Mais il suffit de proposer des solutions pour assister à une levée de boucliers. Dire qu’on veut améliorer les rapports, c’est aussi accepter de prendre en compte l’autre protagoniste. Or c’est cette prise en compte de l’autre qui est vilipendée. Mais il faut se dire qu’on ne change pas une relation seul.
Cet autre, c’est la France. Emmanuel Macron fait-il vraiment ce qu’il faut pour réparer la relation Afrique-France ?
Oui et non. Il fait ce qu’il peut et ce qu’il doit. Son désir, sincère, de faire évoluer la relation n’entre pas en contradiction avec sa volonté, tout aussi sincère, de préserver les intérêts français sur le continent. Il a bien conscience que la relation de jeunes Africains à l’Hexagone change. Et, sans doute parce qu’il appartient à une génération différente de celle de ses prédécesseurs, Emmanuel Macron tente de leur apporter des réponses ou des garanties. Cela ne prend pas toujours les formes les plus pertinentes et ne réussit pas toujours non plus, mais il essaie. Il a multiplié les gestes bien plus qu’aucun autre président français ne l’avait fait avant lui, mais il peut et doit aller plus loin.
La restitution des objets d’art spoliés fait partie de ces gestes censés contribuer à réparer la relation. À ce jour, seuls 28 ont été rendus, sur plus de 90 000 officiellement répertoriés. On est loin du compte.
Ce chiffre peut sembler dérisoire, mais le processus est enclenché. Je préfère retenir les scènes, touchantes, de l’accueil au Bénin des pièces de retour au bercail. Ça continuera. À condition que les États africains n’arrêtent pas de les réclamer. Côté français, il serait souhaitable qu’une loi-cadre voit rapidement le jour.
D’un point de vue philosophique, en quoi est-ce si important que ces objets soient restitués ?
Posez la question aux peuples qui se sont sentis dépossédés de ces figures-là – je dis bien figures. Parler d’objets, comme le dit si bien Felwine Sarr, est une manière anthropologiquement coloniale de nommer des statues. Or, dans nombre de nos cultures, ce sont des sujets vivants ou dépositaires de vies, des ancêtres qu’on voudrait voir revenir. Évidemment, cette dimension spirituelle ou philosophique ne vient pas immédiatement à l’esprit quand on évoque le développement du continent ou la résolution de ses problèmes sociaux les plus élémentaires. Ce n’est pas nier ces autres urgences que de s’en préoccuper.
LA COLÈRE DES JEUNES AFRICAINS N’EST PAS UNIQUEMENT DIRIGÉE CONTRE LA FRANCE, MAIS CONTRE L’IMPÉRIALISME SOUS TOUTES SES FORMES, QUI LES PRIVE DE TOUT HORIZON
Pourquoi le sentiment anti-français semble plus qu’exacerbé en dépit de ces gestes ?
Je ne crois pas en un sentiment antifrançais spécifique. C’est une colère générale, plus diffuse, née de frustrations diverses et d’un désespoir profond, qui englobe la suspicion et la méfiance envers les élites politiques françaises. Il ne serait pas juste de l’en isoler. Il anime surtout les Africains les plus jeunes. Leur colère n’est pas uniquement dirigée contre la France, mais contre l’impérialisme sous toutes ses formes, qui les prive de tout horizon. Une part de ce mécontentement est d’ailleurs orientée contre les élites africaines elles-mêmes, qu’ils tiennent aussi pour responsables de leur désespérance, et va de pair avec le sentiment que le France soutient et parfois légitime les gouvernements qui les oppriment. S’il est souhaitable de discuter sans complaisance avec la France, nous devons aussi prendre nos responsabilités en exprimant clairement nos aspirations politiques et en interpellant nos propres gouvernements. Par exemple, sur le tripatouillage des Constitutions, qui ne relève pas directement du fait colonial…
Quel regard portez-vous sur l’état de la démocratie en Afrique ?
En Afrique de l’Ouest, la région que je connais le mieux, j’ai toujours l’impression qu’on est dans « un régime démocratique de basse intensité », comme dit très justement mon ami Elgas, c’est-à-dire une démocratie de pure forme, où les instruments permettant de la mettre en œuvre concrètement n’existent pas. Nos structures sont là, elles sont anciennes, elles se reproduisent. Il suffit qu’une élection se passe à peu près sans encombre dans un pays pour qu’on salue sa vitalité démocratique et que ses dirigeants s’en vantent alors même que leurs populations ne l’expérimentent pas au quotidien, dans des attitudes citoyennes, dans des débats d’idées, dans l’existence de contre-pouvoir, dans la liberté de la presse. C’est absurde et humiliant.
Le Sénégal ferait partie de ces démocraties au rabais ?
Parce que ses structures de base étaient solides, il a été pendant longtemps été perçu comme un modèle de démocratie. Je m’inquiète de plus en plus des relations entre les différents pouvoirs, entre l’exécutif et le judiciaire, notamment – même si je ne peux nier que la liberté de la presse est une réalité. Les dix dernières années ont vu l’apparition de mouvements citoyens jeunes, forts – critiquables peut-être pour leur absence de projet clair -, qui se sont installés parce que les institutions avaient failli.
J’ESPÈRE FORTEMENT QUE MACKY SALL NE SE REPRÉSENTERA PAS. IL AURAIT AINSI LES COUDÉES FRANCHES POUR MENER À TERME SES DIFFÉRENTS PROJETS POUR LE SÉNÉGAL
Ces mouvements qui sont apparus dans plusieurs pays pourraient donc constituer l’autre terme d’une alternative ?
Je n’aime pas ce terme. Il impose l’idée d’un homme providentiel, prêt à sauver le monde. Finissons-en avec la mythologie du salut. Mais, oui, ces mouvements fournissent des exemples de ce que pourrait être un régime démocratique plus direct. Il faudrait interroger davantage la place du parlementarisme dans nos sociétés. Nos assemblées nationales ont-elles encore du sens ? Je n’en suis pas sûr. Il faudrait réfléchir à des modes de gouvernement ou de distribution des pouvoirs qui engageraient davantage les citoyens et les éduqueraient ainsi à une vie démocratique pleine et entière, vécue sur le plan individuel – ce qui suppose de savoir ce que vivre en citoyen démocrate signifie exactement. Il faudrait partir de la base et ne plus s’enfermer dans des armatures dites démocratiques.
La démocratie implique-t-elle forcément la limitation du nombre de mandats ?
Ce n’est pas le seul critère, mais il est fondamental. J’accorderais bien un satisfecit au Ghana, qui a réglé la question du renouvellement de la classe politique et des mandats à vie, ce qui permet au pays de se consacrer à des sujets essentiels comme la santé, l’éducation, le développement. En Afrique francophone, nous perdons un temps fou parce que nos Constitutions sont fragiles, manipulables avec une facilité désarmante et accablante.
Le président Macky Sall devrait donc s’abstenir de se représenter ?
J’espère fortement qu’il ne se représentera pas. Il aurait ainsi les coudées franches pour mener à terme ses différents projets pour le Sénégal. Pour en avoir discuté avec lui lors de son passage à Paris, je sais qu’il en a un certain nombre. Il lui serait tellement plus simple de s’en occuper s’il était libéré de l’équation du troisième mandat. L’exemple du président Abdoulaye Wade devrait suffire à l’en dissuader. En mars 2021, le président a eu un aperçu de ce dont la jeunesse révoltée est capable, même si cette colère-là n’était pas motivée par son éventuel troisième mandat. La population jeune est si désespérée qu’aller mourir dans la rue lors de manifestations lui semble d’une grande banalité.
Qu’est-ce que le retour des coups d’État au Mali, en Guinée et, dans une certaine mesure, au Tchad inspire au militaire que vous avez failli être ?
Cela m’effraie. Légitimer un coup d’État, c’est oublier la menace d’illégitimité qui pèsera ensuite sur le pouvoir ainsi arraché et qui, tôt ou tard, aura raison de lui. Et, tôt au tard aussi, consacrera une instabilité institutionnelle et militaire. Faire un coup d’État, aussi justifiable soit-il, c’est ouvrir la porte à d’autres coups de force. Que les populations descendent dans la rue pour protester et prendre leur destin en main est appréciable. Mais quand l’armée s’en mêle, c’est toujours inquiétant. Plus encore dans un pays comme le Mali, en proie à la menace terroriste.
Au Sahel, malgré la présence des troupes françaises, on échoue à éradiquer le terrorisme. Pourquoi est-ce si compliqué de venir à bout des insurrections jihadistes ?
C’est un phénomène difficile à circonscrire, à expliquer et à combattre. Les défaillances militaires à elles seules ne peuvent expliquer l’échec de la lutte contre le jihadisme dans cette zone immense, où les frontières compliquent les contrôles et où les modèles de jihadisme diffèrent suivant les pays. Tant qu’il n’y aura pas de réflexion politique élémentaire impliquant que chaque pays africain se sente solidaire du pays menacé, tant qu’on laisse aux autres le soin de s’en occuper, la lutte sera inefficace. Les crises multiples et incessantes du Sahel prouvent que, malgré le G5, il y a un déficit de coopération entre les États. Il faut des actions politiques, militaires et sociales transnationales. Ces crises révèlent aussi la faiblesse de nos armées, lesquelles parviennent pourtant à renverser des chefs d’État.
LES ATTENTATS TERRORISTES RELÈVENT TOUJOURS D’UNE VISION STRATÉGIQUE CLAIRE, AVEC UN PROJET D’OPPOSITION, DE CONQUÊTE ET DE RENVERSEMENT CIVILISATIONNEL
Les insurrections jihadistes posent aussi la question de l’islam politique. Les attentats contre la France étaient-ils un acte de rejet du mode de vie occidental, une riposte aux frappes françaises contre l’État islamique, relèvent-ils d’une pensée stratégique articulée ou d’un simple acte de barbarie ?
Je le dis depuis mon premier roman, Terre Ceinte. Les attentats relèvent toujours d’une vision stratégique claire, avec un projet d’opposition, de conquête et de renversement civilisationnel. C’est aussi cela qui nourrit et fait la force de tous ces mouvements jihadistes autour de l’État islamique. Réduire ces attentats à des représailles, c’est ignorer toute l’idéologie qui se construit depuis de très longues années. Une telle idéologie ne peut se fonder sur la simple idée de représailles. Certes la haine de l’Occident existe et entre dans l’idéologie mais elle ne constitue pas la seule motivation ou le seul principe. Il y a une pensée, structurée, qui peut être de la barbarie. Ça pose des questions philosophiques sur ce que seraient la barbarie, la civilisation ou l’humanité. Reste que les jihadistes sont des êtres humains qui réfléchissent, qui veulent davantage de pouvoir et qui veulent dominer, au même titre que la civilisation occidentale a dominé pendant de longs siècles toute la planète. C’est leur projet et il passe par cet affrontement-là.
Dans Terre Ceinte, il est question de colonisation et de la Shoah. Quel lien établissez-vous entre les deux ? Était-il important de les évoquer dans le même ouvrage sachant que certains n’hésitent pas à se livrer à des batailles mémorielles ?
Il est indécent de parler de concurrence mémorielle. Hiérarchiser les souffrances, les évaluer suivant des critères oiseux, comme la durée, le nombre de morts ou l’exceptionnalité historique, c’est tomber dans le piège de la concurrence des mémoires qui fait perdre de vue le caractère spécifique – le moment historique particulier où ça s’est produit – de toutes ces tragédies, ainsi que les souffrances des individus, qui se valent les unes les autres, dans ces grandes catastrophes humaines. Ces horreurs, qui font honte à toute l’humanité, ne doivent plus arriver et leur mémoire doit être entretenue à cet effet. Il faut donc situer les responsabilités et raconter l’histoire le plus lucidement possible. Chercher à savoir comment cela s’est produit, pourquoi, que faire pour que cela ne se produise plus. De mon point de vue, ce sont ces regards historiques qu’il faut poser tant sur l’esclavage que sur la Shoah et la colonisation.
Vous écrivez en français. La question de la langue peut, elle aussi, se révéler très politique. À votre avis, la francophonie ne consacre-t-elle pas le rapport de domination politique.
La francophonie, c’est d’abord la conscience d’une langue en partage. Disant cela, j’évacue le piège qu’installe le rapport entre centre – la France – et périphérie – les autres pays membres. Personnellement, je ne subis pas ce rapport de domination. Mais, s’il existe, il faut s’en défaire. Le centre de la francophonie de doit pas être en France car le français appartient à plusieurs millions d’autres locuteurs, sans que ceux dont ce n’est pas la langue maternelle soient assujettis aux autres. Je n’ai pas le complexe du français ou devant le Français.
À QUOI SERT UN ESPACE [FRANCOPHONE] S’IL EST IMPOSSIBLE D’Y CIRCULER, Y COMPRIS ENTRE PAYS AFRICAINS ?
Faites-vous allusion à la francophonie culturelle et linguistique?
Il y a une francophonie plus politique et plus institutionnelle qui a du mal à peser. Récemment encore, lors des discussions dans le cadre du comité Mbembe, chargé de réfléchir à la refondation de la relation Afrique-France, la question d’un visa francophone pour faciliter la mobilité s’est encore posée. À quoi sert un espace s’il est impossible d’y circuler, y compris entre pays africains ?
Vous avez déclaré que votre prix est un signal fort adressé à la francophonie.
Il dépasse à la fois ma personne et le livre lui-même. Je ne peux ignorer le symbole qu’il représente. Il doit pouvoir dire à tous les écrivains subsahariens (mais aussi d’ailleurs) d’expression française : « Cette langue est aussi la vôtre, vous pouvez l’utiliser pour écrire des œuvres qui seront saluées. » Mais ça ne doit pas rester un signal exceptionnel. Il ne faudra pas attendre un siècle de plus pour couronner un autre Subsaharien.
Votre roman place en arrière-plan l’écrivain malien Yambo Ouologuem, prix Renaudot 1968 tombé en disgrâce sous des soupçons de plagiat. Avez-vous l’impression de l’avoir réhabilité ?
Je m’inscris dans une grande tradition de personnes qui, en Occident comme sur le continent, ne l’ont jamais abandonné, n’ont jamais voulu l’oublier et qui lui ont consacré au fil des décennies des hommages sous des formes diverses. C’est le cas de l’universitaire Jean-Pierre Orban, qui a ainsi réédité, en 2015, Les Mille et une bibles du sexe. J’ai écrit sur Ouologuem, à ma manière, pour lui payer ma dette, parce qu’il m’a aidé à devenir l’écrivain que je suis. La lecture du Devoir de violence, en particulier, m’a structuré. Si La Plus Secrète Mémoire des hommes peut permettre de relire ses livres sans préjugés, je peux assumer cette forme de réhabilitation-là.
Mais l’avez-vous innocenté ? Selon vous, les auteurs empruntent les uns aux autres, et toute l’histoire de la littérature est celle d’un grand plagiat.
On n’innocente pas un innocent. Il l’était. Parce qu’il concevait la littérature comme un grand espace de jeu à l’intérieur duquel la référence, l’intertextualité et l’hommage occupent une grande place. On n’a pas voulu voir cette inventivité-là, celle des vrais écrivains qui s’autorisent tout dans cet espace réservé. Je reviens sur sa vie pour représenter au monde cet écrivain qui aurait pu construire une œuvre magnifique mais qu’on a perdu parce qu’on lui a dénié le droit d’être singulier. On le lui a dénié parce qu’il s’appelait Ouologuem, c’était à la fin des années 1960, il était jeune, il affichait une insolence qui agaçait autant l’intelligentsia africaine que l’élite culturelle française. On ne lui a pas reconnu le droit de ne pas se plier aux injonctions que les deux bords semblaient lui adresser.
Quels sont les autres auteurs africains qui vous séduisent ?
Ils sont nombreux. Malick Fall, auteur très tôt disparu de La Plaie – récemment réédité par Jimsaan. Il présente quelques similitudes avec Le Devoir de violence. Parus la même année, en 1968, ils sont les œuvres quasi uniques de deux auteurs majeurs, auxquels j’ajouterais Ahmadou Kourouma, auteur de Les Soleils des indépendances. J’apprécie Valentin-Yves Mudimbe, pour ses romans, et, bien sûr, Ken Bugul, qui m’a inspiré le personnage de Siga D dans La Plus Secrète Mémoire des hommes. Boubacar Boris Diop et moi ne partageons pas les mêmes positions idéologiques, mais il reste important pour moi sur le plan de la fiction romanesque. Je suis très proche de Sami Tchak avec qui j’entretiens des relations presque filiales mais aussi très amicales, et dont le roman Hermina a été une source d’inspiration directe. Nous discutons beaucoup de nos goûts littéraires, de ce que nous essayons de faire, de notre travail, des sujets concernant le continent africain, aussi. Je lis de plus en plus Leonora Miano, que je trouve très stimulante, même si je ne partage pas toujours ses idées. Chacune de ses prises de position sur un sujet vous invite toujours à clarifier la vôtre. La liste des écrivains africains que j’admire serait longue. Je vous enverrai un jour, promis, ma bibliothèque idéale africaine, qui inclurait les anglophones et les écrivains du Maghreb.
Et Mongo Beti ?
J’ignore s’il aurait aimé mon roman. Mais il est important pour moi. Il assumait le fait d’être une conscience. Il ne reniait ni ses engagements ni ses prises de position, au prix parfois d’une certaine méchanceté à l’égard de ses confrères. Ses railleries à l’encontre de Camara Laye et Ahmadou Kourouma étaient injustifiées : drôles et féroces, mais un peu faciles.
L’ENGAGEMENT EST TOUJOURS LA RENCONTRE D’UN TEMPÉRAMENT D’AUTEUR ET D’UNE SENSIBILITÉ DE LECTEUR. JAMAIS ABSOLU, IL EST TOUJOURS RELATIF, FRAGMENTAIRE
Et hors du continent, il y a poète, romancier et nouvelliste chilien Roberto Bolano, à qui vous devez le titre de votre roman ?
Oui, il a changé radicalement ma conception de l’écriture en me faisant prendre un tournant décisif, jusqu’à la rédaction de La Plus Secrète Mémoire des hommes. Cela pourrait conforter ceux qui m’accusent d’avoir des « références de Blancs ». C’est ignorer que Sony Labou Tansi s’est inspiré de Gabriel García Márquez, lequel s’est lui-même inspiré des traditions africaines transbordées à Cuba ou à Haïti. Et il existe un « Bolano africain », qui parle du continent comme nul autre. Il situe plusieurs de ses actions dans l’Afrique des années 1980 – 1990, notamment dans Les Détectives sauvages. Son propos sur l’atmosphère d’instabilité politique au Liberia, tout en poésie et sans vision coloniale exotisante, est particulièrement juste, alors qu’il n’y a jamais été. C’est cela la littérature : un voyage, une ouverture, un continent à part qui englobe tous les autres.
Un écrivain doit-il forcément être engagé ?
Oui, au moins dans et pour l’écriture. L’engagement le plus significatif est existentiel. Les grands livres contiennent toujours l’âme et l’esprit de leurs auteurs, qui s’y projettent. Pour ce qui est de l’engagement politique, il ne lui suffit pas à un auteur de le clamer ou de le vouloir pour que son œuvre le révèle. L’engagement est toujours la rencontre d’un tempérament d’auteur et d’une sensibilité de lecteur. Jamais absolu, il est toujours relatif, fragmentaire.
Et quels intellectuels africains admirez-vous ?
Felwine Sarr, pour ses multiples travaux, Achille Mbembe pour l’importance de son œuvre, Fabien Eboussi Boulaga, Cheik Anta Diop, Léopold Sédar Senghor, Sophie Bessis… Au-delà des clivages qu’il peut y avoir entre eux, je les estime. Ma considération n’implique pas une adhésion à leurs idéologiques, mais à l’intérêt que leur pensée ou leur œuvre occupent dans l’histoire des idées. Je peux admirer Souleymane Bachir Diagne aussi bien que Boubacar Boris Diop.
Vous abordez une multitude de thèmes touchant à la littérature. L’édition française en prend pour son grade car vous épinglez les écrivains qui écrivent avec trois mots, la critique pour laquelle tout se vaut, les éditeurs qui fabriquent des produits marketés…
Je force le trait pour attirer l’attention sur l’absence de réelle foi dans la littérature, sur le fait que l’exigence est considérée comme contreproductive car peu commerciale, sur la standardisation et l’uniformisation des œuvres dans le seul but de vendre. C’est une conception éloignée de ce que devrait tenter de faire la littérature : un lieu de connaissances, d’élucidation du monde et de soi, de questionnements toujours plus profonds et plus philosophiques. La littérature doit renoncer uniquement aux clichés – c’est-à-dire à tout ce qui est déjà installé dans une langue donnée – pour tenter de trouver, sous cette langue usuelle et ordinaire, une autre langue, poétique, qui nous interroge mieux, questionne tous les phénomènes du monde en les soumettant à une lumière exigeante. La grande littérature tend vers cette exigence poétique.
L’année 2021 est une année de grande moisson littéraire pour les écrivains africains. Cela préfigure peut-être un âge d’or ?
Il y a toujours eu d’immenses écrivains sur le continent. Peut-être les institutions littéraires se rendent-elles compte que leurs palmarès présentent quelques anomalies et cherchent à découvrir et à mettre en avant cette littérature. Ce n’est pas simplement pour obéir au politiquement correct. Tous les livres primés sont indéniablement de belles œuvres. On arrive peut-être à une époque où, massivement, les œuvres sont reconnues sans que cela ressemble de façon trop évidente à des calculs équilibristes visant à contenter tout le monde. Ces récompenses s’inscrivent dans un moment qui me semble être celui de l’effort fait sur le continent pour la promotion de la littérature. Et ça passe notamment par la création de maisons d’édition qui tentent de se structurer par la création de prix littéraires. Comme le prix Ivoire, qui s’installe dans le paysage. En somme, l’institution littéraire africaine, bien qu’encore balbutiante, fait un mouvement qui, par un jeu de domino, finit aussi par se répercuter dans les grandes institutions internationales. Il faut souhaiter que ça se poursuive.
Comment avez-vous reçu la petite phrase du président de l’Académie Goncourt, Didier Decoin, soulignant les « tournures africaines » de certaines de vos phrases ?
C’était sans doute une petite maladresse, mais sans malice. Didier Decoin a aussitôt ramené le livre vers la littérature et l’a bellement défendu comme œuvre littéraire. Mais au-delà de ce petit épisode, plus généralement, je constate qu’il y a parfois une sorte de malaise à parler en Occident des œuvres d’Africains. L’imaginaire colonial pèse encore sur le langage de l’évaluation, de la description, du jugement de leurs créations.
En 2000, Robert Sabatier, alors membre du jury Goncourt, avait déclaré que le prix n’avait pas été attribué à Ahmadou Kourouma du fait de « ses manières trop africaines ».
Oui, il subsiste parfois dans l’inconscient un arrière-fond douteux. On a des mots qui ne veulent rien dire, ou qui disent tout. Et affirmer que Kourouma a été privé de Goncourt pour cela est profondément scandaleux. En vingt ans, les choses ont évolué. De tels propos ne peuvent plus être tenus aujourd’hui.
L’UNIVERSITÉ FRANÇAISE EST RESTÉE BLOQUÉE SUR QUELQUES NOMS DE LA LITTÉRATURE AFRICAINE ET SUR LES ANNÉES 1970, 1980 ET, PEUT-ÊTRE, 1990
Ces malentendus tiennent peut-être aussi au peu de place que les universités françaises accordent à l’enseignement de la littérature africaine ?
Elles accusent un grand retard dans ce domaine. L’université française est restée bloquée sur quelques noms et sur les années 1970, 1980 et, peut-être, 1990. Elle ignore assez nettement les auteurs contemporains. Si certains font l’objet de thèses individuelles, leurs œuvres ne sont quasiment pas enseignées, ce qui contribue à alimenter encore un peu plus les préjugés dont elles sont victimes.
Et comment accéder à la postérité dans ces conditions ?
C’est une question difficile sous tous les cieux. Tous les écrivains se la posent, sans doute avec angoisse, parce qu’ils ne sont pas assurés de survivre, finalement. Chez les écrivains africains, la préoccupation est double car se pose aussi la question de leur survie dans leur pays d’origine. Ils demeurent dans la mémoire comme des figures importantes. Pour autant, sont-ils lus, sont-ils encore vivants à travers leurs œuvres, celles-ci sont-elles réactualisées ? Appréhende-t-on toute la complexité de leur pensée si les mêmes analyses, les mêmes interprétations et les mêmes cours sont délivrés au fil des décennies ? Pas si sûr.
LA MUSIQUE D’OMAR PENE, C’EST LE RIRE DE DÉMOCRITE ET LES PLEURS D’HÉRACLITE. J’AI TOUJOURS L’IMPRESSION, EN L’ÉCOUTANT, QU’IL SAIT EXACTEMENT CE QUE JE RESSENS
La musique du Sénégalais Omar Pene a accompagné l’écriture de votre dernier roman. Il y a chez lui quelque chose de profondément mélancolique. Qu’est-ce que ça dit de vous ?
Même lorsqu’elle est rythmée, gaie, sa musique conserve un fond de mélancolie. Ce n’est pas tout à fait de la tristesse, ni de la noirceur, mais elle nous touche et nous rappelle que notre rapport au monde est toujours structuré par l’intuition d’un manque, une promesse qui nous attend, une chose vers laquelle nous nous dirigeons et que nous n’attendons pas toujours. Sa musique exprime cet état d’attente, de désir, d’impuissance. Elle rend triste et joyeux à la fois. Ce sont les deux faces de la mélancolie déjà bien représentée par les tableaux métaphoriques de Démocrite (le rire) et d’Héraclite (pleurs). La musique d’Omar Pene, c’est le rire de Démocrite et les pleurs d’Héraclite. J’ai toujours l’impression, en l’écoutant, qu’il sait exactement ce que je ressens et qu’il l’exprime très simplement.
Ce prix change-t-il votre vie ?
Certainement. Ça change le regard des gens sur moi. Mais pas mon rapport à la littérature et à l’écriture. J’essaierai de suivre les principes que je me suis fixés et la complexité que je tente d’introduire dans chacun que mes livres. Je suis un écrivain et j’entends bien le rester.
——–